16/11/2018
Guillaume Apollinaire, Calligrammes

L’avenir
Soulevons la paille
Regardons la neige
Écrivons des lettres
Attendons des ordres
Fumons la pipe
En songeant à l’amour
Les gabions sont là
Regardons la rose
La fontaine n’a pas tari
Pas plus que l’or de la paille ne
[s’est terni
Regardons l’abeille
Et ne songeons pas à l’avenir
Regardons nos mains
Qui sont la neige
La rose et l’abeille
Ainsi que l’avenir
Guillaume Apollinaire, Calligrammes, avril
1918, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 300.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume apollinaire, calligrammes, avenir, rose, abeille, guerre | ![]() Facebook |
Facebook |
07/02/2018
Leslie Harrison, Pantoum pour une marche dans les bois

PANTOUM POUR UNE MARCHE DANS LES BOIS
La rime désigne toute répétition accompagnée de différence :
auditive, grammaticale, rhétorique…
Allen Grossman
Tout rime. Prenez une forêt peuplée d’arbres –
des milliers (tous différents, et pourtant confondus
en une foule), des rochers innombrables, une multitude d’abeilles
dans le chicot d’un arbre mort. Je marche, je passe devant eux
par milliers. Toutes les différences sont confondues :
si nombreuses, si semblables. Elles riment, et pourtant
tiennent ensemble, chicot planté dans le sens, le laissant
se répéter, sans fin. Les différences, si minimes,
sont semblables. Le rythme de la marche
suit les contours de la montée, et le cœur
répète – sans fin. Timide, son petit
bégaiement se fixe sur un rythme calme. Ce motif
suit la cadence de la montée. Le cœur
s’accorde avec le souffle. Les yeux refusent toute différence,
se fixent, en rythme avec le calme bégaiement
des pierres sous le pied. Et les kilomètres défilent,
s’accordent avec le corps pour refuser toutes les distances.
Je me souviens de la foule innombrable et désordonnée
des pierres sous le pied. Et les kilomètres défilent
comme des géants – autoréférentiels, dénués de sens.
Je me souviens de la foule désordonnée des bois,
De la lourde grâce de cet autre mystérieux,
Comme de géants, autoréférentiels, tout leur sens
Caché dans la différence. Nous traversons la vie
dans la foule, innombrables, un millier d’abeilles
se cachant, cachées. Dans nos vies,
rien ne rime. Et nous confondons les arbres
entre eux, avec du bois, avec des bancs.
Leslie Harrison, “Pantoum for a Walk in the Woods”,
in Poetry, juin 2002, traduit de l’anglais (USA) par
Guillaume Condello, dans Catastrophes, n° 2, novembre 2017.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leslie harrison, pantoum pour une marche dans les bois, rime, rythme, forêt, abeille, cadence, souffle | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2013
Jean-Luc Sarré, La Part des anges
Une semaine avec les éditions La Dogana

Citadin, il aime les jardins
mais pour les rejoindre il lui faut
attendre les vacances d'été.
Un après-midi de septembre
il arrive que l'orage survienne
et le trouve, assis sur une fesse,
étrangement irrésolu.
Une tonnelle d'abeilles au travail
l'a détourné de son chemin
pis abandonné sur une souche.
Les gouttes sur les feuilles l'allègent
d'un fardeau qu'il ignorait porter.
*
Oublié le bâton de réglisse
qui jaunissait les commissures ;
une cigarette succédant
à l'indispensable cigarette
ils ne vivent plus que pour fumer.
Mieux vaut en ville être au moins deux
pour oser croiser les regards
réprobateurs ou amusés
— ceux-là sont les plus blessants —
mais parvenus dans les faubourgs,
certains aiment la garder au bec
en évoquant les larmes aux yeux
l'ambiance — Smoke gets in your eyes —
d'une innocente surprise-partie.
Jean-Luc Sarré, La Part des anges, La Dogana, 2007, p. 25, 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, la part des anges, jardin, orage, abeille, fumer | ![]() Facebook |
Facebook |
26/08/2013
Samuel Beckett, Molloy
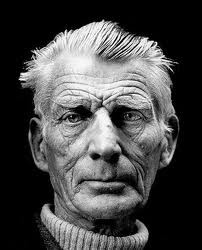
Maintenant je vais pouvoir conclure.
Je longeai le cimetière. C'était la nuit. Minuit peut-être. La ruelle monte, je peinais. Un petit vent chassait les nuages à travers le ciel faiblement éclairé. C'est beau d'avoir une concession à perpétuité. C'est une bien belle chose. S'il n'y avait que cete perpétuité-là. J'arrivai devant le guichet. Il était fermé à clef. Très juste. Mais je ne pus l'ouvrir. La clef entrait dans le trou, mais ne tournait pas. La longue désaffection ? Une nouvelle serrure ? Je l'enfonçai. Je reculai jusqu'à l'autre côté de la ruelle et me ruai dessus. J'étais rentré chez moi, comme Youdi me l'avait commandé. Je me relevai enfin. Qu'est-ce qui sentait si bon ? Le lilas ? Les primevères peut-être. J'allai vers mes ruches. Elles étaient là, comme je le craignais. J'enlevai le couvercle de l'une d'elles et le posai par terre. C'était un petit toit, au faîte aigu, aux brusques pentes débordantes. Je mis la main dans la ruche, la passai à travers les hausses vides, la promenai sur le fond. Elle rencontra, dans un coin, une boule sèche et poreuse. Elle s'effrita au contact de mes doigts. Elles s'étaient mises en grappe pour avoir un peu plus chaud, pour essayer de dormir. J'en sortis une poignée. Il faisait trop sombre pour voir, je la mis dans ma poche. Ça ne pesait rien. On les avait laissées dehors tout l'hiver, on avait enlevé leur miel, on ne leur avait pas donné de sucre. Oui, maintenant je peux conclure. Je n'allai pas au poulailler? Mes poules étaient mortes aussi, je le savais. Seulement elles, on les avait tuées autrement, sauf la grise peut-être. Mes abeilles, mes poules, je les avais abandonnées. J'allai vers la maison. Elle était dans l'obscurité. La porte était fermée à clef. Je l'enfonçai. J'aurais pu l'ouvrit peut-être, avec une de mes clefs. Je tournai le commutateur. Pas de lumière. J'allai dans a cuisine, dans la chambre de Marthe. Personne. Mais assez d'histoires. La maison était abandonnée.
Samuel Beckett, Molloy, éditions de minuit, 1951, p. 270-271.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, molloy, la fin, retour, abeille, poule | ![]() Facebook |
Facebook |
17/01/2013
John Clare, Poèmes et proses de la folie de John Clare

J'ai caché mon amour
J'ai caché mon amour étant jeune et farouche
Jusqu'à ne plus souffrir le bourdon d'une mouche
J'ai caché mon amour pour ma détresse amère
Jusqu'à ne plus souffrir la vue de la lumière
Je n'osais pas jeter les yeux sur son visage
Mais par monts et par vaux je laissais son image
À chaque fleur des champs c'était un baiser pour
Dire adieu encore une fois à mon amour
C'est au plus vert du val que je l'ai rencontrée
La jacinthe des bois s'emperlait de rosée
Et la brise perdue baisait ses yeux d'azur
L'abeille aussi baisait et s'en allait chantant
Un rayon de soleil se frayant un passage
Mit une chaîne d'or à son col éclatant
Celée comme le chant de l'abeille sauvage
Elle est demeurée là tout le long de l'été
J'ai caché mon amour aux champs et à la ville
Jusqu'à être un jouet pour la brise gracile
L'abeille me semblait ressasser des ballades
Et la mouche rugir en lionne irritée
Il n'est pas jusqu'au silence qui ne prît langue
Et qui ne me hantât tout le long de l'été
L'énigme qui laissait la nature impuissante
N'était pas autre chose qu'un amour secret
I hid my love
I hid my love when young till I
Couldn't bear the buzzing of a fly
I hid my love to my despite
Till I could not bear to look at light
I dare not gaze upon her face
But left her memory in each place
Where'er I saw a wild flower lie
I kissed and bade my love good bye
I met her in the greenest dells
Where dewdrops pearl the wood bluebells
The lost breeze kissed her bright blue eye
The bee kissed and went singing by
A sunbeam found a passage there
A gold chain round her neck so fair
As secret as the wild bee's song
She lay there all the summer long
I hid my love in field and town
Till e'en the breeze would knock me down
The bees seemed singing ballads o'er
The fly's bass turned a lion's roar
And even silence found a tongue
To haunt me all the summer long
The riddle nature could not prove
Was nothing else but secret love
John Clare, Poèmes et proses de la folie de John Clare, présentés et traduits par Pierre Leyris, suivis de "La psychose de John Clare" par Jean Fanchette, Mercure de France, 1969, p. 103-105, 101-104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john clare, poèmes et proses de la folie de john clare, amour, abeille | ![]() Facebook |
Facebook |





