16/08/2014
Romain Fustier, Mon contre toi

ma petite voleuse d'oreiller dont le visage reposé. dans une course-poursuite immobile. une traque silencieuse dans les nuages de ses songes. et je pars à sa recherche tandis qu'elle dort allongée devant moi. souffle calme. bouche phylactère. un message suspendu entre les lèvres. mon oreiller sous le visage. ma petite voleuse dort. s'arrêtant dans les bars de carrefour où l'on joue de la guitare la nuit. fonçant sue la fédérale dans une voiture de location. et je me lance à ses trousses. écartant les nuages de ses songes tandis qu'elle dort étendue devant moi. un vent du sud s'échappe de ses lèvres où je me glisse dans la bulle de son visage. ma petite voleuse d'oreiller dort et je deviens complice de sa fuite.
Romain Fustier, Mon contre toi, éditons de l'Atlantique, 2012, p. 48.
Romain Fustier anime avec Amandine Marembert la revue et les éditions Contre-Allées.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : romain fustier, mon contre toi, nuit, sommeil, voleuse, rêve, tendresse | ![]() Facebook |
Facebook |
10/08/2014
Guillevic, Art poétique

Qu’est-ce qu’il t’arrive ?
Il t’arrive des mots
Des lambeaux de phrase.
Laisse-toi causer. Écoute-toi
Et fouille, va plus profond.
Regarde au verso des mots
Démêle cet écheveau.
Rêve à travers toi,
À travers tes années
Vécues et à vivre.
Ce que je crois savoir,
Ce que je n’ai pas en mémoire,
C’est le plus souvent,
Ce que j’écris dans mes poèmes.
Comme certaines musiques
Le poème fait chanter le silence,
Amène jusqu’à toucher
Un autre silence,
Encore plus silence.
Dans le poème
On peut lire
Le monde comme il apparaît
Au premier regard.
Mais le poème
Est un miroir
Qui offre d’entrer
Dans le reflet
Pour le travailler,
Le modifier.
— Alors le reflet modifié
Réagit sur l’objet
Qui s’est laissé refléter.
Chaque poème
A sa dose d’ombre,
De refus.
Pourtant, le poème
Est tourné vers l’ouvert
Et sous l’ombre qu’il occupe
Un soleil perce et rayonne,
Un soleil qui règne.
Mon poème n’est pas
Chose qui s’envole
Et fend l’air,
Il ne revient pas de la nue.
C’est tout juste si parfois
Il plane un court moment
Avant d’aller rejoindre
La profondeur terrestre.
Guillevic, Art poétique, dans Art poétique, précédé de Paroi et suivi de Le Chant, préface de Serge Gaubert, Poésie / Gallimard, 2001, p. 166, 172, 177, 178,180 et 184.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, art poétique, mot, rêve, mémoire, vivre, miroir | ![]() Facebook |
Facebook |
03/08/2014
Max Ernst, Écritures

Réponse à une enquête de Commune, 1935
Pour Max Ernst, art et poésie ne font qu’un. Il assimile la recherche poétique au travail sous-marin du scaphandrier. L’océan doit être sondé autour de ces pics dont le jaillissement signale un monde englouti. De tout ce qu’il aura amené à la surface, le plongeur retiendra les éléments qui lui semblent « trouvailles ». Il rejettera le reste, sans se soucier des chances d’erreur que comporte une telle sélection :
… Ce n’est pas une Atlantide morte que ce monde submergé, précise Max Ernst. Il est fleuri de volcans qui, pour ne pas atteindre le niveau de la conscience, n’en agissent pas moins sur cette conscience, donc sur toute vie individuelle ou collective. Le surréalisme est né en plein déluge dada, quand l’arche eut buté contre un pic. Les navigateurs n’avaient pas la moindre envie de réparer leur bateau, de s’installer dans l’île. Ils ont préféré piquer une tête. Grâce à l’écriture automatique, aux collages, aux frottages et à tous les procédés qui favorisent l’automatisme et la connaissance irrationnelle, ils ont touché le fond de cet invisible et merveilleux univers, « le subconscient », à décrire dans toute sa réalité.
Avant sa plongée, nul scaphandrier ne sait ce qu’il va rapporter. Ainsi, le peintre n’a pas le choix de son sujet. S’en imposer un, fût-il le plus subversif, le plus exaltant et le traiter d’une manière académique, ce sera contribuer à une œuvre de faible portée révolutionnaire. De même celui qui prétend fixer sur une toile les rêves de ses nuits n’accomplira pas une autre besogne que l’artiste acharné à copier trois pommes, sans se soucier de rien d’autre que de la ressemblance. Le contenu idéologique — manifeste ou latent — ne saurait dépendre de la volonté consciente du peintre. Le devenir de l’auteur et de l’œuvre sont indéniablement, indissolublement liés. Sinon, il y a tricherie.
La psychologie concrète a démontré que le subconscient individuel se trouve englobé dans le subconscient collectif. La question de la propriété artistique s’est donc modifiée. La vanité du créateur apparaît dans tout son ridicule éclat. L’exhibitionnisme même perd de sa valeur documentaire. Justice est faite de tant d’autres notions dont l’ensemble constituait le mythe artistique. Les méthodes d’exploration consciente sont à la portée de tous et l’idolâtrie du talent n’est pas moins risible que les autres.
Max Ernst, Écritures, Gallimard, collection Le Point du Jour, 1970, p. 401-402.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max ernst, Écritures, dada, surréalisme, inconscient, rêve, peinture, révolution | ![]() Facebook |
Facebook |
06/07/2014
Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes II

Haïkaïs
L'aube — Chante l'alouette. —
Le ciel est un miroir d'argent
Qui reflète des violettes.
Le soleil en feu tombe dans la mer ;
des étincelles :
Les étoiles !!
Oh ! la pleine lune sur le cimetière.—
Noirs les ifs — Blanches les tombes —
Mais en dessous ?...
Les yeux du Chat :
Deux lunes jumelles
Dans la nuit.
La nuit. — L'ombre du grand noyer
est une tache d'encre aplatie
au velours bleu du ciel.
Vie d'un instant...
J'ai vu s'éteindre dans la nuit
L'éternité d'une étoile.
La cathédrale dans les brumes :
Un sphinx à deux têtes, accroupi
dans une jungle de rêve.
J'ai vu en songe
Des splendeurs exotiques de soleil
Matin gris. — Le ciel est une chape de plomb.
Morte la Déesse,
dansons en rond !!
Mais, mes rêves aussi sont morts...
Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes II,
édition établie par Jean Bollery, avant-propos
de Pierre Minet, Gallimard, 1977, p. 127-128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, Œuvres complètes ii, haïkaï, ciel, lune, chat, rêve, étoile, soleil | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2014
Matthieu Gosztola, Lettres-Poèmes, correspondance avec Gaudi : recension

On remontera volontiers aux Héroïdes d'Ovide pour débuter la tradition des lettres d'amour adressées à un amant ou une maîtresse fictifs, et l'on sait qu'elles eurent de très nombreuses imitations, notamment à la Renaissance. Les Lettres-Poèmes publiés maintenant auraient été écrits par une jeune femme à Antoni Gaudi, le premier envoi daté du 2 mars 1924, suivi de 17 autres, le dernier du 27 avril 1927, donc après la mort de l'architecte catalan, le 10 juin 1926 à l'âge de 74 ans ; suivent deux fragments d'un journal poème écrit en 2000. Matthieu Gosztola aurait hérité d'un oncle une vieille maison en Espagne et l'un de ses premiers soins aurait été de visiter le grenier : il aurait trouvé, évidemment à l'écart, une malle contenant des lettres et, choisissant ce qui débordait l'intime, les aurait traduites. Traduction est toujours trahison : on reconnaît son écriture dans les poèmes en vers libres d'Antonia Maria Arellano, par ailleurs pianiste. Il n'a pas trouvé trace de cette mystérieuse épistolière qui aurait vécu plus que centenaire : on comprendra que, fictive, elle est prétexte pour son inventeur de reprendre des motifs qui lui sont familiers.
La relation à Gaudi, donc à l'architecture, est donnée d'emblée dans la première lettre : un "on" projette l'utopie de maisons ventres qui ressemblent singulièrement au ventre maternel : elles protègeraient « du danger que / représente / l'imprévisible avec lequel le dehors se confond », et leurs chambres, lieux clos, y seraient avant tout le lieu de l'intime, de l'amant et de l'amante. Affirmation lyrique par le biais d'un indéfini auquel, dès la seconde lettre, se substitue un "je". La fictive Antonia s'enthousiasme pour l'art de Gaudi, à la fois écriture de et dans l'espace, danse des éléments, musique, restitution d'une émotion qui transforme la vision du réel.
Histoire d'une rencontre rêvée entre Antonia et Antoni ? une lettre très courte annonce un rendez-vous, la suivante datée du surlendemain la rappelle, avec l'espoir d'une fusion, évoquée dans une autre lettre, « j'existe avec toi /et seulement / avec toi qui / m'existes / en t'exis- / tant », fusion qui donne lieu à des variations sur les deux prénoms, sur le corps des amants, « non pas mêlés, mais / réunis », et qui inscrit ces « passagers de l'évidence » dans une histoire de l'amour.
Mais la rencontre n'aurait pas eu de lendemain, ce qui n'empêche pas la jeune femme d'écrire : manière de journal au toujours absent, à qui elle s'adresse avec le "vous", puis le "tu". Vient sous sa plume le nom d'Orlando, allusion à l'histoire d'amour de l'Orlando furioso de l'Arioste, nom venu du rêve et lié à l'écriture. Le poème serait assemblage de ce qui est dispersé pour devenir harmonie, « fait de pièces de céramiques cassées, le / poème-trencadis »(1), non pas puzzle à reconstituer mais composition qui demeure toujours inattendue. C'est ce que dit autrement une lettre : dans un groupe qui parle, chaque voix est distincte mais leur ensemble forme « une unité / qui à aucun moment les fait / mourir en tant qu'individualités » ; ou le poème est à l'image de la mer dont on imagine saisir quelque chose en collant un coquillage à l'oreille, et l'on ne fait que saisir ce qui interrompt le silence.
Les premières pages du journal d'Antonia n'abandonnent pas Gaudi, toujours présent, « dans l'ignorance superbe de la mort ». Elle évoque un voyage en Inde, « tourbillon », un autre à Venise, « mirage », qui ne sont rien puisqu'ils ne permettent pas d'« être en lieu, comme l'on dit / être en vie », ce que lui apporte les créations de l'architecte. C'est par le dernier fragment du journal que le lecteur est certain du caractère fictionnel d'Antonia : âgée alors de 103 ans, elle lit Fleischer et reçoit des mails de Jean-Paul Michel, poète auquel la revue NU(e) vient de consacrer un numéro préparé par Gosztola..., et c'est par deux citations, dont l'une étendue de Michel que s'achèvent les lettres poèmes.
À partir du personnage d'Antonia, se mêlent l'hommage à un architecte, des variations sur l'écriture et la musique, une vision du couple — « Nous sommes deux, mais le même élan », écrit-elle à Gaudi —, les motifs du rêve et de l'enfance. Matthieu Gosztola continue aussi son approche singulière de la création, écrivant sa lecture d'une œuvre par la poésie comme il l'a fait dans des entretiens — imaginés — avec Lucian Freud en 2013.
—————————————————————————————
1. trencadis : littéralement "pique-assiette", technique de constitution de mosaïque (inventée par Gaudi) par récupération de morceaux de céramique, utilisée notamment dans le Parc Güell à Barcelone.
Matthieu Gosztola, Lettres-Poèmes, correspondance avec Gaudi, éditions Abordo, 2014, 108 p., 12 €. Recension parue le 16 juin dans la revue numérique Sitaudis.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : matthieu gosztola, lettres-poèmes, correspondance avec gaudi, journal, rêve, enfance, création, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
16/05/2014
Anise Koltz, Galaxies intérieures

Le poème
est le regard posé
sur un présent illisible
Des espace se forment
et s'écroulent
devant toi
Le poème
voit sans yeux extérieurs
suspendu
par-dessus le vide des siècles
Il constate :
Tout est dans rien
*
À René
Je te revois en rêve
sombre demeure des morts
où tu vis et travaille
Parfois tu me fais signe
de ta terrasse planétaire
Ton ombre m'approche
jetant à mes pieds
notre monde partagé
*
J'ignore pour qui
pourquoi je vis
J'ignore pour qui
pourquoi je meurs
Anise Koltz, Galaxies intérieures, Arfuyen,
2013, p. 69, 91, 52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anise koltz, galaxies intérieures, poème, néant, souvenir, rêve, mort, signe | ![]() Facebook |
Facebook |
11/03/2014
Jacques Roubaud, Octogone (3)

La rue
Je descendais cette rue qui était droite, inclinée de soleil, entre des automobiles d'une lenteur imprécise. Descendant cette rue j'avais la sensation du passé, d'un loin passé, d'une autre rue. Je ne parvenais pas à m'y revenir. Pas en personne, pas en image de soi, défenestrées : en certitude revenir, seulement en certitude. Dans le passé d'une autre rue quand je serais, je saurais. Mais comment ?
Cette rue-là qui n'était pas cette rue-ci, comment redeviendrait-elle présente, comment m'allait-elle se présenter, cependant que je marchais, poursuivi par le soleil, par le scintillement des arbres, les courbés de poussière ? Il y avait trois chiens jaunes, une bicyclette, une boulangerie. Rue sans rue, aux maisons sans maisons, aux toits sans toits, comment la rue du passé se rapprochant, si je parvenais à lui faire faire ce mouvement vers moi, me pourrait-elle paraitre, là, maintenant, passée ? Cependant je m'efforçais de susciter en moi un tel étonnement.
Une rue d'autrefois annonçait, future, sa présence étrange. Elle viendrait. Elle serait du passé venant à moi. C'est elle qui effectuerait ce mouvement. Et ce qu'elle me donnerait à voir, aussi proche fût-il, se déclarerait comme d'ailleurs. Pae quel signe ? une étiquette ? une voix ?
La rue du passé était au bout d'un chemin, coupé de stations : à chaque station sur le chemin de la recollection, une image. À chaque image son nombre, le nombre du passé. Dix, vingt, trente stations sur le chemin. Mais aucune certitude d'aboutit. Aucune. Sinon qu'elle serait la station ultime. Et qu'elle ne le serait qu'au moment où, par l'effort de remémoration, je me serais placé, d'un seul coup, devant la pénultième image. Alors, le passé serait, immédiat.
La pénultième image était, aussi, celle d'une rue. Ce n'était ni celle de la rue que je descendais maintenant, ni celle que j'avais descendue autrefois, qui ressemblait à la première ou ne lui ressemblait pas, mais tendait vers moi son appel. Je connus que c'était elle, celle d'avant. Rue liquide, sombre ; les mêmes arbres ; d'autres. Mais au moment même où je le sus, je cessai de le savoir.
Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois prose, Gallimard, 2014, p. 287-288.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, la rue, rêve, passé, oubli, fantastique | ![]() Facebook |
Facebook |
04/02/2014
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers

Une semaine avec James Sacré
Animaux
I
Animaux velus sales et grossièrement familiers je vous vois : je lèche un sexe rouge et me réfugie dans vos fourrures et près de vos dents.)
Langage
Nul animal n'y est sauf
Grand cheval rouge ou licorne grande
Misère le mien (lequel ?) m'arrache
Des larmes il traîne à l'envers la charrue
Je rage quoi disparaît
Dans le temps parti je langage
Je vais rêver l'été sera clair il faudra un texte qui prenne régulier le format de la page voilà au centre de l'enfance (l'été s'y abreuve) un cerisier grandit la lumière est l'évidence du bleu je vois par dessus des buissons un bord de tuiles une maison je regarde je désire un poème qui serait du silence le même bleu (j'y bois la transparence de nulle écriture) au centre un cerisier n'y rêve pas que je meurs.
[...]
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers, André Dimanche, 1993, p. 27-28.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des animaux plus ou moins familiers, été, poème, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2013
Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour
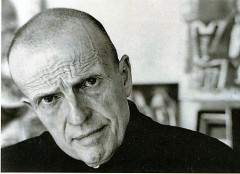
Fin 1954
(au petit matin, après réveil prématuré)
Par besoin d'argent, je me suis engagé comme taureau dans une corrida. Au moment de la signature des papiers, l'imprésario me fait passer une visite pour s'assurer que je possède bien les cinq cornes stipulées sur le contrat par lequel il s'engage, en effet, à fournir un "taureau à cinq cornes" Deux de ces cornes sont censément sur ma tête ; deux autres sont les sommets de mes omoplates, que l'imprésario palpe pour vérifier. Ma femme est là et je lui dis que cela me fait un peu froid dans le dos d'être palpé en cet endroit, un peu au-dessous de la nuque, là même où pénètrera l'estoc. Elle me dit : « Ce n'est qu'une mauvaise matinée à passer. Après, tu seras tranquille...» Je me révolte : « Après, je serai mort !» Tout à fait furieux, je leur crie à l'imprésario et à elle : « Vous vous foutez de moi ! Je ne marche pas ! » et j'ajoute : « J'aime encore mieux tenter ma chance comme torero ! » Le contrat ne sera pas signé et le rêve s'arrête là.
Presque tous ceux à qui je l'ai raconté m'ont demandé où se trouvait ma cinquième corne.
Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961, p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, nuits sans nuit et quelques jours sans jour, rêve, taureau | ![]() Facebook |
Facebook |
02/11/2013
Henri Michaux, L'étang

L'étang
Donne-lui un homme et du temps, il en fait un cadavre, puis il le rejette sur ses bords.
Il le gonfle puis il le rejette.
Lui demeure.
On avait établi des bancs aux alentours où l'on peut s'asseoir.
Ceux qui étaient fatigués venaient auprès de lui fumer de longues pipes.
Un château fut bâti en face.
Ceux qui désormais sont seuls aussi et orphelins et les oisifs volontiers s'approchent de lui qui ne fait rien et les mécontents l'entretiennent des causes de leur spleen, certains disaient, si j'étais noyé, si j'étais cadavre, je serais peut-être plus heureux, et ils réfléchissaient.
D'autres lui jetaient des mottes, des mottes de terre pour colorer sa face.
Il pourrissait les feuilles tombées petit à petit, mais ne sollicitait pas les feuilles encore à l'arbre.
De peu d'utilité à cause de son éloignement, on eût voulu l'approcher plus du village.
Mais voilà, quel charretier s'en serait chargé ?
Et il demeurait.
Il était là et ne venait à personne, ne cherchait point à courir, à souffler, psy, bschu, bschu...
comme l'eau de la rivière qui progresse sur les cailloux, ne recherche pas d'autres poissons que les siens.
Il demeurait.
[...]
Henri Michaux, Textes restés inédits du vivant de Michaux, dans Œuvres complètes, III, édition établie par Raymond Bellour avec Ysé Tran, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2004, p. 1417.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, l'étang, noyé, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2013
Marie Borel, Loin

j'ai choisi dans la mesure où je n'avais pas le choix
je rêve et me souviens et en rêvant j'écris ceci
je prendrai tes doigts endormis je les poserai
en rêvant sur mon cou
les doigts de ceux qu'on aime sont des gouttes de pluie
des coquillages en place d'ongles boire l'eau fraîche
en fermant les yeux pour s'isoler
manger des œillets durs comme tes seins menus
je n'ai pas tourné la tête
mais quelque chose en moi s'est mis à trembler
je t'ai reconnue à ta jambe pensive tes genoux lustrés
ma buveuse de thé
tu t'es inclinée en dansant amoureuse d'un clavecin
au milieu d'un bonheur frêle on entend des ruisseaux
des chiens et des abeilles
tu racontes des histoires des histoires ou bien des rêves
nonchalance & absolut ou aquavit
midi dormait sur les pierres celle que tu connais
depuis une heure a mis sa main sur ton bras nu
je songe au peu que tu me donnes
conclus que tu ne m'aimes pas
désolation muette des dimanches
je me couche sur ta nuque au-dessus de ce petit os
il fait une saillie
et par le dieu de tes doigts et des espaces entre tes doigts
deux fois je t'ai revue dans des salons
dansant parmi les dorures
nous avons dit quelques mots feints je n'en peux plus
ma bouche est pleine de ta poussière
ensuite il a neigé l'oubli
moi j'imagine ces histoires
et sur mes genoux le chat les écrit
(c'est une chatte)
du moment qu'une porte est fermée
les mots prononcés derrière doivent y rester
Marie Borel, Loin, éditions de l'Attente, 2013, p. 100-101.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie borel, loin, rêve, histoire, amour perdu | ![]() Facebook |
Facebook |
11/08/2013
André Frénaud, Les Rois Mages

La création de soi
Mes bêtes de la nuit qui venaient boire à la surface,
j'en ai harponné qui fuyaient,
je les ai conduites à la maison.
Vous êtes ma chair et mon sang.
Je vous appelle par votre nom, le mien.
Je mange le miel qui fut venin.
J'en ferai commerce et discours, si je veux.
Et je sais que je n'épuiserai pas vos dons,
vermine habile à me cribler de flèches.
André Frénaud, Les Rois Mages, Poésie / Gallimard,
1987 [1977], p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, les rois mages, la création de soi, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2013
Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour

19-20 mai 1942
Condamné à mort par les Allemands, je prends la chose courageusement jusqu'au moment où l'on me dit qu'on viendra me faire la barbe au début de l'après-midi, dernière toilette avant l'exécution. Cette dernière toilette, événement sur lequel toute mon attention était fixée, m'avait masqué l'événement ultime que serait l'exécution. Or, maintenant que j'en connais l'heure, ma pensée peut aller au-delà, de sorte que je vois disparaître le dernier écran placé entre la mort et moi par ce détail de protocole. Rien ne me séparant plus de l'exécution elle-même, mon courage fait place à une angoisse indescriptible. Je sens que je ne tiendrai pas le coup, que je pleurerai et hurlerai quand on me mènera au poteau.
Je rêve ensuite qu'on publie des souvenirs de mon collègue du Musée de l'Homme, Anatole Lewitzky (fusillé effectivement par les Allemands le 23 février de cette même année). Notant jusqu'à la dernière minute ses impressions de condamné, il raconte comment l'exécution a eu lieu dans une sorte de parc d'exposition désaffecté, aux abords du Mont Valérien. Ses compagnons et lui, on les a fait s'adosser chacun à une reconstitution de case ronde africaine, en pisé ou en argile séchée. Lewitzky raconte que, devant la porte de la case qui lui tiendrait lieu de poteau d'exécution, il y avait sur le sol un poulet ou un squelette de poulet (comme on peut voir en Afrique, sur des autels domestiques, des plumes provenant de volailles égorgées pour des sacrifices, ainsi que des crânes ou mâchoires d'autres animaux). Le texte se termine par une sorte de testament politique ou profession de foi : mots d'ordre, pronostics plein de confiance quant à l'issue de la guerre.
Michel Leiris, Nuis sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961, p. 143-144.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, nuirs sans nuit et quelques jours sans jour, rêve, angoisse, mort, guerre | ![]() Facebook |
Facebook |
01/06/2013
Antonio Tabucchi, Les oiseaux de fra Angelico

Message de la pénombre
La tombée de la nuit est soudaine sous ces latitudes ; le crépuscule éphémère ne dure que le temps d'un soupir, puis laisse place à l'obscurité. Je ne dois vivre que pendant ce bref intervalle ; pour le reste, je n'existe pas. Ou plutôt je suis ici, mais comme sans y être, car je suis ailleurs, même là, en ce lieu où je t'ai quittée, et partout dans le monde, sur les mers, dans le vent qui gonfle les voiles des voiliers, dans les voyageurs qui traversent les plaines, sur les places des villes, avec leurs vendeurs et leurs voix et le flux anonyme de la foule. Il est difficile de dire de quoi est faite ma pénombre, et ce qu'elle signifie. C'est comme un rêve dont tu sais que tu le rêves, et c'est en cela que réside sa vérité : être réel en dehors du réel. Sa morphologie est celle de l'iris, ou plutôt des gradations labiles qui s'effacent déjà au moment d'exister, tout comme le temps de notre vie. Il m'est donné de le parcourir à nouveau, ce temps qui n'est plus mien et qui fut nôtre, et à toute vitesse il court au fond de mes yeux : il est si rapide que j'y aperçois des paysages et des endroits où nous avons habité, des moments que nous avons partagés, et même les propos que nous tenions autrefois, t'en souviens-tu ? Nous parlions des jardins de Madrid et d'une maison de pêcheurs où nous aurions voulu vivre, nous parlions des moulins à vent, des récifs à pic sur la mer par cette nuit d'hiver où nous avons mangé de la panade, et nous parlions de la chapelle avec les ex-voto des pêcheurs : les madones avaient le visage des femmes du peuple et les naufragés pareils à des marionnettes se sauvaient des flots en s'agrippant au rai d'une lumière venue du ciel.
[...]
Antonio Tabucchi, Les oiseaux de fra Angelico, traduit de l'italien par Jean-Baptiste Para, Christian Bourgois, 1989, p. 44-45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio tabucchi, les oiseaux de fra angelico, message de la pénombre, rêve, souvenir, fantastique | ![]() Facebook |
Facebook |
01/05/2013
Laurine Rousselet, journal de l'attente

l'hiver grandit
il touche à la maison des morts
entre les froids l'ardeur emporte la résistance
les familiers invoquent les doigts à remuer
sous la neige écrire redouble le secret
l'incendie troue l'enfance
les mitaines assurent au sang de fendre la peur
s'endormir poème le crayon dans
tout crie au dehors souffre monde
à l'intérieur du lit pousse le sombre
qui écoute ?
le songe dévore l'inconnu
il faudra désormais tout rebâtir
toujours
la lune monte
et marche du sourire en silence
la petite seule voit la dissipation
le noir en vie est à l'aube du jour qui
le présent vit devant
attends
m'avancer dans l'énormité du ciel
Laurine Rousselet, journal de l'attente, éditions isabelle sauvage,
2013, p. 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurine rousselet, journal de l'attente, hiver, enfance, rêve, nuit, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |





