12/03/2016
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, treize à seize
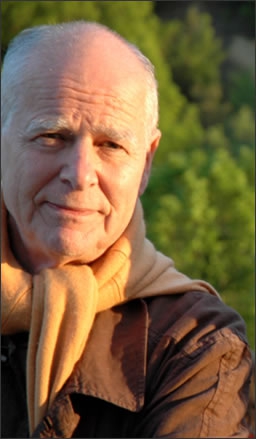
Le 23 juin 2009
Depuis le début, soit depuis l’été 1980, l’étonnement s’est accru de voir ce que fabrique le langage, ce que les choses deviennent après être passées dans ses griffes, ou dans ses voiles, dans toutes ses opérations de passe-passe qui font qu’elles ne sont peut-être pas ou plus tout à fait ce qu’elles sont — si être hors-langue pour une chose a du sens — ou même si la langue peut aller chercher les choses avant leur venue dans les mots, là où elles sont si différentes.
À moins qu’il soit absurde de songer à faire cela, à dire avec des mots un monde sans eux. Pourtant quelque chose leur appartient : la nuit de l’apparence. Ni cela qui simplement brille, ni ce que cet éclat dissimule, mais ce qu’il en est quand on le traverse. Ce qui se passe veut dire. Toujours cette question du transport.
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Flammarion, 2016, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord du juliau, journal, langue, mot | ![]() Facebook |
Facebook |
10/02/2016
Antoine Emaz, Soirs
accorder la langue
sur peu de choses
là ce soir
seul
avec
le jour en vrac
tout est passé
restent l'herbe
quelques feuilles tordues sèches
le froid clair encore le mur
entre l'herbe et le mur
la lumière glace
à chaque fois renvoie
une paroi de froid
à la fin le crépi
craque gris
dans le soleil qui baisse
voilà
peu de choses
dans un temps bref où passent
beaucoup de morts trop
vite
la vie dure
poser le peu comme simple
autant que possible
l'œil ras
dans l'herbe courte
les mots
on ne sait pas trop
ils tracent comme des bouclettes
des mèches de sens sans
tête
même hors vent ils frisent
quand sur la table
une bouteille tient nette
sa forme
pour bien faire il faudrait
des mots cendriers lourds
des pavés de verre clair quand
dehors brûle
[...]
Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,
1999, p. 74-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, langue, temps, vents | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2015
Étienne Faure, Ciné-plage
T’as perdu ta langue
T’as perdu ta langue — effroyablement seule
et soudain exacte est la phrase
entendue quand on se sait plus — stupeur —
lire, écrire, ni rêver dans la langue
qu’on avait crue acquise de longue date,
à cet instant frappé d’hébétude
de n’avoir su garder racine en elle,
mots précaires, locutions locales
qui s’immisçaient vaguement jusqu’à l’âme,
et que noué jusqu’à la glotte par l’émotion
de la perte on revit le mutisme
de l’enfant d’alors qui savait à peine
la langue qu’on lui parlait quand l’autre,
la maternelle, était déjà en voie de partance
sans plus d’espoir de la retrouver, enfouie,
t’as perdu ta langue.
perdue
***
Entrée, sortie
Qui est là — et voilà, debout
après les trois coups pour entrer dans l’histoire
à dormir sur les planches, il déclame
face aux assis en rang sur les fauteuils
qui attendront la fin, cramoisis, pour éclater,
ou transis regardent dans leurs lorgnettes
l’avenir de loin,
entrer le vieil acteur au teint farineux,
un crâne en plastique à la main pour dire,
mis en branle par le corps, son texte
appris par cœur, lui donner le souffle
que la langue et la voix fusionnent
dans l’illusion qui se fait attendre
jusqu’à l’applaudissement, premier rappel
quand, se dit-il, revenu à pas caverneux pour saluer,
le tour est joué.
ceci est du théâtre
Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon, 2015,
- 103 et 118.
Rencontre avec Étienne Faure et lecture, le mercredi
9 décembre, à partir de 19h à la librairie "Libralire",
116, rue St-Maur, Paris, 75011.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, ciné-plage, langue, perte, théâtre, rôle, spectateur, acteur | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2015
Pascal Quignard, Petits traités, VII
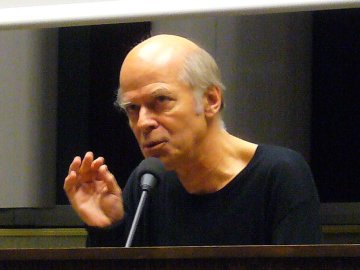
La langue est dans la bouche.
Les écrivains régurgitent un lait imaginaire. Ils sucent un souvenir ou se couchent en chien de fusil dans le vieux pas sonore d’une vieille vache laitière céleste. Dans leur bouche, sur leurs lèvres presque immobiles, ils font doucement revenir le lait de ceux qui n’ont pas de sein.
Quand on voit s’approcher quelque créateur que ce soit, quel que soit l’art où il excelle, il faut se boucher le nez, baisser les yeux avec une espèce d’emphase pour marquer fortement qu’on a honte à sa place.
Pascal Quignard, Petits traités, VII, Maeght, 1980, p. 77 et 199.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, vii, langue, écrivain créateur, lait, honte | ![]() Facebook |
Facebook |
02/09/2015
Pascal Quignard,Petits traités, IV
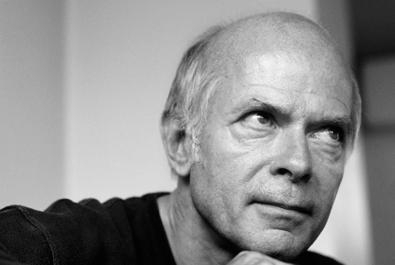
Une part de silence est le propre des livres de littérature. Elle aimante obscurément dans l’attrait qu’ils exercent sur les individus qui les découvrent.
De même que l’aoriste français vit extrêmement dans les livres mais n’est plus parlé. De même certains de nos plaisirs que nous nous avouons à peine à nous-mêmes. Que nous laissons à l’état d’idées et d’idées subreptices sinon tout à fait importunes.
Les langues se soucient comme de l’an quarante de leurs vertus, de leur efficace, etc.
Seuls les hommes qui en disposent rêvent ainsi à leur sujet.
Pascal Quignard, Petits traités, IV, Maeght, 1980, p. 77 et 136.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, iv, littérature, livre, plaisir, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2015
Nelly Sachs, Départ au désert

Départ au désert
Quitter soudain
la table du repas
et sans autre arme que son corps
s’en aller là-bas où les hyènes rient
Rendre visite aux pierres
qui se levèrent aussi un jour
pour revêtir la raideur de millions d’années
Tendre l’oreille pour épier
la faible plainte enfantine
au sein des sources cachées
qui veulent jaillir au monde
pour désaltérer les langues d’étoiles assoiffées —
le zodiaque des langues
qui lapent la lune opaline
et perdent tout leur sang
dans le frémissant rubis du soleil
Se lever soudain de table
s’enfoncer dans la racine de minuit
laisser un éclair fulgurant
déchirer notre poussière
Voir devant soi dans les sables du désert
le mirage vert des flammes végétales
la blancheur insoutenable des secrets dévoilés
la prière qui se déverse par les jointures de la mort
et les neiges éternelles de la rédemption —
Nelly Sachs, traduit de l’allemand par
Barbara Agnese, dans Europe, "Henri Heine",
"Nelly Sachs", août septembre 2015, p. 207-208.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelly sachs, dépat au désert, pierre, source, étoile, langue, nuit, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2015
Nathalie Quintane, Tomates

[...] C’est une autre fois , au Maroc, sur la côte, à Safi, en 2002. Un festival. L’inauguration du festival. Nous entrons dans un bâtiment public un peu décrépit, une vaste salle avec des chaises alignées, et devant, une estrade, haute. Une très longue estrade, et dessus, une longue table rectangulaire recouverte d’une nappe verte. On nous fait signe de ne pas nous asseoir au premier rang. Nous savons que les discours des officiels seront en arabe, que certains d’entre nous ne comprendront pas, mais qu’il est hors de question de ne pas assister à la cérémonie (on nous l’a dit). Nous attendons, nous discutons, je parle avec une poète assise derrière moi. Quand je me retourne, des policiers occupent le premier rang, dans une tenue calquée sur celle de la police française. Les officiels arrivent, un par un, montent sur l’estrade ; le plus jeune , qui doit avoir pas loin de soixante ans, puis les autres, âgés, qui semblent respecter une hiérarchie précise. L’un d’eux a des lunettes noires. Ils se tiennent droit. Ils sont graves. Ils vont parler, longtemps. Ils viennent d’avant, bien sûr, du Maroc d’avant ou de juste avant — mais ça, je n’ai pu me le dire qu’après, quand on a quitté la salle. Pour le moment, tandis qu’ils parlent, c’est moi qui suis dans leur temps, bouclée dans le présent qui est leur présent. Je ne bouge pas. Si je m’évanouis, parce qu’il fait une chaleur étouffante dans cette salle, je m’évanouirai droite sur ma chaise. Je sais que je vais sortir. D’ici là, l’important, c’est de ne pas se faire remarquer.
En fait, je n’ai jamais raconté cette scène-là comme ça, mais pour ce livre je dois faire quelques concessions, je dois écrire quelques au lieu de des, par exemple — des concessions —, parce que quelques concessions est rythmiquement comme un petit cheval qui galope et que je sais que cela fera plaisir, ce petit cheval qui galope, et qu’on me tiendra rigueur, si je ne fais pas galoper le petit cheval. Ils diront : tiens, elle n’a même pas fait galoper le petit cheval ; elle la soigne pas, sa langue ; on peut même pas dire : mais quelle langue ! — il est négligent, cet auteur. Alors je me suis dit que pour une scène onirique, à touche onirique, saveur onirique, il me fallait l’aide de Gérard — on appelle par leur prénom les écrivains malheureux, les personnes atteintes d’une gloire soudaine, qu’on s’accapare ainsi sachant pertinemment que c’est ce qu’elles redoutent le plus. Nerval est le meilleur pour dire le rêve, et comme je prends comme lui au sérieux les inventions des poètes, je l’ai rappelé pour ne pas être seule sidérée sur ma chaise.
Nathalie Quintane, Tomates, Points / Seuil, 2015 [P.O.L, 2010], p. 59-61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie quintane, tomates, récit de rêve, langue, nerval | ![]() Facebook |
Facebook |
21/03/2015
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride
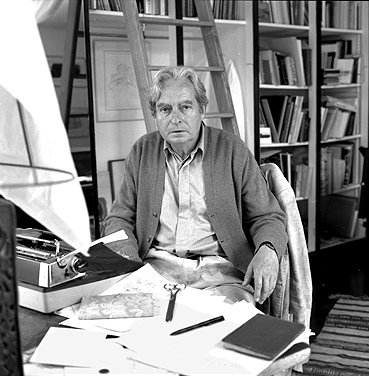
rêvant d’une langue dot les images seraient tellement éblouissantes, profondes et fortes qu’elles tiendraient lieu de toute logique, et du cheminement ordinaire imposé à la pensée.
*
les mots labourent l’air
on pique lourdement de l’avant
L’écume
et le litre tordu du sillage
Cette image qui vient de sortir a mis exactement dix ans à mûrir. Je m’en content pour la fin de la matinée.
*
Poésie : comme dans cette récente découverte physiologique où l’on profite du violent sursaut d’énergie vitale accumulée au moment d’un danger extrême.
*
Je ne peux pas dire ce que je ressens : ce que je ressens ne m’intéresse pas.
Ce que les autres sentent ne m’intéresse pas.
Je m’occupe uniquement des détails de l’accident terrestre.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955, édition établie par Clément Layet, Le bruit du temps, 2011, p. 123, 124, 125, 127.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, langue, image, poésie, sentiment | ![]() Facebook |
Facebook |
15/03/2015
Pascal Quignard, Lycophron et Zétès
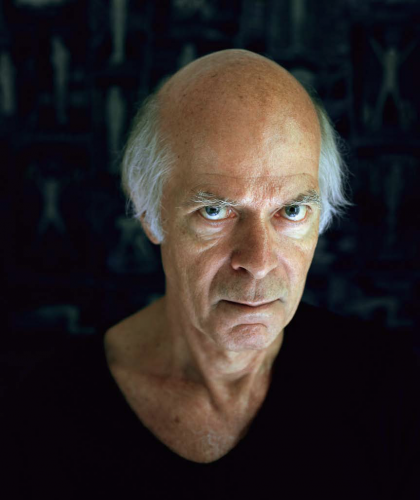
La lecture
Vir virum legit ne signifie pas : l’homme lit dans l’homme. Cette expression était usuelle dans les armées romaines. Cette formule militaire édictait l’ordre commun à tous les fantassins : Chaque soldat se choisit un compagnon d’armes qui répond de sa dépouille s’il tombe.
Chaque homme ramasse l’homme.
Sur l’audition imaginaire
[...]
La voix d’une autre parle loin en nous, encore, au fond de la langue qui nous a envahis.
Mais d’abord, ce n’est pas la langue qui dans la langue
C’est l’émouvoir de la voix du corps dont on était l’habitant, voilà ce qui parle « d’abord » et s’y poursuit « encore »
« Poussant des cris avertissant l’autre qu’on habitait », tel est le sujet avant le sujet (avant que la langue collective l’assujettisse en « personne grammaticale », avant que la société en fasse un « conscrit » sur la ligne de front de ses guerres, avant que le frère d’armes recueille la dépouille de son compagnon d’armes qi tombe, qui tombe, toujours mort, toujours prae, à son côté)
Pascal Quignard, Lycophron et Zétès, Poésie / Gallimard, 2010, p. 236 et 237.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, lycophron et zètès, la lecture, l'audition imaginaire, voix, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
08/03/2015
Luc Bénazet, Articuler

Dialectes, jargons, parlers de pauvres et de riches
(Pier Paolo Pasolini), —
Quelle division des parlers est simple, lorsqu’un groupe est divisé simplement, —
Si une communauté humaine avait multiplié
les divisions en elle, divisions
multiples mais complexes, nous pourrions la même
la même typologie des parlers
(un état de langue particulier
est aliénable. Une langue de pouvoir le domine et
obtient sa disparition :
disparaît la dimension affirmative,
disparaît la forme particulière .)
Mais donner sa force, mais la perdre, non pas
en pure perte : quelque chose autre advient à un autre que soi, —
sa force grandit, un rapport à lui
s’établit. Un voile
aura recouvert ce qui nous sépare d’un autre que soi, —
nous nous parlons ! À l’instant
une langue semblant commune
est disposée.
Disons : des objets singuliers s’imposent
à chacun, avec eux, les parlers
dont ils contraignent
l’état. Et
sont des objets généreux, pour tous
(...)
Luc Bénazet, Articuler, nous, 2015, p. 13-14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc bénazet, articuler, langue, parler, pouvoir, échange | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2014
Joseph Joubert, Carnets, II

Un visage sans trait, un livre dont rien ne peut être cité.
Remplir un mot ancien d'un sens nouveau (dont l'usage l'avait vidé pour ainsi dire ou que sa propre vétusté en avait laissé s'échapper), ce n'est pas innover mais rajeunir. C'est enrichir les langues en les fouillant. Il faut traiter les langues comme champs. Il faut pour les rendre fécondes quand elles ne sont plus nouvelles, les remuer à de grandes profondeurs.
Le poli. Donner le poli. C'est là ce qui exige du temps. Et plus ce qu'on dit est neuf plus il faut de temps et de soins pour donner le poli.
Le poli conserve les livres, le marbre et le bronze. Il s'oppose à leurs rouilles.
Chaque auteur a son dictionnaire et sa manière — c'est-à-dire s'affectionne à des mots d'un certain son, d'une certaine couleur, d'une certaine forme, et à de certaines tournures de style, à de certaines coupes de phrase où l'on reconnaît sa main et dont il s'est fait une habitude.
Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994 [1938], p. 202, 211, 229, 235.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, livre, langue, style | ![]() Facebook |
Facebook |
07/10/2014
Christian Hubin, Touchant à une zone centrifuge

Touchant à une zone centrifuge
Abusive, non légitimée (rendue à quoi, altérant quoi ?) : la poésie, site classé, négociant sa reconversion.
*
Laissons-nous, aux meilleurs moments, nous laver de l'identité. Laissons-nous, émus, nous en remettre.
*
Restant à soi-même son cantus in-firmus, son mini Lascaux portatif.
*
Une logorrhée interchangeable poissant tout. L'invisible pressé au ramis. Le gluten des phrases transitoires.
*
Ozone entre les contours, les bribes de comptines de sens.
*
Rate qui flotte au fil du courant, portant sur le ventre les bubons, les présents vers ce qui l'escorte.
*
Outil de ce qui ne peut pas se dire.
*
Le particules sapides de l'air ; sa destitution du contenant.
*
Le polype invisible que la lecture apporte. Les pauses par tic propitiatoire, orphelinat expectatif.
*
Restituer les plis de sons, des hochements muets de sténoses — quelque chose peut-être en accord, en poudroyante faculté de — là où on est. Où la prosternation perplexe — nos ravages, dans la langue, de nains décatis.
Christian Hubin, Touchant à une zone centrifuge, dans Rehauts, n° 26, octobre 2010, p. 3-4.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian hubin, touchant à une zone centrifuge, poésie, identité, sens, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2014
Bernard Noël, "Qu'est-ce qu'écrire", dans La Place de l'autre, Œuvres III

Écrire aujourd'hui
[...]
L'écriture de recherche [....] ne travaille pas à l'écart d'ici et d'aujourd'hui, pas à l'écart de l'état social dans lequel nous vivons. Au lieu de le contester par le témoignage ou la description, elle l'attaque au niveau de la langue. C'est ce qu'il m'importe maintenant d'essayer d'éclairer.
Une collectivité existe en fonction de la relation qui unit ses membres. Cette relation a deux supports : le lieu et la langue. Traditionnellement, cette langue a pour référence l'ordre qui gère la collectivité, c'est-à-dire l'État. De même que l'État met en circulation la monnaie qui règle es échanges, de même il fait circuler un discours qui, si je puis dire, est l'étalon de la communication par le langage. Cela est encore plus vrai dans les sociétés démocratiques et laïques, nées de la révolution. Symboliquement, d'ailleurs, l'Encyclopédie précède la grande Révolution, car elle est le livre qui, en donnant réponse à tout, donne congé à Dieu. Seulement qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui va toujours s'accélérant dans nos sociétés libérales ? C'est que le discours du pouvoir, non seulement est de plus en plus vide, mais par là même vide le discours collectif de son sens. Alors que la censure nous prive de parole, ce phénomène nous prive de sens, et cette nouvelle Sensure équivaut à un très discret et d'autant plus efficace lavage de cerveau.
L'écriture de recherche s'inscrit contre cette dégradation, d'où l'importance dans son travail du mot "langue", d'où la grande place du souci "linguistique". Évidemment un danger formaliste guette ce travail au niveau de la théorisation, mais ce qui le guette surtout, c'est la récupération sous forme de savoir. On peut s'approprier le savoir, on ne peut pas s'approprier le sens, car il nous conduit vers une limité où lui ne s'arrête pas.
Bernard Noël, "Qu'est-ce qu'écrire", dans La Place de l'autre, Œuvres III, P. O. L, 2014, p. 225.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, "qu'est-ce qu'écrire", dans la place de l'autre, écriture, recherche, État, discours, langue, révolution | ![]() Facebook |
Facebook |
12/05/2014
Pascal Quignard, Petits traités, I
Petits traités, volume 1 à 8

VIIIe traité, Le Livre des lumières
Au cours de la lecture, on dit qu'une voix silencieuse, parfois, se fait jour. À l'évidence, elle ne naît pas du livre. Mais le corps ne l'articule pas. Elle épouse le rythme de la syntaxe et sans qu'elle fasse sonner les mots elle mobilise pourtant la gorge, le souffle, les lèvres. Il semble que tout le corps, pourtant immobile, s'est mis à suivre une certaine cadence, qu'il ne gouverne pas, mais que le livre lui impose : la langue résonne en silence dans les marques syntaxiques, le corps halète un peu et c'est un très lointain fredon.
On le dit.
« On le dit », cela veut dire : ce sont des choses qu'on entend. Mais personne n'entend les livres.
S'il est vrai que la ponctuation d'un livre est plus affaire de syntaxe que de souffle, il reste que parfois pareille voix fictive parcourt effectivement le corps. Même, quand le livre est très beau, elle fait penser que la lecture n'est pas si loin de l'audition, ni le silence du livre tout à fait éloigné d'une « musique extrême », — encore qu'il faille affirmer aussitôt qu'elle est imperceptible.
Aussi entend-on parler de la ponctuation comme d'une sorte de cadence ou, plutôt, de « mouvement d'exécution ». Ce n'est pas un air, une mélodie : mais un rythme, qui est abstrait, qui chiffre la promptitude ou la lenteur, solfiant les groupes des mots, décidant des valeurs Ainsi on estime certaines ponctuations pour agitées, ou contenues, pour graves, ou inquiètes, pour fougueuses, ou sèches, pour domptées, ou tumultueuses, — et il est vrai que le rejet même de la ponctuation, loin qu'il affranchisse d'une règle, consent un sacrifice qu'il n'appelait peut-être pas de ses vœux s'il a pour premier effet des restrictions supplémentaires, des privations exorbitantes. Vouant à vivre de peu, il accroît la misère.
[...]
Pascal Quignard, Petits traités, I, Maeght, 1990, p. 159-161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités i, le livre des lumières, voix, souffle, corps, ponctuation, langue, lecture, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
23/03/2014
Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985 : recension

Un chantier poétique
« Il s'agit maintenant de tout reprendre, de tout recommencer » : c'est la dernière phrase de la "note bibliographique" donnée dans Terre ni ciel (Corti, 2014), qui rassemble des articles autour de la poésie et de l'écriture. Parallèlement, Champs "reprend", revisite deux livres anciens publiés sous ce titre en 1984 et 1987, et Yves di Manno les définit comme un « chantier poétique inaugural » (339), ce que le titre recouvre ; si l'on pense à l'emploi du mot "champ", il désigne un espace et, au figuré, un domaine : ici, les champs sont des espaces où viennent se réunir des moments de l'humanité, mais ce sont aussi des domaines, des lieux d'expérimentation de l'écriture. Je n'explorerai pas ces ensembles foisonnants, me limitant à quelques éléments.
Les mondes anciens sont présents, souvent évoqués, comme dans les épopées du Moyen Âge ou nombre de mythologies, à travers la violence qui a permis de les construire : il n'est guère nécessaire de préciser leurs noms tant ils se ressemblent, ce ne sont que corps à pendre, à écarteler, à ouvrir pour occuper les territoires. La violence des temps modernes est analogue : "Champ : : de massacre" s'ouvre sur "Kambuja", c'est-à-dire concerne l'histoire récente du Cambodge ; ce ne sont plus lances et épées qui défont les corps mais fusils et rafales (86). Il y a d'ailleurs tant de points communs entre passé et présent qu'ils sont souvent entrelacés.
Cependant, les « faces de pierre » qui demeurent du passé évoquent aussi des temps moins tragiques ; la stèle d'Ikhernofret est liée à l'apogée du Moyen empire égyptien, "Note de chevet" se rapporte à une période riche (la fin du Xe siècle) de l'histoire du Japon, quant au « roi lépreux », il s'agit de Baudouin IV, roi de Jérusalem à la fin du XIIe siècle ; etc. Une autre figure, plus présente dans Champs, est celle du Christ ; elle apparaît par l'idée de trahison dans les premières pages, « Ils seront douze à renier son / Nom », et, notamment, occupe l'essentiel des poèmes de la dernière partie du livre, encadrés par l'évocation de "Deux ombres", Orphée et Eurydice.
Dans cette histoire des hommes, pleine d'oppositions — guerres et paix, "Heurts" et "Havre" — se détachent les figures des créateurs, explicitement celle de Rimbaud, avec une citation et par allusion transparente : le titre (au pluriel chez Rimbaud) "Fête de la patience", est repris 4 fois (38, 116, 149, 254), liant les parties du livre. Il apparaît encore avec la reprise du mot "Parapets" (16), titre et dernier mot d'un poème, qui renvoie au "Bateau ivre", et dans « La main revient au papier, le corps à la / Charrue » (123), allusion au poème "Mauvais sang (« La main à plume vaut la main à charrue »). On reconnaît aussi, transformé, le dernier vers de "El Desdichado" de Nerval dans « [...] naquit ton cri / (saintes ou reines) / et dans l'eau blême / le soupir de / la fée », et la voile noire de Tristan et Iseut ; en est aussi issu l'épisode de l'épée entre les deux amants pour signifier la chasteté de la Vierge. Etc.
Ces quelques relevés visent à mettre en évidence des thèmes récurrents dans Champs, ceux de l'absence et de l'oubli, explicites dans un poème « in memoriam Jaufré Rudel », variation sur les amants « Heureux malheureux tour à tour » (32) et l'amor de lonh du troubadour. L'un des rares poèmes avec un "je" en scène commence ainsi : « Je cherche et demande l'oubli » (25), et le motif est régulièrement repris — « Aussi leur chant emmurait-il l'oubli » (87), « [...] d'autres disparurent / Oubliant leur nom » (108), etc. Mais Yves di Manno marque une distance vis-à-vis de ce motif lyrique, si présent soit-il (comme ceux du cri et de l'oiseau) :
... Regain. Si c'est mémoire morte, ou l'on
Nous oubliera. Et puis ? Le langage se tait, se
Suffit à lui-même. Aux parentés de mots (que
Dis-je !) nous préférons la loi d'un récit qui
N'a ni début ni fin — d'un récit sans action et sans
Protagonistes. Le mot. Le mot.[...] (126)
S'esquisse une poétique, qui invite à relire le livreautrement : il s'élabore en partie par la manipulation de mots. Par exemple, Yves di Manno construit le texte en utilisant les ressources de l'anagramme, complète « (mon, nom) », "renié" / "reine[s]", ou partielle ; je retiens un exemple parmi des dizaines : les titres (de 4 lettres) d'une série de poèmes, ont tous 3 lettres en commun : "élan", "aléa", "a lié", "féal", "fléau", "étal" (à partir duquel vient "alto"), seul "étau" ne suit pas la règle (p. 289 et sv.). Une autre transformation, très courante, consiste à engendrer un mot par soustraction, ou par addition, d'une lettre ("ombres" / "nombres", écrits" / "cris"), parfois d'une syllabe ("disciples" / "discipline"), par changement de voyelle ("jade" / "jadis") ou de consonne ("Eau forte" / "Eau morte"), par inversion des syllabes phoniques (« Déchiffré à l'envers : versant / est — s'en expliquer. Ou d'Anvers ») (133), etc.
Parallèlement, les formes strophiques et les types de vers sont des plus variés : on parcourt une partie de l'histoire du mètre en français. On lira les diverses possibilités d'écrire un sonnet, y compris en le commençant par les tercets ; On reconnaîtra à peu près tous les types de strophes, y compris le monostiche, et des associations de rimes chères aux Grands Rhétoriqueurs : la rime brisée — les mots à l'hémistiche riment aussi entre eux — ou le vers léonin — les deux hémistiches riment ensemble. On repèrera le jeu avec les licences anciennes pour obtenir le compte des syllabes ("encor", 2 fois). Etc. En outre, des coupes en fin de vers défont la lecture : « (trop lente us / ure des he /ures : des jo / urs) » (249) ou, à l'inverse, en suggèrent une autre : « des maisons / mor / tu / aires » (244).
Il faudrait encore relever la place des poètes américains dans le livre, qui auront tant d'importance par la suite, ou analyser la relation au lyrisme avec le statut du "je" et du "tu" — relation mise à distance dans « jerre / sachant / taimer » (246), ou... Foisonnement, oui, il fallait pour Yves di Manno tout essayer dans ces débuts, se reconstruire une histoire du vers tout autant que des ancêtres, moment nécessaire pour « l'ouverture d'un autre champ » (340).
Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985, Poésie/Flammarion, 2014, 352 p., 20 €.
Recension publiée sur Sitaudis 21mars 2014
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, champs, un livre de poèmes 1975-1985, mot, histoire, langue, rimbaud, nerval, jaufré rudel | ![]() Facebook |
Facebook |






