22/11/2016
Jean-Luc Parant, Le miroir aveugle

De la nuit et du vide
On m’a menti, il n’y a rien sous mes doigts, je ne sens rien de mon visage dans le miroir, comme je ne sens rien sous mes doigts quand j’ouvre un livre et que je touche ce qui est écrit.
On m’a menti, moi qui suis d’abord un corps, avec ma tête que je touche sans cesse parce que je ne la vois pas, ma peau à travers de laquelle je respire, mes poils qui me protègent, mes cheveux, mon sexe qui me reproduit, mes mains et mes bras qui me dirigent dans la nuit, mes jambes et mes pieds qui me déplacent sur la terre dans le jour. Moi qui suis ce que je suis, avec une matière et une odeur avec lesquelles je suis né, avec lesquelles je disparaitrai.
On m’a menti, on m’a dit que c’était moi dans la glace, que j’étais cette image intouchable, ce reflet insaisissable que l’on ne peut pas atteindre, moi qui suis si proche de moi, qui me touche qui me sens, moi qui suis si fragile, qui ai mal au moindre choc, qui saigne à la moindre blessure, qui m’abîme tous les jours, qui vieillis et qui un jour serai mort et qui ne serai plus que quelques os, un petit tas de poussière sur la terre.
Jean-Luc Parant, Le miroir aveugle, Argol, 2016, p. 147-148.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc prant, la miroir aveugle, visage, mensonge, toucher, corps, livre | ![]() Facebook |
Facebook |
01/05/2016
Jean Genet, Ce qui reste d'un Rembrandt déchiré...
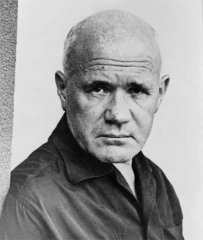
Ce qui est resté d’un Rembrandt…
Comme une odeur d’étable : quand, des personnages, je ne vois que le buste (Hendrijke à Berlin) ou seulement la tête, je ne peux m’empêcher de les imaginer debout sur du fumier. Les poitrines respirent. Les mains sont chaudes. Osseuses, noueuses, mais chaude. La table du Syndic des Drapiers est posée sur de la paille, les cinq hommes sentent le purin et la bouse. Sous les jupes d’Hendrijke, sous les manteaux bordés de fourrure, sous les lévites, sous l’extravagante robe du peintre les corps remplissent bien leurs fonctions : ils digèrent, ils sont chauds, ils sont lourds, ils sentent, ils chient. — Aussi délicat et grave que soit son regard, la Fiancée juive a un cul. Ça se sent. Elle peut d’un moment à l’autre relever ses jupes. Elle peut s’asseoir, elle a de quoi. Madame Trip aussi. Quant à Rembrandt lui-même, n’en parlons pas : dès son premier portrait sa masse charnelle ne cessera de s’accélérer d’un tableau à l’autre jusqu’au dernier, où il arrive, définitif, mais non vidé de substance. Après qu’il a perdu ce qu’il avait de plus cher — sa mère et sa femme — on dirait que ce costaud va chercher à se perdre, sans politesse envers les gens d’Amsterdam, à disparaître socialement.
Vouloir n’être rien, c’est une phrase qu’on entend souvent. Elle est chrétienne : faut-il comprendre que l’homme cherche à perdre, à laisser se dissoudre ce qui, de quelque manière, le singularise banalement, ce qui lui donne son opacité, afin, le jour de sa mort, de présenter à Dieu une pure transparence, même pas irisée ? Je ne sais pas et je m’en fous.
Jean Genet, Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes, dans Ouvres complète, IV, Gallimard, 1968, p. 21-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, ce qui reste d'un rembrandt déchiré.., corps, portrait, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2016
Hervé Piekarski, L'état d'enfance, II

Une fable
On a retrouvé le corps du vieillard dans le fossé, on a déclaré la fin des recherches mais le corps du vieillard continuait de pourrir dans le fossé. On a interrogé la femme dont le fils n’était pas rentré puis la femme s’est mise à pleurer, on a libéré les chevaux mais c’était là chose absurde car les chevaux étaient déjà en liberté. Le lendemain le fils est rentré puis il s’est assis dans le café et il a demandé où était la femme. On avait emporté le corps du vieillard à la morgue et certains auraient voulu qu’on le brûle. Le fils a pensé que la femme était pour quelque chose dans la disparition du corps. Les messieurs de la ville ont dit qu’ils reviendraient et la femme s’est rendu compte qu’un dernier appui avait cédé dans son cœur et qu’il lui faudrait tomber et ensuite se relever.
Hervé Piekarski, L’état d’enfance, II, Flammarion, 2016, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé piekarski, l'état d'enfance, ii, fable, vieillard, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2016
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize

Aborder la terra incognita.
Celle de voir l’écriture nous quitter — qui est celle de la destruction du désir en relation avec un corps qui cesse lui aussi d’avoir envie, comment cette souffrance peut-elle traverser une forme pour dire son effondrement ?
Défi qui serait spécifiquement un combat de poésie : inventer l’expression de la disparition du désir de dire. Situation à la fois simple et extrême, dont la limite est peut-être la banalité même de cette cessation comparable à l’inconnu de la mort.
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, treize à seize, Poésie / Flammarion, 2016, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, terra incognito, désir, écriture, corps, disparition, poésie, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
10/03/2016
François Muir (1955-1997), Toi, l'égaré (poèmes inédits)

Quelle mue soudaine
Te saisit ?
Le vagir s’inscrit en toi,
Te quitte.
Le bégaiement du vieillard
Te poursuit, t’abandonne.
Quel est cet âge ?
Tu dresses la carte
De ton corps.
Désert de mots.
Géographie de morsures.
Tu secoues le planisphère.
Un long sifflement te répond.
Il n’y a plus personne.
François Muir, Toi l’égaré (poèmes inédits),
La Lettre volée, 2015, p. 13, 26.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois muir, toi, l'égaré, mue, vieillard, corps, mots, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2015
Emmanuel Laugier, 27 fois — et suivantes : Jacques Dupin

27 fois — et suivantes : Jacques Dupin
papier de riz cassant le rêve
où sa jambe revenue
ouvre la garrigue
au son rêche des tissus
une écharde orpheline fait assez simple ra-
ccord persistant
la jambe harassée
où le nerf court et brûle
le long de la colonne du souffle
si l’écrire
le détachait de son corps
la semence de la voix
soufflée
là même où il répond
et s’en va
la suffocation à travers laquelle
il ne respire plus
est nœud gordien
logé au rappel de sa voix ici même
où le champ s’ouvre et se consume dans une fumée âcre
[...]
Emmanuel Laugier, 27 fois — et suivantes : Jacques Dupin,
dans Koshkonong, n°8, été 2015, p. 16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel laugier, 27 fois — et suivantes : jacques dupin, corps, femme, voix, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2015
Bernard Noël, Poèmes, I, espace pour ombre

espace pour ombre
espace
de quelle eau lente
fait
un sourire s’épuise
trop devenu sourire
tu
déchires la glace
et
la surface tombe
*
qui parle
si le temps est désert
si ta place gelée
on
pose un souvenir
la nuit écume
le corps se fend
hier
comme une pierre au fond de l’eau
*
regard
de quel regard tombé
cette durée t’exile
l’amour te traverse
et
l’intouchable
la vitre refuse l’ongle
le miroir boit le visage
le rire même
s’éparpille cassé
[...]
Bernard Noël, Poèmes I, Textes / Flammarion,
1983, p. 139-141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, poèmes i, espace pour ombre, regard, nuit, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2015
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo

Aperçu, à la morsure, à la langue de cendre,
illuminé, ses draps déchirés dans la puanteur,
oublié près du gouffre, la salive à la bouche,
comme un garçon d’argile foudroyé, peint, dévoré et sali,
à l’agonie sur l’herbe du pré, puni, poussé dans le trou,
dévorant son foie et touchant l’eau, choisissant,
triant les coquilles dans le noir, écrasant les
bouquets qui puent et qui salissent, les morceaux
perdus dans l’obscurité, Innocent pinçant la fleur,
la feuille rouge de l’arbre, les lèvres sur le bois poli,
la bouche fermée, prêt à mourir, toujours châtié,
toujours libre, les pieds nus sur le limon, en odeur
de neige.
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit,
1986, p. 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, bufo bufo bufo, corps, odeur, obscurité | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2015
Carol Snow (née en 1949), Pour, dans Rehauts

Postures du corps VI
Voulant non seulement l’immobilité des collines
mais une médiation — comme un regain
sur les collines — mur
de silence au-dessus des collines. Moore sculpte une figure
massive en marbre noir : un corps
de femme, couchée, courbée ; une éloquence
d’os, de coquillage,
pierres portées par-delà la contradiction.
Tu t’es arrêtée
au bord de la route, étalement
de collines à mi-distance, quelques maisons. Seules les vertes
étendues du vignoble dans l’entre-deux
semblaient accessibles, c’est-à-dire humaines — question
d’échelle : silence imposant, tel que seules
les collines (également
imposantes) pouvaient reposer.
Cézanne, penché sur sa toile, aurait maîtrisé
cette vue, penses-tu : les bleus et les verts
et les ocres du proche et du lointain, cette posture
précaire de la danse, non le dessin qui unit
le dissemblable, par exemple les corps, mais le maintien
séparé du corps et du terrain, tu étais si
figée, tu pensais que tu pourrais devenir ces collines,
ou bien être née de ces collines
ou bien ton corps
aurait été un modèle pour ces collines.
Carol Snow, Pour, dans Rehauts, n° 35, printemps 2015,
traduit de l’anglais (États-Unis) par Maïtreyi et Nicolas Pesquès,
p. 3-4.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carol snow, rehauts, maïtreyi et nicolas pesquès, collines, corps, femme, cézanne | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2015
Marie Cosnay, Le Fils de Judith

L’étendue liquide clapotait, de larges cercles concentriques s’écartaient, j’aurais cru un lac avec des algues et des aspérités moussues, les cercles s’éloignant étaient tapissés de petits dessins formant des croix, cela faisait des hachures subtiles. Je me frottais les yeux, rien ne changeait. Les hachures étaient dessinées à l’encre verte, j’y noyais mon regard. Le chagrin m’envahit. Il m’était arrivé de douter de mon corps. De nuit, parfois, j’avais l’esprit mangé, quelqu’un entrait par ma bouche et ne voulait pas lâcher.
Marie Cosnay, Le Fils de Judith, Cheyne, 2014, p. 8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, le fils de judith, eau, illusion, chagrin, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2015
Denis Roche (1937-2 septembre 2015), Éros énergumène

Théâtre acte d’amour : 1ère chance
hors du bouillonnement de l’instrument, sem-
blable à cette phrase mal tournée de notre suicide
Ensemble, à l’Épée-de-rose enseigne verte, on
Voit un peu de verdure de Sologne au travers —
N’osant donner de l’héroïne aux vers afin que
Nul ne meure d’une telle agronomique erreur :
Une jupe fleurie qui crée un Amour à chaque pas,
Dérobe à nos yeux de ravissants appas ; et cette cuisse
Comme à Vénus potelée... À mille beautés,
À mille appas vivants, atours, vous ne substituez que
Des empêchements !... Et ce soulier mignon, sui
Couvre un pied d’Hébé, de Vénus, tout provocant qu’il
Est, vaut-il ses charmes nus ?
Tu en as menti, ô fleur de mes lèvres, les
Haricots et les bulles des folles, ton cul bien
Droit fait vers moi quelques périphrase (inuti-
Les aujourd’hui) en forme de tire-bouchons.
Denis Roche, Éros énergumène, Seuil, 1968, p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : denis roche, Éros énergumène, théâtre, amour, corps, vénus | ![]() Facebook |
Facebook |
31/08/2015
Pascal Quignard, Petits traités, II
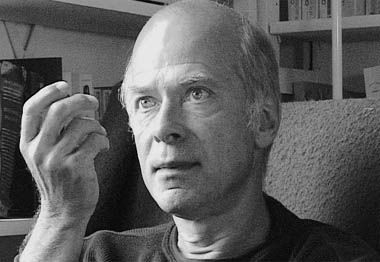
Un livre est assez peu de chose, et d’une réalité sans nul doute risible au regard d’un corps. Il ne se transporte au réel que sous les dimensions qui ne peuvent impressionner que les mouches, exalter quelques blattes peut-être, étonner les cirons. Parfois l’œil d’un escargot enfant.
Il introduit dans le réel une surface dont les côtés excèdent rarement douze à vingt centimètres, et l’épaisseur d’un doigt.
Pascal Quignard, Petits tréités, II, Maeght, 1980, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits tréités, ii, livre, réel, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
10/08/2015
Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort

On attend
depuis le premier jour
qu’on nous touche
le centre
Certains
ont voulu venir
mais n’ont pas été loin
Nous ne sommes peut-être pas
assez élastiques
*
On ne se croise pas
Chacun son enveloppe
*
Il ne faut pas croire
les animaux
différents de nous
Ils attendent
qu’on leur mette les mains dedans
Il fait noir
au milieu de la viande
*
On ne caresse jamais
l’intérieur d’un corps
*
On pense
que quelqu’un viendra pour aider
à nous retenir
C’est une erreur
Le corps se sectionne dans le corps
Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort,
éditions Unes, 1991, p. 9-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, garder le mort, attente, viande, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
02/08/2015
Antonin Artaud, L'amour sans trève

L’amour sans trêve
Ce triangle d’eau qui a soif
cette roue sans écriture
Madame, et le signe de vos mâtures
sur cette mer où je me noie
Les messages de vos cheveux
le coup de fusil de vos lèvres
cet orage qui m’enlève
dans le sillage de vos yeux
Cette ombre enfin, sur le rivage
où la vie fait trêve, et le vent,
et l’horrible piétinement
de la foule sur mon passage.
Quand je lève es yeux vers vous
on dirait que le monde tremble,
et les feux de l’amour ressemblent
aux caresses de votre époux.
Antonin Artaud, Poèmes (1924-1935), dans Œuvres
complètes, I*, Gallimard, 1976, p. 262.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, l'amour sans trêve, corps, caresse, orage | ![]() Facebook |
Facebook |
17/07/2015
Jacques Dupin, Une apparence de soupirail

[...]
Tu t’endors. Ta main froisse des feuilles noires. Tes ongles brillent. Ton nom s’efface... Mes deux mains ennemies pétrissent la terre noire, avant de dormir.
Un profil, et l’absence de récit. Je ne meurs pas. Je ne dessine plus. J’émiette le trait à l’écoute d’un visage. Affilement de la lune à son premier quartier.
Pierres dressées, marches forcées. Il n’a jamais respiré plus librement qu’à travers cette lapidation immobile d’un corps, d’un autre corps contre le ciel.
De toi et de personne, j’ignore le bord et le cœur. Comme un agonisant debout...
Tendresse du vide dans la scansion des pierres sèches du muret. Lourdeur des figues sous les feuilles, la lumière. Et devant elle, mes doigts cassés, ivres morts...
Marques de dents de singe sur ton corps errant. Marques vertes, douleur ambiguë. Je m’enfonce, comme un glacier, dans le soleil...
[...]
Jacques Dupin, Une apparence de soupirail, Gallimard, 1962, p. 61-66.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, une apparence de soupirail, l'autre, tendresse, corps, arbres | ![]() Facebook |
Facebook |





