01/06/2015
Maël Guesdon, Voire

IV
Il y a plusieurs manières pour les yeux d’être utiles à ceux qui les voient.
S‘elle — ne me faites pas dire.
Du dehors des plaies ce qui prend forme — et sur une face tout se donne.
Sort d’une fatigue ancienne où les fragments d’idées ne se répètent plus.
Elle rassemble les bouts. Mange un peu de sa peau.
Par hasard tombe toujours sur la même face. Sans trucage.
Une partie de ses vêtements est restée accrochée au bord. Elle enlève le tissu de sa bouche. Elle essuie sa bouche.
Le monde se lit dans l’eau.
Se connaît par variables — seulement la peur de ce qui n’a pas lieu.
Maël Guesdon, Voire, Corti, 2015, p. 57-60.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, voire, yeux, idée, corps, peur | ![]() Facebook |
Facebook |
28/05/2015
Eugène Savitzkaya, À la cyprine : recension

À la cyprine paraît en même temps qu’un roman, Fraudeur, longtemps après les poèmes de Cochon farci, en 1996, chez le même éditeur. On sait que cyprine désigne une espèce minérale, dont une variété de couleur bleue est utilisée comme pierre précieuse, mais il s’agit ici d’un homonyme ; "cyprine", dans ce livre, est le nom des secrétions vaginales provoquées par l’excitation sexuelle, en accord avec un extrait du Corps lesbien de Monique Wittig donné en exergue : « Une agitation trouble l’écoulement de la cyprine ». Donc, ces poèmes ne sont pas à proposer aux jeunes gens pubères ou, au contraire, on en encouragera la lecture, selon ce que l’on imagine que les dits pubères doivent connaître du vocabulaire et des pratiques sexuels.
Sans jeu de mots, Savitzkaya appelle un chat un chat, et l’on relèvera au fil de la lecture couilles, bite, chatte, baiser, cul, vit, con, également des expressions variées pour évoquer les parties du corps, éléments du désir, et les positions et actions des corps amoureux, par exemple "tailler une plume", "chas de l’aiguille", « babeurre suintant de la baratte », « cirer la fleur », etc. Le corps féminin est exalté, et surtout le sexe, parfois dans des vers au ton ronsardien, comme « doucement moussu de bouclettes ton ventre », mais souvent plutôt brutalement : « à grands coups de cul agite la fleurette reine ». Aux classiques métaphores végétales (« touffe », « tige », « rose ») s’opposent l’emploi recherché de « gynécée » au sens de pistil dans un poème où le corps devient fleur, ou l’inattendue qualification du vagin : « au goût de baie de genévrier ». L’homosexualité — masculine — a sa place (« maigre cul masculin / à cheval sur bâton nerveux ») parmi l’universel coït, conçu comme une dévoration : le corps de la crevette est absorbé par le poisson, lui-même par le héron, à son tour par l’air qui, enfin, disparaît dans l’univers, « vaisseau en mouvement ». La liste n’est pas close mais, si développée soit-elle, elle ne justifierait pas la lecture du recueil, la "poésie érotique" (ou prétendue telle) brodant sur quelques thèmes rebattus depuis fort longtemps. Ce sont donc d’autres caractères qui peuvent retenir le lecteur.
Tout d’abord, il peut reconnaître le bestiaire de Savitzkaya, qui définissait les animaux comme des « fragments de terre animés, les véritables esprits du monde, innombrables et la plupart du temps invisibles »1 ; ils sont présents, par leur nom (mouche, pie, hirondelle, lézard, carpe, canard, moustique faisan, merle, brebis, hulotte, etc.), par ce que leur nom suggère (bouc, tourterelle, coq, dauphin — qui porte la coquille de Vénus sortie des eaux), ou comme personnages d’un récit. Ainsi, les trois cochons (l’un mâle, un autre femelle, un troisième « ange porcin ») trouvent un remède à leurs différences : « [...] tout s’aboucha, s’imbriqua / s’emboita, s’adonna, sabota, samedi / quand tout apparut ». C’est ce travail sur le son et le sens qui importe et fait exister le thème choisi. Ici, le jeu de mots d’un premier vers, « Cybèle bêle », ferait sursauter si l’on ne s’apercevait pas que le poème est organisé à partir de la récurrence de la consonne /b/ ; là, tous les vers riment en /ue/, le dernier à l’écart (« demain ») ; ailleurs, un néologisme, cofourchons, suit la série enfourchée, cofourchée, califourchon. Ajoutons l’emploi des quasi homophones (nous deux / nés d’eux), des quasi anagrammes (ovule / olive), la reprise dans un long poème de la cellule (qui + verbe) chaque fois avec le refrain « à ma porte marbrée », les jeux sur la polysémie (matrice, terme d’anatomie et de typographie), la construction syntaxique symétrique (« Si elle me le demande [...] / Si je lui demande [...] ») suivie par la position asymétrique des corps. Ajoutons encore des figures féminines, comme celles inverses d’Eulalie, la sainte violée, et d’Astrée, nom de la constellation de la Vierge dans la mythologie.
Ces éléments, parmi d’autres, donnent leur sens au recueil mais, cependant, À la cyprine n’emporte pas l’adhésion comme, par exemple, Cochon farci. L’univers si particulier de Savitzkaya est bien là, y compris avec des souvenirs d’enfance comme cette vision de l’enfant dans le pré, monté sur un jars, vision reprise dans Fraudeur, avec son obsession aussi caractère éphémère des choses et des sentiments, du temps qui passe, dès les premiers poèmes (« Elle passe, elle passe / la jolie, la jolie vie »). Sans doute est-ce l’absence d’homogénéité de l’ensemble qui gêne ; un poème sur un restaurant bruxellois ou un autre sur une bière, parmi d’autres, détonnent dans un ensemble thématique par ailleurs bien conduit, mais dont on sait qu’il est habituellement mal reçu.
1. Eugène Savitzkaya, dans la revue Recueil, n° 20, décembre 1991.
Eugène Savitzkaya, À la cyprine, éditions de Minuit, 2015, 104 p., 11, 50 €.
Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 18 mai.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, À la cyprine, corps, amour, désir, animaux, végétaux | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2015
Samuel Beckett, Pour finir encore

Se voir
Endroit clos. Tout ce qu’il faut savoir pour dire est su. Il n’y a que ce qui est dit. À part ce qui est dit il n’y a rien. Ce qui se passe dans l’arène n’est pas dit. S’il fallait le savoir on le saurait. Ça n’intéresse pas. Ne pas l’imaginer. Temps usant de la terre en user à regret. Endroit fait d’une arène et d’une fosse. Entre les deux longeant celle-ci une piste. Endroit clos. Au-delà de la fosse il n’y a rien. On le sait puisqu’il faut le dire. Arène étendue noire. Des millions peuvent s’y tenir. Errants et immobiles. Sans jamais se voir ni s’entendre. Sans jamais se toucher. C’est tout ce qu’on sait. Profondeur de la fosse. Voir du bord tous les corps placés au fond. Les millions qui y sont encore. Ils paraissent six fois plus petits que nature. Fond divisé en zones . Zones noires et zones claires. Elles en occupent toute la largeur. Les zones restées claires sont carrées. Un corps moyen y tient à peine. Étendu en diagonale. Plus grand il doit se recroqueviller. On sait ainsi la largeur de la fosse. On la saurait sans cela. Des zones noires faire la somme. Des zones claires. Les premières l’emportent de loin. L’endroit est vieux déjà. La fosse est vieille. Au départ elle n’était que clarté. Que zones claires. Se touchant presque. Lisérées d’ombre à peine. La fosse semble en ligne droite. Puis réapparaît un corps déjà vu. Il s’agit donc d’une courbe fermée. Clarté très brillante des zones claires.
[...]
Samuel Beckett, Pour finir encore et autres foirades, éditions de Minuit, 1976, p. 51-52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, pour finir encore, se voir, arène, fosse, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
27/02/2015
Yves di Manno, une, traversée, photographies Anne Calas : recension
La collection "ligatures", proposée par les éditions isabelle sauvage à la fin de l’année 20141, porte magnifiquement son titre avec ce livre, tant le lien semble impossible à rompre entre les photographies d’Anne Calas et les vers d’Yves di Manno. Pourtant, malgré leur proximité, les deux voies ont chacune leur autonomie. Pour le poème, il se partage en quatre ensembles, dont un "envoi", tous consacrés à une femme dans une chambre ; on pourrait lire dans une la figure de l’aimée, l’unique, mais aussi par anagramme, nue ; pour traversée, le mot implique un parcours, ici celui du corps, de son image et de son invention. Pour les photographies, la femme nue est presque toujours présente, mais les six dernières images la sortent de la chambre.
La forme choisie par Yves di Manno se prête à la reprise sans cesse d’esquisses qui, progressivement, construisent un imaginaire de la femme. Chaque séquence, sur une page, compte entre quatre et huit cellules d’un ou deux vers, eux-mêmes entre deux et sept syllabes, et la régularité du compte de certaines séquences (par exemple, 4-4 / 4-3 / 3-3 / 2-4 / 3) donne à l’ensemble son unité. Ce qui apparaît d’emblée, c’est une présence auprès de la femme
elle n’est pas seule dans
l’obscurité du lit
présence qui ne devient un "je" que dans l’avant-dernier vers du poème :
les yeux posés sur moi
sans me voir
La vue (la lumière, l’image, le miroir, le regard, le reflet, etc.) est un motif récurrent. Le regard du "je" est d’un voyeur, attentif à ce que la féminité, la nudité qui s’abandonne évoquent : elles sont opposées à la meute, à la horde, et le "je" devient un nouvel Actéon devant le « chien de la déesse ». La femme est également figure de l’origine, associée à la glaise, à la louve devant la lune, à « la barque qui s’éloigne » ; ici, Vénus qui s’offre, plus loin, dans l’ensemble "corps 9" (que je lis « corps neuf »), « corps émergeant des eaux », elle se métamorphose en ondine, partout, « ôtant du jour la nuit qui la dépouille ». Enfin, l’image de l’oiseau qui semble lui faire don d’un insecte en fait une figure de la Nature et, donc, assure qu’elle renaît sans cesse, à la fois dans la lumière et dans la nuit, corps multiple : elle est toujours autre, « seule et nombreuse » — hiérophanie de la déesse originelle.
"Multiple", elle l’est d’une autre manière dans le second ensemble titré "la série monotype". Devenue image, « son dos pris » dans le cadre, elle appelle pour Yves di Manno le souvenir des nus de Degas, à la toilette ou étendus, elle le fait aussi songer aux figures de Lascaux parce que justement elle est première, origine, et il la voit « matière de nuit »2, encore et toujours nue et couverte d’un voile ou dans la brume. Elle est également corps comme écriture, corps à écrire, « : à la lisère // d’une page / que nul d’ici // là ne lira », et le lit, les draps sont comme une page où se construit un récit ; récit dont le motif est explicite dans une page (62) :
: une nuit simple :
: un corps :
abordant les
terres lointaines
après la
traversée
L’envoi est un envol, une sortie. La femme nue aurait été avant tout motif à variations sur le corps insaisissable, sur l’opacité (de la nuit, de l’ombre) et la transparence (de la vitre, de la buée), prétexte à allusions littéraires et mythologiques : celui qui regarde, apparemment sans être vu, ne sera pas regardé :
les yeux posés sur moi
sans me voir
— nue dès lors devant qui ?
Il faudrait examiner tous les mouvements minuscules qu’opère Yves di Manno dans la langue, qu’il glisse d’une voyelle à l’autre — dans « la suie, la soie des nuits » ou de "sigle" à "sangle"—, qu’il introduise des rimes internes, qu’il déroule les contextes de "lune" ou que la ponctuation mime ce qu’un mot annonce, comme dans le vers : « : reflet : » ; etc. Il ne s’agit pas de détails mais de ce qui contribue à construire l’unité du motif de la femme une, traversée par la langue.
Les photographies donnent à voir la nudité féminine comme on ne la regarde pas. Avec le jeu subtil avec les ombres et la lumière — une chambre aux stores baissés, une lampe de chevet — Ane Calas montre une forme inattendue, le grain de la peau, le mouvement d’un voile qui découvre et masque en même temps. Ici, c’est un visage qui regarde l’objectif, donc le lecteur, là, un tissu qui semble un rideau de théâtre, mais toujours le corps entier ou morcelé émeut d’être si nu devant ce voyeur qu’est l’appareil photographique. Et Anne Calas a imaginé, elle aussi, un envoi à la suite de celui d’Yves di Manno ; d’abord au milieu d’arbres face à l’objectif, le visage dans le flou, cette fois habillée, la femme disparaît dans la forêt.
Une belle réussite : le texte et l’image se répondent harmonieusement sans que l’un illustre l’autre ; on pense, mais dans un genre bien différent, à une autre réussite l’interprétation qu’avait donnée Lucien Clergue de Corps mémorable de Paul Éluard.
Yves di Manno, une, traversée, photographies d’Anne Calas, collection "ligatures", isabelle sauvage, 2014, 24 €.
Cette recension a été publiée dans Sitaudis
1 Voir ici une note à propos de Christiane Veschambre, Versailles Chantiers.
2 Une rencontre ? Le vers « matière de nuit » est aussi le titre d’un recueil de Lionel Ray, où l’on peut lire que l’évidence du soleil est opposée à « la légende oubliée des sources ».
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, une, traversée, photographies d’anne calas, corps, nudité, nuit, mythe | ![]() Facebook |
Facebook |
01/02/2015
Yves di Manno, une, traversée, photographies Anne Calas

Corps 9
devant les nuits (d’avant)
: signe tremblant, furtif
d’une femme inscrivant
une impensable geste
: son corps comme une lettre
réinventant le conte
la danse plus ancienne
de celles qui tissèrent
l’étoffe en d’autres temps
éblouie, déchirée
: la brume étirée
la rive et les
îles lointaines
*
: matière de nuit
gisant dans la
blancheur des draps
où les contours
du corps qui
parle sans elle
inscrivent leurs
strophes muettes
: à la lisière
d’une page
que nul d’ici
là ne lira
Yves di Manno, Une, traversée,
photographies Anne Calas,
isabelle sauvage, 2014, p. 73-74.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, une, traversée, photographies anne calas, nuit, corps, lit, page, lecturen | ![]() Facebook |
Facebook |
20/01/2015
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

EMILY B.
(Autour de « Wuthering Heights »)
Psaume I
Chair crayeuse
L’image évincée
De son corps d’enfant
Aux yeux creusés
Une morsure de dent sous la peau
Elle se débat puis voit le sang couler de son pied
Le saccage désormais en guise de destinée
Psaume II
J’attache une lanière au creux de mes reins
Je noie mes cheveux dans le sel ocre
Mes lèvres de givre embrassent l’herbe humide
Psaume III
Je passe l’après-midi à regarder la pluie tomber sur un mur de briques
J’offre mes entrailles à cris répétés
Vous aviez trahi, je l’ai compris.
À travers les maux gênants, la honte de rigueur et l’élan des gestes.
L’ondulation de votre chevelure noire, les tempes ensanglantées, une robe violette.
[...]
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Flammarion, 1997, p. 40-45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, pour emily, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2015
Constantin Cavafy, Poèmes

Désirs
Semblables à des corps superbes de morts qui n’ont point vieilli,
ensevelis, au milieu des pleurs, dans un splendide mausolée,
des roses à la tête et des jasmins aux pieds —
semblables à ces corps sont les désirs qui passèrent
sans être accomplis, et dont aucun ne parvint
à une nuit de volupté ou à son lumineux matin.
Les fenêtres
Dans ces chambres obscures, où je passe
des jours qui m’oppressent, je rôde de long en large
cherchant à trouver les fenêtres. — Lorsqu’il s’en ouvrira
une, ce me sera une consolation. —
Mais il n’y a point de fenêtres, ou c’est moi
qui ne puis les trouver. Peut-être en est-il mieux ainsi.
Peut-être la lumière ne serait que nouvelle tyrannie.
Qui sait quelles choses nouvelles elle ferait surgir…
Constantin Cavafy, Poèmes, traduits par Georges Papoutsakis,
Les Belles Lettres, 1977 (1ère édition, 1958), p. 25 et 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, poèmes, désir, corps, fenêtre | ![]() Facebook |
Facebook |
09/01/2015
Isabelle Garron, Corps fut, “Suite 4”

Suite n° 4
retour] .dernier bain de saison
premiers pas sur la terre
neuve dans les dédales
leurs peaux sont
brunes
les filles du port vont autant
qu'elles possèdent les yeux
plus noirs
que l'olive sur l'arbre
l'oursin au fond
du seau
Nos peaux s'apparentent à celles
des serveuses de leurs
époux
en cuisine, en bateau
aux comptoirs des
cabanes
un lieu d'où tu ne m'as point
écrit
en cette journée prolongée
quelque chose de séparé
de certain et d'inclassable
a enfin lieu de sorte
que la rive du voyage
se rapproche aussi
de la fin du voyage
que le temps est
court celui par
lequel l'oracle attendu
par un monde qui
nous abrite
et quelle joie nous
guette .si possible
en plein jour.
Londres : un après-midi : l'entaille
de la couleur sur le mur de droite
dans la grande salle une
suture violette comme un velours
sur la même surface fleurit un imprimé
tons orange et vert empreintes bleu
orage cernées de ciel clair
je tombe tu me retiens
[...]
Isabelle Garron, Corps fut, “Suite 4”,
Flammarion, 2011, p. 137-141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle garron, corps fut, “suite 4”, voyage, corps, londres | ![]() Facebook |
Facebook |
06/11/2014
Antonin Artaud, Œuvres complètes, I, L'art et la mort
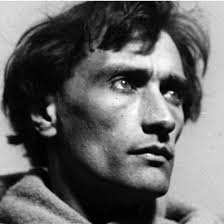
L'art et la mort
Qui, au sein de certaines angoisses, au haut de quelques rêves n'a connu la mort comme une sensation brisante et merveilleuse avec quoi rien ne se peut confondre dans l'ordre de l'esprit ? Il faut avoir connu cette aspirante montée de l'angoisse dont les ondes arrivent sur vous et vous gonflent comme mues par un insupportable soufflet. L'angoisse qui se rapproche et s'éloigne chaque fois plus grosse, chaque fois plus lourde et plus gorgée. C'est le corps lui-même parvenu à la limite de sa distension et de ses forces et qui doit quand même aller plus loin. C'est une sorte de ventouse posée sur l'âme, dont l'âcreté court comme un vitriol jusqu'aux bornes dernières du sensible. Et l'âme ne possède même pas la ressource de se briser. Car la distension elle-même est fausse. La mort ne se satisfait pas à si bon compte. Cette distension dans l'ordre physique est comme l'image renversée d'un rétrécissement qui doit occuper l'esprit sur toute l'étendue du corps vivant.
Antonin Artaud, Œuvres complètes, I, nouvelle édition revue et corrigée, Gallimard, 1976, p. 123.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, Œuvres complètes, i, lart et la mort, angoisse, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2014
Sappho, fragment 31, dans Yves Battistini, Lyra erotica

Mes yeux sont éblouis : il goûte le bonheur des dieux
cet homme qui, devant toi,
prend place, tout près de toi, captivé,
la douceur de ta voix
et le désir d'aimer qui passe dans ton rire. Ah ! c'est bien pour cela,
un spasme étreint mon cœur dans ma poitrine.
Car si je te regarde, même un instant, je ne puis
plus parler,
mais d'abord ma langue est brisée, voici qu'un feu
subtil, soudain, a couru en frissons sous ma peau.
Mes yeux ne me laissent plus voir, un sifflement
tournoie dans mes oreilles.
Une sueur glacée ruisselle sur mon corps, et je tremble,
tout entière possédée, et je suis
plus verte que l'herbe. D'une morte j'ai presque
l'apparence.
Mais il faut tout risquer...
Sappho, fragment 31, dans Yves Battistini, Lyra erotica, VIe siècle de notre ère-IXe siècle avant Jésus-Christ, Imprimerie nationale éditions, 1992, p. 263-264.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sappho, fragment 31, dans lyra erotica, corps, yeux, cœur, amant | ![]() Facebook |
Facebook |
10/09/2014
Jean-Louis Giovannoni, Les mots sont des vêtements endormis : recension

Les mots sont des vêtements endormis a été publié en 1983 par Jean-Pierre Sintive, cette réédition est augmentée de fragments qu'avait conservés le fondateur des éditions Unes, d'inédits et d'une postface de l'auteur : on y apprend notamment comment était né cet ensemble. D'autres livres anciens ont été repris (1), le manuscrit des Voyages à Saint-Maur, longtemps resté dans un tiroir, a été édité cette année (chez Champ Vallon), et le lecteur peut maintenant suivre le parcours de ce poète qui s'est efforcé de restituer ce qu'est « la stupeur et l'incompréhension de vivre », comme l'écrit François Heusbourg dans sa préface.
On pourrait lire bien des poèmes comme des aphorismes en les isolant, ainsi : « Nos mots ne sont que les préliminaires du silence », mais la concision ne vise pas à proposer une vérité et cet énoncé est lié à d'autres, tous se répondent et il n'y a rien de discontinu dans ce livre très homogène. La construction repose surtout sur la reprise de quelques motifs : le corps et sa difficulté à se situer dans l'espace. L'une des issues pour vivre son corps est de fuir dans le sommeil, et le rêve ; la relation du corps au réel est alors annulée, mais le réveil chaque fois rappelle la possibilité de la disparition définitive ; les mots qui, plus ou moins directement, évoquent la mort sont en effet abondants : chute, être emporté, se taire, s'effacer, mourir, sortie, absence, froid, silence, partir, vide, se tuer, etc.
Dans ce livre comme ceux qui suivent, le corps est un élément central, lié à l'absence, au vide («On s'agite parce que le vide nous entoure.) », et l'écriture tourne autour de ce qui apparaît énigme, la place du corps dans le monde des choses qui, lui, reste opaque et muet comme les pierres. Comme si le monde n'avait pas de présence suffisante, qu'il pouvait d'un seul coup s'annuler, d'où le sentiment que les choses autour de soi peuvent s'évanouir : « C'est terrifiant de penser que l'on peut emporter le monde, juste en fermant les yeux. » et, ailleurs, « Bouge un tant soit peu, / et c'est un monde qui s'efface. » Rien ne peut être dit du corps, comme s'il était inatteignable, comme le visage, ce que figure l'image du mur comme miroir, qui ne renvoie rien. Il semble toujours opaque au point qu'il est difficile de se reconnaître « dans les reflets des vitrines ». Corps sans forme, que seuls les vêtements protègent, comme un sac, et quand la mort vient il se vide, retournant à quelque chose d'innommable, d'indistinct ; les mots ne suffisent pas pour le faire vivre, seulement aptes à décrire l'effondrement, « Toujours au bord de l'effondrement. . Au bord. ». Visage qui n'est là que « pour ne pas effrayer les autres. Pour cacher le trou dans lequel on vit » ; le vide toujours présent, autour de soi et en soi : Giovannoni écrit sa fascination devant un tableau de Nicolas de Staël, Les toits, qui donne à voir « le bord du vide ». Que reste-t-il ? Une extrême difficulté à se situer dans l'espace du dehors, autant qu'à vivre le dedans, dans l'isolement, sans pouvoir faire un mouvement suffisant vers l'autre, « Les mots n'ouvrent pas assez ».
Au fil du temps Giovannoni a laissé la forme très brève des premiers textes, le travail de la langue s'est transformé, la prose alterne avec le poème, mais c'est toujours le corps et son espace qui demeurent au centre de tous les écrits et la certitude que l'« On vit toujours à côté ». Dans un texte récent, "Ce que l'immobile tient pour geste", poème écrit dans le livre consacré au peintre Pastor (Les apparitions de la matière, éditions Unes, 2013), est fortement marquée l'indécision quant à ce que peut être le moi : « On croit vivre toute sa vie avec soi-même / Alors que chacun de nos gestes / Est la demeure de ce qui ne peut être atteint. » C'est une indécision analogue que figurait le corps divisé ("Jean" et "Louis") dans S'emparer (2007). Est-il un lieu à trouver ? pour répondre on retourne au "peut-être" de Ce lieu que les pierres regardent : « Ce vide / que tu sens au fond de toi / peut-être / est-ce là / ton seul lieu ».
Jean-Louis Giovannoni, Les mots sont des vêtements endormis, éditions Unes, 2014.
______________________________
1. Dans Ce lieu que les pierres regardent, éditions Lettres vives, 2009.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, les mots sont des vêtements endormis, absence, vide, corps, espace, visage | ![]() Facebook |
Facebook |
24/08/2014
Jean-Louis Giovannoni, Les mots sont des vêtements endormis

Je me regarde sans cesse dans les reflets des vitrines, je me surveille. Toujours cette peur de me perdre.
On court, on s'agite, rien que pour faire croire que l'on connaît la sortie.
Sous ces traits, ce visage à jamais tourné vers lui-même que seuls les murs savent refléter.
Bouge un tant soit peu,
et c'est un monde qui s'efface.
Ce besoin de toujours traîner un corps dans ses rêves.
Tu regardes l'espace : tu penses aux oiseaux. Et lorsque tu t'agites ce ne sont que tes membres que tu agites.
Chaque matin, une force bestiale me pousse à revenir, à émerger.
C'est terrifiant de penser que l'on peut emporter le monde, juste en fermant les yeux.
Que veut-on tuer lorsqu'on se tue ?
Ce sont nos vêtements qui nous donnent corps — sans ça tout s'effondrerait.
Pourquoi faudrait-il qu'on soit sauvé et pas ce chat, ce cendrier... ?
Jean-Louis Giovannoni, Les mots sont des vêtements endormis, éditons Unes, 2014, p. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, les mots sont des vêtements endormis, corps, rêve, espace, perte, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
18/08/2014
Jacques Dupin, Chansons troglodytes, Gravir

Francis Bacon, Portrait of Jacques Dupin, 1990
Ta nuque, plus bas que la pierre,
Ton corps plus nu
Que cette table de granit…
Sans le tonnerre d’un seul de tes cils,
Serais-tu devenue la même
Lisse et insaisissable ennemie
Dans la poussière de la route
Et la mémoire du glacier ?
Amours anfractueuses, revenez,
Déchirez le corps clairvoyant.
Jacques Dupin, Gravir, Gallimard, 1963, p. 94.
Romance aveugle
Je me suis perdu dans le bois
dans la voix d’une étrangère
scabreuse et cassée comme si
une aiguille perçant la langue
habitait le cri perdu
coupe claire des images
musique en dessous déchirée
dans un emmêlement de sources
et de ronces tronçonnées
comme si j’étais sans voix
c’en est fait de la rivière
c’en est fini du sous-bois
les images sont recluses
sur le point de se détruire
avant de regagner sans hâte
la sauvagerie de la gorge
et les précipices du ciel
le caméléon nuptial
se détache de la question
c’en est fini de la rivière
c’en est fait de la chanson
l’écriture se désagrège
éclipse des feuilles d’angle
le rapt et le creusement
dont s’allège sur la langue
la profanation circulaire
d’un bond de bête blessée
la romance aveugle crie loin
que saisir d’elle à fleur de cendre
et dans l’approche de la peau
et qui le pourrait au bord
de l’horreur indifférenciée
[…]
Jacques Dupin, Chansons troglodytes, Fata Morgana, 1989, p. 21-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, chansons troglodytes, gravir, bacon, corps, mémoire, voix, chanson | ![]() Facebook |
Facebook |
22/07/2014
Eugène Savitzkaya, Sang de chien

J’aimerais tant mais je ne peux pas. Ma valise est prête, mes pieds chaussés. J’ai baissé les stores, mais je ne peux pas partir. Il faudrait qu’on me pousse. Si le chien jaune que j’entends hurler me mordait les talons peut-être ferais-je le premier pas et me précipiterais-je vers la sortie, et dehors je me sentirais mieux, plus vaillant. On m’a dit qu’il fallait toujours s’asseoir pendant quelques minutes avant un grand départ. Aussi me suis-je assis. À présent, je ne peux plus me lever. Des objets me retiennent et le monde m’effraie. J’ai mal au foie, j’ai mal à la tête, mes pieds ne supportent aucun soulier, je saigne du nez, j’ai l’impression que je pue, mes cheveux blessent mes yeux, j’ai sommeil mais je ne parviens pas à dormir, le soleil me fait peur lorsqu’il me touche, le feuillage dissimule des visages, des nez, des yeux, des doigts et des tireurs, il y a des animaux morts dans le jardin, des grives et des rats, un chat a démonté un pigeon, en a dispersé les plumes et déroulé les viscères, la cervelle est bleue et les os plus que blancs, quelle est la couleur du sang ? où est ma fiancée ? où aller ? quoi faire ? J’ai tué, j’ai blessé, j’ai chassé, j’ai balayé, j’ai mordu, tordu, limé, et je n’ai plus soif.
Pas besoin de lumière pour me raser. Dans l’obscurité, je me frotte au rasoir électrique qui bourdonne. Un petit rasoir suffit à ma barbe claire. Les vibrations du moteur plaisent à ma peau. Les objets lourds qui tombent sur le plancher ne résonnent pas dans ma poitrine. Pourrais-je encore escalader le frêne et me baigner dans le lac froid Enol ? Il n’y a que le vent qui me fasse encore du bien, ce même vent qui fronce la surface de l’eau et me dégoûte de la pêche au flotteur dans ce bras mort du fleuve.
Quand je regarde celui qui écrit, je me demande pourquoi sa tête est enfoncée dans la niche de son bureau. La main gauche de celui qui écrit est posée à plat sur sa cuisse gauche qu’elle lisse avec application. C’est la main la moins habile qui répète ce geste, la main qui a reçu le coup de tisonnier ou trop de baisers. Ce geste me rend nerveux : je suis obligé d’avaler ma salive et de changer plusieurs fois la position de mes jambes, de me mordre les doigts et de dissimuler mes larmes.
Quand ai-je pleuré pour la dernière fois en plein air ou enfermé, dans quelle maison dans quelle prairie, sur quel toit, nu ou en chemise, fatigué par le soleil ou à peine éveillé, seul ou en compagnie, sur la montagne pointue ou sur la mer plate ? Et l’avant-dernière fois ? Juste un spasme, une contraction du menton et pas de larmes, à peine comme une brève transpiration. Et avant ? Je devais être saoul, ça ne compte pas. Et avant ? Enragé, devant la mer. Et avant ? Encore de rage, sang de chien, ça ne compte pas. Et avant ? En regardant mon jardin sous le soleil, les hautes tiges des asperges, les plumes, le feuillage épuisé, la glycine en bout de course. Et avant, avant ? À peine un désir, mais les larmes ne se commandent pas. Et le dernier bonheur, où, avec qui, à l’aide de quels outils ? [...]
Eugène Savitzkaya, Sang de chien, éditions de Minuit, 1988, p. 8-10.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, sang de chien, partir, corps, lumière, vent, main, pleurer | ![]() Facebook |
Facebook |
15/07/2014
Valérie-Catherine Richez, Précipités

J'étais perchée sur ce miroir zébré de griffures. L'endroit où les blessures remontent à la surface. Sous l'eau miroitantes je voyais tournoyer les poissons carnassiers. Je me souvenais d'eux. Le les appelais par leurs noms. Dents acérées. Rien ne pourrait nous consoler. À certaines heures on aurait voulu tout renier. On se roulait sur le sol jusqu'à peser des pierres. Jusqu'à chuter.
Chaque nuit on jette un corps.
Bancs de lueurs flottantes passant comme des nuées dans la mer, glissant sans bruit sur nos paupières — Peut-être ne devrions-nous jamais parler que de cette nuit où nous marchons, jusqu'à la vider entièrement de son sens. Jusqu'au silence. Prendre si souvent chaque avenue, chaque rue, chaque ruelle, qu'on sache les parcourir les yeux fermés. Et chaque fois nous-mêmes, courants d'air comme usés, épuisées, incréés.
Quelqu'un qu'on ne verra jamais.
Valérie-Catherine Richez, Précipités, éditions isabelle sauvage, 2014, p. 5-6.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie-catherine richez, précipités, miroir, eau, corps, mer, chemin | ![]() Facebook |
Facebook |





