29/05/2016
Alberto Giacometti, Écrits

Enfant, j’avais plutôt l’envie d’illustrer des histoires. Et puis, assez vite, j’ai commencé à dessiner d’après nature, et j’avais l’impression que je dominais tellement mon affaire que je faisais exactement ce que je voulais. J’étais d’une prétention, à dix ans… Je m’admirais, j’avais l’impression de pouvoir tout faire, avec ce moyen formidable : le dessin ; que je pouvais dessiner n’importe quoi, que je voyais clair comme personne. Et j’avais commencé à faire de la sculpture vers 14 ans, un petit buste. Et là aussi cela marchait ! J’avais l’impression qu’entre ma vision et la possibilité de faire, il n’y avait aucune difficulté. Je dominai ma vision, c’était le paradis et cela a duré jusque vers 18-19 ans, où j’ai eu l’impression que je ne savais plus rien faire du tout ! Cela s’est dégradé peu à peu… La réalité me fuyait. Avant je croyais voit très clairement les choses, une espèce d’intimité avec le tout, avec l’univers.. Et puis tout d’un coup, il devient étranger. Vous êtes vous et il y a l’univers dehors, qui devient très exactement obscur… J’essayais de faire mon portrait d’après nature, et j’étais conscient que ce que je voyais, il était totalement impossible de le mettre sur une toile. Laligne — je me rappelle très bien — la ligne qui va de l’oreille au menton, j’ai compris que jamais je ne pourrais copier cela tel que je le vyais, que c’était du domaine pour moi de l’impossibilité absolue. S’acharner dessus, c’ »était absurde, c’en était fini à tout jamais de toute possibilité de copier, même très sommairement, ce que je voyais.
Alberto Giacometti, Écrits, Hermann, 1990, p. 261.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alberto giacometti, écrits, enfance, don, dessin, sculpture, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2016
Jean Ristat, Artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup

La chasse au loup
À cette heure incertaine où l’obscur dispute
Au jour son royaume la déesse repue
Rappelle ses valets avant que de céder
Au sommeil tous les oiseaux se sont tus et les
Pâles enfants des hommes tremblent dans leurs draps blancs
Lorsqu’un rêve très ancien vient les visiter
À la vitre étoilée de la chambre l’ombre
Bleue de la bête qui regarde et attend
*
À l’enclume de la nuit apollon martèle
La lune vieille casserole cabossée
Et blanchie aux feux ronflants de l’empire des
Morts voici l’heure des métamorphoses et des
Enchantements Ô théâtre où tout s’échange et
Se déplie les mots comme fleurs de papier
[...]
Jean Ristat, Artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup,
Gallimard, 2007, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, artémis chasse à courre le sanglier, le cerf et le loup, sommeil, rêve, enfance, apollon | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2016
Cesare Pavese, Le métier de vivre

Un homme qui souffre, on le traite comme un ivrogne. « Allons, allons, ça sffit, secoue-toi, allons, ça suffit... »
Quand un jeune homme — dix-huit, vingt ans — s’arrête pour contempler son tumulte, tente de saisir la réalité et serre les poings, c’est beau. Mais il est moins beau de le faire à trente ans, comme si rien n’était arrivé. Et cela ne te fait pas froid dans le dos de penser que tu le feras à quarante ans et puis encore ?
Avec les enfants, on ne plaisante pas , ma chère. J’ai été un enfant moi aussi (premier mois).
Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 81, 83, 89.
Publié sur Sitaudis (http://www.sitaudis.fr) le 6 avril 2016 :
NUIT DEBOUT, C'EST MAINTENANT
J'étais place de la République samedi et dimanche dernier - les 32 et 33 mars, donc, selon le calendrier en vigueur sur la place et pour ceux qui souhaitent que les temps changent. Je ne suis pas jeune, et bien évidemment, je n'ai jamais vu ça.
Il est tout à fait possible que quelque chose d'approchant se soit passé en 68, par exemple. Sauf qu'en 68, il n'y avait pas les Sans-Papiers, il n'y avait pas les Rroms et les réfugiés dans les rues de Paris, il n'y avait pas les plans « sociaux » ni la fin envisagée des services publics. L'enjeu était qu'ouvriers et étudiants se rejoignent - pas qu'ouvriers, précaires, chômeurs, intermittents, étudiants, lycéens, émigrés de la deuxième, troisième génération, professeurs, infirmiers et médecins des hôpitaux, magistrats, lesbiennes, gays, be et trans, etc, fassent la jonction, de sorte que leurs luttent convergent enfin.
Il est tout à fait possible aussi que quelque chose d'approchant ait eu lieu à Madrid, Puerta del Sol, en 2011. Mais ce qui me fait penser cela, au fond, c'est juste la présence d'un jeune Espagnol samedi 32, assis en cercle, par terre, avec les autres, à discuter longuement de la pertinence, ou non, de compter les abstentions lors des votes. Les discussions auxquelles j'ai assisté (et participé) étaient en effet plutôt « techniques ».
La raison pour laquelle je publie ce compte-rendu sur sitaudis plutôt qu'ailleurs, c'est qu'il était tout le temps question de vocabulaire ; du choix des mots, de la forme des phrases, de leurs conséquences. Qu'on écartait systématiquement les noms propres (rares à venir, d'ailleurs - ni Debord, ni Deleuze, ni Badiou, ni Agamben ou autres au programme, par exemple) et les grands mots (à l'un qui disait Communisme et à l'autre qui disait Commune, on signifia gentiment de reporter le débat sur leur usage à une date ultérieure).
Pourtant, la plupart des participants à ces commissions ne semblaient pas des novices en terme de politique, d'histoire, et des discours qui se sont historiquement tenus. Simplement, le moment de fixer quelque chose d'une situation en mouvement constant était sans cesse repoussé, de manière à ce qu'il advienne le plus tard possible - voire pas.
Ne pas être ramené à un parti, à une cause, à une revendication, à un « bord politique » quel qu'il soit et aussi amical soit-il, a été en effet énoncé clairement, et répété, par Nuit Debout. Là-dessus - sur quelque chose qui ne cherche pas à être identifié et n'est pas identifiable, réductible -, divers impétrants sont venus, et viennent, régulièrement se casser les dents, laissant flotter au-dessus de la place et se poser dans les gazettes et les sites des phrases bienveillantes et définitives. Ils sont tous à côté de la plaque. Ce n'est pas vraiment drôle. Juste curieux, de voir le vieux monde passer sans rien saisir d'une chose qui, peut-être, tombera demain, mais qui ne se sera jamais fait prendre - du moins l'espère-t-on.
Les photos prises et qui paraissent pourraient nous faire croire qu'il y a là essentiellement des jeunes, étudiants et lycéens parisiens. C'est faux. Il y a des salariés, des chômeurs, des retraités, etc, de tous les sexes et tous les âges. Il y a peut-être encore trop peu de secouristes, de juristes, d'avocats, de militaires et de policiers ayant changé de camp ou désireux d'en changer. Il n'est jamais trop tard. Les employés des commerces de la place peuvent aussi venir, après le boulot. Celles et ceux qui vivent en banlieue et qui ne sont pas encore arrivé.e.s. Vous qui lisez ce texte, allez-y aussi : ce sera une action poétique.
Le commentaire de sitaudis.fr
L'auteur ne signe pas son texte, non par peur mais par respect pour le mouvement en cours.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, souffrance, réalité, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
31/12/2015
Tiphaine Samoyault, La main négative, Louise Bourgeois

On n’écrit pas directement avec la main, sauf dans le sable, sauf après l’avoir préalablement trempée dans son sang. Pourtant on fait beaucoup de choses directement avec les mains : manger, boire, se moucher, creuser un trou dans la terre. Vivre et finir de vivre.
Je voudrais être un âne qui n’a pas de mains et n’a donc pas besoin de s’occuper les mains. Je pourrais aussi être un être sans mains. Alors je me plaindrais de n’avoir pas de mains et de ne pas pouvoir faire tout ce qu’on peut faire avec des mains. Mais j’ai des mains et je ne sais pas quoi faire avec elles. Alors j’écris pour m’occuper les mains. L’écriture me prend par la main et me maintient en enfance. Elle m’aide à traverser la rue, à monter les escaliers plus vite, à ne pas me sentir abandonnée. Joindre les mains occupe les mains, mais on ne peut pas écrire les mains jointes. On ne peut pas à la fois écrire et prier, écrire les yeux fermés.
Tiphaine Samoyault, La main négative, Louise Bourgeois, Argol, 2008, p. 37-38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tiphaine samoyault, la main négative, louise bourgeois, écriture, enfance, viver | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2015
Édith Azam, Vous l'appellerez : Rivière

Elle regarde à nouveau le moulin, pense qu’il a encore vieilli, qu’elle ne lui connaît pas d’enfance, qu’il perd ses osselets en inventant des mots qui ne s’oublient jamais, qu’elle a mille ans d’absence sur tous les dictionnaires, que la vie n’est qu’un tour de passe-passe, que ses yeux s’habituent à la nuit, que dans ses mains à lui, même affaiblies, la lumière sera : toujours belle.
Rivière
ils ont bien vu
oui
en retrouvant le sol
qu’elle pouvait
se glisser
partout
qu’elle était
pour la terre
la source :
le langage
Édith Azam, Vous l’appellerez : Rivière, La Dragonne, 2013, p. 74.
©Photo Chantal Tanet.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, vous l’appellerez : rivière, regard, enfance, mot, absence, nuit, lumière, langage | ![]() Facebook |
Facebook |
13/07/2015
Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado

C’est quoi l’art pas brut ?
Les marchands nomment nos œuvres. Refusons. Il y a un clivage effarant en Europe entre art brut et art (art quoi d’ailleurs ?) Or le désir sait que la question n’est pas là mais juste où vivre. Là où nos disions bander pour dire être, bander de toute son âme dont le sexe et l’étoile.
Maimoune m’a raconté quelque chose de ces choses-là.
Le décoffrage de l’imagination d’une vieille mémoire.
L’instant pérenne, l’oxymoron de vivre quand on est un idiot.
Un artiste ? une définition. J’étais berger, maçon, dit Maimoune, à présent je me définis comme artiste. Un idiot, dis-je.
Remplaçons artiste par poète, arts contemporains par arts poétiques. En gros retirons l’argent de l’affaire. Pour voir. Juste pour voir que s’attarde l’homme de Ouarzazate ou d’Arles ou de Messine, en prise aux songes parmi son peuple de ventres affamés, de signes et d’enfances, avec son bestiaire : avec son désir. Alors l’artisan perd le nom de faire, c’est un artiste, un inutile, un miracle de la société, un frère.
L’attardé là.
Alors jubile quelque chose, une chose, et l’homme troue la chose pour qu’infiniment s’invite le monde.
Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado, Centrte international de poésie, Marseille, 2014, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, canto rodado, art brut, art poétique, artisan, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
12/07/2015
Claude Chambard, Cet être devant soi
Enfant quand ai-je jamais fait mon ultime pas d’enfant... ma belle écriture pleine & déliée... ma gracieuse silhouette dans le jardin en fleurs... la vraie lumière sur mes joues rondes & roses... quand ai-je cessé de cracher les noyaux de cerise au pied de l’arbre... quand ai-je osé regarder une fille dans les yeux... quand ai-je perdu mes boucles blondes... quand... L’écriture a pris le dessus mais n’a jamais pu remplacer les jouets de l’enfance, le motif dans le tapis scruté pendant des heures, tissé & retissé jusqu’à l’usure du regard. De la neige, du givre, voilà ce qui a tenté de recouvrir l’enfance, en vain, je sais produire un feu interminable & puissant. Dans la grange je me balance sans fin. Le chat se faufile entre la forge & l’établi, m’ignore. J’ai cueilli les petits pois ce matin avec Grandpère, silencieux nous les écossons, dimanche nous les dégusterons avec une viande blanche. C’est là, ce jour-là sans doute, que j’ai compris que pour écrire il fallait soutenir l’autre, le regarder, l’empêcher de tomber. L’autre, cet être devant soi.
Claude Chambard, Cet être devant soi, encres de Anne-Flore Labrunie, Æncrages & C°, 2012, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, cet être deavnt soi, enfance, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2015
Alain Veinstein, Dix pas avant les ruines

[...]
Pour commencer, je tourne le dos au passé, à l’enfance où il y a la mort...
Hors de ses jambes, pour que la phrase ne se referme pas...
Ce n’est pas le dernier jour... Au début, il faut écrire sans amour...
Pas question de décrire les lieux, les personnages... Pas trace d’affaire d’homme... Je refuse l’aide d’une description de la terre... Je ne tire pas profit d’une scène... d’un concours de circonstances qui m’aurait permis de franchir un grand pas... D’un trait de plume, j’écarte les événements : personne, rien... Je ne m’appuie sur personne et sur rien...
De la précarité, je fais un théâtre... Enfance encore... Difficile de s’arracher ces lambeaux d’enfance... Et cette haine qui me tient... Face au personnage féminin, je puise dans la haine mon désir de l’ouvrir... Je rêve de mise à nu, de sang... Ce n’est pas une violence mauvaise... C’est mon amour, de très loin, hors de portée des lèvres... Je dis mon amour, étourdi encore, désarmé par le bruit d’un pas... Désarmé comme par le fracas, plus haut, de la caisse... J’ai fait un pas et, à chaque pas, s’enfonce une dernière demeure.
J’ai fait un pas et rêve d’un autre pas comme au début de la vie... Presque la force d’écrire à bout portant...
Je parle du premier pas à partir de la mort... Un temps lointain... Quelques arpents de terre où j’aurais trouvé ma nourriture... Toute une histoire... Je me souviens de quelques pas perdus... Et de la peur, rencontrée à chaque coin de phrase...
[...]
Alain Veinstein, Dix pas avant les ruines, dans L’introduction de la pelle, Seuil, 2014, p. 357-359.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, dix pas avant les ruines, enfance, écrire, peur, récit, personnage | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2015
Ossip Mandelstam, Le bruit du temps, traduction Jean-Caude Schneider

Le chaos judaïque
Un jour, il arriva chez nous une personne qui nous était parfaitement étrangère, une jeune fille d’une quarantaine d’années, avec un petit chapeau rouge, un manteau pointu et de méchants yeux noirs. Prétextant qu’elle était originaire de la bourgade de Chavli, elle exigeait qu’on la mariât à Pétersbourg. Avant que nous ayons réussi à nous en débarrasser, elle avait passé une semaine à la maison. Parfois, des auteurs ambulants faisaient leur apparition ; c’étaient des gens barbus et aux longs vêtements, des philosophes talmudiques, des colporteurs de maximes et aphorismes de leur fabrication. Ils laissaient des exemplaires dédicacés et se plaignaient d’être persécutés par de méchantes épouses. Une ou deux fois dans ma vie, on me conduisit à la synagogue, comme s’il s’agissait d’un concert, après de longs préparatifs, c’est tout juste si l’on n’achetait pas un billet à un revendeur ; et ce que je voyais et entendais me faisait revenir dans une lourde hébétude. Il y a, à Pétersbourg, un quartier juif : il commence juste derrière le théâtre Marie, là où gèlent les revendeurs de billets, derrière l’angle de la prison de Lithuanie, qui a brûlé pendant la révolution. Là, dans les rues du Commerce, on rencontre des enseignes juives, avec un bœuf et une vache, des femmes avec des cheveux postiches qui s’échappent de leur fichu et des vieillards plein d’expérience et d’amour pour les enfants, trottinant dans leur redingote tombant jusqu’à terre. La synagogue, avec ses chapeaux pointus et ses bulbes, comme un somptueux figuier étranger, se perd au milieu de pauvres bâtisses.
[...]
Ossip Mandelstam, Le bruit du temps, traduit du russe et annoté par Édith Scherrer, préface de Nikita Struve, Christian Bourgois, 2006 [L’Âge d’homme, 1972], p. 47-48.
Le chaos judaïque
Un jour, une personne totalement inconnue s’est présentée chez nous, une jeune fille d’environ quarante ans à chapeau rouge, au menton pointu, l’œil noir et mauvais. prétextant être originaire du bourg de Chavli, elle exigeait qu’on lui trouve un mari à Péterbourg. Elle resta une semaine à la maison jusqu’à ce qu’on réussisse à s’en débarrasser. De temps à autre des écrivains itinérants s’arrêtaient chez nous : personnages barbus, à longues basques, philosophes talmudistes, colporteurs d’aphorismes et apophtegmes imprimés et rédigés par eux-mêmes. Ils laissaient en partant des exemplaires dédicacés et se plaignaient d’être persécutés par de mauvaises femmes. Une fois ou deux dans ma vie on m’emmena à la synagogue, non sans de longs préparatifs, comme pour un concert, tout juste si l’on n’avait pas acheté un billet chez des revendeurs ; après ce que j’y ai vu et entendu, j’en suis revenu l’esprit péniblement enfumé. Pétersbourg a un quartier juif : il commence juste derrière le théâtre Marinski, là où les revendeurs de billets gèlent devant l’ange du château de Lituanie, la prison incendiée lors de la révolution. Là, dans les deux rues du Commerce, on tombe sur des enseignes juives, avec taureau et vache, sur des femmes dont les fichus laissent échapper des cheveux postiches, et sur des vieillards pleins d’expérience, affectueux avec les enfants, et qui trottinent dans leur redingote traînant jusqu’à terre. La synagogue, avec ses chapeaux coniques et ses coupoles en bulbe, son air d’exotique et fastueux figuier, s’était égarée entre de misérables bâtisses.
[...]
Ossip Mandelstam, Le bruit du temps, traduit et présenté par Jean-Claude Schneider, éditions Le bruit du temps, 2012, p. 45-46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, le bruit du temps, traduction jean-caude schneider, juif, pérzesbourg, synagogue, enfance, mariage | ![]() Facebook |
Facebook |
10/03/2015
Isabelle Garron, Corps fut

Variations 2
[...]
là. enfant .tu évoques l'épreuve d’un texte
aux confins d’une île. ici l’empreinte
d’origine ses contours traduits
dans la neige
la fatigue de l’image .d’une femme
sa condition .et le ventre
les soubresauts et les
expectorations
lire noté à maintes reprises
je ne raconterai point
j’écrirai
sous une nuit l’attente fêlée
d’une voix dans la ruelle
en contrebas
les nuages dans la vallée
la crainte aussi
d’un retour du froid
Isabelle Garron, Corps fut, Flammarion,
2011, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle garron, corps fut, enfance, origine, femme, lire, écrire, voix, froid | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2015
Andrea Zanzotto, Idiome, traduction Philippe Di Meo
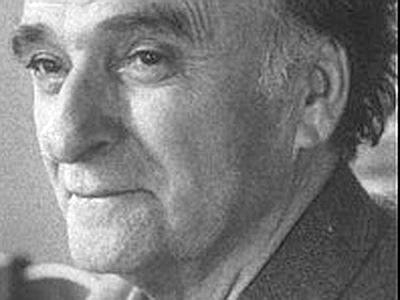
Petits métiers
Comment puis-je oser
vous appeler ici, vous faire signe de la main.
Une main qui n'est plus que son ombre
avare et mesquine,
et d’ailleurs une serre, mais tendre comme de la mie de pain.
Et pourtant, quelque chose maintenant la soutient,
je ne sais s’il s’agit d’une crampe ou d’une force :
pour autant qu’elle vaille, elle est toute vôtre,
vous lui donnez-lui la force de vous appeler.
Donnez-lui une plume qui ne se torde,
faites que sa pointe ne trébuche sur la feuille.
Il me semble n’avoir rien à écrire
pour commencer ce télex
qui doit tout le néant traverser
(la brûlante difficulté
qui brûle comme soufre,
qui corrode, étourdit.)
Mais j’essaierai de suivre la trace, au moins, d’un amour —
en dehors, là dans l’obscurité
profonde des prés du passé.
Ainsi
.....................................
[ ]
Ainsi sous la cheminée presque éteinte,
si un garçonnet regardait
à travers cette minuscule petite fenêtre aveugle
vers le soir encore claire
parmi la suie
(ah quel beau bleu, quel argent,
quels frissons d’hiver éblouissants
de neige et de lumière à cette petite fenêtre) :
qui passait donc, qui frappait
sur cette vitre, et disparaissait
je ne sais si boitant ou dansant ;
grands-mères, était-ce eux tous, les gens de votre temps
avec leur faim de chicorées, avec leur soif
de piquette, avec des travaux qui
leur avaient tordu toute la figure
jusqu’à presque en modifier la nature ?
Mais avec moi, garçonnet, quels joyeux lurons
et que de bonne humeur, et toujours bons...
Et je les vois, me semble-t-il, faire turlututu
cligner de l’œil dans ma direction, rire subtilement, puis me dire salut...
Andrea Zanzotto, Idiome, traduit de l’italien, du dialecte haut-trévisan et présenté par Philippe Di Meo, Corti, 2006, p. 145, 147 et 149.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idiome, traduction philippe di meo, petits métiers, passé, amour, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2014
Erich Fried, Les enfants et les fous

Saint Georges et son dragon
On raconte que saint Georges vint de Cappadoce et qu’il tua un dragon qui voulait dévorer une jolie fille. La légende aime les données simples et les héros compréhensibles. On ne rapporte nulle part que saint Georges a aimé le dragon.
Il connaissait son dragon depuis l’enfance, à un âge où les vires et les voltes du tournoi, sous les arbres à l’écorce rugueuse ou tapissée de mousse, étaient plus importantes pour lui que toutes les méditations sur la beauté ou la disgrâce, sur l’excellence ou la médiocrité de son compagnon de jeu. Plus tard également, lorsque le petit Georges, qui portait alors sa première armure légère, commença à comprendre que son ami était différent de lui, il repoussa aussitôt de telles pensées. Il les oublia, comme il oubliait les tristes rangées de chiffres alignées par son sévère maître en calcul. Non, il ne voulait tenir compte d’aucune différence. Il s’en tenait plutôt à ce que lui et son camarade de jeu avaient pensé en commun. Tous deux étaient vifs et agiles, habiles à la lutte — chacun à sa manière — et tous deux aimaient l’herbe piétinée et, roussis par le feu craché, les vieux tilleuls sous lesquels le camarade de Georges avait élu domicile. Parfois même Georges croyait reconnaître dans l’étrange matière qui recouvrait le corps de l’autre une cuirasse d’écailles semblable à celle qu’il portait par amour pour l’ami, se disait-il ; la cuirasse le rendait plus dur, plus semblable à l’autre.
Erich Fried, Les enfants et les fous, « Saint Georges et son dragon », traduit de l’allemand par Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1968.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, les enfants et les fous, saint-georges, dragon, enfance, combat, monstre, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2014
Marina Tsvétaeva, Le diable et autres récits

Ma mère et la musique
Lorsqu'au lieu d'Alexandre, le fils désiré, réclamé, presque commandé au destin, vint au monde une fille, moi, rien que moi, ma mère avala un soupir avec dignité et dit : « Du moins, elle sera musicienne ». Et lorsque le premier mot manifestement absurde mais tout à fait distinct que je prononçais avant d'avoir un an fut "gamme", ma mère se contenta de réaffirmer : « je le savais bien » et entreprit aussitôt de m'apprendre la musique, me clamant sans cesse cette gamme : « Do, Moussia, et ça c'est ré, do-ré... ». Ce do-ré se transforma bientôt pour moi en un livre énorme, la moitié de ma propre taille, un "rivre" comme je disais alors, son "rivre" à elle, avec un couvercle sous le mauve duquel l'or perçait avec une force si effroyable, que jusqu'à présent j'en ressens en un coin secret, le coin d'ondine de mon cœur, la chaleur et l'effroi, comme si, ayant fondu, cet or sombre se fut déposé tout au fond de mon cœur et que de là, il s'élevât au moindre contact pour m'inonder tout entière jusqu'au bord des paupières et m'arracher des larmes brûlantes.
Marina Tsvétaeva, Le diable et autres récits, traduction et postface de Véronique Lossky, L'âge d'homme, 1979, p. 65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaeva, le diable et autres récits, mère, musique, enfance, gamme | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2014
James Sacré, Le désir échappe à mon poème

Petite note sur le désir d'écrire
[...]
Lecteur qui m'avait pas prévu.
Écrire comme on drague. L'écriture comme une rencontre. Les mots que me tend l'autre toujours : avec sa joue qu'il m'abandonne sans me connaître ; dictionnaire et sa couverture de carton rose dans l'enfance j'y faisais des trous en y découpant des figures d'animaux jamais vus : oui, et depuis, le zorille et l'agouti me mangent le cul en caressant mon cœur. Lecteur que j'avais pas prévu.
*
J'ai envie d'écrire. "Ça te prend-y pas comme une envie d'chier ?" dirait mon père. Ou Rabelais : rondeau en chiant. C'est pas la peine de chercher un ange, on n'en voit jamais.
James Sacré, Le désir échappe à mon poème, dessins de Mohamed Kacimi, Al Manar, 2009, p. 10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le désir échappe à mon poème, le désir d'écrire, dictionnaire, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2014
Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute : recension
La vie moins une minute (vers d'un des poèmes) s'ouvre par une allusion au conte de Perrault, Barbe Bleue : c'est l'annonce de deux récits, vite mis en place et que l'on suit dans les trois parties du livre, celui d'une enfance dans une famille, celui d'une histoire amoureuse. Les deux récits, source d'autres histoires esquissées et presque aussitôt interrompues, s'entrecroisent, l'un appelant l'autre, au point qu'on ne peut toujours démêler les fils tant des éléments de l'un sont enchâssés dans l'autre.
Le conte de Barbe Bleue réapparaît de manière allusive avec l'introduction du placard, celui qui ne doit pas être ouvert, mais, parodie, si la narratrice pousse une porte, contrairement à l'épouse curieuse du conte, elle précise : « Avant de sortir, j'ai veillé à tout remettre en ordre ». Le conte est encore présent, avec insistance, par le rappel du contrat : « C'est un contrat, et si on le rompt on ne lèse que soi » ; et la contrainte, édictée ici par la narratrice, devient dans le couple une condition de son équilibre, et même de son existence : « Tu accepteras mes mystères et j'accepterai les tiens », la règle pouvant d'ailleurs être jouée: « je te dis rien, je te dis tout ». Le conte est également présent dans le récit de l'enfance, puisqu' « on invente des histoires pour les derniers petits », et c'est l'enfant qui réclame la suite de l'histoire avec son insatiable « et après ? ». La demande d'une suite de l'histoire se dit, peut se dire ailleurs, partout identique expression du désir de savoir : « What happens next ? » ; mais la formule "et après", reprise dans un autre contexte, signifie alors "qu'est-ce que ça fait ?", non plus tentative de se satisfaire mais mots de la désillusion. Enfin, le conte entre dans le récit amoureux avec le "Il était une fois", qui associe dans un poème Valentine et Sade ; dérision peut-être de la saint Valentin, et le divin marquis se trouve à l'aise puisqu'il est question de sodomie et de femmes dans les égouts.
Les éléments de récits, dispersés, seraient à associer par le lecteur, sans à vrai dire qu'il puisse reconstituer une histoire cohérente ; c'est heureux, nous ne sommes pas dans la représentation et il suffit de repérer des bribes, depuis les lieux communs revisités, attachés aux discours sur l'enfant — bébé a peur et a faim, mon enfant ne mange pas (« il faut manger si on ne veut pas finir crevée ») —, jusqu'à la présence de « maman », la découverte de la manière dont sont conçus les enfants, la passage de l'état de petite fille à l'adolescence et à l'amour. Rien de linéaire : si la narratrice semble revenir sur une enfance dans la seconde partie (titrée "Looping", donc suggérant un retour, un renversement de perspective) : « j'ai été cette petite fille solitaire », la dernière partie retourne à l'enfance, d'où vient le titre du livre : « l'enfant bascule, tête en avant / plus rien dire sinon la chute / la vie moins une minute ».
La sortie de l'enfance, c'est la rencontre de l'amour ? Sans doute mais, pas plus que ceux relatifs à l'enfance, les fragments d'une histoire amoureuse ne se prêtent à une reconstruction linéaire, ne serait-ce qu'à cause de la difficulté de passer, d'un poème à l'autre, d'un narrateur féminin à un narrateur masculin. Mais c'est surtout qu'aucun récit amoureux ne peut trouver un ordre sans réponses aux questions posées à la fin de la première partie : « Comment faire pour vivre ? [...] Comment faire pour vivre à deux ? » et « Comment (re)devenir 1 femme ». Il y aura donc l'amour réalisé (« j'ai fait tomber ma pudeur aux oubliettes »), les « amours déchues », l'amour-toujours, les étreintes (« prends-moi dans tes draps ») dont on ne peut dire qu'elles ne sont que corps en mouvement : « claquements et rythmes / éphémères et pourtant » ; il y a aussi le passage de « l'amour : un » à « maintenant il est deux » (p. 69), et l'ironique « belle comme un os à moelle ». Tout cela, brisé, elliptique, avec retours et contradictions, restitue quelque chose de la "vraie" vie, bien mieux qu'un récit ordonné.
Au désordre, aux croisements et superpositions des récits, il faut ajouter d'autres fils, par exemple celui des lectures qui s'introduisent dans les vers. On reconnaîtra par exemple le cimetière marin — associé aux vagues et aux varechs — ou Hawthorne avec la maison aux sept pignons, ou Liszt avec la rhapsodie en do, etc. On lira aussi, dans le poème qui ouvre la seconde partie, une manière d'hommage à Rimbaud : ici, le titre "Dingo" et le vers « Je commençai par les hallucinations olfactives », évoquent « L'histoire d'une de mes folies » et « Je m'habituai à l'hallucination simple » de "Alchimie du verbe". Autre rencontre ? On se souvient que, dans "Après le déluge", on lit « le sang coula, chez Barbe Bleue ». Une autre relation, celle-là constante, est celle à Lewis Carroll ; Marie de Quatrebarbes retrouve la grâce des énoncés nonsensiques, en faisant se succéder des vers que le lecteur ne peut assembler pour construire un sens, comme « si monsieur Smith voulait bien me la faire / du savon noir pour récurer » ; on verra là aussi une manière de poser la question du vers, mais laissons ce problème de côté. Nombreux aussi les énoncés dans lesquels s'introduit un vers qui rompt la lecture : « des plaisirs immédiats / elle joue son ombre / sont ceux de la chair et c'est tout /» (souligné par moi). D'autres ruptures contribuent à détruire, ou gêner, le rassemblement des bribes de récit, ce sont les jeux de mots de toutes sortes trop nombreux pour qu'on les rassemble ; jeu sur l'homophonie (« l'anneau se ressert autour du doigt », passage de "de ses seins" à dessin"), l'inversion (« fait des claques et des têtes à bulles »), la polysémie, y compris en anglais (« sheath », signifiant "préservatif" et "vagin"), la variation sonore (« ça décapite .../ ça décapote ... / çadécapsule »), etc.
Que conclure d'une lecture réjouissante ? La vie moins une minute confirme la maîtrise de la langue, le souci de construction d'un ensemble, le goût du récit et l'humour que l'on reconnaissait dans les livres précédents (1) de Marie de Quatrebarbes.
_______________________________________________
(1) Les pères fouettards me hantent toujours (Lanskine, 2012) et Transition pourrait être langue (Les Deux Siciles, 2013).
Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute, Lanskine, 2014, 14 €
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, la vie moins une minute, récit, enfance, amour, humour, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |







