26/02/2022
James Sacré, Figures de solitudes

Les vaches qu’on allait garder
Les animaux qui sont dans les poèmes
Si un peu
C’est pas comme au zoo,
Comme au cirque, ou pareil
Qu’à la ferme où je les ai connus
On fait semblant de les aimer
On les aime, on les enferme.
Tout ce qu’ils m’ont donné :
Rêveries, mots, savoir et désir.
Le fond sale et somptueux du cœur
Et d’autres organes,
Bougent ton poème, tes pensées mal pensées
Animaux parlés mal vivants
Dans l’écriture qui les enferme
Quelle amitié leur est donnée ?
James Sacré, Figures de solitudes, Tarabuste,
2022, p. 52.
Photo T. H.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, figures de solitudes, animaux, vache, désir, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
12/02/2022
Paul de Roux, Entrevoir
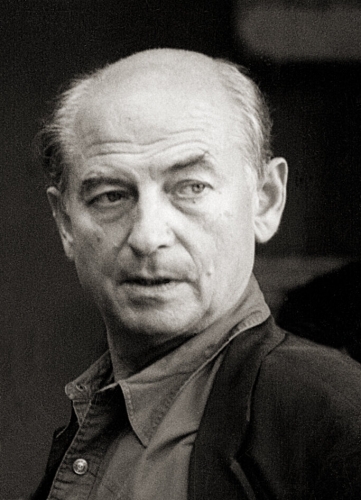
L’enfance
La nuit dans les grands arbres on entendait le vent
ou pour ainsi dire rien, et c’était pire :
comme un bruit de pas trop près des murs
puis escaladant la façade — est-ce possible ?
Les volets sont fermés
la lourde porte verrouillée
mais la peur tombe en piqué sur le cœur
qui bat soudain plus fort que tout.
Paul de Roux, Entrevoir, Poésie / Gallimard, 2014, p. 143.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, entrevoir, enfance, peur | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2021
Étienne Faure, Légèrement frôlée

Le cœur serré sans préavis
entre les murs du bâtiment gris public
d’où les cris fusent, on croirait une enfance
à cause des barreaux qui restreignent
la vue du ciel
les origines restituées
comme on s’en trouve à même les livres
enracinés dans la mémoire
avec l’ennui et les récitations
— craie, encrier, cire d’abeille —
la cour d’école au gravier jaune où crisse
une espèce de véracité française,
racines, à force d’être lues, plausibles
et crues finalement, oui, avec effet rétroactif
tant le désir de croître est commun aux souvenirs
d’une enfance implantée au hasard des sols,
l’autre en papier relue, comme apprise.
Papier relu
Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 88.
Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, école, enfance, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
16/07/2021
James Sacré, Broussaille de bleus

Fontaine de mémoire
Une fontaine fait son bruit de fontaine
Donne son eau claire
Au silence des buissons, on ne sait plus
Si le jour est grand bleu ou larges avancées de nuées
Tout s’efface ou brille un peu
Parmi des débris de mémoire.
Des pays traversés s’emmêlent
En quelques mots familiers qui furent
Ceux donnés par une enfance oubliée.
Quels paysages reviendraient dans le courant d’une écriture ?
Un poème fait son bruit de poème, son bruit de poème.
James Sacré, Broussaille de bleus, dessins de Jacques Barral, Le Réalgar, 2021, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, broussaille de bleus, fontaine de mémoire, enfance, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2021
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers
La fleur de la morelle
La fleur de la morelle (douce amère ou noire)
Donne des baies aux buissons ; l’automne est poison
Nourri de mauvais rouge au fond de la mémoire.
Mais plaisir ! (trop naïf) ah ! j’entends la saison
Qui revient, ses fruits mous, pourriture mais gloire
Et bonheur ! (rouilles, soleil) au bord des buissons.
Alors la saison flambe au faîte des grands ormes ;
Fourche, paille jetée : c’est le goret qu’on tue.
Il brûle dans l’automne et l’enfance perdus.
Je m’en souviens du goût des nèfles et des cormes.
Il brûle dans l’automne et l’enfance est perdue (l’enfance éperdue).
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers, André Dimanche, 1993, p. 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des animaux plus ou moins familiers, morelle, automne, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2021
Nathalie Sarraute, Enfance

J'ai l'embarras du choix, il y a des livres partout, dans toutes les pièces, sur les meubles et même par terre, apportés par maman et Kolia ou bien arrivés par la poste... des petits, des moyens et des gros...
J'inspecte les nouveaux venus, je jauge l'effort que chacun va exiger, le temps qu'il va me prendre... J'en choisis un et je m'installe avec lui sur mes genoux, je serra dans ma main le large coupe-papier en corne grisâtre et je commence... D'abord le coupe-papier, tenu horizontalement, sépare le haut des quatre pages attachées l'une à l'autre deux par deux, puis il s'abaisse, se redresse et se glisse entre les deux pages qui ne sont plus réunies que sur le côté... Viennent ensuite les pages "faciles" : leur côté est ouvert, elles ne doivent être séparées que par le haut, puis quatre "difficiles", et ainsi de suite, toujours de plus en plus vite, ma main se fatigue, ma tête s'alourdit, bourdonne, j'ai comme un léger tournis... « Arrête-toi maintenant, mon chéri, ça suffit, tu ne trouves vraiment rien faire de plus intéressant ? Je le découperai moi-même en lisant, ça ne me gêne pas, je le fais machinalement...»
Nathalie Sarraute, Enfance, Gallimard, 1983, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie sarraute, enfance, livre | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2020
Edmond Jabès, La Clef de voûte

Nous sommes invisibles
Quant tu es loin
il y a plus d’ombre
dans la nuit
il y a
plus de silence
Les étoiles complotent
dans leurs cellules
cherchent à fuir
mais ne peuvent
Leur feu blesse
il ne tue pas
Vers lui quelquefois
la chouette lève la tête
puis ulule
Une étoile est à moi
plus qu’au sommeil
et plus qu’au ciel
distant absent
prisonnière hagarde
héroïne exilée
Quand tu es loin
il y a plus de cendres
dans le feu
plus de fumée
Le vent disperse
tous les foyers
Les murs s’accordent
avec la neige
Il était un temps
où je ne t’imaginais pas
où hanté par ton visage
je te suivais dans les rues
Tu passais étonnée à peine
J’étais ton ombre dans le soleil
J’ignorais le parc silencieux
où tu m’as rejoint
Seuls nous deux
rivés à nos rêves
au large de nos paroles abandonnées
Je dors dans un monde
où le sommeil est rare
un monde qui m’effraie
pareil à l’ogre de mon enfance
[...]
Edmond Jabès, La Clef de voûte,
GLM, 1950, p. 25-26.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, la clef de voûte, invisible, ogre, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
10/01/2020
Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements

L’effroi se sauve
Un mouvement incliné dont l’envol se dénoue
Pourtant rien n’est trop loin l’insatiable
Acceptation respirait
La rapidité et l’absence de ressemblance
Qu’avec l’abîme
L’enfance fait chanceler
Dans l’étonnement sous le désir
Aucun nuage
Et c’est brusquement comme à travers moi tu m’emmènes
Où ton saisissement s’assombrit
Le temps redevient langage
Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements, effroi, enfance, désir | ![]() Facebook |
Facebook |
Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements
L’effroi se sauve
Un mouvement incliné dont l’envol se dénoue
Pourtant rien n’est trop loin l’insatiable
Acceptation respirait
La rapidité et l’absence de ressemblance
Qu’avec l’abîme
L’enfance fait chanceler
Dans l’étonnement sous le désir
Aucun nuage
Et c’est brusquement comme à travers moi tu m’emmènes
Où ton saisissement s’assombrit
Le temps redevient langage
Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements, effroi, enfance, désir | ![]() Facebook |
Facebook |
26/10/2019
James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine

Oiseaux qui sont au loin dans la plaine
Courlis qui sont passés loin quel
cri jeté brille encore à l’extrémité
(peut-être) d’une plaine oh si petite
ou d’une enfance oiseaux poursuivis
précaution fusil pour rien après
des guérets traversés des prairies rases
un autre cri jeté plus loin quel
poème brille (bonheur peut-être oiseaux
solitaires et vrais) que je chasse avec
un autre poème.
Oiseau ventolier les branches
mesurent son effort son aile
sait décliner croître pour
quel point haut dans l’air nul
secret ni leçon à montrer
le vent large l’emporte
un peu plus loin je regarde
à travers un poème un arbre comme
nul moment ni désir mais dans le vent
[...]
James Sacré, Paysage au fusil (cœur) une fontaine,
La Cécilia, 1991, p. 15.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, paysage au fusil (cœur) une fontaine, oiseau, enfance, chasse, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2019
Camille Loivier, Une voix qui mue : recension
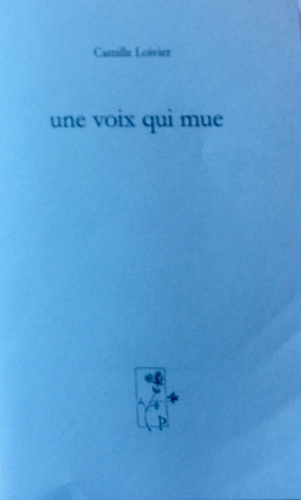
Une voix qui mue est le premier d’une nouvelle série de plaquettes et de livres des éditions Potentille : une couverture différente avec un rabat dans lequel les pages sont insérées et avec une nouvelle vignette. Camille Loivier a déjà publié aux mêmes éditions Joubarbe (2015) ; elle enseigne la littérature de langue chinoise et la traduit — récemment un livre de Hong-Ya Yan, écrivain et réalisateur taïwanais (Le passe muraille, 2018). Son long poème est consacré à la difficulté d’être dans une langue, c’est-à-dire de construire sa relation au monde — peut-être à être soi avec les autres.
Le poème s’ouvre comme un aparté, avec des vers entre parenthèses qui portent sur le désir d’un lieu, de sa nécessité pour vivre ; le rejoindre, c’est retrouver « derrière (…) la rupture / ce qui lie ». Qu’est-ce que le lieu peut apporter ? ce qui est essentiel pour l’identité de la narratrice, la « trace de soi », au point que l’on puisse y vivre sans craindre sa nudité. Ce lieu est nommé plus loin, il s’agit de Taipei, capitale de Taïwan, et il est désigné par « bercail », où, explicitement (sens de "bercail"), elle dit être « comme dans [s]a ville natale » — « c’est donc [s]a ville natale » —, et, fortement, « née une seconde fois », et « j’y suis née ». Vivre à Taipei, c’est connaître la plénitude, toutes fissures de la vie éloignées, et cette certitude d’un accomplissement est restitué dans quelques vers où la seconde naissance dans la ville s’apparente à la fois à la présence du corps dans le ventre maternel et à sa sortie dans le monde. L’ensemble de vers débute par « naître ; » et est immédiatement suivi par « retourner à la chaleur moite et poisseuse » et, plus avant, « on est à l’intérieur d’une serre chaude », puis
soudain on est libre, amphibie
on respire dans l’eau, on est là
dans le monde partie rattachée
au reste
on n’est plus séparée
Cet attachement à la ville chinoise ne peut être dissocié de la langue de Taipei, de Taïwan. Camille Loivier précise que la langue maternelle, celle de Nankin, qui « remonte » et diffère de la langue commune, a été perçue comme une sorte de « patois » et que le changement de langue, à Taipei, a été senti comme une mue de la voix. La langue chinoise, lors de son apprentissage, a été éprouvée comme « une langue / qui ne se parle pas », donc qui ne nécessitait pas d’interlocuteur. Langue pour soi, qu’il n’est pas indispensable de parler, sinon « à soi-même à voix basse ». S’il y a « silence des mots » pour qui la pratique, la langue, alors, conduit à une « complète solitude », ce qui ne semblait pas gêner la narratrice. Le bouleversement semble être survenu quand la langue chinoise a été parlée autrement, ce qui a permis la mue, la transformation ; alors, la langue peut être parlée, et non plus dans la solitude, et est « entendue (…) / telle qu’elle devait me délivrer » : il n’y a plus simplement des signes écrits mais la possibilité d’un tu, d’échanges. Le sentiment d’avoir découvert sa voix (et, évidemment, une voie) est tel que, chaque année, revenir à Taïwan, est à la fois « naître et mourir », perte d’une langue et (re)naissance d’une autre. Sans qu’il y ait croisement de l’une et l’autre, d’où peut-être toujours un manque.
Une voix qui mue, seul texte de Camille Loivier, sauf erreur, qui présente des éléments biographiques, évoque l’enfance où l’« on vit au ralenti » et où se décide pour longtemps une relation à la langue, aux langues, relation au fondement ensuite de ce qu’est le je-tu : rupture du silence, apprentissage du monde. Dans La rivière aux amoures, Camille Loivier écrit, « A-t-on vraiment envie de devenir adulte ? », elle répond sans ambiguïté dans Une voix qui mue, oui, en sachant qu’il faut parfois accepter de perdre ce qu’on pensait être indispensable pour mieux, beaucoup mieux, le retrouver. `
Camille Loivier, Une voix qui mue, éditions Potentille, 2019, 32 p., 7 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 août 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, taïwan taipei, enfance, langue maternelle | ![]() Facebook |
Facebook |
04/09/2019
Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim

Le pain de la faim, le pain des fous
Enfance sans pain,
Pain sans enfance ?
Impossible alliance.
Nous sommes toujours les premiers à réclamer du pain. On nous donne du sucre. En morceaux. Petits quadrilatères de sucre blanc à manger avec la tranche épaisse de pain. Quelquefois le sucre est remplacé par des pâtes de fruits. Le dimanche. C’est une colonie d’enfants déshérités. Sans parents pour certains, ou pour d’autres dont je fais partie, sans héritage. Le pain est notre aliment. C’est le pain des enfants, nous répète-t-on. Celui du goûter mais aussi du matin. Il fait grandir.
Enfance sans fin.
Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim, éditions Rhubarbe, 2019, p. 40.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvie durbec, autobiographie de la faim, pain, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2019
Camille Loivier, une voix qui mue

je suis retournée sur les lieux
où j’ai retrouvé l’enfance
le temps avait arrêté de s’écouler
nous venions du passé
nous venions du temps long et de
l’univers clos, nous venions
de l’époque où nos mères sont jeunes et
nous sourient, où nos pères nous
portent sur leurs épaules, il est si
enivrant de voir le monde d’en haut
plus haut, encore plus haut
on vit au ralenti, extrêmement
précautionneux de nos pas
et de nos
gestes
c’est cela qui m’arrive
je retourne à Taipei
comme dans ma ville natale
c’est donc ma ville natale car
je n’en ai pas d’autre
Camille Loivier, une voix qui mue, Potentille,
2019, p. 5.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, enfance, passé, ville natale | ![]() Facebook |
Facebook |
05/03/2019
Esther Tellermann, Première version du monde : recension

Ce serait sortir du cadre de la simple note de lecture que de montrer la continuité entre les textes d’Esther Tellermann ; notons cependant les liens de ce livre avec Une odeur humaine (2004), également donné comme "récit". Liens formels d’abord : prose qui privilégie souvent des blocs sans ponctuation, passage couramment dans la page d’une séquence à l’autre sans rupture syntaxique « (…) approcher la fin de l’univers, // la plaine est gorgée de sang (…) » (p. 88), introduction de formes considérées comme orales, entrelacement des voix et pas d’indication particulière pour passer de l’une à l’autre. Les rapprochements thématiques sont également nombreux, au point que Première version du monde, sur certains points, pourrait être lu comme une continuation de Une odeur humaine ; à côté de la présence de la Shoah, plus largement du racisme et des massacres de masse, le récit met aussi en scène la relation entre l’homme et la femme — plutôt qu’entre un homme et une femme — dans les échanges amoureux, qui parlent avec des interlocuteurs identiques (Madame, Docteur). En outre ces thèmes sont liés à celui de la disparition (du sujet, de la Terre).
Très tôt dans Première version du monde apparaît l’un des noms utilisés par les antisémites pour parler des Juifs (« youpins, youpinasses »), repris ensuite avec ajout de qualificatifs (« ordure, sale youpin ») ; est évoquée aussi très tôt l’envoi vers les camps de la mort : « on avait rempli les wagons de carnes, futurs cadavres », avec mention de tortures. Autre aspect des destructions, sont également rappelés les temps de la colonisation, avec un bref descriptif raciste de la vie des populations indigènes et un éloge des colons (« y avait pas encore de noms, fallait qu’on vienne ») et de leur action (« on va leur apprendre le vieux monde ! »). Ce type de discours a justifié, et justifie encore, les exactions et l’exploitation des ressources naturelles ; il est répété avec variante dans le récit, cette fois en insistant sur le caractère archaïque des pratiques indigènes, « Ils entouraient les cadavres de feuilles de palmiers, c’était à la naissance de l’Histoire (…) ». À ces « peuplades ignorantes (…) », à cet « abrutissement des races devant un lever de lune (…) », l’occidental oppose et propose ce qu’il est : « on a mieux, // tous en jeans et en baskets, on s’photographie, même que ça r’mue, on s’fait des films… ».
Cependant, si des voix vantent seulement la supériorité de leur modèle, d’autres rejettent la possibilité de toute différence et prônent la disparition de tout ce qui est estimé élément de désordre, « Faudra débroussailler ces youtres, ces nègres ces cafards (…), ce néant puant l’ordure ». Le livre abonde en allusions aux massacres et à la variété des moyens pour les mener à bien, de la machette aux armes biologiques. Éradiquer toute différence serait le moyen de préserver la vie future, « la ville doit être transformée en fosse commune, voilà tout, nous sommes nombreux depuis toujours à vouloir sauver l’espèce humaine ». On reconnaît là un des thèmes de l’eugénisme, pas seulement celui du nazisme mais (souvent) de tout projet d’un "monde nouveau". L’acharnement des humains à (se) détruire met en cause tout le vivant puisque « les océans se recouvr[…]ent de plastique » ; la disparition du monde d’aujourd’hui est vue comme une nécessité pour sortir de ce qui est mauvais (« ils (…) s’appliquaient à récuser la première version du monde ») ou comme un processus inévitable quoique incompréhensible (« nous n’avions pu ni expliquer ni enrayer la volonté humaine d’organiser sa propre fin »).
Voilà une vision peu amène, noircie sans doute par mon choix de retenir tels fragments du récit. Comment dans ce monde à l’avenir incertain peuvent se construire et se vivre les échanges amoureux ? Quel que soit l’état de la société, il est toujours nécessaire de comprendre ce qu’est la relation entre hommes et femmes ; ici, les voix sans visage ne renvoient pas à des personnages romanesques, plutôt au masculin et au féminin, et il n’est qu’une question : « que narrer d’autre que la rencontre de deux corps ? ». Les échanges amoureux évoqués relèvent du désir plus que de l’amour et ils apparaissent fort peu satisfaisants. Les mini scènes érotiques dans le récit ne font pas illusion, elles ne sont que répétition de gestes décevants ; pour lui, « c’est d’une sinistre trivialité ces cuisses ouvertes pour le même remède ancestral je t’aime tu répètes je t’aime, mêmes récidives, remèdes du vieux monde », pour elle, « ça colle cette odeur étrangère, pas lavé le sexe, j’ai rien senti Docteur, ça va trop vite ».
Ne peut-il y avoir quelque accomplissement de soi dans les échanges amoureux ? La recherche n’en est pas absente, mais le résultat toujours dans l’irréel (elle crut, ce serait), c’est dire qu’elle aboutit toujours plus ou moins à un échec. Au-delà des différences — l’homme toujours dominateur, la femme souhaitant être regardée autrement que comme objet de désir — les attentes convergent ; pour lui, la possession « serait une autre façon d’atteindre le ciel ou son envers », pour elle, l’aboutissement serait d’être « aux confins de la vie, plus proche de l’éternité qui ne réclame plus aucun effort pour disparaître ». On rapprocherait sans peine ce lyrisme amoureux, qui associe amour et disparition, de certains récits, par exemple de Bataille. Une autre aspect de la recherche exclut toute tension, rêve cette fois d’un idéal du retour à un temps d’avant tout échange amoureux, quand ce n’est pas à l’enfance.
Il est remarquable que, pour le masculin comme pour le féminin, l’évocation de l’idéal passe par la relation à l’enfance, c’est-à-dire à un moment de la vie où rien du désir amoureux n’a commencé ; pour elle il aurait fallu, non être pénétrée, mais « qu’il s’alanguisse dans un geste enfantin, les choses reviendraient à leur point de départ, l’émoi d’une première rencontre » ; pour lui, « un jour viendra (…) // l’étincelle d’un premier amour (…) // un contact si volatile (…) qu’il ferait croire à une continuité sans fin ». Pourquoi cela ne reste-t-il qu’à l’état de souhait ? Le vécu amoureux ne serait-il que sujet de roman, « illusions de pensionnaire » ? Voyons un autre plan : les conditions de vie, la « misère sociale » dans la "première version du monde" sont sans doute peu favorables à l’épanouissement par les échanges amoureux ; toute l’existence est enserrée dans un cadre rigide, limitée à « quelques actes notariés », et chacun apprend à ne vivre son corps que comme un « sac incongru » avec « une conscience empêchée d’avance ». Rien de possible aujourd’hui, mais peut-on penser un changement comme le laissent plus ou moins croire les derniers mots du livre,
« peut-être demain nous immerge dans une seconde version du monde » ?
Première version du monde offre une vision si complexe de notre monde que d’autres lectures en sont possibles. On pourrait s’attarder, par exemple, aux évocations de ce qui appartient à l’enfance, aux mentions des odeurs, à l’image du corps, à la construction même du livre (les trois parties ne sont pas équivalentes). Le récit d’Esther Tellermann ne se donne pas aisément à la lecture — et c’est tant mieux.
Esther Tellermann, Première version du monde, éditions Unes, 2018, 144 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 10 février 2019.
Publié dans Celan Paul, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, première version du monde, shoah, racisme, échange, désir, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
28/02/2019
Umberto Saba, Presque un récit

Moment
Les oiseaux à la fenêtre, les persiennes
demi-closes : un air d’enfance et d’été
qui me console. Ai-je vraiment l’âge
que je sais avoir ? ou seulement dix ans ? À quoi
l’expérience m’a-t-elle donc servi ? À vivre
satisfait des petits riens qui autrefois
inquiétaient ma vie.
Umberto Saba, Presque un récit, traduction René de
Ceccaty, dans Il Canzionere, L’Âge d’Homme, 1988, p. 584.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, presque un récit, moment, petites riens, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |






