15/03/2012
Aragon, Je 'ai jamais appris à écrire, ou les incipit
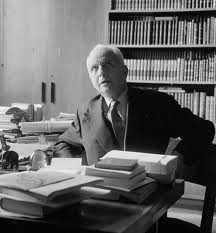 Ce commencement de moi... j'ai très vite appris à lire, au sens enfantin qu'on donne à ce verbe. C'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts, et qu'on entreprit m'enseigner comment le tenir, en tracer des signes séparés et tout ce qui s'en suit, j'eus une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais, difficilement encore il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté par exemple de reconnaître le lion dans quatre lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais là rien de raisonnable, puisque je pouvais parler, crier le mot LION, et même imiter le lion par le geste, le grognement, et la fureur, comme je l'avais vu une fois au Jardin d'Acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire ? puisque je le savais déjà.
Ce commencement de moi... j'ai très vite appris à lire, au sens enfantin qu'on donne à ce verbe. C'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts, et qu'on entreprit m'enseigner comment le tenir, en tracer des signes séparés et tout ce qui s'en suit, j'eus une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais, difficilement encore il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté par exemple de reconnaître le lion dans quatre lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais là rien de raisonnable, puisque je pouvais parler, crier le mot LION, et même imiter le lion par le geste, le grognement, et la fureur, comme je l'avais vu une fois au Jardin d'Acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire ? puisque je le savais déjà.
C'était le plus grand obstacle que ceux qui voulurent m'enseigner l'écriture trouvaient sur leur chemin. Un obstacle quasi insurmontable, tel était mon acharnement. Et je trouvais ces gens stupides, lesquels n'entendaient pas ce que je leur disais, qui me paraissait l'évidence, je cassais mon crayon ou je le jetais par la fenêtre. Enfin on y renonça, ma mère disait que c'était affreux, un enfant qui ne saurait jamais écrire. Moi, je m'en passais. Je dictais ce qui me traversait la tête à ces deux tantes que j'avais, et je constatais qu'après, leur gribouillis restituait pour d'autres yeux ce que j'avais dit, très exactement. Si bien que la parole dit me paraissait fort suffisante.
Aragon, Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit, "Les sentiers de la création", éditions Skira, 1969, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, je n'ai jamais appris à écrire, ou les incipit, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
06/03/2012
Ossip E. Mandelstam, Le Bruit du temps
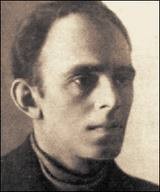
La bibliothèque de la prime enfance est un compagnon de route pour la vie entière. La disposition des étagères, les collections d'ouvrages, la couleur des dos, on les perçoit comme la teinte, la hauteur et la structure mêmes de la littérature universelle. Si bien que les volumes absents d'une première bibliothèque n'alimenteront jamais ce vaste édifice livresque où se reflète l'image du monde. Là, qu'on le veuille ou non, chaque œuvre est classique, et aucun dos de livre n'en peut être soustrait.
[...] L'étagère du bas, dans mon souvenir, offrait toujours une image de chaos ; les livres n'y avaient pas leurs dos alignés, ils étaient couchés comme des ruines : des Pentateuques roussis aux reliures en loques, une Histoire juive écrite dans la langue hésitante et maladroite d'un talmudiste parlant russe. C'était le chaos judaïque précipité dans la poussière. Où il fut très vite rejoint par mon alphabet hébreu ancien, que je n'ai donc jamais appris. [...]
Au-dessus des ruines juives commençaient les livres bien rangés : on y trouvait les Allemands : Schiller, Goethe, Körner — puis Shakespeare en allemand — vieilles éditions de Leipzig et Tübingen, ventrues, râblées, aux reliures bordeaux en cuir estampé, et dont les petits caractères convenaient aux yeux d'un public jeune ; les gravures étaient gracieuses, un peu à la manière antique : femmes aux cheveux indisciplinés se tordant les mains, lampes aux allures de lustre, cavaliers au front haut, grappes de raisin en vignette. Mon père, en autodidacte, s'était frayé là, hors des fourrés talmudiques, un passage jusqu'au monde germanique.
Plus haut encore, il y avait les livres russes de ma mère — Pouchkine, édition Issakov de 1876. Je pense aujourd'hui encore que c'était une belle édition, elle me plaît davantage que celle de l'Académie. Là, rien d'inutile : les caractères sont harmonieux, les colonnes de vers s'écoulent, fluides comme des bataillons que guident en stratèges les chiffres sensés et précis des années jusqu'en trente-sept. La couleur du Pouchkine ? Chacune étant due au hasard, laquelle élire pour des paroles murmurées ? Hou, cet idiot d'alphabet coloré de Rimbaud !
Mon Pouchkine d'Issakov avait une défroque décolorée dans sa reliure de calicot pour lycéens, une soutane brun-noir déteinte, aux intonations terreuses, sableuses ; elle ne craignait ni tavelure ni encre ni feu ni pétrole. Le sable noir de ce froc d'un quart de siècle avait amoureusement tout absorbé en lui — et je ressens, d'autant plus vifs sous cet habit de tous les jours, la beauté spirituelle et le charme presque physique de mon Pouchkine maternel. On y avait écrit d'une encre rouge pâle : « À l'élève de troisième pour son zèle ». Il y avait là, comme ourdis dans le tissu de cette édition, les récits autour des maîtres et maîtresses exemplaires, aux joues rosies de phtisie, aux souliers troués : les années quatre-vingt à Vilno.
Ossip Mandelstam, Le Bruit du temps [1923], traduit du russe et présenté par Jean-Claude Schneider, éditions Le bruit du temps, 2012, p. 36-37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, le bruit du temps, bibliothèque, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
20/07/2011
Thomas de Quincey, Esquisses autobiographiques
 L’affliction de l’enfance
L’affliction de l’enfance
Vers la fin de ma sixième année, le premier chapitre de ma vie en vint soudain violemment à son terme ; ce chapitre qui, même franchies les portes du paradis retrouvé, pourrait mériter un souvenir. « La vie est finie ! », telle était la crainte secrète de mon cœur ; car le cœur de la première enfance sait autant appréhender que celui de la plus mûre sagesse lorsqu’une blessure capitale est infligée au bonheur. « La vie est finie ! Elle est finie ! », c’était là le sens caché qui, de façon à demi inconsciente, était tapi dans mes soupirs ; de même que ces cloches entendues au lointain un soir d’été semblent quelquefois emplies des formes distinctes et articulées des mots, d’une sorte de message prémonitoire qui roule sans cesse dans l’espace ; de même, pour moi, une voix muette et discrète semblait donc ainsi faire continuellement un chant secret, audible à mon seul cœur, où j’entendais que « dorénavant les fleurs de la vie sont fanées pour toujours ». Ce n’est pas que de telles paroles se formaient de manière vocale dans mon oreille ou sortaient de mes lèvres en sorte qu’on les entendît, mais un tel murmure s’insinuait silencieusement jusque dans mon cœur. Et pourtant, en quel sens pouvait-il y avoir là quelque vérité ? Pour un jeune enfant qui n’avait pas plus de six ans, était-il possible que les promesses de la vie eussent été réellement anéanties ? ou que fussent épuisés les plaisirs dorés qui sont les siens ?
Avais-je vu Rome ? Avais-je lu Milton, entendu Mozart ? Non. Saint-Pierre, Le Paradis perdu, les divines mélodies de Don Giovanni, tous et toutes pareillement ne m’étaient pas encore révélés, et pas plus du fait des accidents de ma situation que de la nécessité d’une sensibilité encore imparfaite chez moi. Des extases pouvaient bien demeurer en arriéré, mais les extases sont des modes de plaisir trouble. La paix, le repos, la sécurité fondamentale appartenant à cet amour qui est au-delà de l’entendement ne pourraient plus me revenir. Un tel amour, si insondable, une telle paix — qu’aucun orage ou aucune peur de l’orage n’étaient venus toucher — avaient dominé les quatre premières années de mon enfance et m’avaient conduit durant cette époque à nouer des liens tout à fait uniques avec ma sœur aînée, laquelle avait trois ans de plus que moi. Les circonstances qui furent celles de la soudaine dissolution de ce lien très tendre, je les rapporterai ici à nouveau.
Thomas de Quincey, Esquisses autobiographiques, traduction Éric Dayre, dans Œuvres, édition publiée sous la direction de Pascal Aquien, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2011, p. 412-413 [texte publié aux éditions José Corti en 1994, traduction révisée en 2011].
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas de quincey, autobiographie, enfance, paradis perdu | ![]() Facebook |
Facebook |





