27/03/2019
Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours

C’est bien la vie, c’est bien à lire. J’aime beaucoup certaines biographies. C’était bien aussi à voir, ce matin, vers sept heures. L’orage qui avait sévi toute la nuit s’était éloigné et le parc délicieusement s’étirait, bien mieux qu’il ne l’aurait fait dans le plus merveilleux des romans, à cet instant du moins, et puis je n’ai pas tout lu, et puis ce n’est pas la première fois que je bats la breloque ni que j’extravague, et puis il faut oser « laisser trotter les plumes comme elles veulent »..
Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours, le bruit du temps, 2014, p. 53
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, lire, rêver, ainsi les jours | ![]() Facebook |
Facebook |
23/05/2016
Francis Cohen, Ce que nous savons

En finir
.
Poursuivre
Poursuivre
mais
décider
une ligne
cela reste tenté
…
— poursuivre
endurer
l’insupportable
abandonner
poursuivre
lire ne te laissera
pas
tu t’es
surpris à
mur-
murer
« tu ne t’en sortiras pas »
lire excédait,
tu subis
un déplacement
d’os
étais, n’étais pas
tu as renoncé
accepte que lire ressemble
à tout abandonner
[…]
Francis Cohen, Choses que nous savons,
NOUS, 2015, p. 118-120
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis cohen, ce que nous savons, en finir, abandonner, lire | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2015
Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il lisait un livre. Il voulait être célèbre comme l’auteur et, pour cela, travailler de l’aube à la nuit ; puis, ayant pris fermement cette résolution, il se levait, allait se promener, faire un tour, souffler.
S ! l’inspiration existait, il faudrait ne pas l’attendre ; si elle venait, la chasser comme un chien.
La peur de l’ennui est la seule excuse du travail.
Amitié, mariage deux êtres qui ne peuvent pas coucher ensemble.
La mort des autres nous aide à vivre.
Lire toujours plus haut que ce qu’on écrit.
Jules Renard, Journal, 1887-1910, édition Léon Guichard et Gilbert Sigaux, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 130, 133, 134, 136, 136, 145.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, livre, auteur, travail, ennui, inspiration, lire | ![]() Facebook |
Facebook |
10/03/2015
Isabelle Garron, Corps fut

Variations 2
[...]
là. enfant .tu évoques l'épreuve d’un texte
aux confins d’une île. ici l’empreinte
d’origine ses contours traduits
dans la neige
la fatigue de l’image .d’une femme
sa condition .et le ventre
les soubresauts et les
expectorations
lire noté à maintes reprises
je ne raconterai point
j’écrirai
sous une nuit l’attente fêlée
d’une voix dans la ruelle
en contrebas
les nuages dans la vallée
la crainte aussi
d’un retour du froid
Isabelle Garron, Corps fut, Flammarion,
2011, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle garron, corps fut, enfance, origine, femme, lire, écrire, voix, froid | ![]() Facebook |
Facebook |
07/08/2014
Caroline Sagot-Duvauroux, Köszönöm

Problème. Écrire convient-il à la poésie, il y a tant de poèmes et tous à crans de tourbillon. Si écrire convenait au poème, un suffirait, un de chaque. La pièce s’ajusterait comme s’ajustent la Critique de la raison pure ou le Parménide à leur propos. Et ça n’est pas parce qu’il y a mille façons d’aimer qu’un poème d’amour ne suffit pas. D’ailleurs on sait qu’il n’y a pas mille façons d’aimer. C’est peut-être même parce qu’il n’y en a qu’une et qu’elle se trouve sous le sabot d’un cheval, qu’on se rendra mieux à la chercher qu’à la trouver. La soumission que cherche le poème est bannie de l’écriture. Proche du religieux. De l’hésitation inquiète. L’angoisse décide de l’orée puis sans chemin dans le brouillon, accepte la pleine mer du brouillon pour n’avoir qu’à accueillir le secours ou la mort qui nommera pour elle le silence, sûre d’unique certitude qu’elle est incapable, que sa langue savante de poème est incapable du silence. Alors mieux vaut l’océan pour n’avoir d’autre choix que se mouiller. Et que l’eau du moins soit, avec ses turpitudes de sel. Car ce n’est pas soi, ce n’est pas être que le poème attend mais autre chose, la chose qui ouvrirait taire et qui peut être taire, on ne sait. Passion de chair qui veut dire passion de chair et passion de la parole sous l’autre chose en même temps que chair ouverte à la parole. Qu’est-ce que c’est ? On écrit cependant. On se colle à l’engrenage de distance. Blanchot au bord du poème se tait car tout de même il s’est tu (non par détresse d’écrivain non par triomphe de l’insolence d’homme), par poème, pour se mouiller. Oui tout de même il l’a fait. Il est mort comme un loup.
Savoir quoi que ce soit indiffère la poésie tant l’inquiète la venue. C’est un truc pour paresseux, pour idiots ou pour fidèles. Ce qui est presque dire pour tout le monde, juste pour tout le monde. La poésie est tellement à tous qu’elle n’est plus respectable et voilà ce qui effraye car il faudrait s’y risquer, aller aux putes : lire.
Caroline Sagot-Duvauroux, Köszönöm, éditions José Corti, 2005, p. 113-114.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot-duvauroux, köszönöm, écrire, poésie, lire | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2013
Colette, Paris de ma fenêtre (1942)

Livrées à la hâte et à la facilité de vivre extérieurement, les époques heureuses sont infidèles à la pensée écrite. Une molle félicité excella toujours à brûler les heures, à les presser de témoigner combien elles sont vides, vaines, volantes. De poignants soucis, une tardive clairvoyance leur redonnent leur poids et leur suc, réduisent à leur valeur les plaisirs qui nous viennent du son et des fuyantes images. Ce qui se fixe en nous par l'œil, ce qui par le caractère imprimé réchauffe en nous la pensée, l'esprit de compréhension et de contradiction, prend tout son prix ; n'est-il pas de meilleures augures que des générations égarées, en cherchant leur voie, retrouvent que lire est un bonheur vital ?
[...]
L'amour de lire conduit à l'amour du livre. Si notre curiosité et notre pauvreté s'accordent en vue de ressusciter les cabinets de lecture, il faut qu'elles ramènent aussi le respect dû au livre. [...]
Lire est, selon le live et le lecteur, une griserie, un bonheur, le service rendu à un culte, une patiente prospection à travers l'écrivain et nous-même. Ce ne sera pas chose facile que d'enseigner le respect du tome périssable, du papier sans durée. Elle ne viendra que si on la cultive, cette pudeur du lecteur qui consiste à ne pas se gratter la tête au-dessus des pages, à s'abstenir de manger en lisant, de corner des feuillets... L'espèce humaine n'a jamais assez de vergogne quand il lui faut cacher les traces de ses haltes. D'un livre que j'achetai sur les quais tomba un affreux petit peigne de poche, édenté. J'en faillis perdre le goût du livre d'occasion, joie de mes promenades. Ainsi faillis-je me dégoûter du chocolat en tablettes pour avoir mis la dent sur un bouton de culotte enrobé dans sa pâte...
Un amour sincère se marquant par la délicatesse, je vois que les jeunes gens qui lisent dans le métro rabattent sur un volume fraîchement acheté une couverture volante et ménagent ses tranches non coupées. Bon nombre de ces lecteurs soigneux seraient en chemin de passer bibliophiles, n'était l'insuffisance de leurs moyens. Posséder sous sa forme aristocratique l'auteur que l'on aime, habillé d'une reliure qui lui est contemporaine, caresser, en le lisant, l'époque évoquée par sa typographie et sa mise en pages, ce sont là des plaisirs que la chance et l'ingéniosité rendent souvent abordables. À côté des "originales" d'époque, inexpugnables sous leur reliure signée, le livre d'occasion relié ne coûte pas — pas encore — plus cher qu'un livre neuf, et défie le temps mieux que lui.
Colette, Paris de ma fenêtre (1942), dans Œuvres IV, édition publiée sous la direction de Claude Pichois et Alain Brunet, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2001, p. 603, 604-605.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : colette, paris de ma fenêtre, lire, livre, plaisir | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2012
Nathalie Sarraute, Enfance

J'ai l'embarras du choix, il y a des livres partout, dans toutes les pièces, sur les meubles et même par terre, apportés par maman et Kolia ou bien arrivés par la poste... des petits, des moyens et des gros...
J'inspecte les nouveaux venus, je jauge l'effort que chacun va exiger, le temps qu'il va me prendre... J'en choisis un et je m'installe avec lui sur mes genoux, je serra dans ma main le large coupe-papier en corne grisâtre et je commence... D'abord le coupe-papier, tenu horizontalement, sépare le haut des quatre pages attachées l'une à l'autre deux par deux, puis il s'abaisse, se redresse et se glisse entre les deux pages qui ne sont plus réunies que sur le côté... Viennent ensuite les pages "faciles" : leur côté est ouvert, elles ne doivent être séparées que par le haut, puis quatre "difficiles", et ainsi de suite, toujours de plus en plus vite, ma main se fatigue, ma tête s'alourdit, bourdonne, j'ai comme un léger tournis... « Arrête-toi maintenant, mon chéri, ça suffit, tu ne trouves vraiment rien faire de plus intéressant ? Je le découperai moi-même en lisant, ça ne me gêne pas, je le fais machinalement...»
Nathalie Sarraute, Enfance, Gallimard, 1983, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie sarraute, enfance, lire | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2011
Giorgio Manganelli, Discours de l'ombre et du blason
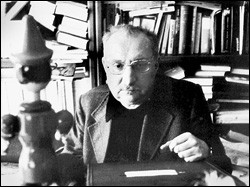 Un écrivain ne cesse jamais d’écrire, jamais ne cesse de lire ; un lecteur jamais ne cesse de lire, jamais ne cesse d’écrire. Les mots ignorent les hiatus, lacunes, haltes, parkings, sommeils ; leur magie n’a pas de cesse, le miracle est la règle, la continuité le prodige, le chaos est un ordre, la fureur une paix, la nuit étincelle, le jour est peuplé des images du rêve. Les mots parlent, les mots n’ont rien à dire, donc ils parlent. Aucune horloge ne scande leur temps, aucune loi ne les emprisonne, aucune prohibition ne les concerne. Aucun désir ne les retient. Vous avez lu : la littérature a tué la nature. Vous auriez dû lire : la parole a, dans le même instant, créé et tué la nature ; avant la parole, il n’y avait pas de nature, et le big bang ne fut rien d’autre que l’explosion d’un dictionnaire. Avoir affaire aux mots est une condition sans remède ; ils exercent sur nous avec indifférence un chantage qui n’admet aucun compromis, et toute concession accroît leurs exigences, et nos tortures. Soyons clairs : je ne parle pas d’exigence de perfection ; ni de style. On ne peut pas perfectionner ses rêves, mais on peut perfectionner sa dépendance à l’égard des rêves, se faire oniromane, s’intoxiquer de logos, de words, words, words, et en ce sens il est facile d’atteindre à l’extrême imperfection, de se dégrader, de se dégrader absolument devant la parole. La dégradation est nécessaire. Je suis désolé, mais je ne peux en distinguer personne, même pas les pères de famille. Un coup de téléphone m’a interrompu. J’aurais pu ne pas répondre, mais voyez-vous, la seule éventualité qu’il y ait des mots — au sens que l’on a dit — m’entraîne au vice. Je devrais dire maintenant : où en étions-nous restés ? Mais je sais aussi qu’il n’y a aucun lieu où rester ; tout lieu est structurellement identique à tout autre ; où que j’aille, je suis « ici ». L’ « ici » me possède, il te possède, tu n’as aucun moyen de t’en libérer, il ne t’est même ni permis ni possible de vouloir t’en libérer. Rien ne rassure davantage que la dégradation. Horrible est le moment où notre dignité se redresse en censeur des mots ; les mots alors se dispersent en riant ; et nous ne distinguons plus le double de la parole. Le double se joue de nous, se déguise en parole. Notre dignité ne cesse de s’accroître au contact de la parole, parole feinte qu’il suffirait de mettre devant un miroir, ou d’exposer à la violente lumière de midi ; car le double n’a pas d’image dans le miroir, et ne donne pas d’ombre ; c’est en cela probablement que le miroir fait allusion au blason.
Un écrivain ne cesse jamais d’écrire, jamais ne cesse de lire ; un lecteur jamais ne cesse de lire, jamais ne cesse d’écrire. Les mots ignorent les hiatus, lacunes, haltes, parkings, sommeils ; leur magie n’a pas de cesse, le miracle est la règle, la continuité le prodige, le chaos est un ordre, la fureur une paix, la nuit étincelle, le jour est peuplé des images du rêve. Les mots parlent, les mots n’ont rien à dire, donc ils parlent. Aucune horloge ne scande leur temps, aucune loi ne les emprisonne, aucune prohibition ne les concerne. Aucun désir ne les retient. Vous avez lu : la littérature a tué la nature. Vous auriez dû lire : la parole a, dans le même instant, créé et tué la nature ; avant la parole, il n’y avait pas de nature, et le big bang ne fut rien d’autre que l’explosion d’un dictionnaire. Avoir affaire aux mots est une condition sans remède ; ils exercent sur nous avec indifférence un chantage qui n’admet aucun compromis, et toute concession accroît leurs exigences, et nos tortures. Soyons clairs : je ne parle pas d’exigence de perfection ; ni de style. On ne peut pas perfectionner ses rêves, mais on peut perfectionner sa dépendance à l’égard des rêves, se faire oniromane, s’intoxiquer de logos, de words, words, words, et en ce sens il est facile d’atteindre à l’extrême imperfection, de se dégrader, de se dégrader absolument devant la parole. La dégradation est nécessaire. Je suis désolé, mais je ne peux en distinguer personne, même pas les pères de famille. Un coup de téléphone m’a interrompu. J’aurais pu ne pas répondre, mais voyez-vous, la seule éventualité qu’il y ait des mots — au sens que l’on a dit — m’entraîne au vice. Je devrais dire maintenant : où en étions-nous restés ? Mais je sais aussi qu’il n’y a aucun lieu où rester ; tout lieu est structurellement identique à tout autre ; où que j’aille, je suis « ici ». L’ « ici » me possède, il te possède, tu n’as aucun moyen de t’en libérer, il ne t’est même ni permis ni possible de vouloir t’en libérer. Rien ne rassure davantage que la dégradation. Horrible est le moment où notre dignité se redresse en censeur des mots ; les mots alors se dispersent en riant ; et nous ne distinguons plus le double de la parole. Le double se joue de nous, se déguise en parole. Notre dignité ne cesse de s’accroître au contact de la parole, parole feinte qu’il suffirait de mettre devant un miroir, ou d’exposer à la violente lumière de midi ; car le double n’a pas d’image dans le miroir, et ne donne pas d’ombre ; c’est en cela probablement que le miroir fait allusion au blason.
Les anciens savaient que chaque mot a un double, et que ce double a un destin qui n’est pas celui du mot. Écho est le double de la parole, qui témoigne pour elle quand elle a passé outre. Ce que nous lisons, écoutons, pensons, est parole, mais ce qui reste en nous est le double sous la forme d’Écho, c’est l’image de la parole « reflétée », mais le reflet n’a pas de reflet. Dans cette triste et gracieuse histoire, Écho se prend d’amour — « Je me suis désespérément prise d’amour » — pour Narcisse, lui-même amoureux, non pas de son double, mais de son image renversée. Il s’ensuit que c’est l’Écho qui permet à la parole de demeurer ininterrompue, car si elle n’avait pas ce double à sa disposition elle finirait par tomber, comme Narcisse, dans un amour spéculaire, porteur de mort comme le sont toutes les tentatives qu’on fait pour se posséder soi-même.
[…]
Giorgio Manganelli, Discours de l’ombre et du blason, ou du lecteur et de l’écrivain considérés comme déments, traduit de l’italien par Danièle Van de Velde, Fiction & Cie, éditions du Seuil, 1987, p. 122-124.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, discours de l'ombre et du blason, rêve, écrire, lire | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2011
Eugène Savitzkaya, entretien, poèmes
 Quand on vous lit depuis longtemps, on a l’impression d’un texte sans fin en passant d’un livre à l’autre.
Quand on vous lit depuis longtemps, on a l’impression d’un texte sans fin en passant d’un livre à l’autre.
Ce sont toujours les mêmes rêves qui agitent le sommeil, les mêmes frayeurs qui me font suer, et les éléments qui composent la formule quasi chimique du bonheur sont quasiment invariables et peu nombreux. Mes livres ne sont chaque fois que des charnières. Ils contiennent à la fois le partiel éclaircissement de préoccupations survenues dans l’un des livres précédents et le surgissement d’autres préoccupations.
Écrire, ce qui occupe une bonne partie de votre vie — et puis ?
Autre chose qu’écrire. De plus en plus de choses — lire, tailler les arbres fruitiers, marcher, semer, planter. Tant de choses… À tel point que je ne sais plus très bien si toutes ces activités sont assujetties à l’écriture ou le contraire. À tel point que je ne sais plus si j’écris pour rendre compte de ce que je fais ou si les autres activités ne sont pratiquées que pour amener l’eau au moulin. Une salutaire et peu confortable confusion.
Lire : quels sont vos points de repère ?
Mes contemporains. Beckett, Guyotat, Pinget, Stéfan, Genet, Izoard, Parant, Pérec, Cela, Leiris, Char, Ponge.
Quelques points de repère : Fable (Pinget), Paulina 1880 (Jouve), Premier amour (Beckett), Le palais des très blanches mouffettes (Arenas), Tombeau pour cinq cent mille soldats (Guyotat), Le Journal du voleur (Genet), Vie de mon frère (Stéfan), Mrs Caldwell parle à son fils (Cela), Souvenirs d’enfance (Tagore), Illuminations (Rimbaud), Office des ténèbres (Cela), N’entre pas sans violence dans cette bonne nuit (Thomas), Aux chiens du soir (Stéfan), La patrie empaillée (Izoard), Notes de chevet (Sei shônagon), Cavalerie rouge (Babel), La Révolte des Tartares (Thomas de Quincey)…, livres tous lus au bon moment.
Quels animaux, si présents dans vos livres… ?
D’abord j’ai toujours adoré les noms qui les désignent : hérisson, ours, tortue, loup, lion, fourmi, lapin, koala. Ils ont toujours été pour moi des fragments de terre animée, les véritables esprits du monde, innombrables et la plupart du temps invisibles.
... tout comme l’enfance.
C’est une mine d’images et de figures parfaites et éternelles : un dindon perché sur le toit le plus haut de la maison, mon petit frère sur le dos du jars le plus agressif, un lapin perdant ses viscères sur l’herbe du verger, les pommiers géants, etc. Figures et images qui ont une valeur d’étalon. Et une intime connaissance du pire et du meilleur.
Mongolie plaine sale, Plaisirs solitaires, Couleurs de boucherie,… : qu’en est-il des titres ?
C’est très difficile de donner un titre à quelque chose qui demeure toujours informe, pas vraiment achevé. Mais c’est une pratique à laquelle j’ai fini par me faire. La plupart du temps, je donne le titre après avoir clos le livre. Une façon de me détacher de ce que je viens d’écrire, de prendre une certaine distance et d’imposer en même temps au lecteur une lecture possible, tout en espérant qu’il s’en moque. J’ai une confiance aveugle dans la totale liberté du lecteur, dans son infinie fantaisie.
Ce texte reprend avec quelques variantes un entretien publié dans la revue Recueil, n° 20, décembre 1991 (éditions Champ Vallon).
Souillée de lait, comme le loup avide, comme
le cygne, dépouillée, lourde comme l’eau de la mer,
le bras du boucher, la jambe de la salie,
la tête du rat, souillée, comme les pattes du héron,
le frère et la sœur, l’ogre matinal éveillant
ses poussins, pourpre et bleue, masquée, veule,
mêlée aux feuilles, aux baies, aux pépins,
petite morveuse près du limon, sur les braises,
sur les coussins brodés, dans la soie, puante,
dans le linge nouveau, brûlée, décapitée, comme
les tournesols, comme le frère et la sœur,
le garçon, le souffleur, le palmier,
à la main blanche, paume de la main froite mordue,
ventre peint, pied blessé dans le piège, dans le sac,
petit soleil de ma journée, trou, tréfonds, salie
la morte qui engloutissait, qui lapait, criant,
ouvrant œil de mercure, anus rose, au bord du gouffre,
salie de cendre, éclaboussée de plumes, tournée
vers le centre de la terre, distribuant les pestes,
perdue, jetée, déchirée, ouverte, envahie, habitée,
tombée sur les graviers.
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit, 1986, p. 35.
Combien de porcs sous les chênes,
combien de chênes dans la forêt, quelle forêt,
qui tient la hache et par quel bout, où, où,
où, où, mon coucou ? en mon sternum entre les
seins se fiche la corne et de mon cul
coule le sang, je suis vierge et perdue,
liée à l’horloge, licorne sans tête têtue,
mon index sur les plis de ma bouche, silence,
je prends rien au fond de ma poche et je jette
rien qui retombe en crépitant sur
les feuilles mortes.
Eugène Savitzkaya, Cochon farci, éditions de Minuit, 1996, p. 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : savitzkaya, lire, écrire, animaux, bufo, cochon | ![]() Facebook |
Facebook |





