15/05/2012
Ahmad Châmlou et Forough Farrodkhzâd, Poésie d'Iran dans Europe, mai 2012
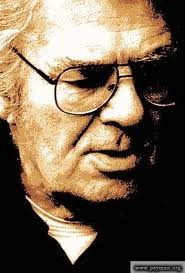
Ahmad Châmlou
Nocturne
Si la nuit est belle en vain
Pourquoi est-elle belle
Pour qui est-elle belle ?
La nuit
Et le flot glacé des étoiles
Les pleureuses aux longs cheveux
Avec le chant déchirant des grenouilles
Sur les deux rives
Lamentations de deuil
Ranimant le souvenir
Quand chaque aube est criblée
Par le chœur
De douze balles de fusil
Si la nuit est belle en vain
Pourquoi est-elle belle
Pour qui est-elle belle ?
Ahmad Châmlou (1925-2000), traduction
Farideh Rava et Alain Lance, dans Europe,
"Littérature d'Iran", n° 997, mai 2012, p. 261.
*

Forough Farrokhzâd
Il n'y a que la voix qui reste
Pourquoi m'arrêterai-je, pourquoi ?
Les oiseaux sont partis en quête d'un chemin bleu
L'horizon est vertical
L'horizon est vertical et le mouvement : jaillissant
et dans les tréfonds du regard
Les planètes lumineuses tournoient
La terre dans les hauteurs se répète
Et les puits emplis d'air
Se transforment en galeries de liaison
Et le jour est une étendue
Que ne saurait contenir le rêve étroit
Du vermisseau qui ronge le journal
Pourquoi m'arrêterai-je ?
Le chemin passe à travers les vaisseaux de la vie
L'atmosphère de la matrice lunaire
Tuera les humeurs
Et dans l'espace chimique après le lever du soleil
Il n'y aura que la voix
Infiltrée par les particules du temps
Pourquoi m'arrêterai-je ?
[...]
Forough Farrokhzâd (1933-1968), traduction Sara Saïdi Boroujeni, dans Europe, "Littérature d'Iran", n° 997, mai 2012, p. 286.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : a. châmlou, f? farrokhzâd, poésie d'iran, la beauté, la voix | ![]() Facebook |
Facebook |
14/05/2012
Guido Cavalcanti, Rime (traduction Danièle Robert)

XIII sonnet
Vous qui par les yeux mon cœur avez percé
et réveillé ma pensée endormie,
voyez combien angoissante est ma vie
qui, soupirante, est par amour brisée.
Et c'est si vaillamment qu'il l'a taillée
que s'en enfuient les esprits affaiblis :
seule survit une forme inouïe,
voix de douleur sous sa loi exhalée.
Cette vertu d'amour qui m'a vaincu
depuis vos nobles yeux vite s'est mue
et m'a lancé un trait là dans le flanc ;
le premier coup au but est parvenu,
si bien que l'âme est sortie en tremblant,
au côté gauche un cœur mort ayant vu.
XIII sonetto
Voi che per li occhi mi passate 'l core
e destaste la mente che dormia,
guardate a l'angosciosa vita mia
che sospirando la distrugge Amore.
E' ven tagliando di si gran valore
che ' deboletti spiriti van via :
campa figura nova, e 'n segnoria
è voce alquanta, che parla dolore.
Quest'è vertù d'Amor, che m'à disfatto :
da' vostr'occhi presta si mosse,
d'un dardo mi lanciò dal fianco ;
si giunse ritto 'l colpo al primo tratto,
che l'anima tremando si riscosse,
veggendo morte 'l cor nel lato manco.
Guido Cavalcanti, Rime, édition bilingue, traduit
de l'italien et annoté par Danièle Robert, éditions
vagabonde, 2012, p. 67 et 66.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guido cavalcanti, rime, poésie amoureuse | ![]() Facebook |
Facebook |
13/05/2012
Alejandra Pizarnik, Récits (traduction Jacques Ancet), Poemas franceses

Tragédie
Avec la rumeur des yeux des poupées agités par le vent si fort qu'il les faisait s'ouvrir et se fermer un peu. J'étais dans le petit jardin triangulaire et je prenais le thé avec mes poupées et la mort. Et qui est cette dame vêtue de bleu au visage bleu au nez bleu aux lèvres bleues aux dents bleues, aux ongles bleus et au seins bleus aux mamelons dorés ? C'est mon professeur de chant. Et qui est cette dame en velours rouge qui a une tête de pied, émet des particules de son, appuie ses doigts sur des rectangles de nacre blancs qui descendent et on entend des sons, les mêmes sons ? C'est mon professeur de piano et je suis sûre que sous ses velours rouges elle n'a rien, elle est nue avec sa tête de pied et c'est ainsi qu'elle doit se promener le dimanche sur un grand tricycle rouge à la selle de velours rouge en serrant la selle avec les jambes toujours plus serrées comme des pinces jusqu'à ce que le tricycle s'introduise en elle et qu'on ne le voie jamais plus.
Tragedia
Con el rumor de los oios de las muñecas movidos por el viento tan fuerte que los hacías abrirse y cerrarse un poco. Yo estaba en el pequeño jardín triangular y tomaha el té con mis muñecas y con la muerte. ¿ Y quién es esa dama vestida de azul de cara azul y nariz azul y labios azules y dientes azules y uñas azules y senos azules con pezones dorados ? Es mi maestras de canto. ¿ Y quién es esa dama de terciopelos rojos que tiene cara de pie y emite particulas de sonidos y apoya sus dedos sobre rectángulos de nácar blancos que descienden y se oyen sonidos, los mismos sonidos ? Es mi professora de piano y estoy segura de que debajo de sus terdiopelos rojos no tiene nada, está desnuda con su cara de pie y así ha de pasear los domingos en un gran triciclo rojo con asiento de terciopelo rojo apretando el asiento con las piernas cada vez más apretadas como pinzas hasta que el triciclo se le introduce adentro y nunca más se lo ve.
Alejandra Pizarnik, Récits, traduits par Jacques Ancet dans La revue de belles-lettres, 2011, 2, p. 79 et 78.
*
Et quoi penser du silence ? — Dormir oui, travailler quelques jours avec le rêve et m'épargner le silence. Il faut renverser tant de choses dans si peu de jours, faire un voyage si long dans si peu de jours. On me dit : choisis le silence ou le rêve. Mais je suis d'accord avec mes yeux ouverts qui devront aller — aller et jamais revenir — à cette zone de lumière vorace qui te mangera les yeux. Tu veux aller. Il le faut. Petit voyage fantôme. Quelques jours de travaux forcés pour ton regard. Ce sera comme toujours. Cette même douleur, cette désaffection. Ce non-amour. On meurt de sommeil ici. On aimerait se donner le plus vite possible. Quelqu'un a inventé ce plan sinistre : un retour au regard ancien, un aller à la recherche d'une attente faite de deux yeux bleus dans la poussière noire. Le silence est tentation et promesse. Le but de mon initiation. Le commencement de toute fin. C'est de moi que je parle. Il arrive qu'il faut aller une seule fois pour voir si pour une seule fois encore te sera donné de voir. On meurt de sommeil. On désire ne pas bouger. On est fatigué. Chaque os et chaque membre se rappelle ses anciens malheurs. On est souffrante et on rampe, on danse, on se traîne. Quelqu'un a promis. C'est de moi que je parle. Quelqu'un ne peut plus.
Alejandra Pizarnik, Poemas franceses, dans La revue de belles-lettres, 2011, 2, p. 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alejandra pizarnik, récits, poemas franceses, jacques ancet | ![]() Facebook |
Facebook |
12/05/2012
Raymond Queneau, Battre la campagne, Courir les rues, Fendre les flots

Jardin oublié
L'espace doux entre verveines
entre pensées entre reines-
marguerites, entre bourdaines
s'étend à l'abri des tuiles
l'espace cru entre artichauts
entre laitues entre poireaux
entre pois entre haricots
s'étend à l'abri du tilleul
l'espace brut entre orties
entre lichens entre grimmies
entre nostocs entre funaries
s'étend à l'abri des tessons
en ce lieu compact et sûr
se peut mener la vie obscure
le temps est une rature
et l'espace a tout effacé
Raymond Queneau, Battre la campagne, Gallimard,
1968, p. 83.
Les entrailles de la terre
La bonne et douce chaleur du métro
dehors il vente il pleut il neige
il y a du verglas il y a de la boue
il y a des ouatures qui veulent vous mordre
et puis voilà le métro qui vous attend le bouche
ouverte
oh ! la bonne la douce haleine
on descend gaiement l'escalier
il ait de plus en plus chaud
on oublie la pluie le vent la neige
le verglas la boue les ouatures
une femme charmante ou un bon noir
fait un petit trou bien rond
dans votre rectangle de carton
et vous voilà bien au chaud
dans la bonne et douce chaleur du métro
Raymond Queneau, Courir les rues, Gallimard,
1968, p. 96.
Le cœur marin
Regrets perdus dans la marée
crêtes abîmées par le vent
ceux-là sans cesse ramenés
et celles-ci disparaissant
nul effluve nulle rosée
ne vient calmer le palpitant
la vague verte abandonnée
s'abat perpétuellement
tandis que chaque jour rapporte
tous ces regrets devant la porte
Raymond Queneau, Fendre les flots, Gallimard,
1968, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, battre la campagne, courir les rues, fendre les flots | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2012
René Char, Chants de la Balandrane

Le jonc ingénieux
J'entends la pluie même quand ce n'est pas la pluie
Mais la nuit ;
Je jouis de l'aube même quand ce n'est pas l'aube
Mais la blancheur de ma pulpe au niveau de la vase.
La bouche d'un enfant me froisse avec ses dents.
Amour des eaux silencieuses !
À l'aubépine le rossignol,
À moi les jeux fascinants.
*
Ne viens pas trop tôt
Ne viens pas trop tôt, autour, va encore ;
L'arbre n'a tremblé que sa vie ;
Les feuilles d'avril sont déchiquetées par le vent.
La terre apaise sa surface
Et referme ses gouffres.
Amour nu, te voici, fruit de l'ouragan !
Je rêvais de toi décousant l'écorce.
René Char, Chants de la Balandrane, Gallimard, 1977, p. 48, 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, chants de la balandrane, jonc, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
10/05/2012
Ariane Dreyfus, Nous nous attendons (lecture)

Nous nous attendons ne réunit pas seulement des poèmes, s'y ajoutent deux essais sur la "fabrique" de deux poèmes (présents p. 64 et p. 65), qui permettent de comprendre le sous-titre. La relation à Gérard Schlosser et à ses tableaux figuratifs est introduite dans la page d'ouverture, "Ce qui est arrivé" ; pour Ariane Dreyfus, sa difficulté à regarder des tableaux vient de ce qu'elle se trouve devant eux, presque toujours, « privée du monde comme on se trouve privé d'air », et qu'alors « le sens de la vie est tout à fait perdu ». Le hasard lui a fait connaître les tableaux de Gérard Schlosser, ce qui a transformé sa relation à la peinture et a suscité l'écriture de Nous nous attendons.
Il ne s'agissait de reproduire avec les mots des tableaux et les allusions à une toile précise sont rares ; on reconnaît en partie un motif du peintre dans le poème "Tu peux dormir si tu veux" et bien des vers peuvent sans difficulté évoquer tel détail d'une toile : il suffit pour s'en convaincre, en ayant le livre d'Ariane Dreyfus en tête, de feuilleter la monographie de Bernard Noël consacrée à Schlosser. L'essentiel n'est pas là, le propos était d'écrire « pour provoquer un effet approchant ». On sait que le peintre restitue sur ses toiles des éléments du quotidien dans leur banalité, le tissu non vu des jours, des corps aussi plus ou moins fragmentés — un sein, des genoux repliés, etc. —, et que le titre de chacune paraît être, souvent, une phrase à la signification transparente, propre à la conversation familière, comme "Tu as trouvé du muguet ?" (1971), "Tu le connais ?" (1974), "Il ne se plaignait jamais" (1976) et, récemment, "À peu près" (2009), "On aurait pu" (2011). Ariane Dreyfus conserve ce principe et introduit ainsi un décalage entre le titre choisi, toujours un lieu commun, et le contenu du poème, pour créer un « effet de béance », alors que dans la tradition poétique le titre constitue plus ou moins un programme— tradition bien malmenée par ailleurs par bien des poètes, mais selon d'autres règles.
Dans ses réflexions sur l'écriture, Ariane Dreyfus précise qu'elle a pris pour règle d'exclure le "je" et le "tu", présents dans les titres, dans le corps des poèmes où viennent seulement « des ils et des elles qui rest[ent] à la frontière entre présence et personnages ». Toute règle étant établie pour ne pas être toujours suivie, on relèvera qu'un titre, "Arrête, veux-tu" prend place dans un vers (p. 48) : « elle se mange un ongle » et « Il prend son poignet arrête veux-tu ». Si la relation entre le titre (par exemple "Tu aurais pu dire une chose pareille ?" ou "Moi aussi j'ai essayé") — et ce qui le suit est presque toujours absente, elle peut à l'inverse être exhibée ; au titre "Je joue" répond :
Elle levait l'escargot devant son visage
En l'air il était bien obligé
De faire des boucles avec son muscle interrogatif
Les heures au fond du jardin
Je ne fais pas de mal je fais du silence
On ne serre pas une aussi légère coquille
Dans ce poème, en même temps la règle d'exclusion du "je" n'est pas suivie.
Ces délimitations faites, qu'en est-il des poèmes, partagés en six ensembles contenant chacun, mais à la suite d'un poème, une citation qui oriente, ou peut orienter, la lecture. La figure du peintre apparaît à plusieurs reprises, par exemple à l'issue de son activité : « Il pose son pinceau dans le pot de pinceaux ». Cependant la quasi totalité du livre est consacrée à "il" et "elle", presque toujours dans une relation amoureuse, relation qui déborde les autres "sujets" de poème ; ainsi, "Tout un après-midi" met en scène deux poireaux (poireaux présents chez Schlosser), mais s'achève par :
Tout penchés dans leur pot, des pinceaux
Se touchent-ils au fond de leur eau ?
Ariane Dreyfus précise que "il" et "elle" « semblent revenir d'un poème à l'autre, sans pour autant rien affirmer de leur identité ». Ce retour aboutit à ce que les poèmes, toujours brefs, les plus longs ne dépassant pas une douzaine de vers, se lisent comme un récit de gestes amoureux intimes, simples, et le sentiment d'une continuité est renforcé par toute une série d'indices. Deux vers, page 29,
Elle a laissé le couteau et l'a posé
La moitié de la pomme aussi
semblent se poursuivre page 102 avec
La pomme coupée
Tombe en morceaux sur la table
Autres marques discrètes, la reprise à différents moments de "oui" ou, plus forte, celle d'un vers qui achève un ensemble (« Sur l'oreiller la joue fait commencer le visage ») et commence le suivant, ou le déplacement d'une serviette, ou d'une couverture sur le lit. Plus visible la quasi unité de lieu — la chambre, le lit — et de saison —le printemps, l'été, en accord avec les gestes amoureux — ; une mention, unique, de l'hiver (« La neige du dehors rafraîchit le carrelage ») est corrigée par la présence d'une jacinthe fleurie. Plus visible encore apparaît le retour de la chevelure de "elle", qui s'étend jusqu'aux poireaux vus « échevelés », et, d'un bout à l'autre du livre, de la nudité féminine, avec la récurrence de "nu", "nudité" (« Nue d'en bas », « Bras entièrement nus », « une cuisse très nue », «La nudité s'arrête à la taille », etc. ) et masculine (« Tout près de la serviette le sexe / reste humide avec ses plis et lourd » ).
Ariane Dreyfus n'a pas abandonné le lyrisme, mais la succession de scènes minuscules avec pour personnages un "il" et un "elle" (pas toujours ensemble) suggère à mes yeux, par une mise à distance du "je + tu", de relire autrement les livres précédents. Certes, l'expérience, le vécu passent ici et ailleurs dans les poèmes, mais qu'Ariane Dreyfus, dans la réalité, adore les cerises (j'en témoigne...) ne signifie pas qu'elle écrit à propos de ces cerises ; elle note justement dans la première annexe, "Cerises interlocutrices", que tout cerisier lui évoque le « paradis entrevu » de l'enfance, mais tout autant important « celui dont parle Rousseau dans le livre IV des Confessions. », et elle ajoute « La cerise est pour moi un fruit essentiellement mental. » Ceci dit, le lecteur retrouvera la force des ellipses qu'affectionne Ariane Dreyfus, comme « Elle se lève avec l'envie d'être deux » qui se résout en « À deux, ils font un corps », la tranquille assurance que tout de l'étreinte peut être dit (« Quand la bouche se décolle du sexe qui a joui »), l'audace de la simplicité pour désigner le sexe féminin (« La moitié d'un losange / En dessous c'est un peu d'ombre c'est creux) ». Une nature aussi, dans laquelle se fondre, magiquement, puisque presque toujours elle ne se sépare pas de l'humain (« Le pommier lance son geste compliqué »), où les éléments se mêlent (« C'est la nature, le ciel touche directement l'herbe ») ; nature parfois inattendue : l'ellipse la rapproche d'un lieu carrollien : « L'herbe va si loin un animal bondirait dessus / Déjà évanoui ».
La mise en place du jeu entre le lieu commun du titre et le "il + elle", présent et abstrait tout à la fois, la composition dont j'ai brièvement souligné la complexité, l'inventivité dans les images elliptiques font de Nous nous attendons autre que, par exemple, Iris, c'est votre bleu (2008). Il était juste d'y inclure les annexes sur la construction de deux poèmes, non pour montrer comment cela se fait : on ne voit rien, mais pour faire prendre conscience que ce n'est pas avec l'"inspiration" que l'on aboutit à une dizaine de vers qui semblent couler de source. Une réussite.
Un poème (p. 61) :
« Peut-être »
Sur l'oreiller la joue fait commencer le visage
Quelqu'un chauffe la terre de son corps
Son épaule fait glisser, obéissante,
La couverture au poids presque vivant
Aux courbes ses lignes, d'orange et de rouge continus
Se perdent, se rencontrent, touchent les losanges noirs,
Les uns repoussés doucement dans un creux,
D'autres tachés de soleil
Jusqu'aux pieds découverts
Ne laissant rien dans la mémoire se tordre.
Ariane Dreyfus, Nous nous attendons (Reconnaissance à Gérard Schlosser), Le Castor Astral, 2012.© Photo Tristan Hordé
Cette note de lecture a paru en avril 2012 dans Terres de femmes la revue littéraire d'Angèle Paoli.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, nous nous attendons, gérard schlosser | ![]() Facebook |
Facebook |
09/05/2012
James Sacré, Si les felos traversent par nos poèmes ?

I
Il y a des noms de villages. De l'ordre dans les champs.
Paysans-masques pour tout chambouler, les voilà
Puis les voilà partis :
Ça se défait d'un coup le carnaval, et comment
C'est là tous les ans, pourquoi ?
Si c'est juste pour que
Tout l'monde un peu rigole ou si
De la vérité soudain te bouscule ?
Pour aussitôt
T'abandonner, silence : le fond d'un pré continue
Ou tel coin de grenier que personne y va plus.
Même à l'occasion des grands défilés fêtards
Organisés tenus selon que c'est prévu,
Bâle ou Rio, Nice et partout, ça s'en va comme à côté :
Un fifre et deux tambours tournent
Le coin de la rue
(Tant pis, t'auras pas ta photo !) ou fifre tout seul
Avec son costume et sa façon têtue
D'avancer dans la ville jusqu'à on se demande, et ça sera
Qu'un retour à la maison, le masque ôté, plus rien.
Si la fête au loin continue ?
Par les chemins de Galice on voit
Les paysans felos
S'en retourner dans les champs
Après qu'il est passé le carnaval,
Passé selon les règles et pas de règles et pas sûr que c'était
Si grande fête au village : façon plutôt de penser
À ça qu'on a perdu, et savoir
Si personne l'a jamais vécu ?
Je pense à des carnavals qui m'emportent
Et qui n'existent plus
Où moi j'ai vécu. Je voudrais venir
Dans un costume de mots
Pour dire à mon village
Qu'on se demande encore, à des endroits qui lui ressemblent
(Châtaigniers, la pluie, quelques paysans),
D'où on vient, qui on est ? Personne a jamais trop su,
Quel sens et pas de sens
En de vieux gestes continués
Parmi ceux de la modernité ?
[...]
James Sacré, Si les felos traversent par nos poèmes ?, photographies d'Emilio Arauxo et James Sacré, éditions Jacques Brémond, 2012, p. 8-15.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, les felos, poèmes, carnaval | ![]() Facebook |
Facebook |
08/05/2012
Jacques Prévert, Choses et autres

Mai 1968
I
On ferme !
Cri du cœur des gardiens du musée homme usé
Cri du cœur à greffer
à rafistoler
Cri d'un cœur exténué
On ferme !
On ferme la Cinémathèque et la Sorbonne avec
On ferme !
On verrouille l'espoir
On cloître les idées
On ferme !
O. R. T. F. bouclée
Vérités séquestrées
Jeunesse bâillonnée
On ferme !
Et si la jeunesse ouvre la bouche
par la force des choses
par les forces de l'ordre
on la lui fait fermer
On ferme !
Mais la jeunesse à terre
matraquée piétinée
gazée et aveuglée
se relève pour forcer les grandes portes ouvertes
les portes d'un passé mensonger
périmé
On ouvre !
On ouvre sur la vie
la solidarité
et sur la liberté de la lucidité.
II
Des gens s'indignent que l'Odéon soit occupé alors qu'ils trouvent tout naturel qu'un acteur occupe, tout seul, la Tragi-Comédie-Française depuis de longues années afin de jouer, en matinée, nuit et soirée, et à bureaux fermés, le rôle de sa vie, l'Homme providentiel, héros d'un très vieux drame du répertoire universel : l'Histoire antienne.
Jacques Prévert, Choses et autres, "Le Point du Jour", Gallimard, 1972, p. 236-237.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques prévert, choses et autres, mai 1968, jeunesse | ![]() Facebook |
Facebook |
07/05/2012
Fernando Pessoa, Poésie d'Alvaro de Campos

Lisbon revisited
Rien ne m'attache à rien.
Je veux cinquante choses en même temps,
Avec une angoisse de faim charnelle
J'aspire à un je ne sais quoi —
de façon bien définie à l'indéfini...
Je dors inquiet, je vis dans l'état de rêve anxieux
du dormeur inquiet, qui rêve à demi.
On a fermé sur moi toutes les portes abstraites et nécessaires,
on a tiré les rideaux de toutes les hypothèses que j'aurais pu
voir dans la rue,
il n'y a pas, dans celle que j'ai trouvée, le numéro qu'on m'avait
indiqué.
Je me suis éveillé à la même vie sur laquelle je m'étais endormi.
Il n'est jusqu'aux armées que j'avais vues en songe qui n'aient été
mises en déroute.
Il n'est jusqu'à mes songes qui ne se soient sentis faux dans
l'instant où ils étaient rêvés.
Il n'est jusqu'à la vie de mes vœux — même cette vie là — dont
je ne sois saturé.
[...]
Lisbon revisited
Nada me prende a nada
Quero cinqüenta coisas ao mesmo tempo.
Anseio com uma angústia de fome de carne
O que não sei que seja _
Definidamente pelo indefinido...
Durmo irrequieto, e vivo num sonhar irrequieto
De quem dorme irrequieto, metade a sonhar.
Fecharam-me tôdas as portas abstratas e necessárias.
Correram cortinas de tôdas as hipóteses que eu poderia ver na rua.
Não há na travessa achada número de porta que me deram,
Acordei para a mesma vida para que tinha adormecido.
Até os meus exércitos sonhados sofreram derrota.
Até os meus sonhos se sentiram falsos ao serem sonhados.
Até a vida só desejada me farta — até essa vida...
Fernando Pessoa, Poésies d'Alvaro de Campos [Poesias de Alvaro de Campos], traduit du portugais et préfacé par Armand Guibert, "Du Monde entier", Gallimard, 1968, p. 67 et 66.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, poésies d'alvaro de campos, lisbonne, nada | ![]() Facebook |
Facebook |
06/05/2012
Samuel Beckett, D'un ouvrage abandonné, dans Têtes-mortes

D'un ouvrage abandonné
Debout au petit matin ce jour-là, j'étais jeune alors, et dans un état, et dehors, ma mère pendue à la fenêtre en chemise de nuit pleurant et gesticulant. Beau matin frais, clair trop tôt comme si souvent, mais alors dans un état, très violent. Le ciel allait bientôt foncer et la pluie tomber et tomber toujours, toute la journée, jusqu'au soir. Puis de nouveau bleu et soleil une seconde, puis nuit. Sentant tout ça, combien violent et la journée que ça allait être, je fis halte et demi-tour. Ainsi retour tête baissée à l'affût d'un escargot, limaçon ou ver. Grand amour au cœur aussi pour tout ce qui est fixe et à racine, cailloux, arbustes et similaires, trop nombreux à dire. Alors qu'un oiseau, voyez-vous, ou un papillon, me voltigeant autour en travers de ma route, tut ce qui bouge, en travers de mon chemin, sous mes pieds, non, pas de quartier. Dire que je me déroutais pour les attraper, ça non, à distance souvent ils semblaient fixes, puis l'instant d'après ils m'arrivaient dessus. Des oiseaux j'en ai vu de ma vue perçante voler si haut, si loin, qu'ils semblaient au repos, puis l'instant d'après ils m'arrivaient tout autour, des corbeaux m'ont fait ça. Les canards c'est peut-être le pire, se voir soudain en train de trépigner et de trébucher au milieu des canards, ou des poules, peu importe, la volaille, il n'y a guère pire. Et même si évitable ce genre de choses pas question que je me déroute pour l'éviter, non, tout simplement pas question que moi je me déroute, tout en n'ayant été de ma vie en route pour quelque part, mais tout simplement en route.
Samuel Beckett, Têtes-mortes, traduit de l'anglais par Ludovic et Agnès Janvier en collaboration avec l'auteur, éditions de Minuit, 1967, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, têtes mortes | ![]() Facebook |
Facebook |
05/05/2012
Anna Akhmatova, Dédicace, dans Requiem

Dédicace
Devant ce malheur les montagnes se courbent
Et le grand fleuve cesse de couler.
Puissants sont les verrous des geôles,
Et derrière, il y a les trous du bagne
Et la tristesse mortelle.
C'est pour les autres que souffle la brise fraîche,
C'est pour les autres que s'attendrit le crépuscule _
Nous n'en savons rien, nous sommes partout les mêmes,
Nous n'entendrons plus rien
Hormis l'odieux grincement des clefs
Et les pas lourds des soldats.
Nous nous levions comme pour les matines,
Dans la Capitale ensauvagée nous marchions,
Pour nous retrouver plus inanimées que les morts.
Voici le soleil plus bas, la Néva plus brumeuse
Et l'espoir nous chante au loin, au loin.
Le verdict... D'un coup jaillissent des larmes.
Déjà elle est retranchée du monde,
Comme si de son cœur on avait arraché la vie,
Ou comme si elle était tombée à la renverse.
Pourtant elle marche... titube... solitaire
Où sont à présent les compagnes d'infortune
De mes deux années d'épouvante ?
Que voient-elles dans la bourrasque sibérienne,
À quoi rêvent-elles sous le cercle lunaire ?
Je leur envoie mon dernier salut.
Mars 1940
Anna Akhmatova, Requiem, traduit du russe par Paul Valet,
éditions de Minuit, 1966, p. 17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, requiem, dédicace, goulag | ![]() Facebook |
Facebook |
04/05/2012
Jean Tardieu, Elle court de branche en branche, dans Margeries

Elle court de branche en branche
Bel ange mon cruel démon
je te l'ai dit je le redis
tu me fais vivre tu me tues
démon de délice, ange d'or,
tu me ravis, tu me dévores,
tu es la halte et le galop,
qui m'emporte jusqu'au délire
jusqu'à la fin de mon chemin
Feu follet flamme autant que femme
tu cours devant moi tu me tires
je te vois partout te poser
sur les visages sur les vitres
sur la neige sur les reflets
je te vois partout traverser
cette immense forêt qui bouge
des gens qui marchent dans la rue
oiseau qui cours de branche en branche
charme et supplice de mon âge
de mon désir et de ma soif
tu sautes d'instant en instant
tu me fais signe tu me parles
j'entends ton rire je m'approche
mais aussitôt tu te dérobes
pour te poser un peu plus loin
et toujours la chasse adorable
et toujours ton malin manège
m'aveugle et je vais à tâtons
dans cette nuit qui m'accompagne
cherchant ce corps qui n'est que flamme
que mes bras ne peuvent saisir
cette bouche qui fuit ma bouche
cette main frêle qui me tient
cette main tendre qui me traîne
dans l'étourdissement du rire
dans l'éblouissement du feu
dans l'abîme de mon destin.
Jean Tardieu, Margeries, Gallimard, 1986, p. 87-88.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, margeries, poème amoureux | ![]() Facebook |
Facebook |
03/05/2012
Georges Perros, Papiers collés

Demander le sens d'un vers, c'est vouloir en savoir plus long que le poète lui-même. Le sens d'un vers, c'est et ce ne peut être que le vers lui-même. Le poète s'embarrasse, manque « d'esprit » si jamais il croit pouvoir signifier autrement que par la poésie. Et donne des regrets.
Ce qu'il y a de brutal et d'exemplaire chez Rimbaud, c'est qu'il rend la vie inutile. Inutilisable. Toute lecture, toute ambition intellectuelle, hors de question. Puisqu'un Rimbaud est possible, tout est vain. Il arrive et il parle. Et sa parole est un chant. Et ce chant implique tous les chants possibles. Et les annule. L'expérience, la durée, l'homme sont ici mis en déroute. Il renverse toutes les lois, en imposant la loi qui est et reste le haut fait d'être ce que l'on est. Il ne vit que par raccroc, il respire parce qu'il faut
bien. Et peu importe alors ce qu'il va faire de cette vie dérisoire. Sa poche d'ignorance, d'inspiration est préservée. Il rend à ce qu'on nomme la vie le suprême hommage, qui consiste à opérer comme si l'on n'avait que faire de ce qu'elle laisse espérer. Héritier milliardaire qui vivrait comme si ce trésor ne lui était de rien. Superbe mépris. Il rendra la cassette pleine, sans même s'être soucié d'en vérifier les richesses. Antiphilosophique extrême qui respecte aussi peu la mort que la vie. Il avance oreilles bouchées, lèvres closes, muet jusqu'au rire ; oui proprement angélique. Brûlant toutes ses cartes sans calcul, sans préméditation, sans plaisir. Il est ce qu'il est et fait ce qu'il fait. Le secret de Rimbaud, c'est l'évidence. Un rien de présence déplacée et c'en était fait. Il réussissait ou il échouait. Alors que son destin n'est pas qualifiable. Est le présent même.
Georges Perros, Papiers collés, Gallimard, 1960, p. 33, 78-79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, papiers collés, rimbaud, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
02/05/2012
Laure, Écrits

Qui es-tu
visage aigu
lame
à reflets durs
fend l'air
entame
mon rêve
que je sois assise
te faisant face
ou couchée
tête renversée
tu m'apparais
échappant à la pesanteur
inscrivant dans l'air
toute une géométrie précise
aussi précise
que cet angle volontaire
où s'inscrit le sourire forcé
de lèvres amères
aux plis railleurs
Précision des gestes,
limite
de l'espace harmonieux,
clair
où tu vis
*
Le moment
où tout retombe
dans l'absurde
si absurde
que mieux vaut
parler
pour ne rien dire
grimacer
et sourire
Laure, Écrits, précédé de Ma Mère diagonale par Jérôme Peignot,
avec une Vie de Laure par Georges Bataille, Jean-Jacques Pauvert, 1971,
p. 232 et 233.
© Cliché collection Jérôme Peignot.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laure, écrits, jérôme peignot | ![]() Facebook |
Facebook |
01/05/2012
Montéhus, L'impôt sur les feignants (chanson, 1930)

L’impôt sur les feignants
Que l’on impose les très grandes richesses,
Ceux qui possèdent des châteaux, des palais,
Ceux dont la vie n’est faite que d’allégresse
Sans nul souci, ne travaillant jamais,
Que l’on impose les archi-millionnaires
Mais qu’ désormais on laisse à l’ouvrier
Intégralement l’argent de son salaire
Pour qu’il n’y ait plus d’ misère à son foyer.
Au lieu d’imposer l’ travailleur
Qui gagne le pain de ses enfants
Imposez plutôt les noceurs
Qui gaspillent tant d’argent.
Refrain :
Oh, oui ! La loi qu’il fallait faire
J’ vous l’ dis, messieurs du Parlement
C’est pas l’impôt sur les salaires
Mais c’est l’impôt sur les feignants
Vous qui voulez qu’on repeuple la France
N’écrasez pas par de nouveaux impôts
Le travailleur, car alors sa conscience
Se révolterait contre tous ses bourreaux.
Ce que le père peut gagner à l’usine
Ça, c’est sacré ! Messieurs, n’y touchez pas !
Oui, votre impôt, c’est l’impôt d’ la famine
Et cette loi, Marianne, fiche-la en bas
Au lieu d’imposer l’ travailleur
Qui enrichit l’ gouvernement
Imposez plutôt les noceurs
Et qu’ils paient pour les pauvres gens
Gaston Mardochée Brunschwick, dit Montéhus (1872-1952)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montéhus, l'impôt sur les feignants | ![]() Facebook |
Facebook |





