06/08/2012
Pierre-Albert Jourdan, Ajouts aux Fragments

Ceci est ma forêt. J'entretiendrai cette exubérance de piliers, mais que pourraient-ils soutenir, ô maçons ! Et que l'on ait pris soin de balayer le sol quand le feu vient d'en haut, qu'il plonge sur ma forêt!
Ceci est ma forêt. Est-ce ma maison ? Cela ne se règle pas par un jeu d'écriture. Et si c'est ma maison, elle est ouverte. Non pas cette porte en face de moi, ces silhouettes. Ouverte à tout autre chose. À ce tout autre qui est là, que les piliers ne peuvent contenir. Ouverte, simplement ouverte comme une déchirure de lumière. Une déchirure, oui. Les piliers ne sont là, qui paraissent soudain s'épanouir, vivre, que pour m'épauler. « Suis-moi... » Je retrouve en moi ce début de phase. Je m'arrête à ce début. Si encore je pouvais m'accomplir en tant qu'homme, me hausser un tout petit peu. Leçon de piliers sans doute. Si encore j'étais capable de me repêcher, n'est-ce pas ?
Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments, éditions Poliphile, novembre 2011, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-albert jourdan, ajouts aux fragments, forêt, maison | ![]() Facebook |
Facebook |
05/08/2012
Antoine Emaz, Peau

Seul, 6 (18. 11. 06)
Il n'y a pas de bout de la nuit
seulement une maison vide
et silencieuse de tous ses murs
on est dedans
pas en prison
mais dedans
et la nuit comme aveugle
tourne en rond
les mots piochent piquent
des étoiles
on dira ça comme ça
des lumières fermées
tension
ce silence qui vient de biais si l'on n'agit pas c'est lui qui va emporter la mise la main les mots dans l'ardoise et plus rien
pas facile d'aller contre l'aigu du silence dans la maison vide il siffle comme chez lui il sape il pèse ensuite habitué qu'il est du lieu
une lame de nuit
tension sans l'avoir vue venir — vite glisser — tension — nerfs cordes mais quelle musique grommellement de mots pour rien ce bruit de chien grondant comme pour intimider le silence dessous qui passe
continuer à parler — rester dans le blanc de la lampe plutôt que la nuit qui tait la maison tait tout
un bruit d'eau presque rassure dans la gouttière
on tient à peu
[...]
Antoine Emaz, Peau, Tarabuste, 2008, p. 113-114.
© Photo Tristan Hordé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, peau, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
04/08/2012
Michel Leiris, Mots sans mémoire
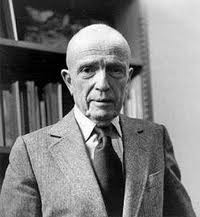
Marrons sculptés pour Miró
1
Les poches veuves de cailloux blancs,
viens-nous-en
où va la ligne qui s'envole
sans avoir à jeter du lest
2
Ciel comme celui du lit
étoile comme celle de la mer
cardinal comme le gentil oiseau que dénomme
sa couleur]
chinois à l'eau-de-vie
3
Quelque chose de l'ordre d'un feu frais
ou d'un désert surpeuplé.
À chaque battement d'horloge
roses des sables et flambées de plumes
jaillissent du creuset de ses doigts
et marquent le vide à son chiffre.
4
Le tubercule n'a-t-il pas ses lagunes
ses estuaires,
ses deltas et ses fleuves côtiers ?
Celui qui lâche des cerfs-volants
aux quatre coins de l'azur
n'a que faire de l'autre face de la lune.
[...]
Michel Leiris, Mots sans mémoire, Gallimard, 1969,
p. 135-138.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, mots sans mémoire, miró | ![]() Facebook |
Facebook |
03/08/2012
Paul Louis Rossi, Visage des nuits

Gens de peu
Gens de peu et gens de rien
Quel est le bras qui vous retient
Lorsque vous passez la Seine
Sans amours qui vous soutiennent
Vous pensez je le sais bien
Sans veine que tout est vain
Sans amis qui se souviennent
À vous jeter dans la Seine
Sachez que ce n'est pas la peine
De troubler l'eau avec des larmes
Essayez de donner l'alarme
Si le courant vous entraîne
Le Fleuve est moins bon que vous-même
Pourquoi voulez-vous qu'il vous aime
Paul Louis Rossi, Visage des nuits, Poésie / Flammarion,
2005, p. 97.
© photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, visage des nuits, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
02/08/2012
Giuseppe Ungaretti, Vie d'un homme

Du soir
Dans les soupirs humides de ta nudité
Tu dérobes un secret. Souriant,
Rien, retenant son souffle, n'est plus doux
Que de t'entendre consumer
Au soleil moribond
L'ultime flamboiement de l'ombre, terre !
Soir
Aux pieds des pas du soir
Coule une eau claire
Couleur d'olive,
Jusqu'au feu bref et sans mémoire.
À cette heure dans la fumée j'entends rainettes et grillons,
Où tremblent tendres les herbes.
Giuseppe Ungaretti, Vie d'un homme, Poésie 1914-1970,
Préface de Philippe Jaccottet, Poésie / Gallimard, 2005 [1973], p. 158 (traduction Ph. Jaccottet), 163 (traduction Jean Lescure).
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuseppe ungaretti, vie d'un homme, philippe jaccottet, soir | ![]() Facebook |
Facebook |
31/07/2012
Jean-Claude Mattrat, La chose le chaos
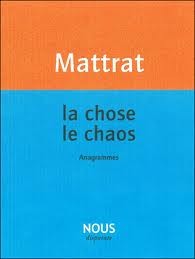
anagrammes :
artiste confirmé artifice monstre
artiste émergeant stratagème entier
l'édulcoré fait l'élu décoratif
l'acte de chair délit à cacher
tu bricoles l'obscurité
en vérité on a lu une révélation
l'identité française cadre et infantilise
l'égalité agit-elle ?
l'alternative être vaillant
pétition géante attention piège
le crétin est le centriste
Jean-Claude Mattrat, La chose le chaos, anagrammes, éditions NOUS, 2012, p. 58-59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude mattrat, la chose le chaos, anagramme | ![]() Facebook |
Facebook |
30/07/2012
Christiane Veschambre, Chaque pas du temps

dans la pièce d'à côté
ce que le souffle
de la flûte
ouvre
ce qu'il trace dans la journée
naissante
un sentier de pierres et branches
un habitat en marche
de ciel par-dessus les toits
de neige gelée
avec la sombre mate
sourde pulsation
de la goutte tombant
du robinet dans la baignoire
solfège du plein de grâces
se faire passereau
sept grammes pour toute une vie
combien les minuscules poumons ?
dans ma poitrine une enclume
prend ses quartiers
d'hiver
Christiane Veschambre, Chaque pas du temps,
Poètes au potager, Contre-allées, 2012, 5 €.
Commande : Contre-allées, 16 rue Mizault, 03100 Montluçon
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, chaque pas du temps | ![]() Facebook |
Facebook |
29/07/2012
James Sacré, Le paysage est sans légende

Malgré des mots qu'on y met
Je me rappelle très bien, près d'une ville dont on pourrait dire le nom
La forme d'un village courant sur l'arête d'un long rocher
On le voit à partir d'un autre parvis de pierre
De ce côté-ci de la faille avec du vert qui suit un cours d'eau
Il y a eu soudain la présence d'un jeune garçon
Dans un vêtement blanc, son invite à traverser. Quelques mots.
On pourrait dire son nom et donner une adresse.
Une autre année le village est resté dans la solitude de nos yeux.
Dans son peu de vert, avec le brillant d'un souvenir.
Une autre année presque tout
Disparaît dans un poème.
*
Je m'en retourne où je ne verrai pas
Ce qui ressemble à du paysage déchiré dans la montagne ;
Si le vif des pentes nues
En cette fin d'octobre, et quelques silhouettes dans le lointain
Peut-être une ou deux mules, la pointe d'un capuchon
Ou le geste qui dresse
Un outil agricole dans un endroit plus cultivé du pays
Vont pas quand même
Récrire dans l'œil de ma mémoire
Ce dessin broussaillé qui déchire le temps ?
James Sacré, Le paysage est sans légende, dessins de Guy Calamusa,
Al Manar, éditions Alain Gorius, 2012, p. 20-21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le paysage est sans légende, nom | ![]() Facebook |
Facebook |
28/07/2012
Marie-Laure Zoss, hécates

S'arc-boute et force la cohue, finira bien par sauter, le couvercle, pas vrai, du brasier de cailloux, tandis que mors à l'échine vient serrer ; colère à sa tordre roulée sur elle-même, accroche grenaille au passage de syllabes, et ça s'arrête bouclé au seuil ; au fer rouge ou même forgeant à froid, celui-là essaie, n'y arrive pas, à travers la croûte terrestre pas de coup possible porté de l'intérieur ; ça ne dégage rien ; jusqu'en lisière de la voix, verbe corseté au point mort ;
à ce jour nulle autre issue que le bond ; pieds dans les ronces fraîches ou la fleur d'acacia, celui-là ne souffre pas de s'entendre, ponts sabrés derrière soi ;
et qu'il réprime ainsi qu'âcre ballot l'empêchement d'articuler, sous folle avoine, orge des murs ; l'espace entrouvert dans le cri qu'affile la suie du martinet, un souffle d'herbe froissant le talus.
Marie-Laure Zoss, hécates (extraits), dans La revue de belles-lettres,
Société de Belles-Lettres de Lausanne, 2011-2, p. 127.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-laure zoss, hécates, la voix | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2012
Charles Dobzynski, Le Baladin de Paris

Le fantôme de la Bastille
De la forteresse des rois
Rien ne subsiste poutre ou pierre,
Sa mémoire tombe en poussière
Sur tous ceux qui furent sa proie.
Un jour de quatorze juillet
Le peuple abattit la Bastille
Plus tard ce fut Rouget de Lisle
Qui fit chanter les Marseillais.
Goliath fut tué par la fronde
D'un sans-culotte de Paris,
Le tournant que le peuple prit
Vit alors naître un nouveau monde.
Délivrant les embastillés,
Des tours on brisa les barreaux.
On ne suit plus dans le métro
Qu'une empreinte : trace oubliée.
La station Bastille a caché
Là sa secrète chapelle.
Une mosaïque rappelle
Le temps des lettres de cachet.
.
Charles Dobzynski, Le Baladin de Paris,
photographies de Louis Monier, Le Temps
des cerises, 2012, p. 62-63.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles dobzynski, le baladin de paris, le fantôme de la bastille | ![]() Facebook |
Facebook |
26/07/2012
Émile Verhaeren, Impressions

Le poète plonge dans la vie totale bien trop profondément pour qu'il écrive d'après une formule et s'inquiète d'autre chose que de s'exprimer et d'exprimer en même temps le monde. Rires, larmes, rages, espoirs, désespoirs, pitiés, charités, haines, égoïsmes, vives, vertus, foi, doutes, ardeurs, peines, vanités, angoisses, terreurs, tout cela se mêle en lui, se combat en lui, s'unit parfois en lui, tout cela, suivant les heures, est tour à tour vainqueur ou vaincu, et c'est tout cela — que la cause d'émotion vienne du dedans de lui ou du dehors — qu'il reflète et qu'il traduit. Et traduisant cela, il est l'écho du monde qui n'est que cela.
Si, dans un instant de sécurité et de joie, le poète érige en son œuvre ce qu'il est convenu d'appeler la Beauté, c'est-à-dire une image grave, simple et régulière, sacrez-le artiste de l'art pour l'art : qu'importe ? S'il décrit des tempêtes d'âmes, s'il plonge et crie, s'il grince et se flagelle, nommez-le un romantique : qu'importe ? S'il se penche sur la misère, s'il aime et guérit les plaies, s'il secourt de sa bonté les errants, les flagellés et les pauvres, appelez-le écrivain social : qu'importe encore ?
Émile Verhaeren, Impressions (troisième série), Mercure de France, 1928, p. 188.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Émile verhaeren, impressions, l'art pour l'art, la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
25/07/2012
Ariane Dreyfus, La terre voudrait recommencer
Un recoin dans un coin
On éteint sauf moi
Je ne suis pas éteinte
Lueur
Dès que ma main ne rencontre pas la terre
Mais ton dos dégagé
Lueur aussi
Le ventre et ta main
À la seconde de la mienne
D'enlever les vêtements devant
Nous derrière nous serrant
Dans les odeurs leur buisson
Il y a des creux dans la nuit
Les caressés ou caressants
Un geste un geste
Et un troisième pour serrer
Ton sexe unique.
*
Ce n'est pas une image
J'ai coupé une rose pour la rapprocher de moi
Il ne s'écartait pas, ses yeux faisaient mal
Comme un verre tendu que vous refusez
En touchant la main qui tient le verre
C'est un prince, reconnaissez-le car le printemps pâlit
De si peu d'amertume
Le plus beau est celui qui n'a pas renoncé
C'est une joie où il y a quelqu'un
Nu vous l'embrasseriez infiniment
Il n'est pas trop tard
Il y a eu ce regard qui fait jeter les fleurs
Ariane Dreyfus, La terre voudrait recommencer, Poésie / Flammarion, 2010, p. 67, 79.
©Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, le monde voudrait recommencer | ![]() Facebook |
Facebook |
24/07/2012
Pierre Dhainaut, Par grande écoute, la nuit, la nuit serait féconde

Par grande écoute, la nuit, la nuit serait féconde
Jamais de noms, uniquement des chiffres sur les portes,
chaque fois que l'on en cherche en ces couloirs,
les pas, d'eux-mêmes, se rapetissent, on le remarque,
on le remarque aussi, jamais les portes ne sont closes,
le seraient-elles, rien ne serait changé.
*
Quels murs assez drus, assez rudes, interdiraient
de chambre en chambre aux bruits de se répandre ?
De nuit, de très loin ils s'annoncent, comme des vagues
à l'assaut du rivage, ils prennent le temps de grossir
avant de se broyer, franchir l'obstacle.
Nul ne parvient à en savoir le nombre, celui des heures,
pas davantage. Aucune image, en fait, ne les atténuera,
ne dénouera l'angoisse, rassemblerait-on toutes celles
qui dès l'enfance ont enchanté l'attente, après les vagues
les arbres de la plaine, que le vent agite, devenu tempête.
[...]
Pierre Dhainaut, Par grande écoute, la nuit, la nuit serait féconde,
dans Rehauts, n° 26, automne-hiver 2010, p. 40-41.
Abonnements à 2 n° : 22 €, 26 rue du Bas, 62180, Airon-Notre-Dame.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre dhainaut, par grande écoute, la nuit, la nuit serait féconde, angoisse | ![]() Facebook |
Facebook |
23/07/2012
Ossip Mandelstam, Lettres

Ma Nadinka ! Je suis complètement perdu. C'est très dur pour moi. Nadik, je devrais toujours être avec toi. Tu es ma courageuse, ma pauvrette, mon oisillon. J'embrasse ton joli front, ma petite vieille, ma jeunette, ma merveille. Tu travailles, tu fais quelque chose, tu es prodigieuse. Petit Nadik ! Je veux aller à Kiev, vers toi. Je ne me pardonne pas de t'avoir laissée seule en février. Je ne t'ai pas rattrapée, je n'ai pas accouru dès que j'ai entendu ta voix au téléphone, et je n'ai pas écrit, je n'ai rien écrit presque tout ce temps. Comme tu arpentes notre chambre, mon ami ! Tout ce qui, pour moi, est cher et éternel se trouve avec toi. Tenir, tenir jusqu'à notre dernier souffle, pour cette chose chère, pour cette chose immortelle. Ne la sacrifier à personne et pour rien au monde. Ma toute mienne, c'est dur, c'est toujours dur, et maintenant je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Ils(1) m'ont embrouillé, me tiennent comme en prison, il n'y a pas de lumière. Je veux sans cesse chasser le mensonge et je ne peux pas, je veux sans cesse laver la boue et je n'y arrive pas.
À quoi bon te dire combien tout, absolument tout est délire, rêve inhumain et blafard ?
Ils m'on torturé avec cette affaire, cinq fois ils m'ont convoqué. Trois enquêteurs différents. Longuement : trois-quatre heures. Je ne les crois pas, bien qu'ils soient aimables.
(13 mars 1930, à Nadejda Mandelstam)
(1) Mandelstam est interrogé par le Guépéou, police politique.
Ossip Mandelstam, Lettres, traduit du russe par Ghislaine Capogna-Bardet, préface d'Annie Epelboin, Solin / Actes Sud, 2000, p. 243.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, lettres, nadejda, police politique soviétique | ![]() Facebook |
Facebook |
21/07/2012
Jean Daive, L'énonciateur des extrêmes

Tard dans sa vie
le photographe André Kertész
met en scène Elizabeth
sa femme qui vient de mourir
au moyen d'une figurine de verre
qu'il pose sur le rebord de la fenêtre
puis d'un buste de verre.
Il présente des transparences. Il conjugue
des transparences
ajoute une seconde figurine.
La lumière est mystifiée
en présence de deux anémones
un cœur de verre, un flacon
un fauteuil dépravant l'air.
Une existence à deux
recomposée, prise au polaroïd
se déroule translucide, transfigurée
jusqu'à une limpidité spectrale.
Un spectre
échappe à la trace
à l'empreinte, à la fouille
cœur et transparence, corps et transparence
langue et transparence, souvenir
et transparence — mémoire
glacée, vie glacée
ce monde photographié
proche, plus proche, très proche, familièrement
en équilibre sur l'accoudoir
d'un fauteuil
retient encore
le battement
le ciel bleu, le nuage passe —
d'une scène à l'autre, d'un buste
à l'autre
une archéologie à fond perdu —
se joue.
Jean Daive, L'énonciateur des extrêmes, éditions NOUS,
2012, p. 53-54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, l'énonciateur des extrêmes, andré kertész, transparence | ![]() Facebook |
Facebook |






