06/07/2012
Pierre Silvain, Du côté de Balbec

Longtemps, à Combray, l'enfant avait fait ses délices de la crème dans laquelle le père écrasait des fraises jusqu'à obtenir une certain ton de rose qui devait rester plus tard pour le Narrateur la couleur du plaisir, être celle du désir et du tourment amoureux. De Cabourg où il terminait Du côté de chez Swann, Proust écrivait à Louise de Mornand qu'il avait rencontré sur la digue, « par un soir ravissant et rose », l'actrice Lucy Gérard dont la robe rose, à mesure qu'elle s'éloignait, se confondait avec l'horizon (ajoutant que, pour s'être attardé à la regarder, il était rentré enrhumé). Quand j'allais à la Ferme en fin de journée acheter des cœurs à la crème, ce n'était pas en pensant à l'épisode des fraises écrasées. Comme je n'avais pas lu la Recherche, je ne savais rien non plus du rose que le soleil levant mettait sur la figure de la petite marchande de café au lait, du rose de l'aubépine dans le jardin de Tansonville, j'ignorais qu'un tissu rose doublait la robe de Fortuny que le Narrateur avait offerte à Albertine pour la tenir à sa merci.
La Ferme était une laiterie au rez-de-chaussée d'une bâtisse où de l'enseigne peinte sur sa façade subsistait seulement le contour de grandes lettres que les intempéries et le soleil avaient effacées. On poussait une porte basse, on entrait de plain-pied dans une pièce qui sentait le fade et l'aigri, le linge humide et la cendre. Dans la demi-obscurité, on s'attendait toujours à déranger une poule ou à se cogner contre un baquet. La femme retirait les cœurs de leur moule en zinc, les empaquetait, glissait l'argent dans la poche de son tablier. Personne n'avait gardé le souvenir qu'elle ait jamais engagé la conversation, salué et encore moins reconduit l'acheteur jusqu'au seuil de son antre. Elle pouvait se montrer méfiante, malgracieuse, mais nullement obligée à l'égard de ce dernier, puisqu'il reviendrait.
Pierre Silvain, Du côté de Balbec, L'escampette, 2005, p. 92-93.
©Photo Tristan Hordé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, du côté de balbec, proust, laiterie | ![]() Facebook |
Facebook |
05/07/2012
Jude Stéfan, La Muse Province
p.[oème] de l'aïeule
Grand-mère
qui écrivais sans ponctuation mais sans faute
j'ai été lu à 11 h 27' 48"" ce 26 janvier 01
qui n'ai jamais pu dire « j'espère » l'arrière
latéral gauche Pignol atteint de cancer Tu
poussais ta brouette tu lavais le linge li-
sais L'Excelsior et n'avais de défauts
ignominieusement emportée par gifle de dieu
comme Toi crispant d'avance les doigts j'
écrivis des poèmes pour rien puis végétai
Tu gis enterrée en face d'une épicerie-café
tes deux fils morts irréconciliés j'incline
encore la clenche je creuse le seuil les
Humains pullulent de plus belle je m'étends
sur la chaise longue à écouter le balancier
ah j'étais au calme Ils croient à Pâques à
leur inexistence Tu ne riais jamais sans
tristesse Tu portais chapeau paillé robe
désuets Leurs chiens gueulards nous oppriment
leur haute Sottise nous suicide
Jude Stéfan, La Muse Province, Gallimard, 2002, p. 14.
©Photo Chantal Tanet (juillet 2010)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, la muse province, grand-mère | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2012
Luis Mizón, Terre brûlée

Mémoire du corps absent.
Le joueur d'échecs
travaille la géométrie de l'écho.
L'éclat des vagues de pierre noire
et le geste qui devine
les moralités du vent.
Je caresse des lèvres de bronze vert
des masques de plâtre.
Je lance des parcelles de soleil
contre murs et angles
forteresses et bateaux de guerre
soldats et marins amnésiques.
J'attaque d'une main souriante avec furie
le raisin vert de l'éclipse.
Je m'assieds sur les traces de l'arbre musicien
pour écouter des histoires de personne
échos anciens.
Histoire et rêve.
La passion du corps invisible
murmure
en effeuillant les grappes
de la fleur de la plume.
Le puits des musiciens
éveille et ressuscite
des scories brillantes
dans la mémoire des enfants
et il guérit de son lait d'ombre
la pierre malade de ton visage
et son ivresse muette.
Le puits pulvérise le ciel.
Arbre de clarté blanche.
Bouche qui murmure
sur la terre brûlée.
Le vent parcourt la mémoire
cherchant les mots
d'un poème ancien échoué dans les vagues
il peint un autre labyrinthe
de pierre transparente
et d'ombre illuminée.
[...]
Luis Mizón, Terre brûlée, traduit de l'espagnol (Chili)
par Claude Couffon, Obsidiane, 1984, p. 55 et 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis mizón, terre brûlée, mémoire, claude couffon | ![]() Facebook |
Facebook |
02/07/2012
Claude Chambard, La Montée des Couardes

Puisque tout le monde rêve, moi non, moi je ne rêve pas, dis-je à Sigmund, dis-je à Grandpère, dis-je montant péniblement la côte, le chemin blanc des Couardes. Tu dis n'importe quoi, dit Grandpère, Sigmund ne dit rien, c'est à peine si l'on devine un léger énervement à cette crispation du pied gauche dans le cuir souple de la chaussure noire. Pousse, pousse la brouette, pousse, ça grince, ça coince, ça souffle, ça claque sur la caillasse, allez bagnard pousse, pousse la brouette dans les Couardes, bras distendus, muscles blancs, doigts sciés tordus — c'est l'arthrose (c'est l'âge [c'est la mauvaise santé], c'est ça c'est l'âge) — & la puanteur des détritus à vomir, à vomir parigot, à gerber.
Jours jours + jours + jours (cf. la Vie de famille), refrain connu, sifflements irrésistibles — & jours de canicule, jours de froid, c'est selon, orage, molaires sensibles — ou est-ce incisives, si ce n'est canines acérées (chaud froid ce n'est pas bon pour l'émail) gencives en sang il faut se soigner — ôter — changer ? sa peau est un souhait, on veut la lumière & l'orage, il pleut, il pleut des cordes, il pleut à seaux, il grêle — c'est mauvais pour la vigne — odeur âcre des trottoirs des villes puantes, chaussée trempée, il fait froid pour ainsi dire — dans les vieux os, il fait froid toujours, toujours il fait froid, toujours trop tôt — Grandpère ne pars pas.
Claude Chambard, La Montée des Couardes, éditions Contre-pied et Claude Chambard, 2012, p. 5-6.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, la montée des courdes, rêver | ![]() Facebook |
Facebook |
01/07/2012
Pierre Bergounioux, Trente mots

Noms d'étoiles
Alors que la signalisation routière rendait perplexe, suggérait, souvent, le contraire de ce que l'endroit disait à sa manière, sans phrase, le ciel parlait une langue mystérieuse et pure. Les étoiles disaient leur nom et il participait directement de leur splendeur. On en a la révélation dès la première fois, à l'instant où l'on se retrouve dehors, la nuit, les yeux ouverts, et que, pour infime qu'on est, encore, le sentiment de l'infini nous soulève. Nulle joie ne passe celle-ci puisqu'il n'existe rien de plus grand, de plus resplendissant que la voûte étoilée; elle s'est trouvée accrue de ce que ses feux avaient été baptisés ni plus ni moins que les carrefours, les hameaux, les bourgs des environs et que, pour le coup, c'était à bon escient.
C'est un livre, où il était question de tout autre chose (j'ai oublié quoi) qui m'a livré les premiers noms d'étoiles. Bételgeuse ou Fomalhaut. Ce devait être un jeudi ou un samedi après-midi, dans la lumière grise, comme ancienne, que filtraient les fenêtres, elles aussi croisillonnées de plomb, de la bibliothèque, au-dessus du local de la société savante. Et j'ai tressailli de la même joie que le jour, la nuit, plutôt, où le ciel nocturne m'avait été révélé. D'autres leur ont succédé sans que je cherche à comprendre, Aldebaran, Altaïr, Antarès, Deneb, Rigel, Vega. Chacun possédait la magique vertu de raviver le sentiment énorme, plus qu'humain, dont nous sommes susceptibles malgré la petitesse et la caducité qui sont notre lot.
Plus tard, lorsque j'ai cherché à dissiper le trouble, l'irritation que faisaient naître les noms de lieux, je suis allé vérifier les appellations stellaires. Je ne sais plus ce que je m'attendais à trouver, de quels dieux je pensais découvrir la langue. J'ai appris qu'Altaïr venait de An Nasr Al tâ'ir, le vautour volant, et s'opposait ainsi à Vega, An Nasr Al Wâqi, le vautour qui s'abat. Bételgeuse est la main d'Orion, Ibt-al-Jawzà, Rigel, son pied, -Rijl, tandis que Fomalhaut et Deneb sont la bouche du poisson et la queue du Lion. Elles perdent, ainsi traduites, l'essentiel de leur pouvoir, comme lorsqu'on parle d'alpha du Taureau ou de bêta du Centaure. Il faudrait interroger des arabophones. Mais qu'on se serve de la forme que leur nom sarrasin a prise dans notre langue et la majesté des astres se met à rayonner, ruisselle, en plein jour, et le sentiment de l'infini nous submerge.
Pierre Bergounioux, Trente mots, Fata Morgana, 2012, p. 111-112.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ierre bergounioux, trente mots, noms d'étoiles | ![]() Facebook |
Facebook |
30/06/2012
Christian Prigent, La Vie moderne (L'amour : une idylle au club)
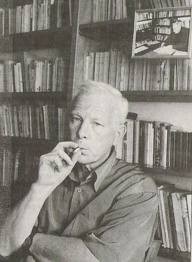
L'amour : 13 (une idylle au club)
Entre pomme et pamplemousse on eut le miel
Des paroles : toi collant noir&blanc moi
Casque de moto — hop ! parti pour la vie
En allure chat de gouttière à l'éternel
Appel du regard univoque. Au bleu tur
Quoise et soleil Red Sea tes cheveux trempés
Roux et tes trous rampants sur le fond caché
Magiquement : ah si raide, ce lieu d'ur
Gence on vit l'intérêt de nos synergies
Rutiler (Ô ma grenadine for ever) !
Ô mon glamour gredin à jamais surgi
Flic, flash in the middle of the picture !
Christian Prigent, La Vie moderne, P. O. L., 2012, p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, la vie moderne, idylle | ![]() Facebook |
Facebook |
29/06/2012
Louis Zukofsky, "A" 13

"A" 13, V
Nu assis, éveillé couché
Le silence non loin de la parole
Se dépassent l'un l'autre pour
Ne pas se marcher dessus
Souvent la nuit un sommet pointe
L'aube enveloppe des bouquets de feuilles
Quand brillent au soleil les contours
Même pénombre soir et matin
Traversant la persienne qui s'ouvre
Et qui éclaire la vue.
Des cinq fenêtres contigües d'un dixième étage,
Comme sur le pont d'un bateau
Tout le cycle solaire
Rappelle le désir innocent : de onze à quatre-vingt dix ans
Et laisse vieillir l'innocence
Se rappelle de la famille à ses débuts
De certains moments comme si c'était aujourd'hui
De quatre mains jointes sur les genoux
Scellées par le regard.
L'étreinte
Quand il est question d'enfants
Le désir observe, il voit
Un étage plus bas
Sur un toit voisin
La décoration un pignon à redan
Surmonté d'une licorne assise
Flanqué par quatre conduits
Formes chantournées _
Châteaux ou jeu d'échecs
Faits de la même pierre tendre
Comme les festons de pierre
D'un ridicule canasson
Gros sac à viande —
Pas moyen de deviner
Pourquoi c'est là
À moins de l'honorer
Comme curieuse esquisse
Du désir avant qu'il ne soit
Pulsion et grandisse non loin d'ici.
[...]
Louis Zukofsky, "A" (sections 13 à 18), traduction de Serge Gavronsky et François Dominique, Collection Ulysse Fin de siècle, éditions Virgile, 2012, p. 89-90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zukofsky, a 13, désir | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2012
Claudia Rankine, Si toi aussi tu m'abandonnes

Moi aussi j'oublie des choses. Ça me rend triste. Ou bien c'est ce qui me rend le plus triste. La tristesse c'est pas vraiment à cause de George W. ou de notre optimisme américain ; la tristesse c'est le fait d'admettre qu'une vie peut ne pas compter. Ou, comme il y a des milliards de vie, ma tristesse grandit avec la conscience que des milliards de vie n'ont jamais compté. J'écris cela sans que mon cœur se brise, sans sortir de mes gonds. C'est peut-être ça la vraie cause de ma tristesse. Ou peut-être, Emily Dickinson, mon amour, l'espoir n'a-t-il jamais été cette chose avec des ailes. Je ne sais pas, je m'aperçois seulement qu'à l'heure du journal télévisé, je change de chaîne. Cette nouvelle disposition pourrait révéler un effondrement de la personnalité : I. M. E. L'Incapacité à Maintenir l'Espoir, qui se traduit par une absence de foi innée dans les lois suprêmes qui nous gouvernent. Cornel West dit que c'est ce qui ne va pas avec les noirs aujourd'hui : trop nihilistes. Trop effrayés par l'espoir pour espérer, trop usés pour l'aventure, en fait trop près de la mort je pense.
Claudia Rankine, Si toi aussi tu m'abandonnes, Traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, "Série américaine", José Corti, 2010, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claudia rankine, si toi aussi tu m'abandonnes, tristesse, oubli, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2012
Yves Boudier, Consolatio
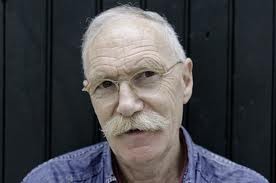
L'aube
toison gardienne
« Il pleut dans mes yeux... »
innocente le corps
de n'être que
vision indocile
du sexe vif
(aliénance des rêves)
je ne marche jamais seul
dans le sommeil
ce qui voile en moi
ne prouve rien
seulement dit
la jointure
l'humanité Janus
cette voie
vers
la nuit d'où naissent les enfants
Je ferme les yeux
cède
au cœur vigile
la présence animale
touche le seuil
désincarne
le verbe
la forêt gagne
et la mort passagère
découpe dans
les draps
au lever des chimères
Yves Boudier, Consolatio, postface de Martin Rueff,
"La mort au carré", Argol, 2012, p. 9-12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves boudier, consolatio, martin rueff, la nuit, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2012
André Suarès, Sur la vie

Suarès par Georges Rouault
Pensées du temps sans dates
Assurément, la poésie est un art en soi-même, et qui se suffit. De là, les surprises de la forme, les chefs-d'œuvre de l'expression et la beauté du métier : il peut être si fort ou si plaisant qu'on n'y résiste pas ; on cède à la fougue de l'artiste ou à son charme. Mais le métier le plus accompli ne donne pourtant pas cet accès aux sommets de l'âme, où est le lieu naturel de la grande poésie. Le rythme et la mélodie populaires ne sont pas plus la musique de Bach, que le plus savant contrepoint, si la pensée de Bach est absente. Pensée qui trempe toujours dans le sentiment.
Ni le métier seul ni la seule émotion ne font le grand poète. Il faut de la pensée, là comme ailleurs. Il n'est pas vrai qu'une citrouille bien peinte vaille l'École d'Athènes, mais il peut être vrai qu'un faux Raphaël d'Académie ne vaille pas une belle citrouille : c'est que les idées académiques ne sont pas plus vivantes, ni plus fécondes, ni plus propres à nous émouvoir et nous faire penser qu'une citrouille, une pipe au bord d'une table et une demi-guitare. On peut dire aussi de Chardin qu'il est plus peintre que Léonard de Vinci ou Rembrandt parce qu'il n'est que peintre. Rembrandt, Raphaël, Jean Fouquet sont de grands poètes qui s'expriment au moyen des couleurs et des lignes.
André Suarès, Sur la vie, essais, éditions Émile Paul, 1925, p. 287-288.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré suarès, sur la vie, poésie, peinture, bach, raphaël | ![]() Facebook |
Facebook |
25/06/2012
Nathalie Riera, Variations d'herbes

Rivière
À Axel
trouble du rythme à secouer le paysage le livre des eaux
je vais librement sur le chemin des mots serrés entre les dents
au vent gelé je vais où je n'ai pas encore écrit une ligne
laver le livre où je vais le plus vert de mon temps vous écrire la
force de vos naissances au plus proche de l'effroi mes défroques de phrase sans uniforme
je suis creusée au taraud pulsée par la beauté
évaporites au cœur je m'évapore de choses très équivoques
En permanence dans l'air, par terre, à contre-jour, les mots, aux pas vifs.
Escapades Escarpement Œil et Terre Corde harmonique Sauter en hauteur
Parce que tant de beautés qui dorment en arrière de soi Parce que toute espérance se trouve dans une poignée de terre, s'accroche à l'arçon de la selle.
À travers champs dans la variation des herbes. Poésie parmi les lampes et les plantes.
Nathalie Riera, Variations d'herbes, Béziers, Les éditions du Petit Pois, 2012, p. 16-17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie riera, variations d'herbes, rivière | ![]() Facebook |
Facebook |
24/06/2012
Pierre Reverdy, La vie fragile, dans La Guitare endormie

La vie fragile
Plus loin entre la plante grasse et le rideau
Dresser l'échelle
Les formes qui remuent dans le fond du jardin sont blanches
d'autres noires
Selon le mouvement brutal du réflecteur
Les maillots des arbres sont roses
Mais au premier plan une main tient la clef du cœur
Un couple ailé marche dans des couleurs qui changent
Celui qui vole bas c'est l'homme
Celui qui va à pied c'est l'ange
Les yeux luttent dans la lumière
La lampe fraîche du matin
Un fil cassé descend derrière
La tête nue s'incline et barre le chemin
Tout le reste est recouvert de feuilles mortes
Quant au ciel il s'ouvre par le fond et de côté mais en triangle
Pierre Reverdy, La Guitare endormie. [1919], dans Œuvres complètes I, édition préparée, présentée et annotée par Étienne-Alain Hubert, "Mille&unepages", Flammarion, 2010, p. 262.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, la vie fragile, la guitare endormie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/06/2012
Louise Labé, Sonnet III

Sonnet III
Ô longs désirs, ô espérances vaines,
Tristes soupirs & larmes coutumières
À engendrer de moi maintes rivières
Dont mes deux yeux sont sources & fontaines :
Ô cruautés, ô dur[e]tés inhumaines,
Piteux regards des célestes lumières :
Du cœur transi ô passions premières,
Estimez-vous croître encore mes peines ?
Qu'encor Amour sur moi son arc essaie,
Que nouveau feu me guette & nouveaux dards
Qu'il se dépite, & pis qu'il pourra face :
Car je s[u]is tant navrée en toutes parts,
Que plus en moi une nouvelle plaie,
Pour m'empirer ne pourrait trouver place.
Louise Labé, Œuvres, Lyon, chez Jean de Tournes, 1555, p. 113.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnet, amour, désir | ![]() Facebook |
Facebook |
21/06/2012
Pascal Commère, Tashuur. Un anneau de poussière

Herbes sèches. Comme joncs, du vent. Chevaux dépassant à peine, tiges hautes, moutons plus loin — combien ? À peine visibles entre les touffes. Deux bergers, et deux autres encore — plus jeunes. Ah si jeunes. Posent pied à terre, s'accroupissent sur les talons comme on le fait ici. Nous leur tendons une tranche de pain. Les bêtes se rapprochent, nez au sol parmi les hautes tiges jaunes. Elle dit : trente-cinq jours pour venir jusqu'ici, et cinq encore pour Ulaanbataar. Je demande pourquoi Ulaanbataar. Elle dit : industrie de la viande. En selle de nouveau, rejoignant le troupeau, l'entourant. J'ai cru qu'ils faisaient paître, mais non. Ils font route ensemble, j'en compte six ( en réalité neuf, à surveiller le troupeau jour et nuit, se relayant) qui poussent de leur fouet — manche dressé appuyé sur l'épaule — bœufs (une trentaine) et moutons (quatre cents, ils ont dit), l'immense troupeau bientôt rassemblé vers la rivière là-bas, plusieurs centaines de mètres d'ici on mesure mal avec les ombres. Un autre galope vers nous — le chef des bergers, elle dit. Genou à terre, la longe roulée à son poignet. Nous lui tendons un bol, raviolis de mouton (buuz). Quelques mot alors, et le vent — lèvres et doigts noircis. Ils viennent de Hövsgöl, tout au nord, près de la frontière russe. Huit cents kilomètres en quarante jours, elle traduit. Rapide calcul, vingt par jour. Elle dit oui, et quand ils sont à la recherche d'eau ils peuvent en faire jusqu'à trente-cinq...
Pascal Commère, Tashuur. Un anneau de poussière, Obsidiane,2012, p.107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal commère, tashuur. un anneau de poussière, mongolie | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2012
Les techniciens du sacré, anthologie Jérôme Rothenberg

Le dieu Dumuzi
Chant de la vulve d'Inana
je suis femme moi
qui dans cette maison
de lapis sacré
portant
dans mon sanctuaire dis ma
prière sacrée
moi qui suis femme moi
qui suis reine des cieux
que l'officiant
le psalmodie
que le chanteur le chante
& que mon nouvel époux
mon Dumuzi mon
taureau furieux me comble
que les mots tombent
de leurs bouches
ô chanteurs chantant
pour leur jeunesse
leur chanson qui s'élève
à Nippour offrande à faire
au fils de dieu
moi qui suis femme chante pour
le louer
l'officiant le psalmodie
moi qui suis Inana
lui donne le chant de ma vulve
ô étoile ma vulve de la Grande Ourse
vulve barque lancée des cieux
nouvelle lune beauté croissante vulve
désert mon labour vulve
chant des oies sauvages en jachère
où ma motte attend
d'être inondée par lui
colline ma
vulve béante
& la fille demande :
qui va la labourer ?
Vulve mouillée inondée
la mienne moi la reine
menant jusqu'ici ce bœuf
« femme il labourera pour toi
notre roi Dumuzi labourera pour toi
ô laboure ma vulve ô mon cœur
mes cuisses sacrées en sont
trempée ô mère sacrée »
[Sumer]
Les techniciens du sacré, anthologie de Jérôme Rothenberg, version française établie par Yves di Manno, José Corti, 2007, p. 354-355.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les techniciens dy sacré, jérôme rothenberg, yves di manno, sumer | ![]() Facebook |
Facebook |






