18/11/2020
Jude Stéfan, À la Vieille Parque
Jude Stéfan, 01/07/1920-11/11/2020

à tous morts en 1984
aux chiens du soir répondent les étrons matinaux
quand l’haleine se dit des vents
la bête est sur ses fins
immobile aux coups
un débris des halles
apaisé comme un qui urine entre cerise et rose
sous l’horreur nue de la troisième heure
enlisé George dans tes idylles bergères
les moutons n’ont pas froid à brouter blanc
et chaque année donne leur mort aux noms
Foucault Michaux Cortazar ou Magne
le lexovien
ordure du cœur ordure de l’être
mes doigts crispés aux robes-cuisses mères
Jude Stéfan, À la Vieille Parque, ‘’Le Chemin’’/ Gallimard,
1989, p. 32.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, À la vieille parque | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2020
Jude Stéfan, Aux Chiens du soir
Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

sur la grève
a fui l’hiver avec
ses enfants dans les jardins de neige
ici temps et marée n’attendent personne
« en vieil anglais steorfan veut dire
mourir » et si j’en retranche l’or reste
ma vie terne
or voici la sterne la visiteuse d’été
haute là-bas sur la mer
où le cerveau n’est que nuée
à ton interrogation la fleur répond :
efface-toi tout vivant du monde avant
la Mort qui glousse au loin près des épaves
Jude Stéfan, Aux chiens du soir, ‘’Le Chemin’’/
Gallimard, 1979, p. 51.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, aux chiens du soir | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2020
Jude Stéfan, Cyprés
Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/ 2020
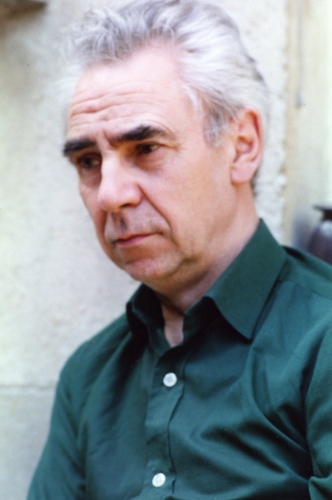
Sauvez-moi de l’ennui forclos gardez-
moi de a lourde luxure aux dents
noires protégez-moi du froid du monde
évitez-moi la haine des odieux
en votre joie dissolvez toute hantise
l’enfance l’infect la sénilité
écartez en fin l’image de la tombe
réelle ô femmes tendres aidez à l’impossible !
(Suprême charité)
Jude Stéfan, Cyprés, ’’Le Chemin’’/Gallimard,
1967, p. 93.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, cyprés | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2020
Jacques Réda et Alexandre Prieux, Entretien avec Monsieur Texte : recension

En ouvrant le livre avec une "Note pour servir à une histoire du vers français", A. Prieux indique d’emblée vouloir introduire des réflexions autour du vers de Jacques Réda dont le précédent livre*ne citait aucun poète vivant ; l’entretien, conduit par correspondance, est suivi d’une "Coda" où Jacques Réda reprend plusieurs des points abordés. On retiendra que, par ses réponses aux questions et par les précisions finales, il explicite à nouveau ce qu’est pour lui le rôle du vers régulier. À nouveau, mais il n’est pas inutile de le faire : sa position avait été clairement exposée dans plusieurs articles (dont un datant de 1972, dans les Cahiers du chemin), réunis dans Celle qui vient à pas légers (1985), recueil auquel renvoie A. Prieux. L’exergue choisi de Cingria résume d’ailleurs les choix de Réda ; en voici le début : « De même qu’il y a beaucoup plus de liberté dans le vers régulier qu’il y en a dans le vers libre, il est patent qu’il y a beaucoup plus de possibilités d’inventions réelles et de positif sursaut général dans un art obligé que dans un art où tout est laissé à l’inspiration. »
Réda a très souvent été associé au vers de 14 syllabes, dont il aurait été l’inventeur ; il relève à juste titre l’inexactitude de cette attribution par quelques-uns qui prétendent faire l’histoire du vers – il suffit en effet de lire pour en trouver, par exemple, dans Verlaine, Apollinaire (« Soleils plénipotentiaires des travaux en blonds Pactoles » ou Éluard (« Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin »). Ce mètre, non rimé, lui apparaissait comme un compromis entre le vers régulier comme l’alexandrin (un des mètres qu’il a pratiqués) et le vers libre — qu’il n’a pas du tout rejeté, pas plus que la prose. Le vers "classique" — le prototype étant l’alexandrin — est lié, en particulier, à l’idée de règle et il a « l’avantage inégalable de rester toujours prêt à l’emploi » ; or Réda affirme avoir toujours voulu « préserver et même (...) étendre (son) aire de jeu » et tout jeu implique la connaissance et le respect de règles. C’est là pour lui un motif déterminant pour en maintenir l’usage, qu’il s’agisse de l’alexandrin ou du vers de 14-syllabes : il permet de noter la mesure, le rythme, comme le jazz, qu’il a découvert en même temps que la poésie. C’est là un point crucial.
Que peut exprimer de la « réalité pure » la poésie ? Le vers compté, lui, est un « artifice destiné à favoriser notre contact avec ce fond insaisissable de la réalité qu’est le rythme ». Contact essentiel, puisqu’alors avec le rythme est approchée « une saisie éternisée de l’instant » ; Réda sur ce point met en relation le rythme du vers et le swing, clairement avec un titre de Charlie Parker, It’s the time, qu’il traduit : « maintenant est toujours le seul moment qui compte ». C’est donc plutôt en observant des règles que, pour tout lecteur, la poésie parvient à une synthèse entre l’« exigence lyrique et la forme », peut-être à son apogée avec La Fontaine et Racine. À partir du moment où le vers n’est plus le lieu du rythme — mis en pièces notamment avec Rimbaud —, la situation est analogue à celle née avec le "free jazz" où chacun a construit sa conception du rythme et de la musique — et souvent le rythme disparaît. Pour Réda, si des réussites du vers libre sont incontestables (Follain, Dadelsen, Droguet sont cités), souvent, il ne fait « sous une facile affectation d’inattendu et de souplesse (...) que chercher à compenser l’insuffisance d’une prose en général atone et sans couleur. » Si la nécessité prosodique disparaît, que reste-t-il ?
Réda s’attache à une autre fonction du vers régulier, elle aussi liée au rythme. Par opposition au chaos du monde, les mots y sont en ordre alors que dans une prose éclatée comme celle de Un coup de dés ils sont dispersés, isolés, « dans le vide qui reste leur dernier lien », et par la suite l’artifice typographique est substitué au musical. C’est grâce à l’ordonnancement des mots que chacun d’eux « détient muettement dans la mémoire une partie de notre passé, de notre savoir, de nos aspirations les plus diverses. » Maîtriser le vers compté classique ne consiste pas à aligner 12 syllabes (ou 14, 10,..., syllabes), mais aboutir à un certain équilibre, à une mélodie ; Réda rapporte qu’il a passé beaucoup de temps à imiter ses prédécesseurs (comme les peintres l’ont fait dans les musées), de du Bellay à Leconte de Lisle, « j’apprenais ainsi l’humilité — au moins la modestie. »
Modestie : il n’a pas le souci de savoir quelle "place" il occupe dans la poésie française, s’il inscrit une "œuvre dans le temps" ; ce qui a un sens, en écrivant, c’est le « sentiment (...) d’être utile sans savoir exactement à qui ou à quoi ». On constate dans ces pages une certaine indifférence vis-à-vis de ce qui préoccupe bien des contemporains qui cherchent à sortir du vague du vocabulaire et tentent de définir ce qu’est la poésie ; Réda rappelle que pour les Anciens il s’agissait d’écrire en vers et que l’on confond trop "poésie "et "poétique". Reprendre des formes régulières du passé, c’est en tout cas une manière de « revenir à celles de la jeunesse de la langue ».
Aux formes seulement. La transformation des savoirs a rendu impossibles l’épopée, la lyrique courtoise, alors ne restait à mesurer que « l’immense reste de l’inintelligible et du non mesurable », et le vers se fait alors un « écho du silence pascalien du monde ». La poésie alors m’interroge sur l’« énigme de toute réalité »
* Jacques Réda, Quel avenir pour la cavalerie : Une histoire naturelle du vers français, Buchet-Chastel, 2019.
Jacques Réda et Alexandre Prieux, Entretien avec Monsieur Texte, fario, 2020, 120 p., 14, 50 € ; Cette note de lecture a été publiée le 25 octobre 2020 par Sitaudis.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda et alexandre prieux, entretien avec monsieur texte, vers français | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2020
Giorgio Caproni, Le Mur de la terre

Moi aussi
Moi aussi j’ai essayé.
Ce fut toute une guerre
d’ongles. Mais maintenant je le sais.
Nul ne pourra jamais trouer
le mur de la terre.
Anch’io
Ho provato anch’io.
È stata tutta una guerra
d’unghie. Ma ora so. Nessuno
porrà mai perforare
il muro della terra.
Gorgio Caproni, Le Mur de la terre,
traduction Philippe di Meo, Atelier
La Feugraie, 2002, p. 85 et 84.
13/11/2020
Bohdan Chlibec, Le sang de la bourse

Le conciliateur
La vie ne sera pas leur œuvre,
et même s’ils venaient peupler l’abîme
et que leurs descendants s’entassaient jusqu’aux sommets,
ils resteraient des multiplicateurs du vide,
des reproducteurs du désastre.
Divers peuples vivent encore et toujours
innombrables, mais sans un seul homme.
Des portes barricadées, voilà
ce qu’ils poussent devant eux.
Bohdan Chlibec, Le sang de la bourse, traduction du tchèque
Petr Zavadil et Cédric Demangeot, éditions Fissile,
2020, p. 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bohdan chlibec, le sang de la bourse, abîme, vide, désastre | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2020
John Clare, Poèmes et proses de la folie de John Clare

Automne
Le duvet de chardon sauvage
Bien que les vents soient tous tranquilles
Tantôt là sur le pâturage
Tantôt gravissant la colline
Le courant qui vient de la source
À présent bout comme un chaudron
Et franchit d’innombrables pierres
En bouillonnant à gros bouillons.
Le sol racorni craquelé
A la mine d’un pain trop cuit
Le gazon vert est saccagé
Ses tiges desséchées sans vie
Les jachères comme de l’eau
Miroitent à perte de vue
Les fils de la vierge tremblotent
D’une herbe à l’autre suspendus.
Les collines tel un fer ardent
Brûlent à leur faîte au soleil
Et les ruisselets dans leur cours
Flambent clair à de l’or pareils
L’air aussi est de l’or liquide
La terre brûle comme un four
Quiconque promène les yeux
Voit l’Éternité alentour.
John Clare, Poèmes et proses de la folie
de John Clare, traduction Pierre Leyris,
Mercure de France, 1969, p. 99 et 101.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
11/11/2020
Dylan Thomas, Et la mort n'aura pas d'empire

Et la mort n’aura pas d’empire
Et la mort n’aura pas d’empire.
Les morts nus ne feront plus qu’un
Avec l’homme dans le vent et la lune d’ouest.
Quand leurs os becquetés seront propres, à leur place
Ils auront des étoiles au coude et au pied.
Même s’ils deviennent fous ils seront guéris,
Même s’ils coulent à pic ils reprendront pied
Même si les amants s’égarent l’amour demeurera
Et la mort n’aura pas d’empire.
Et la mort n’aura pas d’empire.
Gisant de tout leur long dans les dédales
De la mer ils ne mourront pas dans les vents.
Se tordant sur des chevalets quand céderont leurs muscles,
Ligotés sur une roue, ils ne se briseront pas.
La foi dans leurs mains cassera net,
Les démons unicornes les transperceront.
Fendus de toutes part ils ne craqueront pas
Et la mort n’aura pas d’empire.
Et la mort n’aura pas d’empire.
Ils n’entendront peut-être plus les cris des mouettes
Ni le déferlement des vagues sur les rives.
Là où s’ouvrait une fleur, peut-être qu’aucune fleur
Ne montrera sa tête aux rafales de la pluie.
Même s’ils sont fous et morts, tout à fait morts
Leurs têtes comme des marteaux enfonceront les marguerites,
S’ouvriront au soleil jusqu’au dernier jour du soleil
Et la mort n’aura pas d’empire.
Dylan Thomas, Poèmes, traduction Patrick Reumaux, dans
Œuvres I, Seuil, 1970, p. 413.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dylan thomas, et la mort n'aura pas d'empire, mouette | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2020
Gottfried Benn, Poèmes

Un mot
Un mot, une phrase — ; des lettres montent
vie reconnue et sens qui fulgurent,
le soleil s’arrête, les sphères se taisent,
tout se concentre vers ce mot.
Un mot — un éclat, un vol, un feu,
un jet de flammes, un passage d’étoiles —
puis à nouveau le sombre le terrible
dans l’espace vide autour du moi et du monde.
Gottfried Benn, Poèmes, traduction Pierre Garnier,
Gallimard, 1972, p. 249.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gottfried benn, poèmes, pierre garnier, mot, phrase | ![]() Facebook |
Facebook |
09/11/2020
Jacques Demarcq, La Vie volatile
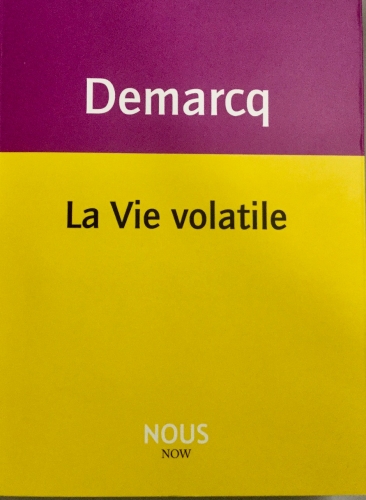
Jacques Demarcq écrit, notamment mais pas seulement, à propos des oiseaux, d’une manière différente de celle de Fabienne Raphoz ou Dominique Meens, pour citer des contemporains, ou Henri Pichette un peu plus avant ; on le retrouve dans une belle livraison de la revue PO&SIE parue en août 2019 (n° 167-168, "Des oiseaux"). Dans ses livres publiés depuis Les Zozios (NOUS, 2008), se mêlent caractère documentaire, autobiographie, poèmes et images, et c’est ainsi qu’est encore construit, très foisonnant, La Vie volatile, avec une place importante réservée aux calligrammes. La simple description des neuf parties de l’ensemble dépasserait les limites d’une note de lecture, on ne s’attachera qu’à ce qui apparaît comme des constantes de l’œuvre.
Le titre l’indique clairement, l’essentiel des textes est relatif aux oiseaux, mais si l’observation est des plus précise, complétée par des ouvrages savants, le propos n’est pas celui d’un naturaliste. Quand besoin est, il s’appuie sur un extrait d’Élisée Reclus ou un ouvrage concernant un peuple mélanésien et sa musique, il renvoie à Utamaro ou cite Chateaubriand, c’est par souci chaque fois d’exactitude : l’ouvrage s’achève d’ailleurs par une bibliographie qui énumère les sources utilisées. Le projet de Demarcq déborde largement ce qui est apparent pour le lecteur qui feuilletterait seulement une partie du livre, la restitution des cris des oiseaux : ce n’en est qu’un aspect et, à différents endroits, sont donnés des éléments pour mieux saisir l’unité du livre.
Regarder avec attention les oiseaux, étudier autant leurs mouvements et leurs cris n’est donc pas pour écrire en ornithologue, bien plutôt « Observer avec eux m’invite à regarder le genre humain avec une distance, un décentrement, une fragile excentricité ». On entend là quasiment un moraliste, sans aucune naïveté ou anthropomorphisme béat ; certes les animaux n’apprennent pas directement ce que sont les hommes mais leur fréquentation incite à voir les hommes autrement. Demarcq le dit autrement à propos d’un séjour au Sénégal, « Je traque les oiseaux pour leurs hommes autant que pour eux. Pour les paysages et sociétés qu’ils côtoient en touristes, immigrés provisoires. » Cette attention aux hommes est lisible dans les pages du Journal tenu au cours de plusieurs séjours à New York ; Demarcq y fréquente les musées mais aussi les parcs, prend le métro, cherche sans succès les traces d’un village ancien, marche beaucoup dans les rues, s’arrête devant les gratte-ciel bâtis pour les milliardaires, constate l’appauvrissement des librairies d’occasion concurrencées par internet, concluant ainsi le Journal : « New York est une loupe rapprochant ce qu’il peut y avoir de splendide et de pire dans un Bref New World. »
Un autre aspect du projet touche à l’écriture puisque, pour Demarcq, « Les rythmes et sons, degrés zéro et infini du poétique, priment sur le sens et désaxent la syntaxe ». Partant de là, proposer de noter le cri des oiseaux n’oblige en rien à tenter une restitution que seuls des enregistrements peuvent accomplir — enregistrements qu’il utilise à l’occasion. Il essaie donc d’inventer dans la langue ce qu’est pour lui le cri du bruant ou de la fauvette, « je pars de quelques syllabes maladroitement imitées d’oiseaux / ce qui raréfie, étoffe, étrangle le vocabulaire à ma disposition ». Mais les modulations du cri ? la typographie joue un rôle puisqu’il est possible de varier le corps des lettres, d’insérer une portée musicale, de donner un mouvement : les mots d’un vers ne sont pas sur la même ligne, une série de vers représente le vol d’un oiseau. On pensera que ces manipulations sont bien éloignées du cri de tel ou tel oiseau ; cela est probable mais répond cependant à ce que recherche Demarcq.
Il y a dans sa démarche un refus du sens à tout prix ; il ne s’agit pas du tout de faire comme si la langue n’existait pas mais « de la rendre naissante, enfantine et fragile, à l’instant où des mots, des articulations s’esquissent dans le bégaiement. » C’est sans doute pourquoi, attentif aux manières de prononcer qu’il rencontre, il transcrit la prononciation différente du français par une personne rencontrée en Amérique (« Les péhuches détuisent toute sôte [...]). C’est pourquoi aussi il introduit, dans les proses comme dans les poèmes, des images pour remplacer les mots, des dessins en forme de lettres — une tente pour le A, par exemple, une suite verticale de points pour le "l" de pluie —des jeux variés avec les couleurs et les formes : ainsi un texte inscrit dans une sorte d’affiche rectangulaire elle-même dans la page.
C’est pourquoi enfin Demarcq pratique le calligramme ; il définit très justement que cet « affrontement » de l’écriture et du dessin implique pour lui « le mélange de caractères disparates, la déformation de certains ou leur détournement figuratif, la dislocation ou torsion des lignes, l’introduction d’éléments non scripturaux tels que vignettes, pictogrammes ou traits rythmiques, et mieux que tout la vibration des lettres et des couleurs, proches des vibratos du chant. » Passionné de peinture, il reprend des toiles, des couleurs ou des formes de peintres, de Monet à Dubuffet, à partir desquelles il construit ses propres formes. Il rappelle d’ailleurs dans son Journal qu’il avait essayé, à partir des toiles de Pollock à New York, de « dessiner des phrases ». Le goût — et le plaisir — de l’expérimentation sont sensibles dans ses tableaux recomposés comme dans ses transcriptions de bruits, ceux de « la futaie [qui] grinsse cracke grezzille d’insectes », du pic qui « tapopote ». Comme dans le choix des paronomases (« python piteux ») et, surtout, des calembours : en plus du titre, on relèvera les titres et sous-titres, « Cygne d’étang », « Recife à ses cieux », « exquis disent plus ? », etc.
On comprend que les réponses à la question posée au tout début du livre, « Pourquoi les oiseaux ? » sont multiples, celles d’un écrivain soucieux de « se penche[r] pour voir ce qu’il y nia ». Il faut ajouter que les réponses s’inscrivent dans une histoire, celle des lectures faites : évoquant ses souvenirs d’enfant abandonné et ses lectures précoces, Demarcq note que « qui lit descend au moins autant des auteurs qu’il a fréquentés que de son milieu », et les références littéraires ne manquent pas ici, notamment de Baudelaire, Poe, Apollinaire à Cummings. Il faut du temps pour lire et apprécier tous les jeux avec la langue de cette Vie volatile, et c’est tant mieux à une époque où tout "doit" aller vite.
Jacques Demarcq, La Vie volatile, éditions NOUS, 2020, 400 p., 30 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 septembre 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques demarcq, la vie volatile, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
08/11/2020
Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo

Septième jour
À quel point jamais on ne dira
à quel point de silence et de nord
l’hiver ému m’a restaurée de gelée blanche
N’ayant plus de peau je choisissais la pierre
et la vérité qui fait de nous
des plongeurs essoufflés
une bouchée d’aurore
Mais un mot à la fin celui qu’on voit s’affaisser
et l’autre qui se redresse et crie
ont grignoté les mêmes baies de chaque côté du ciel
entrevu le mystère qui est comme les orvets
sur les roches, par toute approche empêché
de prendre racine
Mais le soleil, pour eux, ne revient plus
Le monde est dur comme des crics d’étal
épais comme des saules au bord de leur naissance
Il donne à note chant
sa profondeur de granges
Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo,
Arcane 17, 1985, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, une semaine dans la vie de mona grembo, le septième jour, mystère | ![]() Facebook |
Facebook |
07/11/2020
Bartolo Cattafi, Mars et ses idées
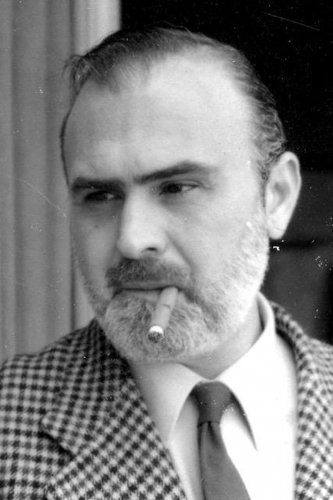
En silence
Un quelque chose qui donne de l’ombre
surgit et pique
une plante à épines
une encre livide
avec de nombreux bras
ici et maintenant avec nos bras
en silence
tête baissée
Bartolo Cattafi, Mars et ses ides, traduction
Philippe Di Meo, Héros-Limite, 2014, p. 95.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bartolo cattafi, mars et ses ides, silence, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
06/11/2020
Pierre Chappuis, Battre le briquet

Ressassement
Que le monde — partie vaut pour le tout — ailleurs sans autre à notre conscience, que, par la grâce du poème, nulle distance (pourtant non abolie) n’intervienne entre les mots et les choses en vertu d’une adhésion unissant de même le poème à son lecteur, cela peut-il n'être qu’un vœu ? Toujours la même ombre au tableau attire le regard au point de l’engloutir. Par-delà, en fin de compte, le poème trouve à vibrer, et le monde, les choses avec lui.
Expérience première, vitale, renouvelée à chaque fois ; éblouissante ? Peut-être simple ressassement d’une idée reçue — c’est dans l’air ! — des plus banales aujourd’hui.
Pierre Chappuis, Battre le briquet, éditions corti, 2018, p. 56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, battre le briquet, ressassement, expérience, poème, lecteur | ![]() Facebook |
Facebook |
05/11/2020
Tristan Tzara, Phases

ce fut un jour sans peur ni haine
ma vie
le cœur ailé
vivant de restes de semaines
au ciel mêlé
vivant — vivions-nous sans nul doute
ni peine —
au gré du vent
c’était le temps où l’on redoute
le mal présent
pourquoi au cours de ces tortures
errantes
lier tes pas
alors que tombe l’ombre mûre
autour de toi
Tristan Tzara, Phases, Poésie 49/Seghers,
1949, p.19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan tzara, phases, haine, torture | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2020
Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur
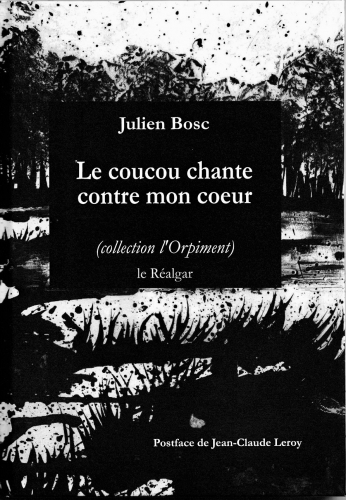
Ce livre posthume de Julien Bosc, en chantier probablement avant 2016, reprend plusieurs des motifs qui lui étaient chers et l’on y entend pleinement sa voix singulière. Le lien avec les livres précédents est au moins une fois explicite ; ainsi un fragment où il est dit qu’un homme sait lire « le verso des miroirs » a donné le titre Le verso des miroirs (2018). Mais ce ne sont pas seulement des mots semblables qui construisent des voies de passage entre les livres, plus profondément est constante la présence de ce qui le hantait : la mémoire des camps d’extermination, de la violence qui ne cesse. Le rêve mais non l’illusion d’une société harmonieuse, le lien profond avec la nature, l’amour d’une femme n’ont pu, dans une solitude choisie, contrebalancer la certitude d’un désastre général.
Julien Bosc connaissait « les souffrances d’un nom / Élu pour le pire » : juif de naissance, il portait toujours les images des camps ; motif principal d’un autre livre, De la poussière sur vos cils (2015), elles sont encore très présentes ici. La destruction n’est pas seulement celle des corps, c’est aussi celle des noms, de toute identité quand il ne subsiste que des cendres et que tout de ce qui a été vécu disparaît à jamais. Ce qui est insupportable à Julien Bosc, c’est à la fois l’extrême difficulté d’imaginer ce que fut le chemin de ceux qui ne revinrent pas des camps et le fait que la voix des survivants n’a pas été (ne pouvait pas être ?) entendue :
Les silhouettes rescapées s’extirpèrent du brouillard
Parler épousa l’innommable
Tout fut tenté pour dire
Rien ou peu fut entendu
Puis tout fut tu
Une femme morte dans un des camps apparaît dans un rêve, invisible mais active, nue sur un cheval et aux longs cheveux comme lady Godiva. Le narrateur accueille cette figure étrange, « mirage » qui « diffus(e) les songes » et qui lui apprend chaque nuit un dizain, le chargeant avant de rejoindre les morts de « poursuivre son chant ». L’écriture naît donc de la nécessité de conserver la mémoire du vécu, de dénoncer « les démences » des tyrans, de défendre ceux qui fuient « la misère et la guerre ». C’est pourquoi dans les dernières pages du livre le sort des migrants, qui meurent en traversant la Méditerranée, est rapproché de celui des Juifs exterminés par le nazisme : Julien Bosc emploie une comparaison sans ambiguïté : « Ils montent mille à bord / Quand le rafiot n’en supporte pas vingt / tels jadis les wagons / qui roulaient vers l’hourban. » ; "hourban", « ruine » en hébreu, est un terme théologique, relatif à la destruction du premier et du second Temple, abandonné aujourd’hui au profit de "Shoah". Le lien est poursuivi : la destruction des Juifs s’est déroulée sans que personne n’en dise rien et la mort des migrants laisse muet, « Qui peut entendre leurs cris ? Personne ou si peu », d’où le constat qui clôt le livre : tout le monde est coupable de garder le silence devant la tragédie, et notamment l’écrivain « À qui la langue manque : / Pour dénoncer ».
Cette impossibilité d’exprimer à propos du réel ce qui devrait l’être parcourt tout le livre ; dès son début, à côté de la forêt, de la mer, donc de la nature telle qu’elle est imaginée par le narrateur, il n’y a rien, ou plutôt « Ce qui doit être dit mais ne peut ». Face au désastre est construite la fiction d’un monde harmonieux où se réfugie un temps le narrateur ; après qu’il eut été battu et torturé parce que différent, il est exilé sur une île très étroite et s’invente alors une sorte de paradis où il est soigné par une sangsue (elle suce ses nécroses) et une épeire (ses toiles suturent les plaies) ; il apprend les oiseaux et, les jours de mélancolie, « le coucou chante contre (s)on cœur ». Tableau idyllique qui fut celui d’un âge d’or détruit par « l’invention des races », la volonté d’accumuler des biens, les conquêtes. Il y a chez le narrateur une hésitation entre une vision proprement apocalyptique (« Le ciel s’obscurcit / Chargé de cendres et de plaintes [...] ») et le rêve d’un monde réconcilié (« Le ciel s’ouvrit / Les oiseaux s’accouplèrent /[...] », parcours d’un extrême à l’autre qui ne permet pas de vivre aisément dans le monde éloigné de ces deux visions.
La tentation est toujours de se retirer, de se dépouiller de tout pour recommencer à vivre, être « Nu de peau de tout / Pour l’aventure la dérive l’amour la mort. » ; l’un des rêves du narrateur découvre d’ailleurs la femme aimée morte dans un fossé mais qui s’éveille — donc tout à fait nouvelle —, et la femme désirée, « contre soi », éloigne « les terreurs et la mort » ; mais le narrateur hésite constamment entre cette relation apaisante et le repli, en particulier la solitude devant la mer qui est « la beauté tout ici devant soi ». Le texte regorge de mots relatifs à la mer (tempête, fanal, naufrage, radeau, phare, lames, vague, écume, clapot, etc.) et aux oiseaux de mer, et l’on retrouve la fascination pour la mer à l’origine de La Coupée (2017).
La forme d’écriture privilégiée dans ce livre s’accorde avec le propos, il s’agit de l’énumération, souvent de groupes nominaux, parfois d’infinitifs, qui sortent le procès du temps et de la personne, énumération chaque fois proche de la psalmodie :
L’ivresse du pouvoir
Le dédain de la parole donnée
La compromission des maîtres
Le mépris vis-à-vis des plus pauvres
L’insanité des mieux pourvus
Les noyés dans l’indifférence
La déportation
Les camps
La mer cimetière
Que regretterai-je ?
Il s’agit, par ce procédé, de « tenter de dire ce qui est » (La Coupée, p. 26), la lecture même devrait accepter le prosaïsme des vers et viser ce but, effectuée « Sans effet ni intonation particulière // (...) non une litanie / Un chant ». Rythme d’un chant qui ne cherche pas d’effets, « dans la lignée des épopées sans gloire » comme l’écrit justement dans son témoignage Jean-Claude Leroy, l’ami de longue date.
Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur, postface de J.-C. Leroy, collection L’Orpiment, La Réalgar, 2020, 84 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 23 septembre 2020.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le coucou chante contre mon cœur, postface de j.-c. leroy, recension | ![]() Facebook |
Facebook |





