17/12/2020
Léon-Paul Fargue, Espaces

CHANSON DU PLUS LÉGER QUE LA MORT
À toute vitesse par assises chaudes
Qui se cristallisent dans la hauteur
Nous coupons la fête ! Ce n'est pas Montmartre !
Ce n'est pas en bas
Quand le canon tonne !
Ce n'est pas la guerre
Aux parcs mugissants !
Nous sommes les hommes sans murailles !
Nous montons en chœur dans la musique !
Chacun a sa baraque
Les dieux font la parade
Petits dieux qui racolent
Le feu qui dans l'espace
Mêle les vérités !
Par ici la mystique
Ici la vraie la seule
Le sanhédrin spirite
Le polypier des schismes
La scissiparité
Du concile de Trente
Le pet des manitous
Le pas des cannibales
Les massacres d'idoles
La sang de Coligny !
Par ici les beaux-arts
Le basalte de Bach
Le bûcher de Wagner
Rembrandt et Michel-Ange
La foudre faite chair !
Par ici les penseurs
Les bouteilles des doctrines
Les aludels des systèmes
Les flacons des hypothèses
Les spirochètes d'idées
Qui vont à toute vitesse
Sur l'ardente glace, assez !
Léon-Paul Fargue, Espaces,
Gallimard, 1929, p. 199-200.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, espaces, chanson du plus léger que la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
16/12/2020
Paul Claudel, Dodoitzu
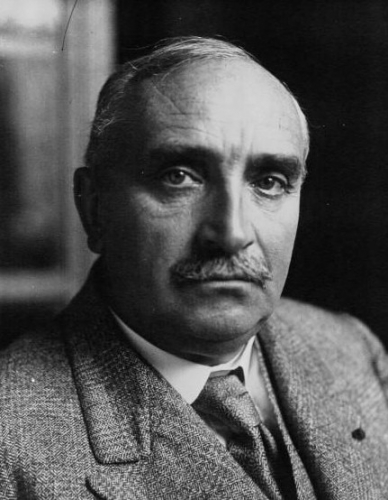
Le crapaud
Quand j’entends dans l’eau
Chanter le crapaud
Des choses passées
J’ai le cœur mouillé !
Nightingale and toad
When I hear in the cool
Gold of the moonlight pool
The nightingale singing,
It is my heart ringing.
Paul Claudel, Dodoitzu,
Gallimard, 1945, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudeel, dodoitzu, crapaud, le passé | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2020
Pierre Silvain, Suite allemande

Wannsee
L'été avant de prendre congé mijote de l'orage
Pour la fin de l'après-midi comme il y a longtemps dans la ville thermale
Où tu traînais parmi les curistes une vacance d'âme
Sous l'étagement poum ! poum ! des feuillages énormes
Décrits par Pierre Jean Jouve alors qu'ici au bord du lac
Tu attends l'appareillage du bateau
La grosse femme avec ses trois mouflets derrière
Te poussant jusqu'au pied de la passerelle
Bercée par une corde et toute l'escouade vacancière
Shorts tee-shirts jambes brunes poils blonds
Comme elle poussant pressée d'atteindre la destination
Finale (sans rien de commun avec la solution du même nom
C'est si loin maintenant aussi ténu que la brume de chaleur
Sur le miroitement de strass des vagues)
Qui pour la plupart est la plage et pour les autres
L'île des Paons. Les vers que tu te récitais
Sous les frondaisons Death is so permanent
Drive carefully1 te reviennent tandis que le bateau
Quitte l'appontement avec le léger tangage
Presque berceur
D'un convoi plombé.
Sarrebruck (1958)
Portrait du Hauptsturmfürher de la Waffen SS
Dans son cadre. Installé près du poste monumental
Diffusant du Bach en sourdine sur la commode. La rose
Ne tient pas à cause de la chaleur du poêle
Qui tire à fond. Elle se défeuille sans bruit
Longuement pétale à pétale devant l'absent.
La tasse de vieux saxe que la femme porte à ses lèvres
Est décorée de motifs champêtres
Aux tons passés. Dehors c'est presque la nuit. Neige. Odeur de houille
Dans les rues. Des particules noires sur les congères.
Sait-on à quoi pense la femme. Guten Abend
(Lance le locataire étranger en traversant le couloir)
Auf Vierdersehen
Frau Krabbe.
Pierre Silvain, Allemande (suite), dans Conférence, n° 15, automne 2002, p. 389 et 395.
1 "Death is so permanent. Drive carefully" : signal routier des Forces américaines en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale (note de T. H.)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, allemande (suite), wannsee, sarrebruck | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2020
Edmond Jabès, La Clef de voûte

Nous sommes invisibles
Quant tu es loin
il y a plus d’ombre
dans la nuit
il y a
plus de silence
Les étoiles complotent
dans leurs cellules
cherchent à fuir
mais ne peuvent
Leur feu blesse
il ne tue pas
Vers lui quelquefois
la chouette lève la tête
puis ulule
Une étoile est à moi
plus qu’au sommeil
et plus qu’au ciel
distant absent
prisonnière hagarde
héroïne exilée
Quand tu es loin
il y a plus de cendres
dans le feu
plus de fumée
Le vent disperse
tous les foyers
Les murs s’accordent
avec la neige
Il était un temps
où je ne t’imaginais pas
où hanté par ton visage
je te suivais dans les rues
Tu passais étonnée à peine
J’étais ton ombre dans le soleil
J’ignorais le parc silencieux
où tu m’as rejoint
Seuls nous deux
rivés à nos rêves
au large de nos paroles abandonnées
Je dors dans un monde
où le sommeil est rare
un monde qui m’effraie
pareil à l’ogre de mon enfance
[...]
Edmond Jabès, La Clef de voûte,
GLM, 1950, p. 25-26.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, la clef de voûte, invisible, ogre, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2020
Eaux de lacs et de rivières

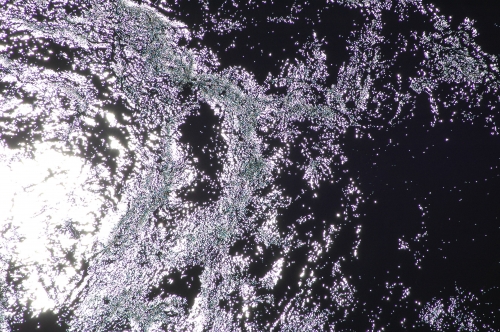



Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eaux de lacs et de rivières | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2020
Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur

Poeta fit, non nascitur
«Comment pourrais-je devenir poète ?
Comment pourrais-je écrire en rimes ?
Un jour vous m'avez dir : « Ce souhait-là lui-même
Participe du sublime ».
Alors dites-moi comment ! Ne me congédiez pas
Avec votre « plus tard » ! »
Le vieil homme sourit de le voir,
D'entendre sa sortie soudaine ;
Il aimait que l'enfant laissât parler son cœur
Avec enthousiasme ;
Et songea : « Il n'y a rien en lui
De tiède ni d'irrésolu.
« Et prétendriez-vous devenir poète
Avant d'être allé à l'école ?
Et bien ! Je n'aurais jamais cru
Que vous fussiez un sot aussi parfait.
Tout d'abord apprenez à être spasmodique —
Règle très simple.
Vous commencez par écrire une phrase ;
Ensuite vous la hachez menu ;
Puis mêlez les morceaux et les tirez au sort
Strictement au petit bonheur :
L'ordre des mots
Est tout à fait indifférent.
Si vous voulez faire impression,
Rappelez-vous ce que je dis :
Ces qualités abstraites commencent
Toujours par des capitales :
Le Vrai, le Bien, le Beau —
Voilà les choses qui paient !
Ensuite, lorsque vous décrivez
Une forme, une couleur ou un son,
N'exposez pas l'affaire clairement,
Mais glissez-la dans une allusion ;
Et apprenez à regarder toute chose
Avec une sorte de strabisme mental.
« Par exemple, si je veux, Monsieur,
Parler de pâtés de mouton,
Devrai-je dire : « des rêves de laineux flocons
Emprisonnés dans un cachot de froment » ? »
« Certes », dit le vieil homme : « Cette phrase
Conviendra parfaitement.
Quatrièmement, il y a des épithètes
Qui vont avec n'importe quel mot —
Tout comme la Sauce Harvey Reading
Avec poisson, viande ou volaille —
Parmi celles-ci, « sauvage », « solitaire », « las », « étrange »,
Sont spécialement recommandables. »
« Et cela ira-t-il, oh ! cela ira-t-il
Si je les utilise en masse —
Comme : « L'homme sauvage alla de son pas las
Vers une étrange et solitaire pompe » ? »
« Erreur, erreur ! Il ne faut pas, à la légère,
Sauter sur de pareilles conclusions.
De telles épithètes, comme le poivre,
Donnent de la saveur à ce que vous écrivez,
Et, si vous en usez avec ménagement,
Elles aiguisent l'appétit :
Par contre, si vous en mettez trop,
Vous gâtez l'affaire complètement.
Enfin, pour ce qui est de la composition :
Votre lecteur, il faut le lui montrer,
Doit prendre les renseignements qu'on lui donne
Et ne compter sur aucune
Divulgation prématurée des tendances
Et desseins de votre poème.
Donc, pour éprouver sa patience —
Savoir ce qu'il peut supporter —
Ne mentionnez ni noms, ni lieux, ni dates,
Et assurez-vous, en tout cas,
Que le poème est bien, d'un bout à l'autre,
D'une obscurité compacte.
Fixez d'abord les limites
Jusqu'auxquelles il devra s'étendre :
Puis complétez, avec du "remplissage"
(Demandez à quelque ami) :
Votre grande STROPHE-À-SENSATION,
Vous la placez vers la fin. »
« Et qu'est-ce donc qu'une Sensation,
Dites-moi, Grand-père, s'il vous plaît ?
Je n'avais jamais, jusqu'à maintenant,
Entendu ce mot employé de la sorte :
Ayez la bonté d'en citer une seule,
« Exempli gratia ». »
Et le vieil homme, regardant tristement
À travers la pelouse du jardin,
Où çà et là une goutte de rosée
Étincelait encore dans l'aube
Lui dit : « Allez à l' "Adelphi",
Et voyez le "Colleen Bawn".
Le mot est dû à Boucicault —
La théorie est sienne ;
Au point où la vie devient un spasme,
Et l'Histoire un Sifflement :
Si cela n'est pas de la Sensation
Je ne sais pas ce que c'est.
Maintenant, exercez-vous ; bientôt la Fantaisie
Aura perdu son présent éclat — »
« Et alors », ajouta son petit-fils,
« Nous publierons ça, n'est-ce pas :
Couverture verte — lettres dorées au dos —
En in-douze ! »
Et le vieil homme sourit fièrement
De voir l'ardent garçon
Se ruer follement sur son encre et sa plume
Et son papier buvard —
Mais, lorsqu'il réfléchit à la publication
Son visage devient grave et triste.
Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur, traduit par Henri Parisot, Deuxième Cahier de Vulturne, 1941, non paginé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lewis carroll, poeta fit, non nascitur, henri parisot | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2020
Jean Tardieu, Jours pétrifiés
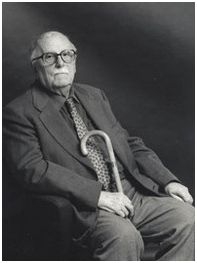
Souvenir imaginaire
Vous qui avez de grands sourires
c’était pour vous pour vous que le jour était là ;
il passait par vos yeux
comme l’eau dans le sable,
il brillait, il fuyait et l’un de nous
laissait pendre ses mains au fil de la lumière,
l’autre écoutait la plus belle
se taire lentement.
Dans la campagne aux longues ombres
ces îlots de statues
c’était peut-être vous peut-être les moissons.
C’était au temps où tout recommence,
le temps qui n’a jamais été,
celui qui est dans mes paroles.
Jean Tardieu, Jours pétrifiés, dans Œuvres,
Quarto / Gallimard, 2003, p. 271.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, jours pétrifiés, souvenir imaginaire, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
10/12/2020
Jean Tardieu, Da capo

Paris ville morte, ou les phosphènes
J’avais les yeux ouverts sur la ville. Redoutable amoncellement d’alvéoles et de murs, de creux et de reliefs, de formes cubiques superposées, de tours très élevées, de bâtiments aveugles et très longs, désordre du hasard et de la préméditation d’angles et d’ombres, coupées de façades illuminées, de recoins dangereux alternant avec d’innocentes surfaces, comme un nid fabuleux de milliards d’oiseaux fous qui ayant les ailes coupées, se terrent, honteux et frileux au bord de leurs abris tremblants. (...)
Jean Tardieu, Da capo, dans Œuvres, Quarto / Gallimard, 2003, p. 1469.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, da capo, paris ville morte, ou les phosphènes | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2020
Jean Tardieu, Comme ceci comme cela

Insomnie
Ma longue nuit les yeux ouverts
seul délivré je veille
pour ceux qui dorment.
Rendu à l’espace
à l’empire du souffle
bien au-dessus des demeures.
Vertige lucide. J’entends monter
vers moi le hurlement secret des morts
le tonnerre d’un monde éteint
silence assourdissant langage
des énigmes confondues.
Bientôt (toujours trop tôt)
la retombée le masque aveuglant
le piège. Délire de vivre
Je verserai dans le jour
trésor amoncelé des nuits
cette réserve obscure
cette ombre comme la mer
où dansent les feux en péril
De nouveau les rumeurs
à la dérive
paroles déchirées
lointaines
indéchiffrables
Jean Tardieu, Comme ceci comme cela, Quarto
/ Gallimard, 2003, p. 1243.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, comme ceci comme cela, insomnie, masque, parole | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2020
Jean Tardieu, Formeries

Participes
Enfui
transmis
jeté
perdu
Noyé
sauvé
surgi
promis
Flétri
caché
nié
repris
Tombé
frappé
brisé
brûlé
Jean Tardieu, Formeries, dans
Œuvres, Quarto / Gallimard,
2003, p. 1154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, formeries, participes | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2020
Roberto Deidier (1965), Une saison continue

Matinal
Il est un sentier incurvé
le long du pli de l’oreiller
avide et souterrain il descend
jusqu’à un cosmos qu’il ne sait distinguer.
Dans le métro l’attention
me contient, les yeux ouverts,
où plus dense est la toile d’araignée
du matin. Chaque station
connue conjugue mes journées
sur le rythme lent du réveil.
J’ai un rendez-vous avec la langue,
les couleurs du trajet
sont des instants à interpréter.
Roberto Deidier, Une saison continue, traduction
Philippe di Meo, La NRF, janvier 2008, p. 159.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberto deidier, une saison continue, traduction philippe di meo, matinal, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2020
Hervé Brunaux, Poèmes de près et de loin, Dessins de Jean-Luc Parant : recension

Poèmes de près et de loin procure (m’a procuré !) un double plaisir, retrouver le graphisme de Jean-Luc Parant et lire des poèmes qui évitent complètement le ton bêtifiant de ce qui s’écrit trop souvent "pour les enfants".
Le premier, "perché", joue sur la répétition du mot titre avant chaque strophe de deux vers, sur l’anaphore — chaque strophe s’ouvre avec « sur » pour indiquer un lieu où se percher —, et la première strophe est reprise pour finir avant de clore le poème, la disposition des strophes mimant les mouvements successifs pour se percher :
perché
sur la branche
du tilleul du parking
il ne reste plus qu’à chanter
quand on est bien perché
Sur la page de gauche (mais l’illustration déborde vers la droite), Jean-Luc Parant a dessiné un arbre sans feuilles où sont perchés deux oiseaux verts (un troisième vole sous l’arbre), l’arbre constitué de minuscules boules caractéristiques de ses dessins ; sur deux portées musicales, feuilles jaunes dans le vent, sont recopiées la strophe finale pour l’une, une autre strophe pour l’autre. Le nombre de boules est noté au pied de l’arbre. Cette description sommaire vise à donner une idée de la construction élaborée du livre. On retrouvera les oiseaux verts, d’autres rouges et bleus, et les portées musicales, d’autres figures apparaissent : un cheval (un Pégase ailé), un poulpe, un soleil bleu, etc., le nombre de boules mentionné dans chaque dessin, précision qui arrêtera la curiosité de tout lecteur.
Hervé Brunaux1 ne se limite évidemment pas au jeu du chat perché ; si les animaux ont leur place dans les poèmes, ils ne sont pas du tout majoritaires : l’un énumère quelques animaux... empaillés — mais la planète et les enfants le sont aussi —, un autre, "histoires", met en scène un oiseau qui plonge son bec dans l’encrier et les histoires écrites occupent les arbres. On observe aussi des ours au fond de la mer et des ouistitis sur la lune. Etc. Mais on sait bien que « La seule imagination ne rend compte que de ce qui peut être », écrivait André Breton (cité par Georges Jean : 2), et les poèmes ici font la part belle à l’imaginaire, variant les motifs sans négliger le réel. Ainsi l’amour / l’amitié avec "dans nos mains" :
dans ta main
les lignes de ma vie
dans ma main
les lignes de ta vie
qui s’achève par ces deux vers « dans nos deux mains enchevêtrées / le labyrinthe de l’avenir ». On voit que les mots employés débordent, et c’est toujours le cas dans le livre, le vocabulaire des enfants. Comme l’analyse Georges Jean, « Des mots difficiles sont éclairés par les autres, et même (et heureusement) parfois restent pour longtemps incompréhensibles, indéchiffrables, magiques ».2 On lira aussi de brefs poèmes-récits qui ressemblent à des souvenirs d’enfance.
D’une manière générale, l’organisation des poèmes rompt plusieurs fois avec les conventions et se rapproche des découpages de la poésie contemporaine, disons depuis Apollinaire, y compris avec l’absence de majuscule en début de vers. Hervé Brunaux privilégie l’emploi de refrains, l’anaphore, les répétitions — y compris d’un vers entier avec seulement une variante, à la manière de Prévert —, la polysémie, le découpage des mots, le jeu des sonorités, tout l’éventail des moyens propres à donner le plaisir de lire.
Les poèmes et les illustrations faussement naïves qui les accompagnent forment un ensemble que l’on voudrait voir dans les bibliothèques, celles des écoles, celle des enfants de tous âges. À offrir sans restriction !
Hervé Brunaux, Poèmes de près et de loin, dessins de Jean-Luc Parant, Lanskine, 2020, 56 p., 13 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 5 novembre 2020.
1 Hervé Brunaux a fondé en 2002 le festival expoésie à Périgueux (lectures (y compris dans des écoles), conférences, expositions). Il a publié plusieurs livres de poésie et des romans.
2 Georges Jean, "L’enfant lecture et poésie", dans Communication et Langages, 1977, n° 34, p. 75.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé brunaux, poèmes de près et de loin, dessins de jean-luc parant | ![]() Facebook |
Facebook |
05/12/2020
Franco Bufoni (1948), Guerre

Guerre
Grandes hécatombes d’humains, contagions,
Vols, incendies. Puis — châtiment divin — inondation.
Tenir dans la montée, sous les coups, et encore
Trouver des vivres, une chambre, un lit,
Même à bas prix.
Dans un pays en guerre et déjà le soir
Et des hommes disposés à payer.
Des hommes non des soldats
Pour lesquels il fallait
Barbouiller la verrière de peinture,
Tant ils accouraient impulsivement,
Des hommes posés.
*
La tête recroquevillée sur le tronc
D’un creux à l’autre,
Sur la fourrure blanche de la valle
La casquette sur le rouge renversée
Pour retenir les intestins,
Des lambeaux de sac à dos sur les épaules
Tombant sur l’herbe.
Sur sa poitrine brillait une amulette rouge sang,
Le long de son côté droit soulevé
Par des jambes arquées.
Une autre grenade encore dans sa main serrée,
telle une cannette,
Le dimanche sur une pelouse.
Franco Buffoni, extraits de Guerre (2005), traduction Philippe di Meo, La NRF, janvier 2008, p. 113 et 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franco buffoni, extraits de guerre, sang, destruction | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2020
Antonio Prete (1939), Menhir

Pauvreté de la parole
L’existence peut-elle se faire alphabet,
son, verbe de présence ?
Le souffle de la terre et de la douleur
effleure la peau des syllabes,
ce n’est pas le sang et le corps de la langue,
mais seulement un hôte, passager.
La mer lèche à peine la lettre qui le dit.
Et le ciel s’éteint dans le mot qui l’accueille.
Antonio Prete, extrait de Menhir, traduction
Philippe di Meo, La Nouvelle Revue Française,
janvier 2008, p. 109.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio prete, menhir, pauvreté de la parole, philippe di meo | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2020
Paul Celan, 23 novembre 1920-20 avril 1970

Publié le 30 novembre dans France Culture
Suite à la parution le 23 octobre 2020 aux Cahiers de l'Herne d'un opus consacré à Paul Celan pour célébrer le centenaire de la naissance du poète, Nicolas Bouchaud, metteur en scène et acteur, revient au micro de Marie Sorbier sur les fugacités du poète des philosophes, dont il a porté les mots à la scène dans son spectacle Le Méridien.
"L'écriture de Celan est elle-même un paysage"
Quand Paul Celan (1920-1970) s’établit à Paris à l’été 1948 ses poèmes ne sont connus que d’une poignée de gens ; à sa mort, en avril 1970, son nom est associé à l’une des œuvres poétiques les plus importantes de la littérature allemande. Pourtant, aborder cette œuvre, a fortiori pour un lecteur francophone, n’a rien d’évident : si les poèmes relèvent bien d’une écriture qui réclame pour elle une « obscurité congénitale » la critique a aussi pu contribuer à en obscurcir le sens. Il faut donc sans cesse reprendre le travail de lecture d’après les coordonnées que Celan a fixées, en partant de ce qu’il appelle « l’accent aigu de l’actualité », inséparable de « l’accent grave de l’histoire » et de « l’accent circonflexe de l’éternité ».
"On dit souvent de la poésie de Celan qu'elle est hermétique. En réalité, son écriture ne cherche pas à représenter quelque chose, ni à reproduire une réalité. Elle n'est pas dans la mimesis, elle est elle-même un paysage. Il faut donc accepter de rentrer d'abord dans un paysage qu'on ne reconnaît pas, et tout le plaisir qu'on peut y prendre est de s'y aventurer quand même". Nicolas Bouchaud
Invité le 22 octobre 1960 à Darmstadt pour recevoir le prix Georg Büchner, Paul Celan accepte la récompense et prononce un discours qui interroge le statut de la poésie à partir d'une interrogation sur l'art. Nicolas Bouchaud a interprété ce texte dans son spectacle Le Méridien, créé en 2015.
"L'envie de ce spectacle m'était venue car l'écriture de Celan est magnifique. Ce n'est pas une histoire de compréhension : je la trouve magnifique parce qu'elle m'appelle d'une façon qui ne passe pas par son sens premier. On peut être appelé par des choses qui nous semblent inconnues". Nicolas Bouchaud
"La poésie n'est pas un geste commémoratif"
La poétique de Celan tient dans un impératif à la fois moral et esthétique, consistant à créer ce qu'il appelait une contre-langue, une mise en accusation implacable et définitive de la langue et de la culture allemandes, dont la Shoah fut l'aboutissement.
"Toute l'œuvre de Celan part d'Auschwitz, de la Shoah. Ce n'est pas la Shoah en tant qu'événement catastrophique qui viendrait clore une séquence, car il écrit à partir de la Shoah. Elle est comme début de quelque chose, non pas comme une chose qui serait terminée et que l'on pourrait commémorer. La poésie, l'art, ne sont pas des gestes commémoratifs". Nicolas Bouchaud
"Ce qu'entreprend Celan est tout à fait merveilleux et bouleversant, il le dit d'une façon très simple et rapide : Je vais enjuiver la langue allemande. La langue allemande a été polluée à travers le régime nazi et l'entreprise de Celan est de laver, de nettoyer et de rendre à la langue allemande ce qu'elle était avant le régime nazi, avant la pollution". Nicolas Bouchaud
Par des jeux correspondances et résonnances de mots et un système de retournement, nous explique Nicolas Bouchaud, Celan se réapproprie sa langue.
"C'est une décision esthétique et éthique extrêmement importante de son parcours que d'avoir continué à écrire en allemand et d'avoir voulu, à travers sa poésie, retravailler du dedans la langue pour la sortir de la gangue mortifère du nazisme". Nicolas Bouchaud
"La zone incertaine où l'ombre se mêle à la clarté"
"Ce qui compte dans le poème avec Celan, c'est la zone incertaine où l'ombre se mêle à la clarté. Ce qui se dérobe à la perception immédiate". Nicolas Bouchaud
Paul Celan le dit lui-même dans son discours de 1960 Le Méridien, en citant Blaise Pascal : Ne nous reprochez pas le manque de clarté, puisque nous en faisons profession. L'œuvre de Celan, note Nicolas Bouchaud, aurait même contribué à faire changer d'avis le philosophe Theodor W. Adorno, qui soutenait qu'on ne pouvait plus écrire de poèmes après Auschwitz.
Grilles de paroles est le premier recueil que Celan envoie à Adorno. On sait aussi qu'il existe une correspondance entre les deux hommes.
Publié dans Celan Paul, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, 23 novembre 1920-2o avril 1970 | ![]() Facebook |
Facebook |





