09/11/2020
Jacques Demarcq, La Vie volatile
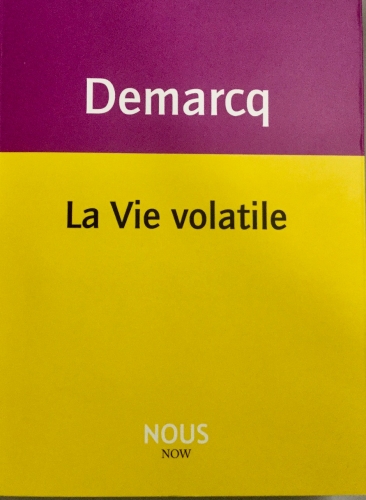
Jacques Demarcq écrit, notamment mais pas seulement, à propos des oiseaux, d’une manière différente de celle de Fabienne Raphoz ou Dominique Meens, pour citer des contemporains, ou Henri Pichette un peu plus avant ; on le retrouve dans une belle livraison de la revue PO&SIE parue en août 2019 (n° 167-168, "Des oiseaux"). Dans ses livres publiés depuis Les Zozios (NOUS, 2008), se mêlent caractère documentaire, autobiographie, poèmes et images, et c’est ainsi qu’est encore construit, très foisonnant, La Vie volatile, avec une place importante réservée aux calligrammes. La simple description des neuf parties de l’ensemble dépasserait les limites d’une note de lecture, on ne s’attachera qu’à ce qui apparaît comme des constantes de l’œuvre.
Le titre l’indique clairement, l’essentiel des textes est relatif aux oiseaux, mais si l’observation est des plus précise, complétée par des ouvrages savants, le propos n’est pas celui d’un naturaliste. Quand besoin est, il s’appuie sur un extrait d’Élisée Reclus ou un ouvrage concernant un peuple mélanésien et sa musique, il renvoie à Utamaro ou cite Chateaubriand, c’est par souci chaque fois d’exactitude : l’ouvrage s’achève d’ailleurs par une bibliographie qui énumère les sources utilisées. Le projet de Demarcq déborde largement ce qui est apparent pour le lecteur qui feuilletterait seulement une partie du livre, la restitution des cris des oiseaux : ce n’en est qu’un aspect et, à différents endroits, sont donnés des éléments pour mieux saisir l’unité du livre.
Regarder avec attention les oiseaux, étudier autant leurs mouvements et leurs cris n’est donc pas pour écrire en ornithologue, bien plutôt « Observer avec eux m’invite à regarder le genre humain avec une distance, un décentrement, une fragile excentricité ». On entend là quasiment un moraliste, sans aucune naïveté ou anthropomorphisme béat ; certes les animaux n’apprennent pas directement ce que sont les hommes mais leur fréquentation incite à voir les hommes autrement. Demarcq le dit autrement à propos d’un séjour au Sénégal, « Je traque les oiseaux pour leurs hommes autant que pour eux. Pour les paysages et sociétés qu’ils côtoient en touristes, immigrés provisoires. » Cette attention aux hommes est lisible dans les pages du Journal tenu au cours de plusieurs séjours à New York ; Demarcq y fréquente les musées mais aussi les parcs, prend le métro, cherche sans succès les traces d’un village ancien, marche beaucoup dans les rues, s’arrête devant les gratte-ciel bâtis pour les milliardaires, constate l’appauvrissement des librairies d’occasion concurrencées par internet, concluant ainsi le Journal : « New York est une loupe rapprochant ce qu’il peut y avoir de splendide et de pire dans un Bref New World. »
Un autre aspect du projet touche à l’écriture puisque, pour Demarcq, « Les rythmes et sons, degrés zéro et infini du poétique, priment sur le sens et désaxent la syntaxe ». Partant de là, proposer de noter le cri des oiseaux n’oblige en rien à tenter une restitution que seuls des enregistrements peuvent accomplir — enregistrements qu’il utilise à l’occasion. Il essaie donc d’inventer dans la langue ce qu’est pour lui le cri du bruant ou de la fauvette, « je pars de quelques syllabes maladroitement imitées d’oiseaux / ce qui raréfie, étoffe, étrangle le vocabulaire à ma disposition ». Mais les modulations du cri ? la typographie joue un rôle puisqu’il est possible de varier le corps des lettres, d’insérer une portée musicale, de donner un mouvement : les mots d’un vers ne sont pas sur la même ligne, une série de vers représente le vol d’un oiseau. On pensera que ces manipulations sont bien éloignées du cri de tel ou tel oiseau ; cela est probable mais répond cependant à ce que recherche Demarcq.
Il y a dans sa démarche un refus du sens à tout prix ; il ne s’agit pas du tout de faire comme si la langue n’existait pas mais « de la rendre naissante, enfantine et fragile, à l’instant où des mots, des articulations s’esquissent dans le bégaiement. » C’est sans doute pourquoi, attentif aux manières de prononcer qu’il rencontre, il transcrit la prononciation différente du français par une personne rencontrée en Amérique (« Les péhuches détuisent toute sôte [...]). C’est pourquoi aussi il introduit, dans les proses comme dans les poèmes, des images pour remplacer les mots, des dessins en forme de lettres — une tente pour le A, par exemple, une suite verticale de points pour le "l" de pluie —des jeux variés avec les couleurs et les formes : ainsi un texte inscrit dans une sorte d’affiche rectangulaire elle-même dans la page.
C’est pourquoi enfin Demarcq pratique le calligramme ; il définit très justement que cet « affrontement » de l’écriture et du dessin implique pour lui « le mélange de caractères disparates, la déformation de certains ou leur détournement figuratif, la dislocation ou torsion des lignes, l’introduction d’éléments non scripturaux tels que vignettes, pictogrammes ou traits rythmiques, et mieux que tout la vibration des lettres et des couleurs, proches des vibratos du chant. » Passionné de peinture, il reprend des toiles, des couleurs ou des formes de peintres, de Monet à Dubuffet, à partir desquelles il construit ses propres formes. Il rappelle d’ailleurs dans son Journal qu’il avait essayé, à partir des toiles de Pollock à New York, de « dessiner des phrases ». Le goût — et le plaisir — de l’expérimentation sont sensibles dans ses tableaux recomposés comme dans ses transcriptions de bruits, ceux de « la futaie [qui] grinsse cracke grezzille d’insectes », du pic qui « tapopote ». Comme dans le choix des paronomases (« python piteux ») et, surtout, des calembours : en plus du titre, on relèvera les titres et sous-titres, « Cygne d’étang », « Recife à ses cieux », « exquis disent plus ? », etc.
On comprend que les réponses à la question posée au tout début du livre, « Pourquoi les oiseaux ? » sont multiples, celles d’un écrivain soucieux de « se penche[r] pour voir ce qu’il y nia ». Il faut ajouter que les réponses s’inscrivent dans une histoire, celle des lectures faites : évoquant ses souvenirs d’enfant abandonné et ses lectures précoces, Demarcq note que « qui lit descend au moins autant des auteurs qu’il a fréquentés que de son milieu », et les références littéraires ne manquent pas ici, notamment de Baudelaire, Poe, Apollinaire à Cummings. Il faut du temps pour lire et apprécier tous les jeux avec la langue de cette Vie volatile, et c’est tant mieux à une époque où tout "doit" aller vite.
Jacques Demarcq, La Vie volatile, éditions NOUS, 2020, 400 p., 30 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 septembre 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques demarcq, la vie volatile, recension | ![]() Facebook |
Facebook |





