01/07/2020
Jean Tardieu,Les tours de Trézibonde
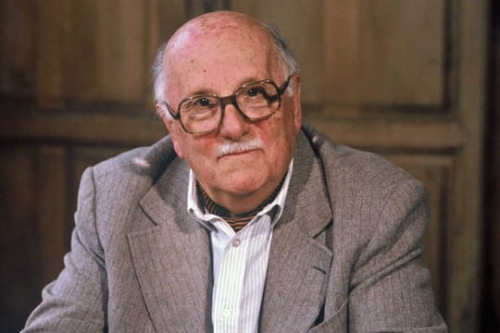
Les volets
Pendus aux murs de la maison comme feuilles aux branches mobiles mais tenus comme les feuilles au grand marronnier de la place par une matinée tournante incertaine triste et joyeuse dorages et d’éclaircies les volets les ns ouverts les autres clos ou bien les mêmes tour à tour le vents les ouvres et les rabat comme autant d’oreilles de lapins famille de lapins famille de volets poursuivis immobiles par le vent qui va-vient par le soleil qui s’endort dans un nuage et se réveille dans un courant d’air le bruit des oreilles de bois de lapins toujours battant les volets de la maison jamais lassés d’indiquer l’heure qui s’ouvre et l’heure qui se ferme la présence ou l’absence des habitants de la maison le temps qu’il fait le temps qui passe qui toujours va qui toujours vient toujours revient sinon pour nous qui partirons mais pour tous ceux qui reviendront.
Jean Tardieu, Les tours de Trézibonde, dans Œuvres, édition J.-Y. Debreuille, Quarto / Gallimard, 2003, p. 1285.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, les tours de trézibonde, les volets, ponctuation | ![]() Facebook |
Facebook |
30/06/2020
Jean Tardieu, Un mot pour un autre
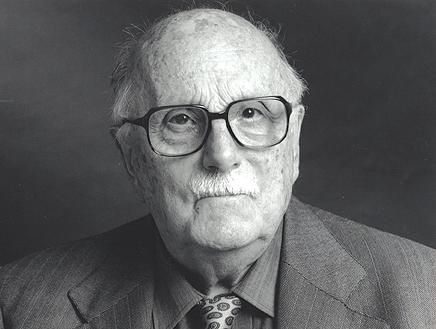
Le coco du bla-bla
Foin des chichis, flonflons et tralalas
Et des pioupious dur le dos des dadas ?
Loin des cancans, des bouis-bouis, des zozos,
Ce grand ding-ding faisant du du fla-fla
Et fi du fric : c’était un zigoto !
Il a fait couic. Le gaga eu tic-tac
(Zon sur le pif, patatras et crac-crac !),
Dans son dodo lui serra le kiki.
Mais les gogos, les nians-nians, les zazous
Pour son bla-bla ne feront plus hou-hou
La Renommée lui fait kili-kili.
Jean Tardieu, Un mot pour un autre, dans Œuvres,
édition J.-Y. Debreuille, Quarto / Gallimard,
2003, p. 423.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, un mot pour un autre, langue, humour | ![]() Facebook |
Facebook |
29/06/2020
Jean Tardieu, L'Espace et la flûte

Épilogue I
Après avoir effacé
tout ce que d’ombre promet
le sifflement qui me charme
après avoir en ce lieu —
Marsyas clown ou couleuvre _
rejeté toute ma vie
l’horizon clarté n’entend
volumes crevés outres vides
que le très doux glissement
d’une même ligne longue
qui me lie à la surface
Silence ailleurs qu’en moi seul
de rien je gonfle ma joue
dans le signe que je trace
tout l’espace est donné
Jean Tardieu, L’Espace et la flûte, variations
sur douze dessins de Picasso, dans Œuvres,
édition J.-Y. Debreuille, Quarto / Gallimard,
2003, p. 722.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, l’espace et la flûte, épilogue, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2020
Anna Akhmatova, Requiem

3 versions de
Requiem : Épilogue, I
Et j'ai appris comment s'effondrent les visages,
Sous les paupières, comment émerge l'angoisse,
Et la douleur se grave sur les tablettes des joues,
Semblables aux pages rugueuses des signes cunéiformes ;
Comment les boucles noires ou les boucles cendrées
Deviennent, en un clin d'œil, argentées,
Comment le rire se fane sur les lèvres sombres,
Et, dans un petit rire sec, comment tremble la frayeur.
Et je prie Dieu, mais ce n'est pas pour moi seulement,
Mais pour tous ceux qui partagent mon sort,
Dans le froid féroce, dans le juillet torride,
Devant le mur rouge devenu aveugle.
Anna Akhmatova, Requiem, traduction du russe par Paul
Valet, éditions de Minuit, 1966, p. 41.
*
J'ai appris comment se flétrissent les visages,
Comment la peur regarde sous les cils baissés,
Comment la souffrance burine sur les joues
Des pages rudes en signes cunéiformes,
Comment les boucles noires et cendrées
Soudain deviennent argentées,
Le sourire se fane sur les lèvres dociles,
Et l'effroi tremble dans un petit rire sec.
Et je ne prie pas pour moi seule,
Mais pour tous ceux qui étaient avec moi là-bas,
Dans un froid de loup et dans un juillet brûlant,
Sous le mur rouge devenu aveugle.
Anna Akhmatova, Poème sans héros, Requiem et autres œuvres,
présentation et traduction de Jeanne et Fernand Rude,
François Maspero, 1982, p. 187.
*
J'ai appris comment se défont les visages,
Comment, sous les paupières, la peur guette,
Comment la souffrance transforme les joues
En dures tablettes gravées de signes cunéiformes,
Comment les boucles noires ou cendrées
Soudat deviennent d'argent,
Comment le sourire se fane sur ls lèvres dociles,
Comment dans un petit rire sec tremble la peur.
Et je ne prie pas seulement pour moi,
Mais pour toutes celles qui étaient avec moi
Dans les grands froids et dans la canicule
Au pied du mur rouge aveugle
Automne 1939
Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes, traduits par
Marion Graf et José-Flore Tappy, La Dogana, 2010, p. 221.
Publié dans Akhmatova Anna, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, requiem (3 versions) | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2020
Hebri Michaux, L'étang (texte inédit dans Œuvres complètes)
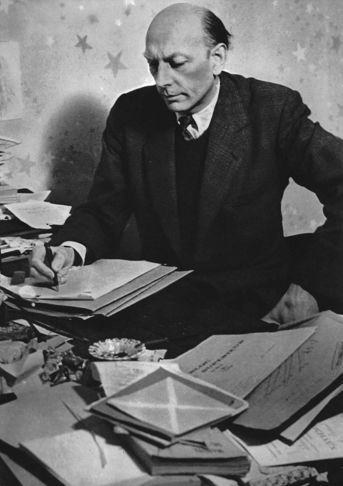
L'étang
Donne-lui un homme et du temps, il en fait un cadavre, puis il le rejette sur ses bords.
Il le gonfle puis il le rejette.
Lui demeure.
On avait établi des bancs aux alentours où l'on peut s'asseoir.
Ceux qui étaient fatigués venaient auprès de lui fumer de longues pipes.
Un château fut bâti en face.
Ceux qui désormais sont seuls aussi et orphelins et les oisifs volontiers s'approchent de lui qui ne fait rien et les mécontents l'entretiennent des causes de leur spleen, certains disaient, si j'étais noyé, si j'étais cadavre, je serais peut-être plus heureux, et ils réfléchissaient.
D'autres lui jetaient des mottes, des mottes de terre pour colorer sa face.
Il pourrissait les feuilles tombées petit à petit, mais ne sollicitait pas les feuilles encore à l'arbre.
De peu d'utilité à cause de son éloignement, on eût voulu l'approcher plus du village.
Mais voilà, quel charretier s'en serait chargé ?
Et il demeurait.
Il était là et ne venait à personne, ne cherchait point à courir, à souffler, psy, bschu, bschu...
comme l'eau de la rivière qui progresse sur les cailloux, ne recherche pas d'autres poissons que les siens.
Il demeurait.
Henri Michaux, Textes restés inédits du vivant de Michaux, dans Œuvres complètes, III, édition établie par Raymond Bellour avec Ysé Tran, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2004, p. 1417.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, l'étnd, château, fiction | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2020
Paul Louis Rossi, Le voyage de Sainte Ursule

(mémoire)
En ce temps-là j’étais dans un pays lointain et j’écoutais
dans le froid crépiter les glaces où luisaient
la flamme des autel et l’or fin
des missels
C’était dans un temps très ancien et je me trouvais dans une
Ville lointaine enfouie autant qu’il m’en
souvienne dans les neiges et pourtant
tiède et familière
Et j’entendais au cœur de cette Ville d’Europe une
musique résonner au fond des rues comme je
suppose doit résonner dans les cours
l’orgue de Barbarie
Et sans doute demeurais-je depuis toujours dans cette
Ville au ciel précieux comme un vieux pastel
qui le soir se teintait de rose
et de violet
Paul Louis Rossi, Le voyage de Sainte Ursule, Gallimard, 1973, p. 17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, le voyage de sainte ursule, orgue de barbarie, pastel | ![]() Facebook |
Facebook |
25/06/2020
Bernard Vargaftig, Le monde le monde

Feuillage et craie étonnés
Un abîme m’envahissait
La grève sans cacher près de l’éboulis
Ce qui est incomparable
La durée avec le gué
Et les oiseaux là-bas là-bas
Et comme éperdument chancelle en criant
La profondeur des contrées
Vent où la clarté traverse
À nouveau oubli et poursuite
Lilas dont la vivacité se répète
Ombre et première épouvante
Quand tout à coup rien ne manque
Les rochers le pli et ta robe
À l’écart dans l’ensoleillement désert
Emmurée par ton langage
Bernard Vargaftig, Le monde le monde, André Dimanche,
1994, p. 17
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, le monde le monde, abîme, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
24/06/2020
Jean Ristat, La Mort de l'aimé

La Mort de l’aimé, VI
Sur les bords de la loire j’ai perdu mon cœur
Et les flots paresseux ne m’ont rien rendu
L’oiseau ne m’a pas entendu qui s’endort au
Couchant mais qui donc possède sinon le vent
Je me suis enivré sur les bords de la loire
Le vin noir ne m’a rien donné que des larmes
Le sommeil et la froidure comme on voit aux
Gisants dans les églises où brûle l’encens
Sur les bords de la loire pas de pitié
On est vieux sans amour et comme un chien qui traîne
À la recherche d’une âme qui vive et tremble
Ici ou ailleurs que m’importe le désert
Jean Ristat, La Mort de l’aimé (1998) dans Ode pour hâter la venue du printemps, Poésie / Gallimard, 2008, p. 134-135.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, la mort de l’aimé (1998), loire, vent, larme | ![]() Facebook |
Facebook |
Jean-Claude Pirotte, La promenoir magique
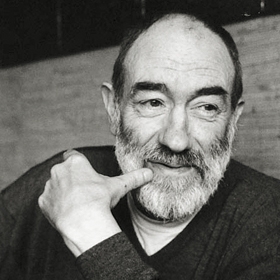
Max Jacob il souhaitait
s’ennuyer comme la Loire
je l’ai vue couler dans l’été
depuis longtemps Max était mort
et moi j’avais envie de boire
à Saint-Benoît pour oublier
que vivre étouffe les remords
ou les attire ah je ne sais
ce qui me faisait le plus mal
l’indifférence de la Loire
ou le grande douceur du soir
ou le scandale de l’étoile
qui a mené Max à Drancy
la même étoile que les mages
suivaient avec leur caravane
et qui brille au fond des âges
et dans l’âme de Max aussi
Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique,
La table ronde, 2009, p. 289.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, le promenoir magique, max jacob, loire, remords | ![]() Facebook |
Facebook |
23/06/2020
Gaspara Stampa (1523-1554), Poèmes

Vous qui écoutez mes poèmes,
ces tristes, tristes voix, ces accents désolés
de mes lamentations, échos de mon amour,
et de mes tourments sans pareils,
si vous savez, en nobles cœurs,
apprécier la grandeur, j’attends de votre estime
pour mes plaintes ieux que pardon, acclamation
leur raison étant si sublime.
J’attends aussi que plus d’un dira : « Heureuse
est celle qui, pour le plus illustre idéal
a subi si illustre épreuve !
Ah ! que n’ai-je eu la chance de ce grand amour,
grâce à un si noble seigneur !
Je marcherais de pair avec telle héroïne ! »
Gaspara Stampa, Poèmes, traduction de l’italien Paul Bachman, Poésie / Gallimard, 1991, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaspara stampa, poèmes, amour, renaissance | ![]() Facebook |
Facebook |
22/06/2020
Vittorio Sereni, Étoile variable
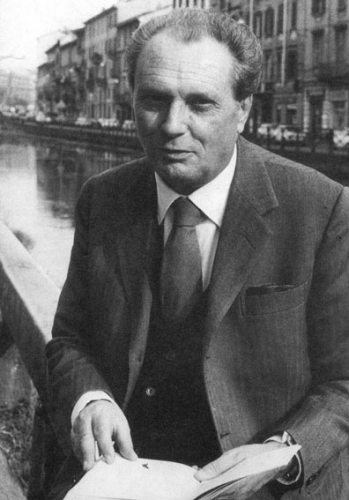
Lieu de travail
Ces marches où l’escalier fait un coude, tous
ces gens qui passent (et repassent chaque jour :
pour le travail) tournant au coin de l’escalier de la vie.
Usé
par ces réitérants le tapis à cet endroit
sous un froid reflet de lumière. L’hiver comme l’été
et là se refroidit
dans le guet-apens d’une pensée toujours semblable à elle-même
toujours prévue pour cet endroit
toujours pensée pareille
le regard qui là invariablement tombe
chaque jour chaque heure
d’années de travail d’années-lumière
de froid — comme toujours
là commence un automne.
Vittorio Sereni, Étoile variable, traduction P. Renard et B. Simeone, Verdier, 1981, p. 27.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vittorio sereni, Étoile variable, lieu de travail | ![]() Facebook |
Facebook |
21/06/2020
Henri Thomas, La joie de cette vie
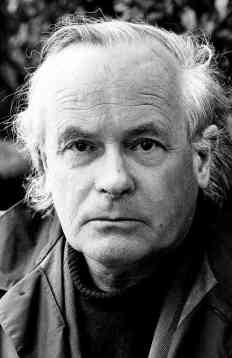
Je n’ai pas vécu ce que j’écris maintenant ; je le vis, je le découvre, en l’écrivant — sur le mode de l’écriture, comme on dit en croyant par cette formule expliquer quelque chose.
Un ami — il lui faudrait des qualités que je n’ose rêver de personne, et dont je n’ai pas en moi le modèle. C’est en ce sens que « Ô mes amis, il n’y a pas d’amis ».
Vivre, être, s’exprimer — je ne vois rien de plus — car voir ne passe pas outre.
Une bonne part des ennuis de la vieillesse vient des autres, jeunes ou vieux : ils vous retirent, par prudence ou par indulgence ou par mépris, les outils de la vie, les armes, les fonctions, « dont vous n’avez plus besoin ; Reposez-vous, ce serait risqué, ne vous exposez pas... » Ils n’ont jamais tout à fait raison, mais à la fin, de guerre lasse, par indifférence ou mépris, on lâche prise.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1992, p. 30, 32, 45, 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, vivre, ami, vieillesse | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2020
Emmanuel Laugier, Chant tacite

4 juillet
le lent décroché de l’écrire
: de ne pas
pouvoir écrire selon que le montage
expose aux assauts de ce qui vient
à l’instant même
redistribue les rapports :
- une plaque d’aluminium fondue
du fleuve large frappe l’esprit
qu’en écrire le décroché
à l’échancrure même de la branche basse où je vis
chevaux postés derrière la lisière
en attente
dans ce tableau
une masse de bruns nets un trouble
gagnent l’image par un point de lumière insistante
je ne sais plus si j’avance ici
ou là dans la limite de la vue donnée
il me souvient pourtant
de ramasser les branches sèches éparpillées
d’en faire plus tard un savoir local
dans mon carnet d’y notifier le poids
et parfois l’odeur entêtante
du cheval aiguise
le feu
Emmanuel Laugier, Chant tacite, NOUS, 2020, p. 192.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel laugier, chant tacite, écrire, montage, carnet | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2020
Petr Král, Déploiement
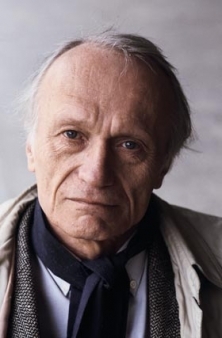
Petr Král, né le 4 septembre 1941, est décédé le 17 juin 2020. Déploiement venait d’être publié par les éditions Lurlure.
La vie urbaine
Sur la périphérie parfois un tramway vide
est dépassé par un camion plein de couverts tintants
On marche
et de l’autre bout de la rue vient
quelqu’un de tout à fait différent
L’ouvrier à l’entrée du métro viennois ignore même
au centre de quelle ville il se dresse. Certains arrivent de divers quartiers
pour chercher en costume sombre un accord commun sur l’estrade
d’autres seulement dans la même brasserie
criaillent à qui mieux mieux
Dans le silence profond de la ville soudain calmée
retentit clairement le mot fructifier
Belle viande vieillie lit-il dans la chaleur
comme obnubilé sur le tableau devant une boucherie
Même la jeune étrangère semble plus âgée dans sa robe blanchâtre
comme si elle avait tout apporté — le corps et le sort — du lointain Boston
Il la regarde et pense qu’il pourrait vivre un roman
avec elle ou du moins l’écrire minutieusement
Puis il voit l’ombre derrière une fenêtre ouverte
près du toit creuser mystérieusement une façade
et sait que rien ne peut être plus excitant
que le regard qu’il plonge dans cette ombre
pour la sonder
Petr Král, Déploiement, éditions Lurlure, 2020, p. 13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : petr král, déploiement, la vie urbaine | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2020
Antoine Emaz, Personne : recension

Le livre reprend quatre poèmes, dont trois parus chacun en édition limitée — deux en 2017, un en 2018 — le dernier dans une anthologie en 2018, et un poème plus ancien (1996), "Personne", lui aussi publié en tirage limité. Il s’ouvre par la question « et donc là qui », à laquelle Antoine Emaz refuse, comme il l’a toujours fait, « d’aboyer / moi moi moi ». Ce n’est pas nier la présence de celui qui écrit mais rappeler qu’il est, d’abord, comme « chaque un », « paquet de viande / bardé de peau » ; le "je" n’est pas ce qui importe, ici mis de côté, sous la forme « j’euh » ou placé entre deux termes — « quelqu’un je ou / personne » — qui renvoient à ce qui est le plus général, comme le "on", toujours adopté dans les poèmes. Refuser l’effusion n’est pas effacer le corps, qui sera « debout / parmi les corps-mots qui bougent » ; il s’en faut d’une lettre pour que l’on entende "corps-morts". Outre "debout", le lecteur reconnaît dans ce premier poème d’autres mots propres à Antoine Emaz, "mur" et, qu’il retrouvera sous une autre forme dans les poèmes récents, le couple "dans (dedans)" / "dehors".
Il s’agit toujours de tenter de restituer quelque chose des émotions à partir de la saisie de la réalité extérieure, non de s’épancher, c’est par ce qu’il retient des choses vues que le sujet apparaît. Le poème "Passants" en est un exemple ; contrairement à la passante dont l’œil « fascine » Baudelaire ("À une passante") et qui suscite chez le "je" des images amoureuses, les passants sur la plage n’ont pas de visage, « passants / rien d’autre », et c’est la désignation elle-même qui entraîne des images et le retour aux « passés », ces temps retrouvés avec « l’œil dedans » : la scène du dehors, elle, est « vide, à nouveau ». À partir des mouvements du dehors naissent plus ou moins vivement des traces du vécu et, comparables aux mouvements des vagues à marée basse quand elles ont perdu leur « énergie », « les êtres passés » qui reviennent à la mémoire sont devenus des « ombres », les images donnent fugitivement l’illusion qu’on revient dans un autre temps, mais seules les vagues « effacent ramènent », parce que « les mêmes / pas les mêmes ».
La mer, le sable et le vent sont les motifs des poèmes des dernières années d’écriture. L’espace se définit fortement par sa stabilité — le sol « serré / sous le pas » —, familier, rassurant parce que paraissant toujours identique à lui-même, les pas s’impriment dans le sable, disparaissent avec les vagues et il suffit de reprendre la marche pour qu’ils soient à nouveau visibles. Ressassement, toutes choses semblant ne jamais se transformer, « sable mer ciel » identiques ici ou ailleurs, ce qui accroît le sentiment d’être seul, dans la solitude, au milieu du paysage. Quand on passe de la plage à la page, les mots échouent à restituer l’apparence d’immobilité du paysage, il est là et cependant manque ce qui le fait vivant, il est maintenant « un lieu sûr sans lieu / nulle part / ici », on peut le répéter mais le vent — le mouvement de la vie — y sera toujours absent.
C’est le mouvement du vent dans des branches, alors images du désordre, qui fait aussi surgir, elles aussi désordonnées, les images du passé, fouillis, avec tout ce qui aurait dû être dit. Rien de ce qui a été vécu ne peut être retrouvé par les mots, de quelque manière que ce soit, et c’est cette illisibilité qui domine quand on cherche à classer ce qui fut, parce que « passent la vie et le sable des gens ».
Quelque chose de la maladie d’Antoine Emaz passe dans les poèmes, mais ce ne sont pas tant les défaillances du corps, la difficulté à se déplacer normalement qui l’indiquent que le sentiment de ne pouvoir restituer ce que le regard perçoit, « on ne sait plus // sans avoir peur », ou de ressaisir autre chose que des bribes dans la mémoire. De là sans doute dans un poème la reprise de la fin du premier vers, « tristesse étrange », de "Semper eadem" de Baudelaire. "Plein air" s’ouvre aussi avec Baudelaire, les premiers mots, « long linceul », venus de "Recueillement" ; "linceul" est, plus avant dans le texte associé à « suaire » ; ces mots sont liés à la mort, tout comme la proximité ensuite de "linge" et de "face" — comment ne pas penser au Christ ? Mais que la vie s’éloigne semble s’inscrire dans la construction même des séquences du poème : le verbe en disparaît presque complètement, comme dans ce fragment, « mots face rien dans leur peu presque vide bleu ». L’allitération du début (rare chez Antoine Emaz), « le bleu du linge qui bat l’air là », est comme un adieu aux ressources de la langue pour le choix d’un dépouillement beckettien, bien lisible dans la fin du poème, « de l’air au bout rien d’être que bruit de langue qui passe dans le vent sous le ciel // c’est encore dire ».
La préface de Ludovic Degroote n’est pas seulement l’hommage d’un ami ; reposant sur une connaissance approfondie des livres d’Antoine Emaz, elle y situe précisément les poèmes de Personne et, suggérant sans pesanteur une interprétation, elle est une invitation à explorer une œuvre brutalement interrompue.
Antoine Emaz, Personne, éditions Unes, 2020, 64 p., 16 64 p., 16 €. Cette note de elcture a été publiée par Sitaudis le 27 mai 2020.
Publié dans Emaz Antoine, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, personne, éditions unes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |





