19/09/2020
Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes

Sombre
Quand j’en aurai assez de moi
je me jetterai dans le soleil doré,
l’aile bruissante je revêtirai,
je mêlerai le vice et le sacré.
Je suis mort, je suis mort et le sang a coulé
sur l’armure en large torrent.
Je reviens à moi, différent, vous toisant
à nouveau du regard de guerrier.
Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes,
Traduction Luda Schnitzer, édition
Pierre Jean Oswald, 1967, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vélimir khlebnikov, choix de poèmes, vice, sacré | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2020
Jacques Réda, Du rythme — revue Catastrophes

Lettre parue dans la revue en ligne Catastrophes le 15 septembre 2020
Du rythme
Hyères, le 13 juillet 2020
.
Cher Laurent Albarracin,
Chers Catastrophés,
merci de me convier une fois encore dans votre cénacle dont aucun de ceux qui l’ont précédé dans l’histoire de la littérature ne s’est réuni sous un nom aussi approprié aux circonstances.
Mais répondre point par point à un questionnaire, m’a toujours laissé l’impression un peu désagréable de subir un interrogatoire. Aussi répondrai-je globalement au vôtre qui, d’ailleurs, concerne divers aspects du rapport qu’entretiennent, non moins globalement, prose et poésie.
Ici j’observe déjà un temps d’arrêt, car on sait à peu près ce que signifie le mot prose (si l’on fait abstraction du sens particulier qu’il a en latin de la liturgie romaine), mais je ne connais aucune définition communément acceptable du terme poésie. Je lui préférerai donc le mot vers, puisque même après l’abandon de ses formes régulières, et de ce qui justifiait pleinement l’emploi de ce nom, les poètes ont continué, pour la plupart, à présenter leur prose découpée d’abord en suivant plus ou moins les règles de la syntaxe, puis, fatalement, après l’avoir bousculée, selon des modèles arbitraires individuels qui relèvent de l’artifice typographique.
Prose et vers, donc, si vous le voulez bien, étant entendu qu’il existe des proses poétiques et des vers d’un prosaïsme parfait.
Mais il me semble que nous devons remonter à une époque où le langage ne connaissait pas la partition entre écrit et parlé. Certainement alors, en raison de ses avantages en matière de mémorisation, mais aussi des ressources de mystère et de puissance qu’il paraissait détenir pour le prêtre ou le sorcier, le vers a permis de distinguer le sacré du profane, et d’introduire ensuite dans le profane un élément particulier que nous appelons vaguement poésie.
Toutefois je vois les choses autrement, et je les ai vues ainsi de bonne heure, non en raison d’un « génie » particulier, mais bien parce que je suis, au contraire, longtemps resté au niveau commun brut où nous abordons le langage. C’est-à-dire, et peut-être même avant d’être nés, que nous découvrons d’instinct qu’il existe deux états principaux du langage : l’un qui n’est qu’une modulation, dans le mouvement incessant du temps, du sens qu’il véhicule dans le domaine de la vie courante ; l’autre qui, comme à contretemps, et sans pouvoir échapper à l’écoulement de la durée, y introduit un élément fixe qui est le vers. C’est en lisant La Naissance de la tragédie de Nietzsche (je ne suis pas nietzschéen pour autant), que j’ai compris en quoi mon intuition, universellement partagée, était juste : avant tout, il y a le rythme. Et les gestuelles comme les danses et arrangements de son qui ont dû précéder le langage (voyez les autres animaux), traduisent cette relation du vivant (de l’inerte aussi) avec le rythme.
L’invention progressive de l’écrit a tout changé. Longtemps encore, danse, musique et vers ont été réunis et, pour ce qui regarde notre propre histoire, le divorce ne s’est définitivement accompli qu’au moment de ce qu’on appelle curieusement la Renaissance.
Sans jamais rompre franchement mes liens avec ce qui me parait la prosodie naturelle, puisqu’elle fait droit au rythme qui informe tout, j’ai comme tout le monde écrit diverses espèces de vers réputés libres, avant de revenir aussi strictement que possible au vers régulier. Ce qui s’est passé depuis Rimbaud – et avec lui – prouve que notre langue s’est révélée, pour cause d’usure, incapable de trouver une autre structure susceptible de replacer le vers dans le continu rythmique à l’œuvre partout. Elle n’y peut parvenir qu’en changeant profondément elle-même, comme les divers latins en usage dans les Gaules entre le IIIe et le Xe siècle sont insensiblement devenus, au XVIIe, un intangible français.
Il ne sert à rien de le défendre. Mais il serait aussi vain de croire qu’avec le processus de métamorphose où son âge et toutes sortes de circonstances l’ont engagé depuis cent-cinquante ans, notre langue puisse se fixer de façon durable, utile à la communauté, autrement qu’à la faveur d’initiatives ponctuelles, individuelles, stériles et éphémères dans le parlé comme dans l’écrit.
Le français écrit se présente actuellement sous deux formes : une forme relativement stable de prose qui est en somme notre latin (et, en gros, celui de la langue littéraire), et celui du vers qui ayant perdu le contact avec le rythme, peine indéfiniment à le rechercher jusque dans les diverses et innombrables contorsions qu’on veut lui imposer.
C’est sans doute ce qui explique le mieux la désaffection dont la poésie est l’objet : on ne comprend plus la langue qu’elle emploie, chacun ayant son propre dialecte en vers, l’ensemble offrant la seule cohésion paradoxale d’un chaos typographique.
Écrire comme on parle ? Mais l’on ne parle déjà plus aujourd’hui le français que l’on parlait hier, et qui aura changé demain encore. Durant environ trois bons siècles (disons de 1620 à 1920), la langue écrite est restée proche comme jamais de la langue parlée par ceux qui savaient écrire. Et c’était certes un privilège, désormais à peu près aboli, mais sans effet, puisqu’en même temps la langue parlée a commencé à perdre l’énergie nécessaire à son renouvellement et à son simple maintien.
Voilà pourquoi j’écris en ce moment même en latin, et pourquoi, dans ce latin, je réutilise les formes de vers qu’il a patiemment et anonymement élaborées, car j’ai renoncé à croire que je pouvais me montrer plus savant que lui. Sa pratique n’exige qu’un peu de travail et un peu de modestie. À la portée de tous, il est le plus éminemment démocratique. Des dizaines de milliers de poètes l’ont employé (davantage peut-être), et permis de voir apparaître ceux que l’on peut attribuer sans erreur à Du Bellay, La Fontaine, Delille, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Toulet, Audiberti. (J’en passe.)
La vieillerie que lui a reprochée Rimbaud, est devenue celle du vers parfois gâteux qui universellement radote, au besoin avec une très constante intention de contribuer à la ruine qui le menaçait de toute manière.
Personne n’est coupable. Comme un jour me l’a dit prosaïquement Guillevic, en son temps célèbre, « on fait ce qu’on peut, on n’est pas des bœufs. » Voilà de quoi en rabattre sur le lyrisme. Et malheureusement pas que sur lui...
Pardon de m’être montré si loquace : le sujet me tient à cœur. Je comprendrais très bien que vous ne puissiez pas publier la totalité de ma réponse. mais je ne souhaite pas que l’on n’en donne que des extraits. Comme je suppose que vous, vous l’aurez lue, j’estimerai avoir eu ainsi suffisamment de vrais lecteurs.
.
Avec ma sympathie la plus sincère,
JRéda
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, du rythme, prose, poésie, français, écrit, oral, vers, prose — revue catastrophes | ![]() Facebook |
Facebook |
17/09/2020
Laurent Albarracin, Sonnets de contrebande

Prendre une clochette pour de l’argent content
N’est certes pas commettre une bien grande erreur.
Il est parfois plus de vérité dans un leurre
Si l’on prend celui-ci pour midi au cadran,
Car il faut bercer les illusions qui nous bernent,
C’est le meilleur moyen de les circonvenir.
Et dans le but de ne pas trop con devenir,
Vidons nos vessies pour éclairer nos lanternes.
Tomber dans le panneau miraculeusement
Arrive à qui est naïf délibérément.
Cela survient quand le mot fait fourcher la chose
Et que bifide elle se darde et se regarde
En chien de faïence, stupéfaite, hagarde,
Elle correspond quand à soi-même s’oppose.
Laurent Albarracin, Sonnets de contrebande, dans
Place de la Sorbonne, n° 8, mai 2018, p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, sonnets de contrebande, humour | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2020
Petr Král, Déploiement : recension
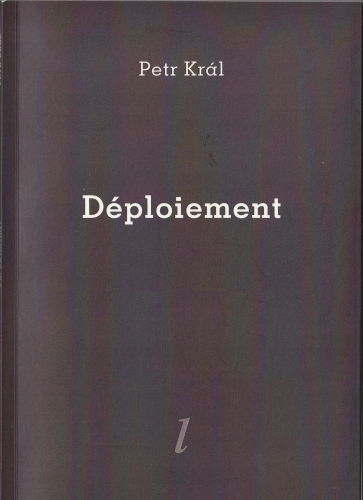
Petr Král, né en Tchécoslovaquie (1941), quitte comme Kundera son pays après l'écrasement en août 1968 du Printemps de Prague par les armées soviétiques ; il s'installe en France, où il sera naturalisé, et écrit une grande partie de son œuvre (récits, essais et poésie) en français. De retour à Prague à partir de 2006, il y est mort le 17 juin 2020.
Les quatre parties du livre ont un point commun, la plus grande partie des poèmes a pour lieu la ville. Le premier a pour décor Vienne, précisément le "Café Schwarzenberg", évoqué tel qu'il devait être avant la Seconde Guerre mondiale et à sa fin, quand les Russes l'occupèrent, fréquenté désormais par un public aisé. Dehors, le flâneur connaît avec le soir une « illusion apaisante », mais ce n'est qu'un « mirage », rien n'est transparent et rassurant dans la ville, il suffit de se demander ce qui pourrait apparaître à l'angle de la rue pour aussitôt imaginer quelque chose de mystérieux. La ville, par excellence, est le lieu de l'inattendu ; Petr Král, qui fut un des surréalistes tchèques, y guette sans cesse la surprise dans ses errances,
On marche
et de l'autre bout de la rue vient vers nous
quelqu'un de tout à fait différent
À côté de la banalité de ce qui est visible dans la rue — la promenade des chiens le soir, une réclame à la devanture d'une boucherie — s'offre une variété infinie de choses qui font travailler l'imagination ; c'est l'ombre qui rend mystérieuse une façade, c'est une fenêtre ouverte où l'on devine un fait-divers, et c'est aussi une jeune étrangère que l'on croise et qui disparaît, « Il la regarde et pense qu'il pourrait vivre un roman / avec elle ou du moins l'écrire minutieusement ». Impossible de ne pas penser à André Breton et à sa rencontre, en 1926, avec celle qui se nommait elle-même Nadja.
La présence des mystères dans la ville, tels qu'ils se manifestaient dans le surréalisme, est explicitement exprimée dans plusieurs poèmes et la démarche même de Petr Král met en évidence les aspects irrationnels de la vie urbaine ; il privilégie en effet pour rendre compte de ce que voit le narrateur — le plus souvent un "je", parfois un "il" — l'énumération, qui fait se succéder des éléments sans aucun lien entre eux ; ainsi :
Une bûche qui atterrit
une ville se défait
Un poème est d'ailleurs titré "Inventaire", un autre s'achève par « Et ainsi de suite / jusqu'à épuisement du stock », et dans "Planète", la liste rassemble des faits hétéroclites dont certains n'ont d'autre réalité que d'écriture — comme : « Les jeunes mères essuient en hâte le sol de la cuisine / avec leur culotte » — ce que confirment les deux derniers vers, « Je repose mon stylo / L'histoire de la poésie pour l'instant s'arrête là ». Le caractère hors de toute logique des quelques énoncés est d'autant plus mis en évidence qu'ils sont parmi d'autres qui relatent des évènements du quotidien ; le surréel encadre dans un poème, "Tâche", diverses tâches à accomplir ; le premier vers, « Tuer une concierge couleur fraise », a en effet pour réponse le dernier, « Tuer la concierge avec une fraise ».
L'étrangeté inhérente à la ville, Petr Král la rencontre partout, en Tchéquie à Prague, à Brno, à Vrchlabi, mais sont évoquées aussi Bruxelles, Venise, New York, comme s'il était indispensable de vérifier que « La ville change toujours ». Aussi dans bien des poèmes est présent ce qui est lié au départ, au voyage : les aéroports, les gares, les quais, les trains, et au déplacement dans la ville, le tramway, — ce qui donne lieu à des portraits de voyageurs, casque sur les oreilles, femmes bavardes, yeux porcins, chacun indifférent aux autres et, amère conclusion, « Le conducteur bien sûr nous déteste tous ». Le monde de la ville d'aujourd'hui n'a rien d'aimable, on peut rencontrer un cadavre dans le fleuve arrêté par la pile d'un pont ; mais surtout, la vie est dominée par la futilité et l'argent, dans la conversation d'un café « retentit clairement le mot fructifier », ailleurs c'est la folie des soldes et des achats inutiles ou la recherche dérisoire du record sportif, dérisoire dès que l'on regarde les étoiles. Que reste-t-il ? Certes, dans la ville où l'on marche, « La seule vérité est le pavé désert / des rues nocturnes dépeuplées », mais contre les hommes d'affaires qui cherchent à y imposer leurs fausses valeurs, existe cependant toujours « Chaplin-vagabond ».
C'est ce vagabondage, ce refus de l'ordre des choses qui anime Petr Král, refus qu'il retrouve dans la littérature, représenté notamment par les écrivains qu'il cite, Čapek, Reverdy, Swift, Kosovoï, Rimbaud, José Carlos Becerra. Les œuvres « apportent la joie », comme les voyages mais qui, eux, « attristent » parce qu'on rencontre toujours les mêmes solitudes. Au fil des poèmes est aussi récurrente la présence des femmes et elle éclaire aussi le quotidien ; par là, Petr Král poursuit une certaine célébration de la femme par le surréalisme, le narrateur s'adressant à l'aimée, « Ta nudité et le frémissement d'un papillon sont le monde ». On retrouve donc dans Déploiement les motifs de la poésie de Petr Král, avec l'amour de la ville, lieu des découvertes les plus étranges, le goût du concret, comme au début d'un poème « J'achève de manger une salade de poissons / sans cesser d'écrire la barquette vide fait désormais partie du poème ».
Petr Král, Déploiement, éditions Lurlure, 2020, 80 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudisle 17 août 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : petr král, déploiement, éditions lurlure | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2020
Anne Seidel, Khlebnikov pleure

SARAT II / Origine
le poème commence
nous laissons une image
telle une fumée
de cheminées
monter, un navire
qui sombre
nous regardons les petits
(tristia-)
meurtri
étroit,
silencieux, bourdonnant ou rusé.
soir (avec fin)
étranger
effleurée, la couverture brillante
près
des réseaux électriques
un lambeau de shakespeare
Anne Seidel, Khlebnikov pleure, traduction
(allemand) de Laurent Cassagnau,
éditions Unes, 2020, p. 13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne seidel, khlebnikov pleure, origine, shakespeare, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2020
Paysages du Cantal






Photos Chantal Tanet
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2020
Étienne Faure, Tête en bas

Manger du pain noir fut longtemps craint
de tous ceux que la guerre asséna
sur tous les fronts de part et d’autre,
comme si ce froment allait faire revenir
les années noires de frêle constitution
quand il fallait à défaut de croître
escompter, surseoir, subsister,
rassasié jamais en ces temps rassis,
en appelant aux mots, ces ersatz
dont la bouche et les os, les corps dans l’attente
étaient devenus friands, même à l‘école,
à délier gravement à l’encre de sureau
sur des cahiers les lettres mauves, resserrées
— je déguste, il savoure, nous nous régalons — l
longeant les jours de guerre en courant
dans des vêtements hérités des grands,
inaptes, pendant longtemps, à les remplir.
aux mangeurs de pain noir
Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard,
2018, p. 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2020
Étienne Faure, Ciné-plage

Logeaient-ils dans la grandiloquence,
le bruit sec bien réel des chaussures
les ramenait, comédiens jour et nuit
sur les planches — presque des étagères —,
à se déplacer lentement, parole et gestes,
dans une jeune ou vieille chair bientôt carne,
mince à passer les portes du décor,
ou tonitruante et tremblante
sous le trouble du verbe en mouvement,
experts à déclamer jusqu’à leur mort
tout ce qu’une cervelle encore recèle
— ce n’est pas là qu’il faut applaudir —
la voix reprenant le dessus,
les mots leur envol déployé
jusqu’aux battements d’ailes imprécis
à la fin qui se joignent
— et le reste est silence.
parole et gestes
Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon,
2015, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, ciné-plage, comédien, parole, geste, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2020
Étienne Faure, La vie bon train

Lents comme des états d’âme,
après l’été les trains revenaient,
las d’avoir trimballé tous ces corps
à la mer, dans les montagne, dans les contrées
dont furent natifs les pères (introuvables sur la carte),
à grincer de nouveau en gare,
y faire leur rentrée, annoncer le pire
qui toujours sera à venir,
le soleil ras rougissant la face des ultimes
voyageurs ; c’était l’automne,
chacun se rappelait les vers
d’Apollinaire — un train qui roule ; ô ma saison mentale
et la violente espérance de vie :
devait-on revenir
quand il aurait fallu ne partir jamais
— et puis après,
dans la gare sans issue,
on n’allait pas pleurer pour ça.
revenir
Étienne Faure, La vie bon train, Champ Vallon,
2013, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, la vie bon train, partir, revenir | ![]() Facebook |
Facebook |
10/09/2020
Étienne Faure, Horizon du sol

Le taffetas des robes
au chevet des mourants inspire
une espèce de rémission :
les morts, in extremis, les robes
leur accorderont un semblant de répit.
Il faut finir,
ne penser à manger ni dormir
— adieu mon amour, le moins possible —
et ils respirent, c’est ça,
l’éternité — souffles longs —
des grains d’amaryllis au parfum suspendu,
spacieuse éternité,
à la lenteur des pas pressentant du drapé
le mouvement des plis qui frôlent
la lourdeur de la litre, à tout âge
le gris fatidique des femmes.
les robes mortes
Étienne Faure, Horizon du sol, Champ Vallon,
2011, p. 89.
Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, horizon du sol, les robes mortes, éternité | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2020
Étienne Faure, Vues Prenables

Et puis après tout ce remue-ménage
laisser les dieux se reposer,
les meubles se déglinguer, lentement
retrouver le guingois propice à la résonance.
Sans inquiétude à l’idée de chute
il reste et prend goût en précaire imposture
à la minime durée qui lui échoit,
pour rire, traverser la langue et s’attarder
dans un vérisme où le soleil dru tombe
sur des motifs très humbles :
ici l’abandon d’un mot qui tout disait
mais boiteux contrariait le texte
— une mortaise le remplace
pas trop visible, ainsi qu’une console au pied plus clair,
ces meubles naguère aimés
quand jeune (pas un ver, rien de vermoulu)
il parlait aux meubles ; ils l’écoutaient, endurant ses mots
poussés jusqu’à la sciure.
énième consolation
Étienne Faure, Vues prenables, Champ Vallon,
2009, p. 95.
Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, vues prenables, consolation, vérisme | ![]() Facebook |
Facebook |
08/09/2020
Étienne Faure, Légèrement frôlée

Aux champs dans les kermesses,
cérémonies et fêtes, c’est la fusion
des corps, des âmes, feux et foyers
avec le tintamarre des cloches
à la volée, en concordance avec les oiseaux migrateurs
et les canards dans le ciel incendié, les fanfares
et les drapeaux des jours fériés traversés de soleil
et des lois qui les ont institués :
toutes les générations présentes,
à venir, passées, hantent les lieux à la cantonade,
la bouche ouverte au rire, mégot, cigare ou pétard à mèche,
au boire et au manger,
fêtant leur saint patron, plastronnent
avec la certitude éternelle d’être au cœur
du monde et de l’instant
(à peine à cette heure sait-on qu’elle est ronde
et tourne, ignorant
par une sorte d’application de la théorie des vases,
où va le soleil qui s’abat, s’engloutit en silence,
comme étranger aux clameurs du canton).
le centre du monde en plein champ
Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ
Vallon, 2007, p. 65.
Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, le centre du monde, fête, champ | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2020
Johannes Bobrowski, Boehlendorff et quelques autres

La béatitude des païens
Au-dessus du manteau court, taillé dans la peau d’une bête abattue, un visage comme de fer. Avec des yeux profondément enfoncés, que la lumière ne doit pas atteindre. Même la chevelure grise, qui mange une partie du front, n’accepte pas la lumière, tout comme le vent qui vient de la rivière, en sautes rases, et parle sans s’arrêter, et dit un nom, toujours le même.
Ici, avant les rapides, la rive envoie des bancs de sable en travers du courant jusqu’à ce que l’eau vive cède du terrain, se détourne, se heurte à l’autre rive. Juste de l’écume encore à la pointe plate des langues de terre et le bruit des eaux, comme des débris de verre, des tourbillons au-dessus desquels les oiseaux fusent comme s’ils voulaient calmer les flots, et le silence inévitables propre aux lieux désertés.
[...]
Johannes Bobrowski, Beohlendorff et quelques autres, traduction Jean-Claude Schneider, La Dogana, 1993, p. 71-72.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, beohlendorff et quelques autres, la béatitude des païens | ![]() Facebook |
Facebook |
06/09/2020
Johannes Bobrowski, Temps sarmate

Nymphe
Le temps des cigales, un temps
blanc, alors que le garçon, assis
au bord de l’eau, sur ses bras
inclinait la rondeur de son front. Où
est-il allé ?
Il y a des chemins
à travers la forêt,
secrets. J’y vais cueillir une herbe
qui saigne. Sur les pierres je la pose,
lance par-delà la lisière le cri
de chasse du geai, clair.
Et, le regard verdissant,
elle émerge dans la poudreuse, la tendre
ombre des aulnes.
Syrinx, ton ah, un bris de verre,
court parmi les buissons.
Johannes Bobrowski, Temps sarmate,
traduction Jean-Claude Schneider,
L’Atelier La Feugraie, 1995, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, temps sarmate, nymphe, cigale, syrinx | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2020
Johannes Bobrowski, Terre d'ombres fleuves

Récit
Rajla Gelblung
échappée à Varsovie
d’un transport parti du Ghetto,
la fille
a traversé des forêts,
avec une arme, la partisane
fut prise
à Brest-Litowsk,
portait une capote (de soldat polonais),
fut interrogée par des officiers
allemands, il y a
une photographie, les officiers sont
des personnes jeunes, aux uniformes impeccables,
aux visages irréprochables,
leur apparence
est exemplaire.
Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves,
traduction Jean-Claude Schneider, Atelier
La Feugraie, 2005, p. 137.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, terre d’ombres fleuves, récit, ghetto, juif, camp | ![]() Facebook |
Facebook |





