01/05/2016
Jean Genet, Ce qui reste d'un Rembrandt déchiré...
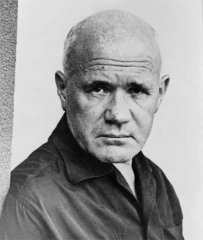
Ce qui est resté d’un Rembrandt…
Comme une odeur d’étable : quand, des personnages, je ne vois que le buste (Hendrijke à Berlin) ou seulement la tête, je ne peux m’empêcher de les imaginer debout sur du fumier. Les poitrines respirent. Les mains sont chaudes. Osseuses, noueuses, mais chaude. La table du Syndic des Drapiers est posée sur de la paille, les cinq hommes sentent le purin et la bouse. Sous les jupes d’Hendrijke, sous les manteaux bordés de fourrure, sous les lévites, sous l’extravagante robe du peintre les corps remplissent bien leurs fonctions : ils digèrent, ils sont chauds, ils sont lourds, ils sentent, ils chient. — Aussi délicat et grave que soit son regard, la Fiancée juive a un cul. Ça se sent. Elle peut d’un moment à l’autre relever ses jupes. Elle peut s’asseoir, elle a de quoi. Madame Trip aussi. Quant à Rembrandt lui-même, n’en parlons pas : dès son premier portrait sa masse charnelle ne cessera de s’accélérer d’un tableau à l’autre jusqu’au dernier, où il arrive, définitif, mais non vidé de substance. Après qu’il a perdu ce qu’il avait de plus cher — sa mère et sa femme — on dirait que ce costaud va chercher à se perdre, sans politesse envers les gens d’Amsterdam, à disparaître socialement.
Vouloir n’être rien, c’est une phrase qu’on entend souvent. Elle est chrétienne : faut-il comprendre que l’homme cherche à perdre, à laisser se dissoudre ce qui, de quelque manière, le singularise banalement, ce qui lui donne son opacité, afin, le jour de sa mort, de présenter à Dieu une pure transparence, même pas irisée ? Je ne sais pas et je m’en fous.
Jean Genet, Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes, dans Ouvres complète, IV, Gallimard, 1968, p. 21-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, ce qui reste d'un rembrandt déchiré.., corps, portrait, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
20/04/2016
Étienne Faure, Légèrement frôlée
La nuit quelqu’un pleure en elle
plus souvent qu’autrefois.
Sur le ponton, sa peur
— chair évidée des poissons servant d’appâts —
cent fois réveillée, c’est la noyade.
Ce chagrin d’un autre, elle le porte
ainsi qu’un deuil à très haute tension
dans la gorge, au sternum, sous les os.
Puis, le jour revenu, le sang circule,
chacun respire,
de nouveau la vie va reprendre,
on a eu peur ; pourtant
l’amour que le mort lui porte
n’a pas quitté ce corps, chair votive
où la beauté résiste à fleur de peau
— tant le mort pense à elle —
comme en janvier fleurissent
les camélias du littoral
malgré le froid, puis fanent,
offerts à la jetée.
les camélias du littoral
Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon,
2007, p. 60.
Étienne Faure a publié Vues prenables (2009),
Horizon du sol (2011), La vie bon train (2013),
Ciné-plage (2015).
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, légèrement frôlée, les camélias du littoral, perte, chagrin | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2015
Étienne Faure, Ciné-plage
T’as perdu ta langue
T’as perdu ta langue — effroyablement seule
et soudain exacte est la phrase
entendue quand on se sait plus — stupeur —
lire, écrire, ni rêver dans la langue
qu’on avait crue acquise de longue date,
à cet instant frappé d’hébétude
de n’avoir su garder racine en elle,
mots précaires, locutions locales
qui s’immisçaient vaguement jusqu’à l’âme,
et que noué jusqu’à la glotte par l’émotion
de la perte on revit le mutisme
de l’enfant d’alors qui savait à peine
la langue qu’on lui parlait quand l’autre,
la maternelle, était déjà en voie de partance
sans plus d’espoir de la retrouver, enfouie,
t’as perdu ta langue.
perdue
***
Entrée, sortie
Qui est là — et voilà, debout
après les trois coups pour entrer dans l’histoire
à dormir sur les planches, il déclame
face aux assis en rang sur les fauteuils
qui attendront la fin, cramoisis, pour éclater,
ou transis regardent dans leurs lorgnettes
l’avenir de loin,
entrer le vieil acteur au teint farineux,
un crâne en plastique à la main pour dire,
mis en branle par le corps, son texte
appris par cœur, lui donner le souffle
que la langue et la voix fusionnent
dans l’illusion qui se fait attendre
jusqu’à l’applaudissement, premier rappel
quand, se dit-il, revenu à pas caverneux pour saluer,
le tour est joué.
ceci est du théâtre
Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon, 2015,
- 103 et 118.
Rencontre avec Étienne Faure et lecture, le mercredi
9 décembre, à partir de 19h à la librairie "Libralire",
116, rue St-Maur, Paris, 75011.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, ciné-plage, langue, perte, théâtre, rôle, spectateur, acteur | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2015
Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes

Une sorte de perte
Utilisés en commun : des saisons, des livres et une musique.
Les plats, les tasses à thé, la corbeille à pain, des draps et un lit.
Un trousseau de mots, de gestes, apportés, employés, usés.
Respecté un règlement domestique. Aussitôt dit. Aussitôt fait. Et toujours tendu la main.
De l’hiver, d’un septuor viennois et de l’été je me suis éprise.
De cartes, d’un nid de montagne, d’une plage et d’un lit.
Voué un culte aux dates, déclaré les promesses irrévocables,
porté aux nues un Quelque chose et pieusement vénéré un Rien,
(_ le journal plié, la cendre froide, un message sur un bout de papier)
intrépide en religion car ce lit était l’église.
La vue sur la mer produisait ma peinture inépuisable.
Du haut du balcon il fallait saluer les peuples, mes voisins.
Près du feu de cheminée, en sécurité, mes cheveux avaient leur couleur extrême.
Un coup de sonnette à la porte était l’alarme pour ma joie.
Ce n’est pas toi que j’ai perdu,
c’est le monde.
Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes (poèmes 1942-1967), édition, introduction et traduction François Rétif, Poésie / Gallimard, 2015, p. 437 et 439.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, toute personne qui tombe a des ailes, perte, vie quotidienne, absence, joie, monde | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2015
Caroline Sagot Duvauroux, 'j

[...]
Qui pleure-t-on ?
Y a-t-il un secours ?
Couper dans soi ?
Tu fut-il ?
Je n’est plus pour le savoir ?
Si tu n’est plus pour que je
Y a-t-il un autre destinataire du monde ?
Sans doute.
Pour qui sont ces serpents ?
Y a-t-il encore du blanc aux fleurs de camélia ?
Le lierre coule-t-il encore des parois ?
Le crime de défaire ?
Ne fait pas très bon, là
Faut-il refaire ces choses où je fut malhabile ?
La mort ? Je ne sais pas
Apprends-moi ce que je sais
pour que je reconnaisse
Où es-tu ? je ne peux me souvenir
Quelle contingence avec demain ?
Indigne de contingence ?
Dès aujourd’hui mais
demain ? qu’est-ce dire ?
Qui suis-je ? est-ce ? et pour qui sont ?
Rêvais-tu ?
Je n’étais pas là
Rêvais-tu pour carner le dogme ?
J’faut
sans la violence
Faudrait
mais sans la violence
Et dire encore merci ?
Tu ne seras pas là je n’étais pas là
Je ? là ? qu’est-ce ?
Nous n’étions qu’ici
Qui dans le feu tord une aurore ?
pour légender l’instant d’un incipit
au point du jour
Avant l’erreur point de jour au rideau
[...]
Caroline Sagot-Duvauroux, ’j, éditions Unes,
2015, p. 46-47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, 'j, deuil, identité, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2014
Paul Auster, Dans la tourmente, dans Disparitions

En mémoire de moi
Simplement m'être arrêté.
Comme si je pouvais commencer
là où ma voix s'est arrêtée, moi-même
le son d'un mot
que je ne peux prononcer.
Tant de silence
à faire naître
dans cette chair pensive, battement
de tambour des mots
au-dedans, tant de mots
perdus dans le vaste monde
au-dedans de moi, et de ce fait avoir compris
que malgré moi
je suis là.
Comme si c'était le monde.
Paul Auster, Dans la tourmente, dans Disparitions, traduit
par Danièle Robert, Babel, 2008 (éditions Unes/ActesSud, 1994), p. 158.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul auster, dans la tourmente, dans disparitions, mot, silence, perte, monde | ![]() Facebook |
Facebook |
11/10/2014
Alain Veinstein, Voix seule

Aujourd'hui
Encore une approche manquée...
Trop de mots, décidément,
trop de mots tonitruants.
La terre, jusqu'à nouvel ordre,
n'a rien d'un théâtre
où se déploie le merveilleux.
Seul le froid s'invite dans l'air,
s'infiltre, se resserre,
épaissit le silence.
Il m'accompagne depuis l'enfance
ce silence glacé
dans le calme accablant
du noir.
Aujourd'hui
Voix
en grandes capitales rouges,
oubliée et remontée
de l'épaisseur de la nuit,
restée à l'abri de la mort.
Dans le recoin où je vis,
je la rejoue de mémoire,
elle résiste,
ne se laisse pas faire,
chante, oui,
de ne pas chanter.
À chaque instant
je suis sur le point de la perdre,
à chaque instant
tout peut être perdu.
Alain Veinstein, Voix seule, Seuil, 2011, p. 139, 175.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, voix seule, mot, terre, froid, nuit, voix, chant, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
26/08/2014
Antonio Rodriguez, Pulsion fission

Pulsion fission
tout n'est pas perdu, même si les noyaux éclatent, même si les particules se percutent, même si c'est l'âge de la fission, l'époque des amours sensibles, l'époque des amours déçues, avec des déçus qui résistent et des déçus qui s'évadent, et tous se percutent ; nous y sommes, je crois, nous comme les autres, sensibles et déçus dans cette fission, à nous percuter lentement dans l'espace restreint de notre cuisine, dans l'espace restreint de la salle de bains, avec des meubles lourds qui nous regardent, avec des objets ébahis qui nous questionnent, nous et nos meubles qui nous regardent, tandis que nous rêvons de nous assembler autrement, d'échanger encore des fluides, de suinter délicatement, sans ces meubles, sans leur regard lourd ; est-elle restée la même, merveilleuse qui s'oublie parfois, douce et bestiale ? est-elle restée la même, avec sa part de sucre entre les jambes ?
Antonio Rodriguez, dans L'étrangère, n° 35-36, 2014, p. 183.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio rodriguez, pulsion fission, perte, amour déçue, espace, femme, objet | ![]() Facebook |
Facebook |
24/08/2014
Jean-Louis Giovannoni, Les mots sont des vêtements endormis

Je me regarde sans cesse dans les reflets des vitrines, je me surveille. Toujours cette peur de me perdre.
On court, on s'agite, rien que pour faire croire que l'on connaît la sortie.
Sous ces traits, ce visage à jamais tourné vers lui-même que seuls les murs savent refléter.
Bouge un tant soit peu,
et c'est un monde qui s'efface.
Ce besoin de toujours traîner un corps dans ses rêves.
Tu regardes l'espace : tu penses aux oiseaux. Et lorsque tu t'agites ce ne sont que tes membres que tu agites.
Chaque matin, une force bestiale me pousse à revenir, à émerger.
C'est terrifiant de penser que l'on peut emporter le monde, juste en fermant les yeux.
Que veut-on tuer lorsqu'on se tue ?
Ce sont nos vêtements qui nous donnent corps — sans ça tout s'effondrerait.
Pourquoi faudrait-il qu'on soit sauvé et pas ce chat, ce cendrier... ?
Jean-Louis Giovannoni, Les mots sont des vêtements endormis, éditons Unes, 2014, p. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, les mots sont des vêtements endormis, corps, rêve, espace, perte, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
31/05/2014
André du Bouchet, Je suis sur les traces d'un autre

Je suis sur les traces d'un autre
je suis sur les traces d'un autre
là, je ne me serais pas risqué si un autre — inattendu — ne s'était pas résolu à prendre les devants. tout cela demeuré, sinon, perdu ou fermé.
la perte même aujourd'hui de ce qui est perdu — mots à la hâte griffonnés debout illisibles, ou carnets eux-mêmes plus d'une fois perdus ou manquants — la perte même de ce qui est perdu m'apparaît aujourd'hui insignifiante. mesure pour moi d'une distance, hauteur, ou détachement — cela revient au même, et termes synonymes — prise, qui rend, lorsque je m'en avise, les choses plus respirables. et cette transcription lorsqu'à mon tour, et rapidement, je m'y serai résolu, apport de ce manque — manque sans regret — respirable.
perte de ce qui est perdu apparue insignifiante.
et voilà, sur ses blancs, pour autrui — et l'œil d'un autre que moi-même je puis être — le temps sur ses fractures à nouveau homogène, comme aisé.
[...]
André du Bouchet, Je suis sur les traces d'un autre, dans Europe, "André du Bouchet", juin-juillet 2011, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, je suis sur les traces d'un autre, perte, mots, carnet, distance, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
03/05/2013
Virginie Poitrasson, Journal d'une disparition — mai 2008

6 mai
présence du vélo sous mes pieds, les pédales qui tournent sous la poussée, l'essoufflement prend forme
première annonce de ta disparition
7 mai
retour aux bases, première gestuelle de survie, avec peut-être de l'agitation, et la matière, la matière si forte à cet instant
ta chambre vide de ta présence
8 mai
en recherche, en action, à tourner en rond, avec les scénarios les plus probants, échafaudages accrochés aux émotions
et ta trace comme s'évaporant au soleil
9 mai
statique, tendue, arrêtée dans le salon, du salon au jardin, du jardin au salon, périmètre du raisonnement mental
quand tu commences à te livrer virtuellement
10 mai
le début de la liste, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, parce que faire des listes fait tenir (faire des listes pour ne pas devenir fou)
et tu es ressenti comme une perte — mais pas totale
11 mai
une pause suspendue, bulle de patience, oreilles et bouches multiples, tout dans la gravité, suspendue en l'air, gravitation qui s'incite et s'insinue en moi
toi, ton odeur, ta musique, tes objets, ta souffrance encore présents dans la pièce
[...]
Virginie Poitrasson, Journal d'une disparition — mai 2008—, Ink, 2009, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginie poitrasson, journal d'une disparition — mai 2008, vide, trace, perte, chambre | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2013
Yasmina Reza, Nulle part

La petite fille marche en tirant son cartable. Dix fois, elle se retourne, dix fois, elle s'arrête ou ne s'arrête pas avec son cartable, son gros manteau de cosmonaute, pour faire un signe de la main, toujours souriant, toujours gaie, partant toute seule dans le petit matin pour l'école, toute seule tournant le coin de la rue, à demi cachée par les arbres, trouvant encore des feintes pour apercevoir sa mère à travers les grilles du jardin public et souriant gentiment et envoyant encore des baisers et disparaissant avec son cartable, son petit bonnet et son manteau. Et sa mère sur le balcon qui voit cette forme adorée et qui l'inonde de baisers soufflés avec sa main et qui fait de grands signes de gaieté dans sa robe de chambre fine, souriant et embrassant dans le froid, le cœur étreint de voir la petite s'éloigner comme elle s'éloignera dans le temps, comme elle ne voudra plus que je sois là, à la fenêtre à faire tous ces gestes, que je sois là, sa maman perchée et elle maladroite et gentille, boule joyeuse avec son cartable tiré.
Elle part pour le collège, elle tient au mot collège, quand je dis lycée, elle dit collège maman. Elle a des baskets, un blouson bleu clair et un bonnet blanc. Elle marche comme on marche à son âge, un peu sur les talons, un peu vite, son cartable est un sac à dos (je ne veux pas parler de sa lourdeur). Elle longe les grilles du jardin et se retourne pour me dire au revoir. Elle marche encore, se retourne au coin, en hiver je la vois plus longtemps parce qu'il n'y a pas de feuilles aux arbres. Elle fait un dernier signe avant d'être effacée par le mur d'immeuble. Et c'est un soulagement que tu disparaisses, car jamais sinon je quitterais la fenêtre, je serais toujours là, chose restante, à agiter ma main, jusqu'à ce que tu sois un point.
Yasmina Reza, Nulle part, Albin Michel, 2005, p. 11-14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yasmina reza, nulle part, enfance, départ, perte, temps | ![]() Facebook |
Facebook |







