20/09/2025
Jean Paulhan, À demain la poésie

CE QU'EN DIT LE PREMIER VENU
Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du monde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.
Ensuite vient le poème, laissons cela. Et quand il est passé ? Non, tu n'as pas appris grand-chose. Que le temps passe vite. Si l'on veut. (Pourtant il est toujours là.) Qu'il faut profiter de la vie pendant que tu la tiens. Bien sûr. Peut-être que tes cheveux ressemblent à des feuilles, et tes dents à des rochers. (D'ailleurs, pas tant que ça.) Tu t'en doutais. Cependant, tu te sens vaguement changé, il t'est resté quelque trace de l'évènement : c'est comme s'il était soudain devenu bizarre que les cheveux ressemblent plus ou moins à des feuilles, et que ta vie soit courte. Dans quelle stupeur es-tu plongé, où le plus banal te paraît singulier, et le singulier banal ? Or il arrive que l'état se prolonge et t'étrange quelques moments. (Comme si le mystère de la poésie, c'était de rendre mystérieux tout ce qui n'est pas elle.) Il dépasse de ta manche un fil qui t'agace parce que tu le vois trembloter sur le papier de ton livre. Tu le brûles à la base, du bout de ta cigarette. Alors tu le vois soudain qui se tord en grelottant, puis se penche et s'abat comme un arbre coupé à la hache, tu crois l'entendre gémir. Tu demeures consterné. Un peu plus tard, tout rentre dans l'ordre. Mais entre l'attente et la retombée, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est proprement là le mystère. Et si l'on accorde qu'il est précisément mystérieux que reste-t-il à en dire ? Rien.
Jean Paulhan, À demain, la poésie, Introduction à une anthologie [1947], dans Œuvres complètes, tome II, Le Cercle du Livre précieux, 1966, p. 312.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, à demain le poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2021
André Breton, Jean Paulhan, Correspondance
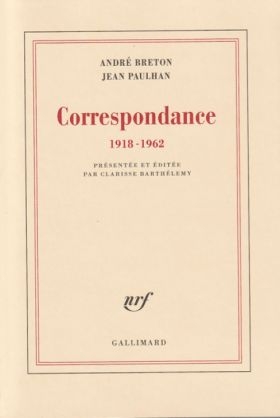
La correspondance entre André Breton et Jean Paulhan, remarquable par sa durée, introduit le lecteur à des aspects mal connus des relations des surréalistes avec l’institution littéraire représentée par la Nouvelle Revue Française et permet de comprendre, malgré l’absence d’un grand nombre de ses lettres, combien les liens d’amitié avec Paulhan ont été essentiels pour Breton. En outre, on retrouve à diverses occasions le polémiste vigoureux qui a dirigé le mouvement surréaliste. Les premières années de la correspondance, les lacunes empêchent de suivre les réactions de Paulhan aux propos de Breton, c’est pourquoi l’éditrice, Claire Barthélémy, reconstruit précisément le contexte des échanges et rappelle le parcours des deux écrivains et, pour Breton, la mise en œuvre de la revue Littérature, ses relations avec Jacques Rivière qui dirigeait la NRF. Les notes nécessaires pour éclairer le contexte sont précieuses ; le sont aussi les fac-similés de lettres dans le volume et les annexes (textes de Breton, de Paulhan et de Jouhandeau liés à la correspondance), et l’on n'oublie pas les très utiles appendices (index des noms, des titres, table des illustrations).
La première lettre publiée de Breton (18 juin 1918) répond à une offre d’amitié de Paulhan, offre recopiée et envoyée à Aragon. Breton souhaite se lier avec son aîné (douze années les séparent) et l’exprime nettement ; « Vous ne savez pas encore le prix que j’attache à ce qui me vient de vous », écrit-il et, un peu plus tard, en juillet, « Vous êtes précisément l’ami que j’attendais à cette époque de ma vie ». Il considère alors que Paulhan, à qui il a dédié son premier texte publié, peut dans leurs échanges apporter des réponses à des questions littéraires qu’il se pose ; lecteur attentif de Valéry (dont il recopie des poèmes dans ses lettres), il admet les lacunes de sa lecture : « Vous tenez le sens total du poème quand je fais encore, moi, le jeu des mots ». Le premier numéro de la revue Littérature, qu’il dirige avec Aragon et Philippe Soupault, ouvre son sommaire avec un texte de Gide ("Les Nouvelles nourritures") et un poème de Valéry ("Cantique des colonnes"), mais aussi avec "La Guérison sévère" de Paulhan qui publiera dans trois numéros en 1920 "Si les mots sont des signes ou Jacob Cow le pirate". Cette étude rencontre des préoccupations de Breton, « ces pages sur les mots me sollicitent en tous sens », écrit-il à Paulhan.
De son côté, Paulhan, ce que relève Clarisse Barthélémy, « dans cette ardeur vitale, initiatique, radicale qui caractérise Breton, (...) retrouve son goût de la liberté et une forme de pureté, — ainsi, sans doute, que ses premières convictions anarchistes ». Ils avancent tous deux avec des questions analogues concernant l’expression ; cependant, la transformation progressive de la revue, qui devient le 1erdécembre 1924 La Révolution surréaliste éloigne Paulhan du surréalisme. Le projet lui-même, énoncé dans le premier numéro, ne pouvait lui convenir : « Le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l’intelligence n’entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l’homme tous ses droits à la liberté ».
Jacques Rivière, qui dirigeait la Nouvelle Revue Française, meurt en février 1925 et Paulhan, qui assurait le secrétariat depuis 1920, prend sa place. Les divergences entre la revue, Paulhan et les surréalistes, tant pour les choix esthétiques que politiques, s’accroissent jusqu’à la rupture, consommée par une brève lettre de Breton le 4 mars 1926, « J’ai l’honneur de vous informer que je vous tiens pour un con et un lâche » ; l’intéressé répond sur le même ton par pneu, « Il y a longtemps que vous m’emmerdez. Vous auriez dû comprendre plus tôt que je vous tiens pour aussi lâche que fourbe ». Un an plus tard, l’adhésion du surréalisme au Parti communiste, justifiée dans un tract, Au grand jour, entraîne dans la NRF une réponse d’Antonin Artaud, À la grande nuit, et un commentaire de Paulhan, sous le pseudonyme de Jean Guérin. Breton réagit par une lettre ordurière, Paulhan lui envoie ses témoins mais il refuse le duel. La rupture durera jusqu’en 1935.
L’éditrice trace à grands traits l’histoire du surréalisme pendant les années 1930. C’est la séparation d’avec le Parti communiste, dont Breton explique les raisons en 1935 dans la préface de Position politique du surréalisme, qui permet à nouveau le dialogue avec Paulhan ; il accuse notamment le pouvoir soviétique d’avoir trahi les espoirs de la révolution de 1917. Les échanges épistolaires reprennent mais, surtout, Paulhan publie Breton dans la NRF et dans Mesures, la revue amie d’Henry Church, puis prend L’Amour fou dans sa collection "Métamorphoses". Le silence reprend avec l’exil de Breton aux États-Unis à partir de 1941. Il revient en France en juillet 1946, sans pourtant rencontrer Paulhan ; ils ne se verront qu’au cours de leur engagement, pour un temps, dans l’organisation pacifiste "Citoyens du monde" initiée par Robert Sarrazac, qui fera connaître à Breton le village de Saint-Cirq-Lapopie où le poète s’installera. Ils se retrouvent pleinement sur des questions de critique littéraire, en 1949, avec la publication le 19 mai d’un faux de Rimbaud, La Chasse spirituelle, avec une préface de Pascal Pia ; le faux est défendu par une partie de la critique, par exemple avec force par Maurice Nadeau. Dès le 21 mai, Breton dénonce dans une lettre au journal Combat le « caractère particulièrement méprisable » du pastiche — la lettre n’est publiée que le 26 ; il publie la même année sur cette affaire Flagrant délit, Rimbaud devant la conjuration de l’imposture et du trucage, salué par Paulhan, « c’est une grande joie de l’esprit et du cœur que donne Flagrant délit ». Une autre affaire les rapprochera en 1960, celle de l’élection du "Prince des poètes" pour succéder à Paul Fort ; malgré ses efforts Breton, qui déteste Cocteau, n’empêchera pas qu’il soit choisi. Il semble que les échanges cessent dans le courant de l’année 1962 — Breton meurt en décembre 1966, Paulhan en octobre 1968 —, sans que l’on en connaisse vraiment la raison.
L’un et l’autre, intransigeants dans leurs choix intellectuels, se sont reconnus et rencontrés sur des questions littéraires essentielles pour eux. Breton a souvent regretté de trop peu rencontrer Paulhan et il lui écrivait en 1959, « Je mourrai sans avoir compris pourquoi vous et moi nous ne serons vus, pourtant parfois de si près, que par intermittences mais seul le sentiment de chance demeurera ». Dans le numéro de la NRF en hommage à Breton, Paulhan concluait son article par ces mots « il n’est pas toujours possible à un homme de dire ce qu’il sait. Breton est mort. Tout est à recommencer ». On lit souvent dans cette correspondance de précieux témoignages d’une vraie amitié.
Correspondance André Breton-Jean Paulhan, 1918-1962, présentée et éditée par Clarisse Barthélémy, Gallimard, 2021, 268 p., 22 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 2 décembre 2021.
Publié dans Breton, André, Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : a 13breton, jean paulhan, correspondance | ![]() Facebook |
Facebook |
18/12/2020
Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance 1920-1959 : recension
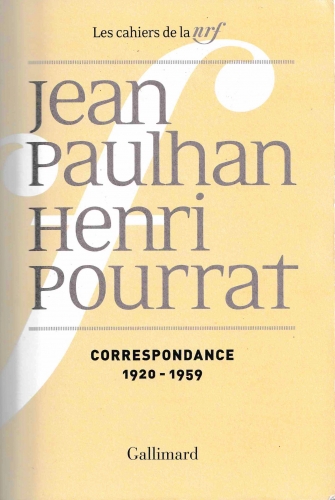
La correspondance commence avec une lettre de Paulhan du 19 avril 1920, demandant à Pourrat une note, pour La NRF, à propos d’un livre de Francis Jammes ; la note est écrite et les deux écrivains s’envoient leurs livres. Paulhan regrette l’éloignement de Pourrat, qui vit à Ambert, et sollicite rapidement une collaboration régulière. Après quelques échanges d’éléments plus personnels — mais les lettres de Pourrat sont absentes jusqu’au 26 septembre —, Paulhan termine sa longue lettre du 15 juin 1920 par « Je suis votre ami » et débute la suivante par « Mon ami », à quoi répond un « Cher ami » suivi, comme ce sera souvent le cas, de nouvelles développées.
Tout semblait séparer les deux hommes, outre l’éloignement géographique : Paulhan (1884-1968) avait un métier, en même temps qu’il assurait le secrétariat de La NRF avant d’en prendre la direction, en 1925, à la mort de Jacques Rivière ; cette fonction lui faisait rencontrer le milieu littéraire, de Gide et Valéry aux surréalistes : il écrivit dans Littérature, la revue d’André Breton. Henri Pourrat (1887-1959), souffrant de la tuberculose, avait dû abandonner sa formation d’agronome et vivre à Ambert ; il publia très tôt des poèmes, collaborait à des journaux régionaux en Auvergne et trouva sa voie avec la publication de Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes en 1921. Les différences ont été mises entre parenthèses et les deux hommes se sont vite découvert des motifs d’échanger.
Pourrat exprime souvent un lien très fort, vivant, à la nature qui l’environne, soucieux d’aménager un potager, de planter des arbres fruitiers, et il écrit à propos des changements dans la montagne au fil des saisons, de la dureté des hivers, des plaisirs simples de la campagne (« Je cueille des champignons rosés dans de jolis prés »). Toute son œuvre est écrite principalement « sur les gens d’Auvergne, leurs coutumes, leurs mœurs », c’est-à-dire à propos du monde paysan dont, en observateur avisé, il observe la mort possible et, écrit-il dès 1928, « Ce pourrait être intéressant (...) ces transformations qu’on a sous les yeux, et [de] se séparer de tout un régionalisme. » Ses descriptions du quotidien, comme ses livres, ont toujours été très favorablement accueillis par Paulhan qui était également un observateur de la nature. Il raconte qu’à Paris une marchande de journaux gardait dans son kiosque une salamandre qu’elle nourrissait de salade, ou que Paul Éluard lui « a apporté un caméléon de Tunisie » ; lui-même élevait des lézards verts, des poissons rouges. Il note qu’au moment de la migration des hirondelles, les plus anciennes s’occupent des plus jeunes et, qu’au mois de juin, son jardin est « pris d’une sorte de folie bien plus animale que végétale, et lance de tous côtés des fleurs et des tiges que l’on reconnaît à peine ». Il serait aisé de multiplier les traces du souci de la nature dans leur correspondance ; en octobre 1937 encore, Pourrat ajoute à la fin d’une lettre, « Hier nous avons vu une si belle monstrueuse salamandre. J’ai pensé à la capturer pour toi. »
Les échanges portent aussi régulièrement sur les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Pourrat et Paulhan se font part de leurs problèmes de santé, de ceux de leurs proches : pour le premier, il souffrira beaucoup de la mort de sa fille aînée, âgée de dix ans, en mai 1940, pour le second, il voit l’évolution de la maladie de Germaine, son épouse, qui perd toute sa mobilité. Les rationnements au cours de la guerre ont donné à Pourrat l’occasion d’apporter à Paulhan, alors installé à Paris, une aide efficace en lui expédiant des sacs de charbon de bois pour le chauffage et des vivres, pommes de terre, topinambours et miel. On lit des deux côtés une attention constante à l’autre et les témoignages réciproques d’amitié sont aussi nombreux en ce qui concerne leur travail, chacun tenant l’autre au fait de ce qu’il écrit.
Dès le début de leur relation, en 1920, Pourrat remercie Paulhan d’avoir publié dans La NRF quelques poèmes qui contribuent à le faire connaître ; il ne cessera les décennies suivantes de lui savoir gré de ses lectures attentives et critiques. On peut voir par les remarques de Paulhan ce que pouvait être alors un éditeur ; à propos d’un roman de Pourrat, Le Mauvais garçon, il détaille tout le bien qu’il en pense (délicatesse, justesse, poésie) et, ensuite, précise ce qui lui paraît à reprendre — « Il faut que je te tracasse sur deux ou trois points » —, à alléger ou supprimer dans la première partie, etc. Cet éditeur savait découvrir dans Pourrat autre chose qu’un écrivain "régional", lisant dans un récit un « sentiment d’horreur ou d’effroi (...) qui donne à ton œuvre une raison tragique ». Il ne se posait pas pour autant en supérieur, insistant sur le rôle positif de Pourrat pour lui, «Tu es mon homme libre ; il y a beaucoup de choses que je choisis ou que je juge à partir de toi, ou de ce que je serais si j’étais toi », projetant d’écrire deux romans ensemble lors d’une rencontre, lui demandant son avis quand il publiait un livre ou l’écrivait (« Ça ne t’ennuie pas que je te parle un peu des Fleurs de Tarbes ? »). Pourrat, de son côté, a toujours sollicité et apprécié les remarques et conseils de son ami : « Je pense à toi comme à celui qui m’a donné le sens de la qualité et comme au meilleur des témoins, des juges, des parrains », lui écrit-il, et il a régulièrement commenté les livres de Paulhan dans ses lettres et dans des articles*, très intéressé notamment par l’art du récit.
Pourrat publiait beaucoup (c’était son gagne-pain), en partie aux éditions Gallimard, et il a souvent sollicité l’aide de Paulhan pour régler des problèmes de tirage, de promotion de ses livres, et il était parfois furieux par la désinvolture — le mépris ? — manifesté par certains membres des éditions, comme Brice Parain ; ses lettres reviennent régulièrement sur ces difficultés, accrues par son éloignement de Paris. Paulhan intervient chaque fois qu’il le peut et, par ailleurs, lui donne des nouvelles de la vie de l’édition (en 1931, « Tout va vraiment très mal pour les livres »), des revues. Tous deux échangent à propos des écrivains qu’ils apprécient, Francis Jammes, Cingria, Bove, Ramuz, Joë Bousquet, etc., de Vialatte, que Pourrat a présenté à Paulhan.
Pendant la période de la guerre les confidences se font plus rares. Paulhan s’est engagé très vite dans la résistance, fondant notamment dès 1941 avec Jacques Decour Les Lettres françaises, alors que La NRF était passée sous la direction de Drieu La Rochelle en novembre 1940. Il batailla après la guerre contre les excès de l’épuration, sachant que sa revue, « souillée » sous l’occupation, ne pouvait reparaître — ce sera La Nouvelle Nouvelle Revue française en 1953. Pourrat, de son côté, a d’abord vu dans Pétain celui qui résistait au nazisme ; il recueillit des Juifs dans les années sombres et, plus tard, reconnut qu’il avait été en partie aveugle, « je pense à tout ce que j’aurais dû comprendre mieux auprès de toi ». La maladie gâcha ses dernières années et il voyait la disparition accélérée du monde qu’il avait décrit, « l’homme vient travailler à Ambert pour bénéficier des lois sociales », écrivait-il en 1957.
Ce fort volume est une traversée de quarante ans d’histoire littéraire ; on y découvre l’acharnement de Paulhan pour que sa revue se développe et devienne une référence dans le monde des lettres, l’énorme travail de Pourrat pour restituer la vie et les mœurs d’une région rurale. On y suit également les développements d’une belle amitié.
Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance, 1920-1959, édition Claude Dalet et Michel Lioure, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 2020, 816 p., 45 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 18 novembre 2020.
* On lira la liste de ses recensions en appendice et celle des Fleurs de Tarbes reprise intégralement.
Publié dans Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, henri pourrat, correspondance, 1920-1959, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2020
Jean Paulhan, Braque le patron

Plus ressemblant que nature
Je ne crois guère aux fantômes, ni aux spectres. Mais je vois bien que j’ai tort. Parce qu’au fond nous y croyons tous, et qu’il serait plus loyal de l’avouer. Jamais un homme normal ne s’est tout à fait reconnu dans ses portraits. Le jour où l’on nous fait voir notre profil dans un jeu de miroirs, entendre notre voix dans un disque, lire nos vieilles lettres d’amour, est un mauvais jour pour nous : et sur le moment nous avons plutôt envie de hurler. Tant il est évident que nous sommes n’importe quoi, mais pas ça. Les photos exactes, les portraits fidèles, peuvent être puissants subtils, beaux ou laids. Ils ont un trait qui passe de loin ceux-là : c’est qu’ils ne sont pas ressemblants. Montaigne était à peu près le contraire du rat sadique que nous montrent les images. Léonard de Vinci n’avait pas vraiment l’air d’un chrysanthème, ni Gœthe d’un melon. Il faut avertir dès maintenant nos petits-fils que nous n’avons rien de commun avec les tristes images qu’ils garderont de nous.
Mais il est plus difficile de savoir ce que nous sommes, et l’idée physique que nous en formons. Peut-être nous voyons nous secrètement en écorchés ? Non, c’est moins sanglant. En squelettes ? Non, c’est moins décisif. C’est à la fois insaisissable et diablement net. C’est assez précisément ce qu’on appelle un spectre, et somme toute cela nous est familier, puisque nous l’avons en tête à tout moment. C’est d’ordre aussi pratique qu’un escargot ou un citron.
Un citron. Voilà où je voulais en venir. Car il nous semble, bien entendu, que l’escargot ou le citron doit être content de son apparence, si l’homme ne l’est pas ; que c’est tout ce qu’il mérite, qu’il n’avait qu’à ne pas être escargot. Mais il se peut qu’il n’en soit rien. Il est même vraisemblable (sitôt que l’on y songe) que l’escargot, lui aussi, ne cesse de protester (silencieusement) contre la coquille, les yeux à échasses et même la peau nacrée que nous lui voyons. Et peut-être se trouvera-t-il un jour des peintres assez subtils — ou, qui sait, suffisamment avertis — pour prendre le parti de cet escargot intérieur ; pour traiter les cornes et la coquille comme elles souhaitent d’être traitées.
Je ne cherche qu’à être fidèle, tant pis si j’ai l’air sot. Qu’il y ait un secret chez Braque comme il y en a un chez Van Gogh ou Vermeer — c’est ce dont ne laisse pas douter une œuvre à tout instant pleine et suffisante : fluide (sans qu’il soit besoin d’air) ; rayonnante (sans la moindre source de lumière) ; à la fois attentive et quiète : réfléchie jusqu’à donner le sentiment d’un mirage posé sur sa réalité. Pourtant, sitôt que je veux nommer ce secret ou le sentiment du moins qu’il me laisse, voici tout ce que je trouve : c’est que Braque propose aux citrons, aux poissons grillés et aux nappes, inlassablement, ce qu’ils attendaient d’être. Ce après quoi ils soupiraient : leur spectre familier. Il y a je ne sais quoi de triste dans un devoir ; d’amer dans une attente : c’est que l’on craint d’être déçu. Mais chaque tableau de Braque donne le sentiment d’une attente joyeuse, et d’un devoir comblé.
Bien entendu, il faudrait là-dessus des preuves. — Et je les donnerai. Au demeurant, je ne dis rien que de banal. (Il suffirait bien d’user d’un autre mot — de parler d’idéal, par exemple.) Tant mieux. Ce que je voulais dire aussi, c’est que la peinture de Braque est banale. Fantastique sans doute, mais commune. Fantastique, comme il est fantastique, si l’on y réfléchit, d’avoir un nez et deux yeux, et le nez précisément entre les deux yeux.
Jean Paulhan, Braque le patron, Gallimard, 1952, p. 17-22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, braque le patron, spectre, ressemblance | ![]() Facebook |
Facebook |
27/10/2017
Jean Paulhan, Braque le patron

Braque dans ses propos
Il est un peu voûté. Il poursuit à la fois dix ébauches, dont les unes posent sur des chevalets, les autres à terre sur des sortes de grils. Il déplace parfois une feuille morte, une patte de crabe, un squelette de lézard, qui attendaient quoi sur leur table ? Il retouche. Il émonde. Comme un jardiner entre ses plantes.
Ou comme un éleveur entre ses bêtes, non sans timidité. Il s’y prend de mille façons. Je l’ai vu dessiner à la craie sur un tableau noir. Un jour, je l’ai même surpris qui reportait sur son panneau des mesures. Il n’avait pas l’air de s’amuser.
Quand une toile vient mal, il l’allonge par etrre. Ce n’est pas pour la piétiner. C’est pour la voir de haut.
Jean Paulhan, Braque le patron, Gallimard, 1952, p. 35-36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, braque le patron, propos, peinture | ![]() Facebook |
Facebook |
24/05/2017
Jean Paulhan-Georges Perros, Correspondance 1953-1967
Cher Georges
Mardi [8 mars 1960]
(…)
Voici ce qui m’a toujours intrigué, irrité : un Monsieur quelconque fait un discours : de préférence un discours populaire (un peu chaleureux) dans une assemblée populaire (un peu agitée — mais, après tout, la scène peut aussi bien se passer dans un salon). Eh bien, une bonne part des assistants vont penser : « Tout ça c’est des lieux communs, des clichés, des-mots-des-mots » (comme disait l’autre). Mais une autre bonne part : « Quels beaux sentiments, quelles pensées justes, sincères, fondées ! » Or le discours est le même pour tous. Cependant un lieu commun est le contraire d’une forte pensée, un mot est le contraire d’une idée.
Imaginez cent, mille exemples analogues. Les analyses les plus subtiles n’y pourront rien : il faut bien qu’il y ait un lieu de notre esprit où le mot ne soit pas autre chose que la pensée, et les contraires soient indifférents.
À cela rien d’impossible. C’est ce que Nicolas de Cues, Blake, Hölderlin, cent autres, n’ont pas arrêté de dire, d’une part. Et de l’autre : notre esprit ne peut observer qu’à faux : en prélevant sur lui-même la part qui va l’observer. Donc rien ne s’oppose à ce qu’un esprit entier (et donc invisible) soit apte à confondre les contraires, se meuve dans une sorte d’âge d’or où l’action soit le rêve, où le ciel soit la mer : et l’erreur, la vérité.
Jean Paulhan, Georges Perros, Correspondance 1953-1967, édition Thierry Gillybœuf, éditions Claire Paulhan, 2009, p. 221-222.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, georges perros, correspondance 1953-1967, discours, mot, idée, esprit | ![]() Facebook |
Facebook |
07/08/2016
Jean Paulhan, Braque le patron

Braque le patron
Qu’il y ait dans ses toiles, au-delà de tant de lumières, un climat (et comme une embellie) qui les commande, c’est ce que je vois bien. Je serais en peine de le définir. Mais je pourrais le raconter. Je l’ai vu apparaître : c’était au sortir de l’époque fauve, des toiles de l’Estaque, de toute cette fanfaronnade de couleurs.
« La première année, dit Braque, c’était le pur enthousiasme, la surprise du Parisien qui découvre le Midi. L’année suivante, ç’avait déjà changé. Il m’aurait fallu pousser jusqu’au Sénégal. On ne peut pas compter plus de dix mois sur l’enthousiasme. »
C’est alors, vers 1907, qu’ont dû se montrer, dans la couleur pâlissante, ces traits aigus et ces angles qu’un peu plus tard on appela cubisme.
« Cela se faisait tout seul. Un jour, je m’aperçois que je puis revenir sur le motif par n’importe quel temps. Je n’ai plus besoin de soleil, je porte ma lumière avec moi. Il y avait même un danger : j’ai failli glisser au camaïeu. »
Jean Paulhan, Braque le patron, Gallimard, 1952, p. 43-44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, braque le patron, cubisme, estaque | ![]() Facebook |
Facebook |
15/03/2013
Jean Paulhan, Le clair et l'obscur

Je me suis trouvé en Quatorze, un jour d'avances et de reculs, coincé, entre quelques morts et mourants, dans une maison à demi démolie, sur laquelle s'obstinait pourtant le tir de l'artillerie — de plus d'une artillerie, car la maison, se trouvant à égale distinction des deux lignes et bien en vue, ne servait pas moins de cible à nos canons qu'aux canons adverses. Personne, de vrai, ne savait au juste qui se trouvait dedans, en sorte que, par l'effet d'une modestie commune aux hommes de guerre, chacun pensait y voir l'ennemi. Non pas tout à fait à tort, car nous n'occupions qu'une partie de la ruine. Mais il faut l'avouer, nous ne songions guère, pour le moment, à détruire nos voisins — si tant est qu'il y avait des ennemis — ni même à les chasser.
Au fait, à quoi songions-nous ? Imaginez là-dessus une lumière d'éclipse, des éclats ronflant à droite et à gauche, le bruit d'orgue que fait un obus en plein vol, un cadavre qui vous regarde sans vous voir, un cheval éclaté comme un poisson de grands fonds et, dans une poussière de pierre et de fumée que traversaient des fusées éclatantes, de tous côtés, le désordre et la dislocation.
Tout cela était étrange, mais à certains égards merveilleux. Et je dois avouer qu'il m'arriva un instant de m'en réjouir : que de feux d'artifice ! Que de châtaignes et de girandoles, de crapauds et d'acrobaties, de clowneries et de parades ! D'aimables figurants faisaient le mort à la perfection. Quel spectacle ! Est-ce donc pour moi qu'on a monté tout ça ?
C'était là sans doute une réflexion égoïste. Ce fut, en tout cas, une réflexion imprudente. Car elle déclencha presque aussitôt le sentiment irrésistible (avec l'angoisse qui s'ensuit) que je me trouvais dans quelque farce gigantesque. Non, rien là-dedans en pouvait être vrai. De toute évidence, il ne s'agissait que d'un cauchemar, dont je tentai de me tirer en donnant de grands coups de soulier dans une glace demeurée, par quel hasard ? intacte, et même brillante. La glace se fendilla, s'écailla, puis s'écroula dans un grand bruit, et je connus très bien que je ne rêvais. Je le connus, et me trouvai, chose curieuse, satisfait — en tout cas comblé. Il faut bien que la vérité — fût-elle atroce — nous soit d'un grand prix..
Jean Paulhan, Le clair et l'obscur, préface de Philippe Jaccottet, Le temps qu'il fait, 1985, p.27-29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, le clair et l'obscur, philippe jaccottet, guerre de 14, fusée, glace, mort, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2012
Marcel Jouhandeau, Correspondance avec Jean Paulhan

Depuis trois mois, une chatte mendiante se terrait à notre porte du côté du jardin du matin au soir. Sans doute, une abandonnée. Après les repas, ma mère lui apportait nos restes, mais je sentais que pour la pauvre bête, c'était moins de nos restes qu'elle avait faim que de notre intimité. Chaque fois qu'on entrouvrait la porte en effet, elle regardait l'avenue de cette cuisine où il devait y avoir du feu et une bonne odeur avec un geste si naïf et si éloquent d'envie et d'impatience, mais ma mère ne sachant pas d'où la bête venait, ne voulait pas la laisser pénétrer chez elle. Hier, j'ai obtenu qu'on l'adoptât et elle s'est précipitée à l'intérieur de son rêve comme d'un Paradis et elle s'y pavane maintenant, ivre de bonheur. Sans bassesse, elle est en admiration devant toute chose et ne cesse de nous remercier en se serrant tour à tour contre les jambes de ma mère et contre les miennes. Je la prends sur mes genoux, quand elle n'ose même pas monter sur une chaise. Son humilité et sa discrétion me ravissent. Je me plais à la combler et je ne saurais dire ce que cette présence du « bonheur » me fait du bien. C'est une chatte de l'espèce la plus commune, mais distinguée, à la robe blanche et manteau de deuil ; son petit museau plus blanc que le reste, sous deux bandeaux noirs très réguliers où s'enchâssent les yeux verts. J'aime surtout quand à demi assise elle vire sur elle-même comme aidée par une aile invisible sur deux pattes de devant longtemps levées, telles deux menottes, sans qu'elle paraisse avoir besoin de les reposer sur le plancher pour garder l'équilibre, avec des grâces de kangourou. On dirait qu'elle sait beaucoup plus qu'une autre, qu'elle sait beaucoup mieux le prix de la moindre joie. La misère et la souffrance lui ont donné une âme et cette science.
Marcel Jouhandeau, dans Marcel Jouhandeau, Jean Paulhan, Correspondance, 1921-1968, édition établie, annotée et préfacée par Jacques Roussillat, Gallimard, 2012, 11 février 1931, p. 114-115.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel jouhandeau, jean paulhan, correspondance, chat | ![]() Facebook |
Facebook |
13/11/2011
Jean Paulhan, À poésie rêveuse, poète chétif
À poésie rêveuse, poète chétif
 J'imagine qu'un ange, un Persan, un homme tombé d'une autre planète vît d'un trait (comme il est naturel à ces personnages) toute la poésie française — et l'allemande ou l'anglaise tout aussi bien — du XIIe au XXe et de Théroulde, ou simplement de Chênedollé à Paul Éluard. Voici, en gros, ce qu'il observerait : c'est que la poésie nous paraît aujourd'hui chose infiniment plus grave et précieuse qu'elle ne paraissait jadis : sacrée, peu s'en faut ; c'est aussi qu'elle est devenue misérable et dépouillée, à proportion même qu'elle nous semblait précieuse — ainsi perdant chaque année en moyens ce qu'elle gagnait en mérites.
J'imagine qu'un ange, un Persan, un homme tombé d'une autre planète vît d'un trait (comme il est naturel à ces personnages) toute la poésie française — et l'allemande ou l'anglaise tout aussi bien — du XIIe au XXe et de Théroulde, ou simplement de Chênedollé à Paul Éluard. Voici, en gros, ce qu'il observerait : c'est que la poésie nous paraît aujourd'hui chose infiniment plus grave et précieuse qu'elle ne paraissait jadis : sacrée, peu s'en faut ; c'est aussi qu'elle est devenue misérable et dépouillée, à proportion même qu'elle nous semblait précieuse — ainsi perdant chaque année en moyens ce qu'elle gagnait en mérites.
Car il est commun de nos jours d'entendre prononcer par des gens d'allure très raisonnable, des écrivains et même des critiques, par exemple qu'un poème suffit à ébranler les forces secrètes du cosmos, qu'un mot imprudemment rythmé s'en va susciter au loin des îles et des forêts, qu'un vers a le pouvoir d'engendrer la substance et qu'il suffirait de penser sur la première lettre de l'alphabet pour assez vite ruer dans la folie.1 Oui, cela se dit tous les jours, et personne ne s'évanouit ; cela, et mille autres choses subtiles, si profondes qu'on ne se défend pas de l'impression que leurs auteurs les savent, sans doute, puisqu'ils les disent. Mais sont-ils parvenus à les croire ? On se demande comment ; on fait en ce sens quelques timides essais. On continuera. Quant à aller plus loin qu'eux dans la hardiesse et dans l'invention, chacun voit bien qu'il n'y faut pas songer. Ce serait déjà très beau si l'on arrivait à les comprendre — à les réaliser (comme nous disons à présent). Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'au pris de tels rêves une simple petite poésie de deux sous, comme il s'en est fait de tout temps, comme il s'en invente par dizaines à chaque repas de noces, jeu d'enfants ou banquet d'anciens militaires, devient une merveille d'innocence et de clarté — de naturel. C'est qu'il nous prend grande envie d'en imaginer nous-mêmes quelques-unes (ne fût-ce que pour échapper aux thèses et explications dont il s'agit). Et je dois bien supposer que c'est là un sentiment tout à fait naturel et commun, puisque l'on voit en fait les poèmes devenir sous nos yeux d'autant plus simples, et même simplistes, et décharnés en tout cas, que les théories sont plus flatteuses. Le poète découvre un beau jour que la poésie est prière, et ce même jour abandonne les rimes empierrées, les empérières et les couronnées, la poésie sacrée et la villanelle. Il invente que la poésie, au comble de la création, survole toute morale, et aussitôt renonce à l'épopée. Que le poète est mage et voyant, et le discours en vers, l'épître, la satire lui semblent désormais des genres mesquins. Qu'Orphée avec Amphion mettent en branle les animaux et les pierres — et que ferait-il encore d'une épigramme ou d'un petit triolet ? Que le poème est conscience de l'inconscient, conversion du Rien dans le Tout, exercice spirituel, frénétique apprentissage de l'aventure mystique, et le voilà qui balance le madrigal avec le rondeau. Que la poésie est ascèse et magie, assez d'épithalames et de dithyrambes ! qu'elle est identité des contraires, au diable les métagrammes, les monologues et les tercets ! Mise en question de notre condition humaine, finis les centons, équivoques et contrepèteries. À la fois création et créature, plus de tragédies en vers, plus de sonnets ni de proverbes ! [...]
Jean Paulhan, À demain la oésie, Introduction à une anthologie, dans Œuvres complètes II, L'art de la contradiction, Gallimard, 2009.
Publié dans Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, à poésie rêveuse, poète chétif, l'art de la contradiction | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2011
Jean Paulhan, À demain la poésie
Ce qu'en dit le premier venu
 Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du onde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.
Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du onde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.
Ensuite vient le poème, laissons cela. Et quand il est passé ? Non, tu n'as pas appris grand-chose. Que le temps passe vite. Si l'on veut. (Pourtant il est toujours là.) Qu'il faut profiter de la vie pendant que tu la tiens. Bien sûr. Peut-être que tes cheveux ressemblent à des feuilles, et tes dents à des rochers. (D'ailleurs, pas tant que ça.) Tu t'en doutais. Cependant, tu te sens vaguement changé, il t'est resté quelque trace de l'évènement : c'est comme s'il était soudain devenu bizarre que les cheveux ressemblent plus ou moins à des feuilles, et que ta vie soit courte. Dans quelle stupeur es-tu plongé, où le plus banal te paraît singulier, et le singulier banal ? Or il arrive que l'état se prolonge et t'étrange quelques moments. (Comme si le mystère de la poésie, c'était de rendre mystérieux tout ce qui n'est pas elle.) Il dépasse de ta manche un fil qui t'agace parce que tu le vois trembloter sur le papier de ton livre. Tu le brûles à la base, du bout de ta cigarette. Alors tu le vois soudain qui se tord en grelottant, puis se penche et s'abat comme un arbre coupé à la hache, tu crois l'entendre gémir. Tu demeures consterné. Un peu plus tard, tout rentre dans l'ordre. Mais entre l'attente et la retombée, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est proprement là le mystère. Et si l'on accorde qu'il est précisément mystérieux que reste-t-il à en dire ? Rien.
Jean Paulhan, À demain, la poésie, Introduction à une anthologie [1947], dans Œuvres complètes, tome II, Le Cercle du Livre précieux, 1966, p. 312.
Publié dans MARGINALIA, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
30/04/2011
Jean Paulhan, Braque le patron
Plus ressemblant que nature
Je ne crois guère aux fantômes, ni aux spectres. Mais je vois bien que j’ai tort. Parce qu’au fond nous y croyons tous, et qu’il serait plus loyal de l’avouer. Jamais un homme normal s’est tout à fait reconnu dans ses portraits. Le jour où l’on nous fait voir notre profil dans un jeu de miroirs, entendre notre voix dans un disque, lire nos vieilles lettres d’amour, est un mauvais jour pour nous : et sur le moment nous avons plutôt envie de hurler. Tant il est évident que nous sommes n’importe quoi, mais pas ça. Les photos exactes, les portraits fidèles, peuvent être puissants subtils, beaux ou laids. Ils ont un trait qui passe de loin ceux-là : c’est qu’ils ne sont pas ressemblants. Montaigne était à peu près le contraire du rat sadique que nous montrent les images. Léonard de Vinci n’avait pas vraiment l'air d’un chrysanthème, ni Gœthe d’un melon. Il faut avertir dès maintenant nos petits-fils que nous n’avons rien de commun avec les tristes images qu’ils garderont de nous.
Mais il est plus difficile de savoir ce que nous sommes, et l’idée physique que nous en formons. Peut-être nous voyons-nous secrètement en écorchés ? Non, c’est moins sanglant. En squelettes ? Non, c’est moins décisif. C’est à la fois insaisissable et diablement net. C’est assez précisément ce qu’on appelle un spectre, et somme toute cela nous est familier, puisque nous l’avons en tête à tout moment. C’est d’ordre aussi pratique qu’un escargot ou un citron.
Un citron. Voilà où je voulais en venir. Car il nous semble, bien entendu, que l’escargot ou le citron doit être content de son apparence, si l’homme ne l’est pas ; que c’est tout ce qu’il mérite, qu’il n’avait qu’à ne pas être escargot. Mais il se peut qu’il n’en soit rien. Il est même vraisemblable (sitôt que l’on y songe) que l’escargot, lui aussi, ne cesse de protester (silencieusement) contre la coquille, les yeux à échasses et même la peau nacrée que nous lui voyons. Et peut-être se trouvera-t-il un jour des peintres assez subtils — ou, qui sait, suffisamment avertis — pour prendre le parti de cet escargot intérieur ; pour traiter les cornes et la coquille comme elles souhaitent d’être traitées.
 Je ne cherche qu’à être fidèle, tant pis si j’ai l’air sot. Qu’il y ait un secret chez Braque ¬ comme il y en a un chez Van Gogh ou Vermeer — c’est ce dont ne laisse pas douter une œuvre à tout instant pleine et suffisante : fluide (sans qu’il soit besoin d’air) ; rayonnante (sans la moindre source de lumière) ; à la fois attentive et quiète : réfléchie jusqu’à donner le sentiment d’un mirage posé sur sa réalité. Pourtant, sitôt que je veux nommer ce secret ou le sentiment du moins qu’il me laisse, voici tout ce que je trouve : c’est que Braque propose aux citrons, aux poissons grillés et aux nappes, inlassablement, ce qu’ils attendaient d’être. Ce après quoi ils soupiraient : leur spectre familier. Il y a je ne sais quoi de triste dans un devoir ; d’amer dans une attente : c’est que l’on craint d’être déçu. Mais chaque tableau de Braque donne le sentiment d’une attente joyeuse, et d’un devoir comblé.
Je ne cherche qu’à être fidèle, tant pis si j’ai l’air sot. Qu’il y ait un secret chez Braque ¬ comme il y en a un chez Van Gogh ou Vermeer — c’est ce dont ne laisse pas douter une œuvre à tout instant pleine et suffisante : fluide (sans qu’il soit besoin d’air) ; rayonnante (sans la moindre source de lumière) ; à la fois attentive et quiète : réfléchie jusqu’à donner le sentiment d’un mirage posé sur sa réalité. Pourtant, sitôt que je veux nommer ce secret ou le sentiment du moins qu’il me laisse, voici tout ce que je trouve : c’est que Braque propose aux citrons, aux poissons grillés et aux nappes, inlassablement, ce qu’ils attendaient d’être. Ce après quoi ils soupiraient : leur spectre familier. Il y a je ne sais quoi de triste dans un devoir ; d’amer dans une attente : c’est que l’on craint d’être déçu. Mais chaque tableau de Braque donne le sentiment d’une attente joyeuse, et d’un devoir comblé.
Bien entendu, il faudrait là-dessus des preuves. — Et je les donnerai. Au demeurant, je ne dis rien que de banal. (Il suffirait bien d’user d’un autre mot — de parler d’idéal, par exemple.) Tant mieux. Ce que je voulais dire aussi, c’est que la peinture de Braque est banale. Fantastique sans doute, mais commune. Fantastique, comme il est fantastique, si l’on y réfléchit, d’avoir un nez et deux yeux, et le nez précisément entre les deux yeux.
Jean Paulhan, Braque le patron, Gallimard, 1952, p. 17-22.
Publié dans ÉCRITS SUR L'ART, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, braque, citron, escargot, ressemblance en peinture | ![]() Facebook |
Facebook |






