29/09/2023
Antoinette Deshoulières, De rose alors ne reste que l'épine

Chanson
À la Cour
Aimer est un badinage,
Et l’amour
N’est dangereux qu’au Village.
Un Berger,
Si sa bergère n’est tendre,
Saura se pendre,
Mais il ne saurait changer.
Et parmi nous quand les belles
Sont légères ou cruelles,
Loin d’en montrer du dépit ,
On en rit,
Et l’on change aussitôt qu’elles.
Antoinette Deshoulières, De rose alors ne reste que l’épine,
édition Sophie Tonolo, Poésie/Gallimard, 2023, p. 98-99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoinette deshoulières, de rose alors ne reste que l’épine, chanson, dépit | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2023
Antoinette Deshoulières, De rose ne reste alors que l'épine

Rondeau
Le bel esprit, au siècle de Marot
Des dons du Ciel passait pour le gros lot,
Des Grands Seigneurs il donnait accointance,
Menait parfois à noble jouissance,
Et qui plus est, faisait bouillir le pot.
Or est passé ce temps où d'un bon mot,
Stance ou dizain, on payait son écot.
Plus n’en voyons qui prennent pour finance
Le bel esprit.
À prix d’argent l’auteur comme le sot,
Boit sa chopine, et mange son gigot,
Heureux encor d’en avoir suffisance.
Maints ont le chef plus rempli que la panse
Dame ignorance a fait enfin capot
Le bel esprit.
Antoinette Deshoulières, De rose alors ne reste que l’épine,
édition Sophie Tonolo, Poésie/Gallimard, 2023, p. 98.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoinette deshoulières, de rose alors ne reste que l’épine | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2023
William Carlos Williams, Scènes & Portraits

Fleurs au bord de la mer
Au-dessus du bord net et fleuri des prés
invisible, l’océan salé soulève sa forme
les fleurs de la mer
apportent l’un à l’autre un changement
Pâquerettes et chicorées, serrées, mais relâchées
ne paraissent plus seulement des fleurs
mais couleur et le mouvement ou les formes
de la tranquillité, alors que
l’idée de la mer décrit un cercle et
se balance paisiblement sur sa tige végétale
William Carlos Williams, Scènes et portraits, édition
bilingue, traduction et présentation Jacques Demarcq,
Seghers, 2023, p. 85.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william carlos williams, fleurs au bord de la mer | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2023
William Carlos Williams, Scènes & Portraits
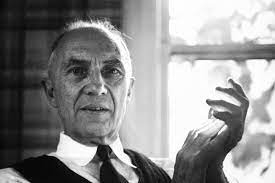
Le cheval
Le cheval avance
indépendamment
sans s’occuper
de sa charge
il a des yeux
de femme et
les tourne,
lance en arrière
ses oreilles et
reste en général
conscient
du monde. Mais
il tire quand
il faut et
tire bien, soufflant
de la brume par
ses naseaux
comme fument
les deux pots
d’une voiture.
William CarlosWilliams, Scènes & Portraits,
édition bilingue, traduit et présenté par
Jacques Demarcq, Seghers, 2023, p. 177.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william carlos williams, le cheval, souffler | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2023
William Carlos Williams, Scènes & Portraits

Le poivrot
Toi poivrot
titubante
cloche
ô Jésus
malgré toute
ta crasse
vraiment sordide
je
t’envie
C’est le visage
de l’amour
même
abandonné
dans cet impuissant
enfermement
du désespoir
William Carlos Williams, Scènes &
Portraits, Anthologie inédite, édition
bilingue,traduit et présenté par
Jacques Demarcq, Seghers, 2023, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william carlos williams, alcoolisme, désespoir | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2023
Ernst Jandle, Retour à l'envoyeur
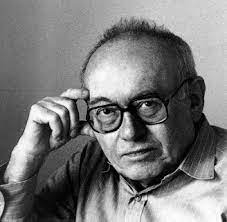
nocturne aux fleurs
dans la chambre où je ronfle
les fleurs ça me gonfle
c’est la punition du dormeur
la mouche quand l’odeur
des fleurs exhalée
l’incite à rappliquer
du côté du lit
les fleurs c’est du vivant
moi pareil vivant ;
et la mouche aussi
de mort y a que la fumée
que via bouche et nez
de mes poumons je souffle
pour chasser la mouche
sur les fleurs elle veut butiner
du coup me voilà levé
la tapette à la pogne
debout rn pyjama je grogne —
jamais mouche de son vivant
même si ça doit durer longtemps
n’atteindra ici le but
où l’attend l’autre mouche en rut
Ernst Jandle, Retour à l’envoyeur, traduction
Alain Jadot et Christian Prigent, grmx éditions,
2012, p. 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jandle, retour à l'envoyeur, nocturne aux fleurs, mouche | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2023
Ernst Jandle, Retour à l'envoyeur

sommaire
pour faire un poème
j’ai rien
qu’ne langue
qu’une vie
qu’une pensée
qu’une mémoire
pour faire un poème
j’ai rien
Enst Jandle,Retour à l’envoyeur,
traduction Alain Jadot et Christian
Prigent ; Drmx, 2012, p. 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enst jandle, retour à l’envoyeur, sommaire, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2023
Jean Follain, Appareil de la terre

Au seuil d’une porte, le balai en main, la servante ressent un bien-être à écouter : des gens en blouse, veste de coutil ou caraco de nuit, se parlent en plein jour. Dans l’agitation demeurent calmes découvreurs de charades et problèmes : il ne faut pas dit un homme, la croix et la bannière pour trouver la capacité des citernes. Une clef du pressoir détruit reste enfouie, rouillée. Un mulot, un instant, inspecte. Il semble tout d’un coup que le monde veuille basculer dans le vide pour en terminer avec les bavardages du présent.
Jean Follain, Appareil de la terre, Gallimard, 1953, p. 10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Follain Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, appareil de la terre, écoute, vide | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2023
Jean Follain, Appareil de la terre

Solitaires
Toujours leur porte s’ouvre mal
derrière eux s’endort la bête
couleur de feu
au seul pas d’homme ou de femme
ils reconnaissent qui passe
sur a route tournante
regardent un instant
pendant du plafond noir
la lampe ornée
une plante verte ocellée meurt
pleure un enfant perdu
sous le vaste ciel bas
puis il neige enfin.
Jean Follain, Appareil de la terre,
Gallimard , 1964, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Follain Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, appareil de la terre, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2023
Robert Desnos, Sirène-Anémone

Sirène-Anémone
Qui donc pourrait me voir
L’anémone du soi
Fleurit sous mes fougères
Moi la flamme étrangère
O fougères mes mains
Hors l’armure brisée
Sur le bord des chemins
En ordre sont dressées
Et la nuit s’exagère
Au brasier de la rouille
Tandis que les fougères
Vont aux écrins de houille
L’anémone des cieux
Fleurit sur mes parterres
Fleurit encore aux yeux
À l’ombre des paupières
Anémone des nuits
Qui plonge ses racines
Dans l’eau creuse des puits
Aux ténèbres des mines
Poseraient-ils leurs pieds
Sur le chemin sonore
Où se niche l’acier
Aux ailes de phosphore
Verraient-ils les mineurs
Constellés d’anthracite
Paraître l’astre en fleur
Dans un ciel en faillite
En cet astre qui luit
S’incarne la sirène
L’anémone des nuits
Fleurit sur son domaine
Alors que s’ébranlaient avec des cris d’orage
Les puissances Vertige au verger des éclairs
La sirène dardée à la proue d’un sillage
Vers la lune chante la romance de fer
Sa nage déchirait l’hermine des marées
Et la comète errant rouge sur un ciel noir
Paraissait par mirage aux étoiles ancrées
Rayait de feu le ciel et d’écume les eaux
L’anémone fleurie aux jardins des miroirs
Et parallèlement la double chevelure
Fougères surgissez hors de la déchirure
Par où l’acier saigna sur le fil des roseaux
[…]
Robert Desnos, Sirène-Anémone [1929], dans Domaine public, Le Point du jour, Gallimard, 1953, p. 155-156.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, sirène anémone | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2023
Robert Desnos, Langage cuit

La colombe de l’arche
Maudit !
soit le père de l’épouse
du forgeron qui forgea le fer de la cognée
avec laquelle le bûcheron abattit le chêne
dans lequel on sculpta le lit
où faut engendré l’arrière-grand-père
de l’homme qui conduisit la voiture
dans laquelle ta mère
rencontra ton père.
(14 novembre 1923)
Robert Desnos, Langage cuit, dans Domaine public, Gallimard, 1953, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnoods, langage cuit, maudire, généalogie | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2023
Robert Desnos, L'aumonyme

Autant pour les crosses
Autant pour les crosses, évêques caducs qui baptisez les Êves aux aqueducs.
Autant pour les crosses, gens qui associez à l’amour votre sorte.
Flexible, Flexible, ma chère Flexible,
Est-ce ma chair, ma chère, sont-ce des crosses que vous cherchez ?
Autant pour
Autant dire.
Ici c’est Charles Cros.
Jamais plus pour Charles Cros.
Robert Desnos, L'aumonyme, dans Domaine public, Gallimard, 1953, p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, crosse, charles cros | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2023
Robert Desnos, Rrose Sélavy

Rrose Sélavy
29. Ah ! meurs, amour !
35. Si le silence est d’or, Rrose Sélavy abaisse ses cils et s’endort.
39. Rrose Sélavy propose que la pourriture des passions devienne la nourriture des nations.
49. Rrose Sélavy vous engage à ne pas prendre les verrues des seins pour les vertus des saints
53. Devise de Rrose Sélavy :
Plus que poli pour être honnête
Plus que poète pour être honni.
Robert Desnos, Rrose Sélavy, dans Domaine public, Gallimard, 1953, p.41, 42, 42, 43, 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, rrose sélavy | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2023
Robert Desnos, Rrose Sélavy

Rrose Sélavy
1.Dans un temple en stuc de pomme le pasteur distillait le suc des psaumes.
7. Ô mon crâne, étoile de nacre qui s’étiole.
10. Rrose Sélavy se demande si la mort des saisons fait tomber un sort sur les maisons.
19. Rrose Sélavy voudrait bien savoir si l’amour, cette colle à mouches, rend plus dures les molles couches.
21. Croyez-vous que Rose Sélavy connaisse ces jeux de fous qui mettent le feu aux joues ?
Robert Desnos, Domaine public, Gallimard, 11953, p.39, 39, 40, 40, 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, rrose sélavy, contrepéterie | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2023
Tristan Tzara, Où boivent les loups

errer errer dans une tête pleine
où j’attends la seule l’absente
la mal choisie d’entre les belles
la pierre au cou
par les profondes ruelles du sourire
tant d’hommes s’égarent près du pont
toujours partie — ni rides ni vents
parmi les rares
vieille l’ombre s’est rompue
de la branche sans amis
et la dernière est morte
qui voulait revivre une jeunesse morte
toute le neige toute
le ciel où demeurent toutes
ancrées désespérément
dans un cri — d’avoir trop compris
Tristan Tzara, Où boivent les loups, dans
Œuvres complètes, 2, 1925-1933, éditions
Henri Béhar, Flammarion, 1977, p. 207.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan tzara, où souvent les loups, amour perdu | ![]() Facebook |
Facebook |





