30/11/2023
Louis Aragon, En étrange pays dans mon pays lui-même

Marguerite
Ici repose un cœur en tout pareil au temps
Qui meurt à chaque instant de l’instant qui commence
Et qui se consumant de sa propre romance
Ne se tait que pour mieux entendre qu’il attend
Rien n’a pu l’apaiser jamais ce cœur battant
Qui n’a connu du ciel qu’une longue apparence
Et qui n’aura vécu sur la terre de France
Que juste assez pour croire au retour du printemps
Avait-elle épuisé l’eau pure des souffrances
Sommeil ou retrouvé des rêves de vingt ans
Qu’elle s’est endormie avec indifférence
Qu’elle ne m’attend plus et non plus ne m’entend
Lui murmurer les mots secrets de l’espérance
Ici repose enfin celle que j’aimais tant
Aragon, En étrange pays dans mon pays lui-même, dans
Œuvres poétiques complètes, I, édition dirigée par
Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 891.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marguerite ici repose un cœur en tout pareil au temps qui meurt, en étrange pays dans mon pays lui-même, dans Œuvres poétiques complètes, i, édition dirigée par olivier barbarant, pléiadegallimard, 2007, p. 891. apparence, espérance | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2023
Louis Aragon, La Grande Gaîté

Art poétique
On me demande avec insistance
Pourquoi de temps en temps je vais à
La ligne
C’est pour une raison
Véritablement indigne
D’être cou
Chée par écrit
Aragon, La Grande Gaîté, dans
Œuvres poétiques complètes, I, édition
dirigée par Olivier Barbarant,
Pléiade/Gallimard, 2007, p. 406.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, la grande gaitera, art poétique | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2023
Louis Aragon, Le Paysan de Paris

Je ne veux plus me retenir des erreurs de mes doigts, des erreurs de mes yeux. Je sais maintenant qu’elles ne sont pas que des pièges grossiers, mais de curieux chemins vers un but que rien ne peut me révéler qu’elles. À toute erreur des sens correspondent d’étranges fleurs de la raison. Admirables jardins des croyances absurdes, des pressentiments, des obsessions et des délires. Là prennent figure des dieux inconnus et changeants. Je contemplerai ces visages de plomb, ces chènevis de l’imagination. Dans ces châteaux de sable, que vous êtes belles, colonnes de fumées ! Des mythes nouveaux naissent sous chacun de nos pas. Là où l’homme a vécu commence la légende, là où il vit.
Aragon, Le Paysan de Paris, dans Œuvres poétiques complètes, I, édition dirigée par Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 149.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, le paysan de paris, étrangeté | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2023
Louis Aragon, Les Destinées de la poésie

Le dernier des madrigaux
Permettez Madame
C’est grand liberté
Que je le proclame
Vous atteignez à la beauté
Ce n’est pas peu dire
Ce n’est pas pour rire
C’est même exactement
Pour pleurer
Votre manière agaçante
De manier l’éventail
Vos airs de reine ou de servante
Vos dents d’émail
Vos silences pleins d’aveux
Vos jolis petits cheveux
Ce sont des raisons excellentes
Pour pleurer
Aragon, Les Destinées de la poésie, dans
Œuvres poétiques complètes, I, éditions dirigée
par Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard,
2007, p. 120-121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, les destinées de la poésie, le dernier des madrigaux | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2023
Luis Cernuda, La Réalité et le Désir

Avec toi
Mon pays ?
Mon pays c’est toi.
Mon peuple ?
Mon peuple c’est toi
L’exil et la mort
pour moi sont
où tu n’es pas.
Et ma vie ?
Dis-moi, ma vie, qu’est-elle, sinon toi ?
Luis Cernuda, La Réalité et le Désir, traduction
Robert Marrast et Aline Schulman,
Gallimard, 1965, p. 145.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis cernuda, la réalité et le désir, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2023
Claude Royet-Journoud, Histoire du reflet
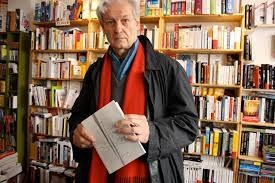
une forme humaine
sans clarifier son objet
ou la noirceur du lieu
retire l’enfant d’une description
corps et voyelles ont beau faire
le réel est encore l’ombre
sous la chaise
par secousses par saccades se prépare
un cercle de respiration
le sol est froid
une accumulation d’outils
neutralise la figure
Claude Royet-Journoud, Histoire du reflet, dans
K.O.S.K.H.O.N.O.N.G.,n° 25, automne 2023, p. 7.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude royet-journoud, histoire du reflet, lieu, réel | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels

Je n’oserais pas quitter mon ami,
Au cas où — au cas où il devrait mourir
Pendant mon absence — et que — trop tard —
Je rejoigne le Cœur qui m’attendait —
Si je devais décevoir les yeux
Qui ont scruté — tant scruté — pour voir —
Et ne pouvaient se résoudre à se fermer avant
Qu’ils m’aient « aperçue » — ils m’ont aperçue —
Si je devais poignarder la foi patiente
Si sûre de ma venue —
Bien sûr je suis venue —
À l’écoute — à l’écoute — endormi —
En prononçant mon nom doucement —
Mon ©œur souhaiterait se briser avant ça —
Se briserait alors — alors brisé —
Serait aussi inutile que le prochain soleil du matin —
Là où le givre de minuit — s’étendait !
Emily Dickinson, Du côté des mortels, traduction
François Heusbourg, éditions Unes, 2023, p. 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels, ami, amant | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels

Tu m’aimes — tu en es sûre —
Je n’ai pas à craindre de méprise —
Je ne me réveillerai pas trompée—
Par un matin souriant —
Pour trouver l’Aube partie —
Et les Vergers — intouchés —
Et Dollie — envolée !
Je ne dois pas tressaillir — tu en es sûre —
Une telle nuit ne se produira jamais —
Quand apeurée — me précipitant chez Toi —
Pour trouver les fenêtres éteintes —
Et plus de Dollie — vraiment —
Plus du tout !
Sois sûre d’être sûre — tu sais —
Je le supporterais mieux maintenant —
Si tu me le disais simplement —
Plutôt qu’ensuite — un petit Baumier terne ayant poussé —
Sur cette douleur mienne —
Tu piques — encore !
Emily Dickinson, Du côté des mortels, poèmes
1860-1861, traduction François Heusbourg,
éditions Unes, 2023, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels

Marcher pour toujours à Ses côtés —
La plus petite des deux !
Cerveau de Son Cerveau —
Sang de Son Sang —
Deux vies — Un Être — Désormais —
Partager Son Sort pour toujours —
En cas de chagrin — abandonner ma part
À ce Cœur bien-aimé —
La vie entière — pour connaître l’autre
Que nous ne pouvons jamais apprendre —
Et petit à petit — un Changement —
Appelé Paradis —
Voisinage d’humains en extase —
Découvrant alors — ce qui nous troublait —
Sans le lexique !
Emily Dickinson, Du côté des mortels, poèmes
1860-1861, traduction François Heusbourg,
Editions Unes, 2023, p. 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels, vie, apprendre | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels

S’il n’avait pas de crayon
Emprunterait-il le mien —
Usé — là — émoussé — mon cher
De t’écrire tant.
S’il n’avait pas de mot —
Ferait-il la Pâquerette,
Presque aussi grande que je l’étais —
Quand il m’a cueillie ?
Emily Dickinson, Du côté des mortels (poèmes
1860-1861), traduction François Heusbourg,
Editons Unes, 2023, p. 57.
18/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels, poèmes 1860-1861

Elle est morte en jouant —
Tournoyant tout le long
De son bail aux heures inachevées
Puis elle a glissé aussi gaiement qu’un Turc
Sue un Coussin de fleurs
Son fantôme flottait doucement sur la colline
Hier, et aujourd’hui —
Son vêtement une toison d’argent —
Son visage — un embrun —
Emily Dickinson, Du côté des mortels, poèmes
1860-1861,traduction François Heusbourg,
éditions Unes, 2023, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2023
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls

mais où s’égare le soleil
où part-il s’égayer
place de la Fraternité
sur de curieux bancs de très grands enfants jouent
ici le temps redouble
il fait nuit brune
j’ignore où commence
la rue que je recherche
oh le terrible
bruit de mon cœur
là dans la fosse de mon corps
incarcéré mais clair comme une gigue
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls,
Gallimard, 2023, p. 136.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne paulin, poèmes pour enfants seuls, soleil, enfant | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2023
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls

Il y aura partout
dans le spectaculaire ennui
dans ton visage à claire- voie
des brins dans la forêt
tu ne seras pas sourd, grand corps affamé d’ombre
tu prendras quelque chose
un peu de mer vidée
des cendres qui s’attroupent
tous les désordres simples à confondre
à redire
c’est comme un minerai la mort
une caresse des extrêmes
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls,
Gallimard, 2023, p. 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne paulin, poèmes pour enfants seuls, mer, cendre | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2023
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls

tu te le rappelles
le petit sentie
perdu dans la Ruhr
laid pour tout le monde ?
je l’ai emprunté
dans un rêve entier
il était crayeux
petit chagrin sans âge
je voudrais savoir
à qui je m’adresse
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants
seuls, Gallimard, 2023, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne paulin, poèmes pour enfants seuls, sentier | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2023
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls

Dernière offre
la poésie
que l’on surprend au fond de la boutique
derrière la réserve
par-dessus l’extincteur et sous les vies vécues
les destins politiques les drames romancés
horizons cornés
ciels à la va-vite
— comme si vous y étiez : venez voir
on ne paie qu’en sortant
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls,
Gallimard, 2023, p. 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne paulin, poèmes pour enfants seuls, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |





