16/01/2016
Reinhardt Priessnitz, 44 Poèmes :recension
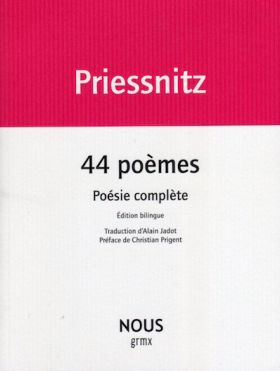
Une leçon de lecture
En France, parler de poésie en langue allemande, quand il s’agit de la poésie écrite après 1945, c’est d’abord parler de Celan, parfois d’Ingeborg Bachman que l’on associe à Celan, moins de Hans Magnus Enzenberger, rarement de Rose Ausländer, de Hilde Domin, d’Erich Fried, de Johannes Bobrowski ou de Paul Hucher, pour ne citer que quelques noms. Aucun n’est dans un courant auquel appartient Priessnitz, c’est peut-être pourquoi il est quasiment inconnu en France, sinon de quelques germanistes ; la publication de son œuvre est bienvenue, représentant une des traces importantes de ce qu’ont été les recherches dans la poésie allemande d’après-guerre. Cette édition fait suite à celles en 2012 de Retour à l’envoyeur d’Ernst Jandl (1925-2000) et en 2013 de Poèmespoèmes d’Oskar Pastior)(1). Par leurs recherches formelles, la traduction de ces trois poètes pose des problèmes redoutables ; Alain Jadot (avec le renfort de Christian Prigent pour Jandl) a su quand c’était nécessaire transposer, notamment, les jeux phoniques des uns et des autres, jeux que l’édition bilingue permet d’apprécier.
Il faut lire et relire la préface de Prigent (et aller lire aussi celle écrite pour Poèmespoèmes de Pastior) qui situe précisément « l’ambiance de dissidence sociale et d’inventivité formelle » dans laquelle a vécu Priessnitz (1945-1985). Comme d’autres, il a écrit contre ce qu’a été « le massacre de toute langue vivante et de toute pensée libre » pendant le nazisme, contre la société de consommation, contre la disparition de la singularité de la langue, contre le lyrisme toujours convenable inscrit dans la tradition — choix qui, dans un contexte différent, ne sont pas étrangers à l’aventure, à peu de choses près parallèle, du groupe autour de TXT (revue née en 1969 avec Prigent, Steinmetz, Verheggen). Prigent ne se contente pas de décrire précisément ce que fut l’expérimentation du poète autrichien, il insiste sur son travail pour « former des formes capables de répondre de façon adéquate à la violence de l’expérience qui pousse à écrire. »
Personne n’écrit sur une table rase. Priessnitz cite parodiquement Richard iii de Shakespeare (« Mon royaume pour un cheval »), avec « qu’un cheval soit mon empire », à partir de quoi viennent des mots relatifs au cheval croisés avec des mots liés à l’oiseau (« que ton coup d’aile, soit celui de mon sabot »). Dans un autre poème où NO (= non) est présent en majuscules dans un grand nombre de mots, c’est le monologue de Nora dans l’Ulysse de Joyce qui est évoqué. Plus généralement, des formes de la tradition sont reprises : un poème en quatrains, un autre en strophes régulières de sept vers, ou en strophes de trois vers chacune suivie d’un refrain qui se donne pour tel : « & retour toujours ». On lira aussi un poème écrit avec deux rimes et reprises de quelques mots, un poème rimé — trois strophes de huit vers — titré ‘’stances’’, qui conteste la vertu de sa régularité en rappelant « la venteuse vérité contenue dans tout écrit ». À une ballade en strophes de deux vers succède une « ballode » de même forme mais qui accumule lettres et sons, « mrtnmrtn mrtn fta fta ».
On l’aura compris, une forme connue n’est présente que pour être interrogée ; il en est de même de toute thématique classique. Le motif du ciel sombre en accord avec le moi est un lieu commun du lyrisme, il est ici brisé par la présence d’un mot suscrit (traduit par « une frange flottant tant au vent ») et une manière de bégaiement, mehrere, ‘’plusieurs’’, devenant mehrererere. Mais les atteintes aux formes admises de la poésie sont régulièrement plus violentes ; une partie d’entre elles appartiennent aujourd’hui à l’histoire de la poésie — ce qui n’empêche pas qu’elles soient toujours mal reçues — et il faut se souvenir que Priessnitz a écrit les 44 poèmes entre 1964 et 1978. Relevons la multiplication des parenthèses dans un poème, l’esperluète (&) à la fin d’un vers reprise au début du suivant, les coupes à la rime impossibles : « zwei / g » [‘’ram / eau’’], la répétition d’une lettre : « eeeee (e) » ou d’un mot : « und und und undund und und » [et et et etet et et], l’emploi de mots valises : « vorrüberrollen » [provisoiroulement], le collage de plusieurs mots : « oder wasweißeinfremder was oder » [ou questcequilensaitlui ou quoi] ; etc.
On comprend qu’il s’agit d’introduire le désordre dans le bien dire et Priessnitz introduit souvent dans son écriture des pratiques étrangères, habituellement, à la poésie. Les lettres d’un poème sont à demi effacées, comme s’ils avaient été dactylographiés avec une machine au ruban fatigué ; dans un poème présenté manuscrit la notation musicale de la noire remplace le ‘’o’’ ; un poème est raturé, un autre rayé d’un trait. Retenons encore l’usage régulier de l’allitération et le dérèglement de la syntaxe, et même souvent l’abandon du texte : des mots sont écrits en croix entretenant deux à deux une relation phonique : « napf — nabe, kopf — knospe ». Mais l’atteinte la plus lisible à l’ordre réside, me semble-t-il, dans la multiplication des anagrammes, évidemment intraduisibles (Le traducteur propose à chaque fois une adaptation) ; un poème en contient toute une série, annoncée par le titre, « schlafe, falsche, flasche » et ces anagrammes ont toujours un sens ; ainsi celes de l’un des derniers poèmes : « — lage ? — nebel ! — leben ? — egal ! », littéralement « — situation ? — brouillard ! — vivre ? — peu importe ! »(2).
Qu’on ne s’y trompe pas, s’il y a violence faite à la langue, c’est bien comme l’analyse Prigent que « les poèmes de Priessnitz miment les façons dont le monde nous affecte ». Quand les allitérations s’accumulent dans des vers (restituées dans la traduction), vient une question : « tous les sirops, sèves, sucs, / sauces suaves et harissa : est-ce ça le sens ? » ; et répondre, c’est dire qu’il faut écrire « le fracassé, l’enfilé, la fêlure », l’éparpillement de ce qui est devant nous. Ainsi un poème reprend le vocabulaire de la ballade qui le précédait (ciel, neige, flocons, coq, etc.), mais ‘’verre’’ est transformé :
je fonce tel un coq écorché vers un rêve
où s’époumone une poule : c’est mon ode d’antan ;
mais son brio me semble là si minable,
que le ciel s’abat sur moi en éclats de vers.
Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, Poésie complète, édition bilingue, traduction d’Alain Jadot, préface de Christian Prigent, NOUS, 2015, 160 p., 18 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 23 décembre 2015.
- Les trois auteurs sont publiés par les éditions NOUS, Jandl et Priessnitz dans la collection grmx dirigée par Yoann Thommerel —‘’gmrx’’, sigle de la revue Grumeaux qu’il a fondée.
- Alain Jadot préfère garder l’anagramme avec une adaptation : « - l’âge ? — né bel ! — le ben ? — égal ! ».
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, christian prigent, poésie allemande, critique sociale, invention formelle | ![]() Facebook |
Facebook |
15/01/2016
Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres II, 1941-1956

Lettre à Georges Duthuit, 11/08/ 1948
L’erreur, la faiblesse tout au moins, c’est peut-être de vouloir savoir de quoi l’on parle. À définir la littérature, à sa satisfaction, même brève, où est le gain, même bref ? De l’armure tout ça, pour un combat exécrable. Je crois savoir ce que vous ressentez, acculé à des jugements, même suggérés, seulement, chaque mois, enfin régulièrement, arrachés de plus en plus difficilement à des critères haïs. C’est impossible. Il faut crier, murmurer, exulter, intensément, en attendant de trouver le langage calme sans doute du non sans plus, ou avec si peu en plus. Il faut, non, il n’y a que ça apparemment, pour certains d’entre nous, que ce petit bruit de hallali insensé, et puis peut-être le débarras d’au moins une bonne partie de ce que nous avons cru avoir de meilleur, ou de plus réel, au prix de quels efforts, et peut-être l’immense simplicité d’une partie au moins du peu redouté que nous sommes et avons.
Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres II, 1941-1956, Gallimard, 2015, p. 186.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les années godot, lettres, georges duthuit, littérature, définir, langage, simplicité, suggestion | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2016
Jean-Paul de Dadelsen (1913-1957), Gœthe en Alsace

Je vous aime ...
Je vous aime. C’est une phrase que l’on entend parfois. Au cinéma par exemple.
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?
Je dois avouer ne pas être bien certain de ce qu’elle signifie, cette petite phrase de trois mots dont chaque mot me paraît, à la réflexion, assez obscur : le mot « aime », le mot « vous » et même le mot « je ».
Un jeune homme nommé John rencontre une jeune européenne nommée Éva. C’est le printemps et quelque part dans l’Atlantique les millions de harengs serrés en bancs commencent à pondre leurs milliards d’œufs. Éva, depuis qu’elle a découvert le parfum Mistigris, le soutien-gorge Luxur et le dentifrice Magnétic, Éva, comme disent les pages de publicité, Éva a une personnalité folle. C’est-à-dire qu’elle est assez gentille. Ils vont se marier ; le journal local dira que c’était le coup de foudre (love at first sight), ils se sont aimés depuis le premier regard, sans préciser si la foudre est tombée sur la lingerie publicitaire d’Éva ou sur la voiture grand sport de Johnnie.
Peut-être, si les gens étaient véridiques et savaient de quoi ils parlent, pourrait-on entendre — peut-être au début de quelque civilisation encore à venir entendra –t-on en pareille circonstance des conversations sensiblement différentes, ar exemple :
— Je vous aime
— Pardon ?
— Je vous aime
- Excusez-moi ; je ne sais si je vous comprends bien. Exactement, de quoi s’agit-il ? En effet la question se pose. Que vous veut, chère Mademoiselle, ce jeune homme de bonne famille ? « Je vous aime » peut signifier, non seulement « la situation de votre papa me plaît », ou bien « profitons des allocations familiales », mais encore, par exemple : « J’aime votre beauté, elle est flatteuse pour moi-même », ou « elle est un peu sotte, donc, elle m’admirera », ou peut-être « voilà une femme plus forte que moi » ou encore « j’en ai assez de manger au restaurant ».
Jean-Paul de Dadelsen, Gœthe en Alsace, Le temps qu’il fait, 1987, p. 77-78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul de dadelsen, gœthe en alsace, je vous aime, coup de foudre, illusion, ambiguïté | ![]() Facebook |
Facebook |
13/01/2016
Philippe Beck, Dans de la nature

61.
À Anne Morin
Que peut bien le :
« Qui suis-je pour demander
du paradis ici ? »
dans de la nature ?
La question a voyagé
et a de la sève isolée.
Question usée est un tesson
dans de l’usure.
Si elle est plaine criante
enrouée,
alors « Qui suis-je pour... ? »
est l’énergie satirique
qui aère les morceaux de bravoure,
les « Par ici ! » archaïques
dont je canalise les rivières
en pleine cité. Comme celui
qui empoignait grammaticalement
un frêle et gracile pipeau
et marchait sur du pétrole enterré.
« Qui suis-je pour... ? »
est roucoulement de tourterelle,
bête interdite et chantant ardemment.
Les tourterelles font et refont des Oh !
« Oh ! » est l’étiquette sur la Dame qui chante.
Philippe Beck, Dans de la nature, Flammarion,
2003, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 61. À anne morin que peut bien le : « qui suis-je pour demander, alors « qui suis-je pour... ? » est l’énergie satirique qui aère, les « par ici ! » archaïques dont je canalise les rivières en pl, bête interdite et chantant ardemment. les tourterelles font et r, dans de la nature, qui-jequestion, chant | ![]() Facebook |
Facebook |
12/01/2016
Apollinaire, Funérailles
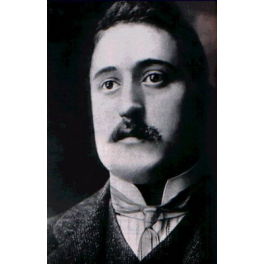
Funérailles
Plantez un romarin
Et dansez sur la tombe
Car la morte est bien morte
C’est tard et la nuit tombe
Dors bien dors bien
C’est tard et la nuit tombe
Dansons dansons en rond
La morte a clos ses yeux
Que les dévots prient Dieu
Dors bien dors bien
Que les dévots prient Dieu
Cherchons des prie-dieu
La mort a fait sa ronde
Pour nous plus tard demain
Dors bien dors bien
Pour nous plus tard demain
Plantons un romarin
Et dansons sur la tombe
La mort n’en dira rien
Dors bien dors bien
La mort n’en dira rien
Priez les dévots mornes
Nous dansons sur les tombes
La mort n’en saura rien
Dors bien dors bien
Guillaume Apollinaire, Pèmes divers, dans
Œuvres poétiques, Pléiade / Gallimard,
1965, p. 575.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume apollinaire, funérailles, danse, mort, prière, romarin | ![]() Facebook |
Facebook |
11/01/2016
Danielle Collobert (1940-1978), Survie

balancé au chaos sans armure
survivra ou non résistance aux coups la durée longue de
[vie
je parti l’exploration du gouffre
tâtonnant contre jour
déjà menottes aux mains les stigmates aux poignets
aux pieds les fers les chaînes
la distance d’un pas l’unité de mesure
je raclant mon sol avec ça
traîne le bruit dans l’espace
en premier sur la bande son du prométhée
le vautour dans la gorge
à coups au sang rabattu sans fin vers le silence
au milieu du front le plat désert futur
derrière caché peut-être le corps à s’agglomérer
Danielle Collobert, Survie, Orange Export Ltd, 1978,
repris dans Change, n° 38, octobre 1979, repris dans
Œuvres, I, P.O.L, 2004.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, survie, chaos, prométhée corps | ![]() Facebook |
Facebook |
10/01/2016
Agnès Rouzier, À haute voix, dans Change
Tout vouloir dire et ne pouvoir rien dire, quand on dit. Cette distance invincible qui fait effectivement que la parole ne serait valable que si elle pouvait être, en même temps, une forme de fête. Parce que quand on écrit, elle est fête, ou faite pour la fête, très exactement, oui, faite pour la fête. Mais la fête n’arrive jamais. Alors l’écriture est silence, et c’est dans cet intervalle : être faite pour la fête et ne devenir que silence, qu’il faut la situer, comme si dans cet intervalle le silence devenait : une fête, une sorte de fête, une fête, difficile de trouver le mot : ce n’est pas défaillant, ce n’est pas triste, une fête à part, une autre fête, une fête qui est redoublement du silence, peut-être que le silence, alors, devient quelque chose d’insolent, je ne sais pas. Je ne comprends pas bien. Je crois qu’il serait très important de définir, de chercher à comprendre ce que peut contenir cette forme de silence, ce qui le rend possible, ce qui rend cette parole-silence possible.
Agnès Rouzier, ‘’À haute voix’’, Change, ‘’La machine à conter’’, n° 38, octobre 1979, p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, ‘’À haute voix’’, change, ‘’la machine à conter’’, écrire, fête, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
09/01/2016
Eugène Savitzkaya, Nouba

[...]
y a-t-il quelqu’un
à côté d emoi ?
qui partagera ma couche ?
où serai-je demain ?
demain sera-t-il ?
serai-je demain ?
où demain sera-t-il ?
qu’en sera-t-il demain ?
de qui sont ces os ?
qui tient à ses os ?
où serons-nous demain ?
qui boit mon sang ?
ai-je du sang ?
que dit le sang ?
qui saigne ?
à quelle heure saigne-t-on ?
saigne-t-on à sa guise ?
où est mon mari ?
mon mari est-il ?
est-il mon mari ?
qui est contre mon cœur ?
contre qui est mon cœur ?
qui contient mon cœur ?
que contient mon cœur ?
où est ma fiancée ?
qui est ma fiancée ?
ai-je une fiancée ?
on se fiance ?
qui se fiance ?
se fiance-t-on ?
fiance-t-on ?
comment faire ?
on nous flétrit ?
nous flétrit-on ?
qui est au timon ?
qui nous émascule ?
qui est l’homme ?
qui est la femme ?
quel temps fait-il ?
fait-il du temps ?
du temps se fait-il ?
comment se fait le temps ?
où se fait-il ?
[...]
Eugène Savitzkaya, Nouba, Yellow Now
(Crisnée, Belgique), 2007, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, nouba, aimer, fiancée, temps, sang, cœur, demain | ![]() Facebook |
Facebook |
08/01/2016
Rachel Blau Duplessis, Brouillons — traduction Auxeméry

Brouillon 89 : Interrogatoire.
Tout cela, pourquoi en as-tu été touchée à ce point ?
La soif, d’aller ici, là, partout.
Et où va-t-on quand on part de là ?
Il n’était pas prévu que ce soit une impasse.
Es-tu prête ?
Jamais de ma vie.
Déclares-tu ici bien être l’auteur des termes que tu employais ?
Non, il y avait quelque chose qui dépassait l’idée d’auteur.
As-tu eu plaisir à déposer ?
C’est devenu une condition de mon travail.
En réponse à quoi, exactement ?
À deux mots, un de ses poèmes, jadis, ‘’cendres froides’’.
C’est arrivé quand ?
À moment donné, il y a longtemps, mais encore en ce moment.
En es-tu vraiment à ce point de désespoir ?
Dépend des fois, et d’où. Oui et non.
De quelle sorte de confession s’agit-il ?
Je ne fais pas de confession, j’expose seulement des faits.
Naïveté de ta part, non ?
Ça oui, je peux l’avouer.
Où en as-tu entendu parler ?
Sur la toile, dans l’air du temps, ici ou là.
Tu es à l’écoute, mais comme de façon surnaturelle.
Elle, quand je l’ai entendu en parler, c’est comme si moi, j’en avais parlé.
La déclaration que tu as faite était donc exacte ?
Je ne sais pas ; c’est une déclaration venue d’ici ou là
Il y a trop de vague dans tout ça : ici ou là, jadis ou maintenant.
Je ne fais que donner les réponses, c’est toi qui poses les questions.
Mais ton opinion réelle, elle ne peut pas se résumer à ça.
Je ne veux pas renoncer à la poésie —
Et elle, elle n’a perdu tout espoir en l’écriture...
mais moi, c’est tous les jours que la poésie m’exaspère.
Pourquoi dis-tu ça ? C’est faire du sentiment, apparemment.
Adéquation entre langue telle que produite, et telle que reçue.
Peut-on savoir ce qu’on risque de trouver là, finalement ?
Quelqu’un d’entortillé dans un auto-interrogatoire.
[...]
Rachel Blaud Duplessis, Brouillons, traduit par Auxeméry
avec la collaboration de Chris Tysh, Corti, 2013, p. 217-218.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rachel blau duplessis, brouillons, auxeméry, interrogatoire, indécision, question, réponse | ![]() Facebook |
Facebook |
07/01/2016
Gustave Courbet : pourquoi refuser la Légion d'honneur

au ministre des Beaux-Arts
[...]
Mes opinions de citoyen s’opposent à ce que j’accepte une distinction qui relève essentiellement de l’ordre monarchique. Cette décoration de la Légion d’honneur, que vous avez stipulée en mon absence et pour moi, mes principes la repoussent. En aucun temps, en aucun cas, pour aucune raison, je ne l’aurais acceptée. Bien moins le ferai-je aujourd’hui que les trahisons se multiplient de toutes parts, et que la conscience humaine s’attriste de tant de palinodies intéressées. L’honneur n’est ni dans un titre, ni dans un ruban : il est dans les actes et dans le mobile des actes. Le respect de soi-même et de ses idées en constitue la majeure part. Je m’honore en restant fidèle aux principes de toute ma vie : si je les désertais, je quitterais l’honneur pour en prendre le signe.
Mon sentiment d’artiste ne s’oppose pas moins à ce que j’accepte une récompense qui m’est octroyée par la main de l’État. L’État est incompétent en matière d’art. Quand il entreprend de récompenser, il usurpe sur le droit public. Son intervention est toute démoralisante, funeste à l’artiste, qu’elle abuse sur sa propre valeur, funeste à l’art, qu’elle enferme dans des convenances officielles et qu’elle condamne à la plus stérile médiocrité. La sagesse pour lui est de s’abstenir. Le jour où il nous aura laissés libres, il aura rempli vis-à-vis de nous tous ses devoirs.
Souffrez donc, Monsieur le Ministre, que je décline l’honneur que vous avez cru me faire. J’ai cinquante ans , et j’ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre ; quand je serai mort, il faudra qu’on dise de moi : « Celui-là n’a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n’est le régime de la liberté ! »
Gustave Courbet, Lettre du 23 juin 1870 au Ministre des Beaux-Arts.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave courbet, légion d'honneur, citoyen, artiste, principe, liberté | ![]() Facebook |
Facebook |
06/01/2016
Olivier Domerg, Le temps fait rage

© Brigitte Pallagi
pour toute poétique & pour toute morale, ce qui est devant
nous. pont de l’Anchois, un matin d’avril. léger voile malgré
grand soleil, soleil et beau temps. léger voile peut-être du fait
de la petite rivière, là, derrière, en contrebas. tout indique
que ce sentier conduit au refuge qui porte son nom. le plein
d’oiseaux dans les vallons boisés, repousses vert tendre,
crissement des chaussures de marche dans le désert du
sentier. pour toute poétique & pour toute morale, ce qui est
devant nous. je n’ai jamais fini, disait-il, jamais, jamais. elle
est nue, presque unicolore. c’est davantage un éclat lumineux
qu’une couleur. ici, et sur une centaine de mètres, le vacarme
de l’eau domine, prend le dessus sur le ronflement des
voitures qui passent de temps à autre sur la départementale.
petite gorge arborée, cascades, eau claire, remontée de son
amplifié par la caisse de résonance du vallon. pied de la
montagne comme pied du mur ; pareil pour l’écriture. on
entend des rossignols, mais pas que des quantités.
Olivier Domerg, Le temps fait rage, Le bleu du ciel, 2015, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier domerg, écriture, nature, soleil, oiseaux | ![]() Facebook |
Facebook |
05/01/2016
Pascal Quignard, Princesse Vieille Reine

[...] Le vendredi 17 septembre 1808, le père de George Sand se rendit de Nohant à La Châtre afin de faire un quatuor chez les Duverret.
Il y dîna, tint parfaitement sa partie de violon, les quitta à onze heures.
Le cheval, qui avait pris le galop en quittant le pont, heurta dans l’obscurité un déblai de pierres, manqua rouler, se releva avec une telle violence qu’il projeta son cavalier derrière lui, à dix pieds de là.
Les vertèbres du cou furent brisées. Le père de George Sand avait trente et un ans. On le plaça sur une table d’auberge. On transporta le mort sur sa table, avec une lanterne sourde tenue devant lui, afin de voir dans l’obscurité, jusqu’à Nohant. On réveilla l’enfant de quatre ans, qui était en train de dormir, et on lui dit que son père était mort en revenant de faire du violon.
Orpheline de père, enfant d’une servante méprisée et à demi-folle, petite-fille d’une vieille dame aristocratique et malade (princesse de songe, riche comme Crésus, habillée comme l’as de pique, triste à étouffer, excellent musicienne). Aurore, quand elle fut adolescente, au désespoir d’avoir été arrachée à la paix du couvent où elle était heureuse, tout à coup, « vingt pieds d’eau dans l’Indre » l’attirent.
Pascal Quignard, Princesse Vieille Reine, Galilée, 2015, p. 51-53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mort, orpheline, couvent, quignard | ![]() Facebook |
Facebook |
04/01/2016
André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein
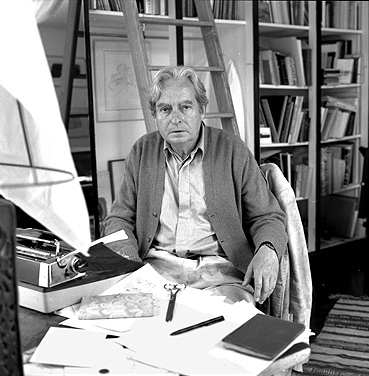
[...]
Alain Veinstein
Quelle a été la fonction des carnets par rapport à l’écriture des poèmes, et des livres. Vous insistiez sur le travail, tout à l’heure : précisément, on retrouve dans les livres des phrases des carnets soumises à un processus de travail.
André du Bouchet
Dans les vrais livres, dans ce qui a pris forme de poème, il y a un travail d’élaboration qui, chaque fois, m’a obligé à sortir du carnet. Il y a un point de cristallisation et de travail sur des mots sortis du carnet qui fait que ce qui est un poème a un commencement et un point final. Lequel constitue généralement une difficulté pour le lecteur Quand on interrompt, on prend congé de ce que l’on a écrit, c’est une rupture, et une rupture appelle un commencement, qui vous engage bien davantage qu’une succession de notes courant indéfiniment. La fin d’un poème vous renvoie en sens inverse au commencement. Pour commencer, comme pour finir, il faut s’engager. Je pense que dans ce qui fait un poème, il y a une difficulté absente d’un livre de notes. Le livre de notes paraît beaucoup plus facile. On prend quelque chose qui est en cours. Peut-être que le lecteur est libéré de la décision qu’il devrait prendre, comme moi-même, au fond, j’ai été libéré de la responsabilité de ce livre, assumée à l’origine par quelqu’un d’autre que moi.
André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein, L’Atelier contemporain / Institut National de l’Audiovisuel, 2016, p. 78.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, entretiens avec alain veinstein, livre, poème, travail | ![]() Facebook |
Facebook |
03/01/2016
Jean Tardieu, Formeries ; Comme ceci comme cela

La fin du poème
C’est la fin du poème. Épaisseur et transparence, lumière et misère — les jeux sont faits.
On avait commencé par la rime pour enfants. On avait cherché des ondes de choc dans d’autres rythmes. On avait gardé le silence, ensuite murmuré : on cherchait à se rapprocher du bruit que fait le cœur quand on s’endort ou du battement des portes quand le vent souffle. On croyait dire et on voulait se taire. Ou faire semblant de rire. On voulait surtout sortir de son corps, se répandre partout, grandir comme une ombre sur la montagne, sans se perdre, sans rien perdre.
Mais on avait compté sans la dispersion souveraine. Comment feindre et même oublier, quand nos débris sont jetés aux bêtes de l’espace, — qui sont, comme chacun sait, plus petites encore que tout ce qu’il est possible de concevoir. Le vertige secoue les miettes après le banquet.
Jean Tardieu, Formeries, Gallimard, 1976, p. 81.
Complainte du verbe être
Je serai je ne serai plus je serai ce caillou
toi tu seras moi je serai je ne serai plus
quand tu ne seras plus tu seras
ce caillou.
Quand tu seras ce caillou c’est déjà
comme si tu étais n’étais plus,
j’aurai perdu tu as perdu j’ai perdu
d’avance. Je suis déjà déjà
cette pierre trouée qui n’entend pas
qui ne voit pas ne bouge plus.
Bientôt hier demain tout de suite
déjà je suis j’étais je serai
cet objet trouvé inerte oublié
sous les décombres ou dans le feu ou dans l’herbe froide
ou dans la flaque d’eau, pierre poreuse
qui simule une murmure ou siffle et qui se tait.
Par l’eau par l’ombre et par le soleil submergé
objet sans yeux sans lèvres noir sur blanc
(l’œil mi-clos pour faire rire
ou une seule dent pour faire peur)
j’étais je serai je suis déjà
la pierre solitaire oubliée l
le mot le seul sans fin toujours le même ressassé.
Jean Tardieu, Comme ceci comme cela, Gallimard, 1979,
p. 45-46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, formeries, comme ceci comme cela, la fin du poème, jeu | ![]() Facebook |
Facebook |
02/01/2016
Cavafy, ''Une nuit'' : trois traductions

Une nuit
C’était une chambre pauvre et de fortune
Reléguée au-dessus d’une taverne louche.
De la fenêtre, on voyait la ruelle
Sordide et étriquée. D’en bas
Montaient les voix d’ouvriers
Jouant aux cartes et s’amusant.
Là, sur le lit banal, sur l’humble lit,
J’ai possédé le corps de l’amour, les lèvres
Sensuelles et roses de l’ivresse,
— Les lèvres roses d’une ivresse telle que
[maintenant encore,
Cependant que j’écris, tant d’années après,
Chez moi, dans l’isolement, l’ivresse me reprend.
Cavafy, Œuvres poétiques, traduction Socrate C. Zervos
et Patricia Portier, Imprimerie nationale, 1991, np.
Une nuit
La chambre était pauvre et commune,
cachée en haut de la taverne louche.
Par la fenêtre, on voyait la ruelle
malpropre et étroite. D’en bas
montaient les voix de quelques ouvriers
qui jouaient aux cartes et s’amusaient.
Et là, sur cette couche humble et vulgaire,
je possédais le corps de l’amour, je possédais
les lèvres voluptueuses et roses de l’ivresse —
roses d’une belle ivresse, que même en ce moment
où, après tant d’années ! j’écris,
dans ma maison solitaire, je m’enivre à nouveau.
- C. P. Cavafy, Poèmes, traduit par Georges Papoutsakis,
Les Belles Lettres, 1977, p. 92.
Une nuit
La chambre était pauvre et vulgaire,
cachée au-dessus de la taverne louche.
Par la fenêtre on voyait la ruelle,
étroite et sale. D’en bas
montaient les voix de quelques ouvriers
qui jouaient aux cartes et s’amusaient.
Et là, dans l’humble lit d’un quartier populaire
j’avais à moi le corps de l’amour, j’avais les lèvres
voluptueuses et roses de l’ivresse —
roses d’une telle ivresse, qu’en cet instant
où j’écris, après tant d’années !
dans mon logis solitaire, l’ivresse revient.
Constantin Cavàfis, Une nuit, traduit par Michel
Volkovitch, Le Cadran ligné, 2012, np.
Tableau de Thalia-Flora Karavia, 1926
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, une nuit, trois traductions, chambre, amour, ivresse | ![]() Facebook |
Facebook |





