28/02/2015
Gérard Macé, Le Manteau de Fortuny : recension

Pour des lecteurs qui ne trouvaient leur bien que dans les bibliothèques, l’arrivée du "Livre de Poche" au début des années 1950 a représenté un moment heureux : on a eu le sentiment que l’on pourrait tout avoir chez soi. Et il est vrai qu’aujourd’hui presque tout (presque...) est disponible ; pour quelques euros, on peut lire les vivants et les morts, Kafka et Faulkner, Quignard et Roubaud. Mais pas encore Prigent ou Beck. Et bien d’autres. Aussi est-ce un vrai plaisir de voir apparaître une nouvelle collection qui propose des auteurs peu représentés en "poche" : le Hongrois Péter Nádas (La Fin d’un roman de famille), le Russe Isaac Babel (Histoire de mon pigeonnier), l’Américain Henry James (avec une nouvelle traduction des Ambassadeurs) et deux écrivains français trop peu lus, Gilles Ortlieb avec Soldats et autres récits, Gérard Macé et Le Manteau de Fortuny — que je retiens.
Gérard Macé, traducteur de Cristina Campo et Thomas de Quincey, préfacier de Nerval et de Jean Tardieu, a notamment publié plusieurs livres dans la collection "Le Chemin" de Gorges Lambrichs, dont Le Manteau de Fortuny en 1987. Parcours dans À la recherche du temps perdu, le livre est suivi dans cette édition d’une étude ("Manteaux et tombeaux") sur l’œuvre de Macé, dans laquelle Jean-Pierre Richard analyse un motif dominant, celui du manteau, « figure originelle d’enveloppement, de contenance ». Comme le rappelle Macé, Mariano Fortuny (1878-1949), admiré de Proust, était installé à Venise ; peintre, scénographe et couturier, ses manteaux et ses robes (que portait Sarah Bernhardt), s’inspiraient notamment de tableaux des peintres Carpaccio et Véronèse. Pour Macé ces vêtements, qui semblaient surgir du temps passé, sont des « parures de ce temps qu’on perd et retrouve à l’intérieur du récit, dont ils ont l’épaisseur apparente et l’irréelle légèreté » ou, pour reprendre Proust, c’étaient des créations « fidèlement antiques mais puissamment originales ». C‘est pourquoi Macé, détachant des détails et opérant des rapprochements, voit une ressemblance entre l’activité de Fortuny et la construction romanesque de Proust, mettant au jour chez les deux artistes des emprunts transposés, de lointaines imitations, la lumière du songe et la perspective en dehors des lois, la nature rehaussée par les couleurs du vitrail, un mélange de caprice et d’architecture, de précision héraldique et d’invention personnelle, mais par-dessus tout cette vue d’ensemble qui permet des rapprochements vertigineux dans l’espace et dans le temps.
Devant le tableau de Carpaccio auquel Fortuny a emprunté arabesques et couleurs d’Orient, la narrateur de la Recherche revoit le manteau d’Albertine, porté sur la toile par un jeune homme. Le lecteur, lui, assemble les multiples allusions à l’Orient, toutes relevées par Macé ; s’en détachent deux personnages féminins qui renvoient à deux espaces et deux temps différents, celui de Shéhérazade et des Mille et une nuits, celui d’Esther et de l’histoire juive. Macé retrace l’épisode concernant Esther et Assuérus, rappelle que les rôles masculins de la pièce de Racine étaient interprétés par des jeunes filles, les pensionnaires de Mme de Maintenon et analyse le rôle qu’elle joue dans le roman. Il montre ensuite la fonction jouée par les Mille et une nuits et l’Orient, « rime intérieure » dans la Recherche. Avec ces deux références, « l’Orient est ainsi partagé entre magie et tradition, entre tapis volant et terre promise ».
Le livre s’achève avec deux chapitre de réflexions sur les souvenirs de Céleste Albaret, « moins superficiels et moins niais qu’on ne l’a dit quelquefois », grâce auxquels on apprend mille détails de la vie quotidienne de Proust et ce qu’elle a vu de près, « comme tout lecteur attentif de la Recherche » le reconstitue, « c’est sa métamorphose en Shéhérazade » et « ce qu’elle pressent quelquefois, c’est la mystérieuse présence du plus invisible des personnages, le Temps ». D’où l’absence de Proust au monde visible, la vie dans le silence toute consacrée aux personnages invisibles, l’entrée progressive dans la mort.
Je n’ai repris que quelques éléments de ce livre, à la fois lecture de la Recherche et lié aux autres ouvrages de Macé qui, comme l’écrit Jean-Pierre Richard, « semble penser [...] qu’on écrit pour réparer un corps cassé, un manteau déchiré, mais à partir du geste de la déchirure même. » On relit sans doute Proust autrement après Le Manteau de Fortuny et, surtout, on continue à lire Macé.
Gérard Macé, Le Manteau de Fortuny, Le bruit du temps, 2014, 120 p., 7 €.
Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 13 février 2015.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dérard macé, le manteau de fortuny, marcel proust, carpaccio, orient | ![]() Facebook |
Facebook |
27/02/2015
Thanassis Hatzopoulos, Cellule

Héritier
Il allume des feux
Qui content des territoire et inhume
En des douleurs révolues les maigres ossements qui subsistent
Files d’ancêtres trépassés
Des hommes à la file, assassinés, solitaires,
D’hommes qui trahissent, hommes
Qui se lavent les mains
Qui mesurent sans parler si vraiment ils mesurent
Pour mettre le feu à des papiers brûlés
Et fondues dans la cendre
Des bagues en or
Pour brûler tout ce qui subsiste
Et que tout ce qui manqua, tout ce qui manque
Manque : déshérité, piteux,
Qu’il s’illumine, buée dans le demi-jour
Et la vérité, le temps mesure dans l’eau
Thanassis Hatzopoulos, Cellule, traduit du grec par Alexandre Zotos et Louis Martinez, Préface de Jean-Yves Masson, Postface de Katérina Kostiou, Cheyne, 2012, p. 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thanassis hatzopoulos, cellule, héritier, ancêtre, jean-yves masson | ![]() Facebook |
Facebook |
Yves di Manno, une, traversée, photographies Anne Calas : recension
La collection "ligatures", proposée par les éditions isabelle sauvage à la fin de l’année 20141, porte magnifiquement son titre avec ce livre, tant le lien semble impossible à rompre entre les photographies d’Anne Calas et les vers d’Yves di Manno. Pourtant, malgré leur proximité, les deux voies ont chacune leur autonomie. Pour le poème, il se partage en quatre ensembles, dont un "envoi", tous consacrés à une femme dans une chambre ; on pourrait lire dans une la figure de l’aimée, l’unique, mais aussi par anagramme, nue ; pour traversée, le mot implique un parcours, ici celui du corps, de son image et de son invention. Pour les photographies, la femme nue est presque toujours présente, mais les six dernières images la sortent de la chambre.
La forme choisie par Yves di Manno se prête à la reprise sans cesse d’esquisses qui, progressivement, construisent un imaginaire de la femme. Chaque séquence, sur une page, compte entre quatre et huit cellules d’un ou deux vers, eux-mêmes entre deux et sept syllabes, et la régularité du compte de certaines séquences (par exemple, 4-4 / 4-3 / 3-3 / 2-4 / 3) donne à l’ensemble son unité. Ce qui apparaît d’emblée, c’est une présence auprès de la femme
elle n’est pas seule dans
l’obscurité du lit
présence qui ne devient un "je" que dans l’avant-dernier vers du poème :
les yeux posés sur moi
sans me voir
La vue (la lumière, l’image, le miroir, le regard, le reflet, etc.) est un motif récurrent. Le regard du "je" est d’un voyeur, attentif à ce que la féminité, la nudité qui s’abandonne évoquent : elles sont opposées à la meute, à la horde, et le "je" devient un nouvel Actéon devant le « chien de la déesse ». La femme est également figure de l’origine, associée à la glaise, à la louve devant la lune, à « la barque qui s’éloigne » ; ici, Vénus qui s’offre, plus loin, dans l’ensemble "corps 9" (que je lis « corps neuf »), « corps émergeant des eaux », elle se métamorphose en ondine, partout, « ôtant du jour la nuit qui la dépouille ». Enfin, l’image de l’oiseau qui semble lui faire don d’un insecte en fait une figure de la Nature et, donc, assure qu’elle renaît sans cesse, à la fois dans la lumière et dans la nuit, corps multiple : elle est toujours autre, « seule et nombreuse » — hiérophanie de la déesse originelle.
"Multiple", elle l’est d’une autre manière dans le second ensemble titré "la série monotype". Devenue image, « son dos pris » dans le cadre, elle appelle pour Yves di Manno le souvenir des nus de Degas, à la toilette ou étendus, elle le fait aussi songer aux figures de Lascaux parce que justement elle est première, origine, et il la voit « matière de nuit »2, encore et toujours nue et couverte d’un voile ou dans la brume. Elle est également corps comme écriture, corps à écrire, « : à la lisère // d’une page / que nul d’ici // là ne lira », et le lit, les draps sont comme une page où se construit un récit ; récit dont le motif est explicite dans une page (62) :
: une nuit simple :
: un corps :
abordant les
terres lointaines
après la
traversée
L’envoi est un envol, une sortie. La femme nue aurait été avant tout motif à variations sur le corps insaisissable, sur l’opacité (de la nuit, de l’ombre) et la transparence (de la vitre, de la buée), prétexte à allusions littéraires et mythologiques : celui qui regarde, apparemment sans être vu, ne sera pas regardé :
les yeux posés sur moi
sans me voir
— nue dès lors devant qui ?
Il faudrait examiner tous les mouvements minuscules qu’opère Yves di Manno dans la langue, qu’il glisse d’une voyelle à l’autre — dans « la suie, la soie des nuits » ou de "sigle" à "sangle"—, qu’il introduise des rimes internes, qu’il déroule les contextes de "lune" ou que la ponctuation mime ce qu’un mot annonce, comme dans le vers : « : reflet : » ; etc. Il ne s’agit pas de détails mais de ce qui contribue à construire l’unité du motif de la femme une, traversée par la langue.
Les photographies donnent à voir la nudité féminine comme on ne la regarde pas. Avec le jeu subtil avec les ombres et la lumière — une chambre aux stores baissés, une lampe de chevet — Ane Calas montre une forme inattendue, le grain de la peau, le mouvement d’un voile qui découvre et masque en même temps. Ici, c’est un visage qui regarde l’objectif, donc le lecteur, là, un tissu qui semble un rideau de théâtre, mais toujours le corps entier ou morcelé émeut d’être si nu devant ce voyeur qu’est l’appareil photographique. Et Anne Calas a imaginé, elle aussi, un envoi à la suite de celui d’Yves di Manno ; d’abord au milieu d’arbres face à l’objectif, le visage dans le flou, cette fois habillée, la femme disparaît dans la forêt.
Une belle réussite : le texte et l’image se répondent harmonieusement sans que l’un illustre l’autre ; on pense, mais dans un genre bien différent, à une autre réussite l’interprétation qu’avait donnée Lucien Clergue de Corps mémorable de Paul Éluard.
Yves di Manno, une, traversée, photographies d’Anne Calas, collection "ligatures", isabelle sauvage, 2014, 24 €.
Cette recension a été publiée dans Sitaudis
1 Voir ici une note à propos de Christiane Veschambre, Versailles Chantiers.
2 Une rencontre ? Le vers « matière de nuit » est aussi le titre d’un recueil de Lionel Ray, où l’on peut lire que l’évidence du soleil est opposée à « la légende oubliée des sources ».
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, une, traversée, photographies d’anne calas, corps, nudité, nuit, mythe | ![]() Facebook |
Facebook |
26/02/2015
Maël Guesdon, Voire

[...]
Se frôlent au goût de ce qui. Marchent ensemble. Les rues nous perdent. Avez-vous déjà écouté ma voix quand je suis loin.
Il serre sous la peau les reliefs dont le récit.
On oubliera le nom. Ne reste que. Nos articulations, ce ne sera plus comme avant, les images filmées le café les images de la mer. Elle répète : les images filmées ou la mer.
Et les autres découvrent.
Qui manque. Suit les contours. Nous nous retrouverons derrière la forme — si. Tu as l’air toutes choses, assieds-toi, cela ne restera pas ainsi, pose un pied, viens.
Lorsqu’il découvre. Qu’il ne voit plus ce que voient ses yeux. S’arrête, dehors là il s’effondre.
Maël Guesdon, Voire, Corti, 2015, p. 22-24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, récit, voix, image, mer | ![]() Facebook |
Facebook |
25/02/2015
Nathalie Quintane, Les poètes et le pognon
Conclusion de : "Les poètes et le pognon", article de Nathalie Quintane publié le 23 février dans Sitaudis.
À lire intégralement !
Parler travail et parler de travail, c'est la chose dégoûtante à laquelle a du mal à se résoudre le « milieu culturel » - donc les poètes qui en font partie. Aussi prend-on bien soin de dire plutôt "activité" ou "passion", quand on parle d'art et de poésie, pour soigneusement les distinguer du travail salarié ou des "interventions" payées au lance-pierre qui, par transfert, permettent de vivre "en poésie". Tant que le travail artistique ne sera pas reconnu et défini comme un chantier ou un laboratoire - au premier degré, littéralement et non métaphoriquement -, tant qu'on lira métaphoriquement Rimbaud (« d'autres horribles travailleurs »), tant qu'on refusera (ou qu'on omettra, par intérêt et non par pudeur) de considérer le travail artistique comme un travail et d'appeler un chat un chat (car je bosse, présentement), tant qu'on le fera, plus ou moins consciemment, pour ne pas être assimilé et confondu avec la plèbe des travailleurs ordinaires, tant qu'on contribuera à faire perdurer la légende de l'artiste moderne en croyant qu'elle nous protège alors qu'elle ne fait que nous exposer davantage à la dureté des temps en nous isolant, et par cet isolement, empêche qu'on envisage de possibles actions communes, des actions qui aillent au-delà du collectif ad hoc ou des associations provisoires qui se sont multipliées ces dernières années (pour [...] compenser l'atomisation du marché de l'art, la fin des galeries, etc), des actions qui ne regroupent pas seulement des artistes ou des intellectuels précaires (mais c'est déjà ça) et iraient à la rencontre des autres travailleurs, nous pourrons dire non seulement que nous avons largement contribué à installer la situation calamiteuse dans laquelle nous sommes, nous, mais qu'en plus nous y avons contribué pour tous les autres en pariant essentiellement sur notre propre tête - "au cas où", "tôt ou tard", comme diraient les économistes, qui sait, ça peut tomber sur moi, je peux enfin réussir en art -, et en validant ainsi le fait que parier sur sa propre tête est le bon modèle, le modèle à suivre.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : natgalie quintane, les poètes et le pognon, travail | ![]() Facebook |
Facebook |
24/02/2015
Agnès Rouzier, À haute voix

À haute voix
À haute voix.
Le lyrisme.
Les anges. Les monstres. Ce qu eles anges de Rilke peuvent avoir de monstrueux. « Car le beau n’est rien d’autre / que le commencement du terrible. »
Ne pas oublier ces moments où je ne peux plus écrire.
Étrange silence.
C’était parler des mots contenus dans la gorge. Le « travail de la mort », le « travail du deuil » sont inclus dans la voix lyrique. Quelque chose qui commence, qui chante, mais qui ne s’inscrit nulle part.
Toute belle voix est, effectivement, pour moi, une voix de silence.
Le lyrisme. Cerner à nouveau le lyrisme, sa manière, cerner le moment où il commence et où la défaite est déjà là, mais triomphe et défaite se mélangent, où triomphe est comme un triomphe du corps, le triomphe d’un instant, le triomphe et la préparation d’une chute. C’est cela qui est important.
Agnès Rouzier, À haute voix, dans Change, "La machine à conter", octobre 1979, p. 71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, À haute voix, change, écrire, silence, lyrisme | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2015
Andrea Zanzotto, Idiome, traduction Philippe Di Meo
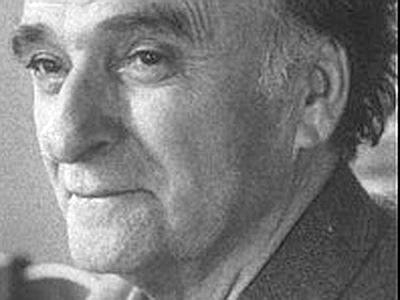
Petits métiers
Comment puis-je oser
vous appeler ici, vous faire signe de la main.
Une main qui n'est plus que son ombre
avare et mesquine,
et d’ailleurs une serre, mais tendre comme de la mie de pain.
Et pourtant, quelque chose maintenant la soutient,
je ne sais s’il s’agit d’une crampe ou d’une force :
pour autant qu’elle vaille, elle est toute vôtre,
vous lui donnez-lui la force de vous appeler.
Donnez-lui une plume qui ne se torde,
faites que sa pointe ne trébuche sur la feuille.
Il me semble n’avoir rien à écrire
pour commencer ce télex
qui doit tout le néant traverser
(la brûlante difficulté
qui brûle comme soufre,
qui corrode, étourdit.)
Mais j’essaierai de suivre la trace, au moins, d’un amour —
en dehors, là dans l’obscurité
profonde des prés du passé.
Ainsi
.....................................
[ ]
Ainsi sous la cheminée presque éteinte,
si un garçonnet regardait
à travers cette minuscule petite fenêtre aveugle
vers le soir encore claire
parmi la suie
(ah quel beau bleu, quel argent,
quels frissons d’hiver éblouissants
de neige et de lumière à cette petite fenêtre) :
qui passait donc, qui frappait
sur cette vitre, et disparaissait
je ne sais si boitant ou dansant ;
grands-mères, était-ce eux tous, les gens de votre temps
avec leur faim de chicorées, avec leur soif
de piquette, avec des travaux qui
leur avaient tordu toute la figure
jusqu’à presque en modifier la nature ?
Mais avec moi, garçonnet, quels joyeux lurons
et que de bonne humeur, et toujours bons...
Et je les vois, me semble-t-il, faire turlututu
cligner de l’œil dans ma direction, rire subtilement, puis me dire salut...
Andrea Zanzotto, Idiome, traduit de l’italien, du dialecte haut-trévisan et présenté par Philippe Di Meo, Corti, 2006, p. 145, 147 et 149.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idiome, traduction philippe di meo, petits métiers, passé, amour, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
22/02/2015
Basho seigneur ermite, l'intégrale des haïkus

« Est-il aveugle ? »
ainsi me voit-on —
Admiration de la lune.
Que mangent ces pauvres gens ?
La petite maison d’automne
à l’ombre d’un saule.
L’odeur de fleur d’orchidée
persistante dans le beau rideau —
Sa chambre privée.
Fin d’automne
je tire sur moi
une étroite couverture.
Impossible amour —
D’une femme contemplant le soir
rêve mélancolique.
Basho seigneur ermite, l’intégrale des haïkus,
édition bilingue de Makotu Kemmoku et
Dominique Chipot, La Table ronde,
2012, p. 369, 370, 371, 372, 383.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : basho seigneur ermite, l'intégrale des haïkus, lune, saule pauvreté, automne, femme, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
21/02/2015
Erri de Luca, Les saintes du scandale

La beauté
[...]
La beauté féminine est un mystère qui tourmente la pensée et les sens. Il est écrit qu’Adam connut Ève / Havvà. Il parvient à la connaître à travers l’expérience physique du contact et de l’étreinte, elle et sa perfection. La réciprocité n’est pas éceite, elle n’a pas besoin de connaître Adam. Lui est extrait d ela poussière, elle de son flanc. Ici, la nature masculine est faite de matière inerte rachetée par le souffle de la divinité. Ève / Havvà provient d’une fabrication ultérieure, d’une deuxième intervention de la divinité. Elle sort du flanc de l’homme endormi, mais non pas toute faite comme la déesse Athéna de la grosse tête de Zeus. Les choses se passent ainsi en réalité :
« Et construisit Yod Elohim le flanc qu’il a pris de l’Adam pour (en faire) une femme » (Bereshit / Genèse, 2, 22). Construire, verbe de l’œuvre qui intervient pour perfectionner la partie retirée à l’homme, pour produire Ève / Havvà. C’est la construction de la beauté. Ici, l’homme est un produit semi-fini par rapport à la femme, le produit fini de la haute chirurgie de la divinité.
Le verbe vaiven, « et il construisit », est un verbe de fabrication et de fils. Il a la même valeur numérique que haim, « vie ». La vie de l’Écriture sainte est une œuvre de construction. La détruire est une démolition.
Erri de Luca, Les saintes du scandale, traduit de l’italien par Danièle Valin, Folio, 2014, [Mercure de France, 2013], p. 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erri de luca, les saintes du scandale, Ève, adam, fabriquer, construire, beauté, divinité | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2015
Samuel Beckett, Bande et Sarabande

Ding-Dong
Mon ci-devant ami Belacqua égaya la dernière phase de son solipsisme — avant de rentrer dans les rangs et de commencer à apprécier le monde — en croyant que ce qu’il avait de mieux à faire était de se déplacer sans cesse d’un endroit à un autre. Il ne savait pas comment il était arrivé à cette conclusion mais ce n’était pas à cause de quelque préférence pour un endroit plutôt qu’un autre, il en était sûr. Il aimait à penser qu’il pouvait fausser compagnie à ce qu’il appelait les Furies, simplement en se mettant en mouvement. Quant aux lieux, ils se valaient tous car tous disparaissaient à peine était-il venu y faire halte. La seule action de se lever et de se mettre en chemin, quelles que fussent la provenance ou la destination, lui faisait du bien. Indéniablement. Il regrettait de ne pas avoir les moyens de se laisser aller à ce penchant comme il l’eût désiré, à grande échelle, sur terre et sur mer. Ça et là sur terre et sur mer ! Il ne pouvait se le permettre car il était pauvre. Pourtant, modestement, il faisait ce qu’il pouvait De l’âtre à la fenêtre, de la chambre d’enfants à la chambre à coucher, voire d’un quartier de la ville à un autre, et retour, il trouvait bien le moyen de les accomplir, ces petits exercices de mobilité, et ils lui faisaient assurément du bien, en règle générale. C’était la vieille rengaine des vertes années, le tourment des trimestres et, durant les intermèdes, un bien-être relatif.
Samuel Beckett, Bande et Sarabande, traduit de l’anglais par Édith Fournier, Les éditions de Minuit, 1994, p. 63-64.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, bande et sarabande, se déplacer, lieu, mouvement, pauvreté, bien-être | ![]() Facebook |
Facebook |
19/02/2015
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Paysage mauvais
Sable de vieux os — le flot râle
Des glas : crevant bruit sur bruit
— Palud pâle, où la lune avale
De gros vers pour passer la nuit.
— Calme de peste, où la fièvre
Cuit... Le follet damné languit
— Herbe puante où le lièvre
Est un sorcier poltron qui fuit...
— La lavandière blanche étale
Des trépassés le linge sale,
Au soleil des loups... — Les crapauds
Petits chantres mélancoliques
Empoisonnent de leurs coliques,
Les champignons, leurs escabeaux.
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans
Charles Cros, T. C., Œuvres complètes, édition
Louis Forestier et Pierre-Olivier Walzer,
Pléiade / Gallimard, 1970, p. 794.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, paysage mauvais, nuit, crapaud, mélancolie | ![]() Facebook |
Facebook |
18/02/2015
Yves di Manno, une, traversée, photographies d'Anne Calas ; recension
La collection "ligatures", proposée par les éditions isabelle sauvage à la fin de l’année 2014, porte magnifiquement son titre avec ce livre, tant le lien semble impossible à rompre entre les photographies d’Anne Calas et les vers d’Yves di Manno. Pourtant, malgré leur proximité, les deux voies ont chacune leur autonomie. Pour le poème, il se partage en quatre ensembles, dont un "envoi", tous consacrés à une femme dans une chambre ; on pourrait lire dans une la figure de l’aimée, l’unique, mais aussi par anagramme, nue ; pour traversée, le mot implique un parcours, ici celui du corps, de son image et de son invention. Pour les photographies, la femme nue est presque toujours présente, mais les six dernières images la sortent de la chambre.
La forme choisie par Yves di Manno se prête à la reprise sans cesse d’esquisses qui, progressivement, construisent un imaginaire de la femme. Chaque séquence, sur une page, compte entre quatre et huit cellules d’un ou deux vers, eux-mêmes entre deux et sept syllabes, et la régularité du compte de certaines séquences (par exemple, 4-4 / 4-3 / 3-3 / 2-4 / 3) donne à l’ensemble son unité. Ce qui apparaît d’emblée, c’est une présence auprès de la femme
elle n’est pas seule dans
l’obscurité du lit
présence qui ne devient un "je" que dans l’avant-dernier vers du poème :
les yeux posés sur moi
sans me voir
La vue (la lumière, l’image, le miroir, le regard, le reflet, etc.) est un motif récurrent. Le regard du "je" est d’un voyeur, attentif à ce que la féminité, la nudité qui s’abandonne évoquent : elles sont opposées à la meute, à la horde, et le "je" devient un nouvel Actéon devant le « chien de la déesse ». La femme est également figure de l’origine, associée à la glaise, à la louve devant la lune, à « la barque qui s’éloigne » ; ici, Vénus qui s’offre, plus loin, dans l’ensemble "corps 9" (que je lis « corps neuf »), « corps émergeant des eaux », elle se métamorphose en ondine, partout, « ôtant du jour la nuit qui la dépouille ». Enfin, l’image de l’oiseau qui semble lui faire don d’un insecte en fait une figure de la Nature et, donc, assure qu’elle renaît sans cesse, à la fois dans la lumière et dans la nuit, corps multiple : elle est toujours autre, « seule et nombreuse » — hiérophanie de la déesse originelle.
"Multiple", elle l’est d’une autre manière dans le second ensemble titré "la série monotype". Devenue image, « son dos pris » dans le cadre, elle appelle pour Yves di Manno le souvenir des nus de Degas, à la toilette ou étendus, elle le fait aussi songer aux figures de Lascaux parce que justement elle est première, origine, et il la voit « matière de nuit »(1), encore et toujours nue et couverte d’un voile ou dans la brume. Elle est également corps comme écriture, corps à écrire, « : à la lisère // d’une page / que nul d’ici // là ne lira », et le lit, les draps sont comme une page où se construit un récit ; récit dont le motif est explicite dans une page (62) :
: une nuit simple :
: un corps :
abordant les
terres lointaines
après la
traversée
L’envoi est un envol, une sortie. La femme nue aurait été avant tout motif à variations sur le corps insaisissable, sur l’opacité (de la nuit, de l’ombre) et la transparence (de la vitre, de la buée), prétexte à allusions littéraires et mythologiques : celui qui regarde, apparemment sans être vu, ne sera pas regardé :
les yeux posés sur moi
sans me voir
— nue dès lors devant qui ?
Il faudrait examiner tous les mouvements minuscules qu’opère Yves di Manno dans la langue, qu’il glisse d’une voyelle à l’autre — dans « la suie, la soie des nuits » ou de "sigle" à "sangle"—, qu’il introduise des rimes internes, qu’il déroule les contextes de "lune" ou que la ponctuation mime ce qu’un mot annonce, comme dans le vers : « : reflet : » ; etc. Il ne s’agit pas de détails mais de ce qui contribue à construire l’unité du motif de la femme une, traversée par la langue.
Les photographies donnent à voir la nudité féminine comme on ne la regarde pas. Avec le jeu subtil avec les ombres et la lumière — une chambre aux stores baissés, une lampe de chevet — Ane Calas montre une forme inattendue, le grain de la peau, le mouvement d’un voile qui découvre et masque en même temps. Ici, c’est un visage qui regarde l’objectif, donc le lecteur, là, un tissu qui semble un rideau de théâtre, mais toujours le corps entier ou morcelé émeut d’être si nu devant ce voyeur qu’est l’appareil photographique. Et Anne Calas a imaginé, elle aussi, un envoi à la suite de celui d’Yves di Manno ; d’abord au milieu d’arbres face à l’objectif, le visage dans le flou, cette fois habillée, la femme disparaît dans la forêt.
Une belle réussite : le texte et l’image se répondent harmonieusement sans que l’un illustre l’autre ; on pense, mais dans un genre bien différent, à une autre réussite l’interprétation qu’avait donnée Lucien Clergue de Corps mémorable de Paul Éluard.
Yves di Manno, une, traversée, photographies d’Anne Calas, collection "ligatures", isabelle sauvage, 2014, 24 €.
Cette recension a été publiée par Sitaudis le 9 février 2015.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, une, traversée, photographies d'annes calas, femme, nudité, image | ![]() Facebook |
Facebook |
17/02/2015
Christian Prigent, Entretien sur Arno Schmidt

Arno Schmidt
– À vos yeux, la littérature française offre-t-elle des œuvres qui font au français ce qu'Arno Schmidt fit à l'allemand ?
Ch. P.
— Il me semble que dans la littérature française du siècle dernier, les écrivains qui ont « fait » quelque chose à la langue œuvraient plutôt dans le genre poésie et les « grandes irrégularités de langage » initiées par la « révolution poétique » des années 70 du siècle précédent (Lautréamont, Mallarmé, Rimbaud, Jarry...). Même si, souvent, ce fut pour mettre en cause (voire pour récuser) l’idéologie poétique elle-même (Artaud, Bataille, Ponge, Denis Roche...). Ou pour détourner l’outillage poétique (rythmique, ritournelle, écholalie, polyphonie..) et le faire travailler dans la prose narrative (Beckett, Guyotat) ou le drame (Novarina). Côté roman, au sens à peu près strict du label, je ne vois vraiment rien qui ait eu la rigueur refondatrice qui anime le réalisme analytique de la prose schmidtienne (trouver, comme il le dit lui-même, « une structure de prose plus conforme aux modes de l’expérience humaine », faire de l’écriture un acte de « description et d’éclaircissement du monde par le mot »).
Bien sûr Proust (mais la langue de Proust, en gros, est classique). Bien sûr Céline (mais le « métro émotif » relève d’un lyrisme qui n’a rien à voir avec le raide grincement sablonneux de la prose de Schmidt). Dans les années Schmidt (vers 1952/1960, donc), la prose française moderne, c’est le « nouveau roman ». Rien, à mon sens, qui y soit au niveau de l’exigence méthodique et de l’inventivité stylistique qu’on apprécie chez Arno Schmidt.
X :
– Robbe-Grillet ?
Ch. P.
– Je l'ai à peine lu, et fort tard (trop tard pour que cette lecture ait compté). Autour de moi, dans les années 1970/1980, cette œuvre ne jouait aucun rôle. J'en avais pris connaissance surtout à cause de sa polémique contre Francis Ponge (qui était pour moi un modèle théorique et pratique), dans Pour un nouveau roman. Plus tard (1989), j'ai passé quelques très charmantes heures avec Robbe-Grillet, à Berlin. C'était gai, fort peu « littéraire ». J'aimais sa causticité provocante et sa façon de distiller distraitement des vacheries. Ça ne m'a pas fait aimer beaucoup plus ses livres (surtout ceux qu'il publiait à l'époque).
J'ai davantage lu Claude Simon. Et dit dans Ceux qui merdRent (1993) ce que j'avais à en dire.
X
– Voyez-vous quand même quelques auteurs qu'on pourrait, sans brader l'épithète, qualifier de « schmidtiens » ?
Ch. P.
– Vraiment, je doute que Schmidt ait été beaucoup lu par les écrivains français. Et je ne crois pas qu’il ait eu une influence. Sur les textes de ceux qui écrivent aujourd’hui un peu différemment de ce qu’attend la commande médiatique et marchande, on voit assez bien les marques (souvent délavées) de Beckett et de Duras ; le souvenir aussi de Gertrude Stein, de Thomas Bernhard. Mais Arno Schmidt... Non, vraiment. Peut-être faudrait-il aller voir du côté de ce prosateur extraordinaire qu'est Onuma Nemon (qui a lu Schmidt). Le seul, à ma connaissance, qui serait effectivement « schmidtien » (mais je ne sais pas s'il a lu Arno Schmidt), c’est le très remarquable Hubert Lucot – dont la prose narrative poursuit effectivement un effort semblable d’élucidation de l’expérience (le souvenir) et d’invention de formes (lexicales, syntaxiques, typographiques...) adéquates à cet effort. Mais Lucot est plus... français: plus stylistiquement maniériste, plus psychologique, plus obsédé par le nombril autobiographique, et (aujourd’hui, en tous cas) plus politiquement déclaratif.1Ou: «formes de prose exactement adaptées aux différents mécanismes de la conscience et modes d’expérience » (in Calculs, 1, 1955)
.
X
– Qu'est-ce, selon vous, qu'une influence littéraire, et comment définiriez-vous celle qu'Arno Schmidt a pu exercer sur vous ?
Ch. P.
– Une influence littéraire s’exerce dans le temps de formation d’un mode d’expression propre. Une œuvre propose soudain, de l’expérience (du « réel »), des modes de symbolisation qui viennent, comme dit Rimbaud, « affiner » votre « optique », outiller votre vision et formaliser l’expérience d’une façon qui paraît. Alors on s’applique à comprendre ses procédures, à apprendre ses façons et à user de ses outils. Mais bientôt, voici que ces formes de représentation-là deviennent à leur tour impertinentes, inadéquates – et qu’elles sont perçues comme un nouvel écran entre le monde et vous. Il faut donc leur donner congé, pour traverser autre chose. Ce pourquoi l’amour des Maîtres est toujours un amour ambivalent : il faut tuer les Maîtres, aussi – pour trouver sa voix. J’ai connu cela avec Rimbaud et les poètes surréalistes (dans les années 1960), puis avec Ponge (années 1970), puis avec Denis Roche (idem). Rien ni personne depuis. Arno Schmidt est entré bien trop tard dans ma bibliothèque pour avoir eu sur moi la moindre « influence ». Je ne l’ai lu pour la première fois que vers 1992, alerté par Pascale Casanova, schmidtienne enthousiaste, qui trouvait quelque rapport entre les écrits de Schmidt et ce que je venais de publier côté fiction (Commencement, 1989) et côté théorie (Ceux qui merdRent, 1991). C’était trop tard pour intégrer cette marque nouvelle : les questions qui me travaillaient, les formes dont j’avais besoin pour traiter ces questions, c’était déjà en place. Mais ce que je lisais dans Calculs, par exemple, me semblait effectivement très proche des préoccupations stylistiques qui étaient les miennes dans mes livres de prose.
X
– Quelle est votre pratique de ses textes ? (sauts et gambades ? linéaire ? plusieurs livres simultanés ?)
Ch. P.
– Encore une fois : découverte très tardive, pratique très sporadique, connaissance très lacunaire. J’ai été enthousiasmé par quelques textes, comme le Paysage lacustre avec Pocahontas. Et été, comme j’ai dit, très intéressé par les écrits théoriques (Calculs). Mais je n’ai rien creusé, ni complété (je le regrette bien, croyez-le). Sans doute parce que trop pris, dans les années où cela aurait été utile et possible (entre 1992 et aujourd’hui), par le travail sur mes propres livres, d’une part ; et, d’autre part, par mon attention à ce qui apparaissait d’un peu neuf en France dans le domaine poétique.
13 septembre 2009, inédit (Pour un volume collectif sur l'œuvre d'Arno Schmidt).
Christian Prigent, dans SILO, sur le site des éditions P. O. L
Les œuvres d'Arno Schmidt (1914-1979) ont été traduites en français chez Christian Bourgois et aux éditions Tristram.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ENTRETIENS, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, entretien sur arno schmidt, roman, écriture, influence | ![]() Facebook |
Facebook |
16/02/2015
Oscar Wilde, Poèmes en prose, traduction Bernard Delvaille

Le Maître
Lorsque l’obscurité se fut étendue sur la terre, Joseph d’Arimathie, ayant allumé une torche de bois de pin, descendit de la colline dans la vallée. Car il avait affaire dans sa maison.
Agenouillé sur le silex de la vallée de la Désolation, il vit un jeune homme qui était nu et qui pleurait. Sa chevelure avait la couleur du miel et son corps était comme une fleur blanche, mais il avait meurtri son corps avec des épines et sur ses cheveux il avait mis des cendres comme une couronne.
Celui qui avait de grands biens dit au jeune homme qui était nu et qui pleurait :
« Je ne m’étonne pas que ta douleur soit si grande, car sûrement Celui-là était un homme juste. »
Le jeune homme répondit :
« Ce n’est pas sur lui que je pleure, mais sur moi-même. Moi aussi j’ai changé l’eau en vin et j’ai guéri les lépreux et donné la vue aux aveugles. J’ai marché sur les eaux, et de ceux qui habitent dans les tombeaux j’ai chassé les démons. J’ai nourri les affamés dans le désert où il n’y avait aucun aliment, et j’ai fait lever les morts de leurs demeures étroites, et à ma voix, et devant une grande multitude de peuple, un figuier stérile s’est desséché. Toutes ces choses que cet homme a faites, je les ai faites aussi. Et cependant ils ne m’ont pas crucifié. »
Oscar Wilde, Poèmes en proses, traduction Bernard Delvaille, dans Œuvres, sous la direction de Jean Gattégno, Pléiade / Gallimard, 1996, p. 56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oscar wilde, poèmes en prose, traduction bernard delvaille, le maître, crucifier, nudité, cendre | ![]() Facebook |
Facebook |
15/02/2015
Emily Dickinson, Le Paradis est au choix, traduction Patrick Reumaux

Il n’y a pas de Silence sous terre — aussi silencieux
À endurer
Le formuler découragerait la Nature
Et hanterait le Monde.
*
Qui était-ce sinon Moi qui gagnait la Hauteur —
Qui étaient-ce sinon Eux, qui échouaient !
Mourir a maints tours dans son sac
S’ils pouvaient vivre, ils le feraient !
*
Les collines en syllabes Pourpres
Racontent les Aventures du Jour
À de petites bandes de Continents
Qui regagnent leurs Pénates après l’École.
*
Mourir — sans le Mort
Vivre — sans la Vie
Telle est la pilule Miracle
Qu’on veut nous faire avaler.
Emily Dickinson, Le Paradis est au choix, traduit et
présenté par Patrick Reumaux, Librairie Élisabeth
Brunet, 1998, p. 347.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, le paradis est au choix, patrick reumaux, sielnce, nature, école, mourir, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |





