01/05/2012
Montéhus, L'impôt sur les feignants (chanson, 1930)

L’impôt sur les feignants
Que l’on impose les très grandes richesses,
Ceux qui possèdent des châteaux, des palais,
Ceux dont la vie n’est faite que d’allégresse
Sans nul souci, ne travaillant jamais,
Que l’on impose les archi-millionnaires
Mais qu’ désormais on laisse à l’ouvrier
Intégralement l’argent de son salaire
Pour qu’il n’y ait plus d’ misère à son foyer.
Au lieu d’imposer l’ travailleur
Qui gagne le pain de ses enfants
Imposez plutôt les noceurs
Qui gaspillent tant d’argent.
Refrain :
Oh, oui ! La loi qu’il fallait faire
J’ vous l’ dis, messieurs du Parlement
C’est pas l’impôt sur les salaires
Mais c’est l’impôt sur les feignants
Vous qui voulez qu’on repeuple la France
N’écrasez pas par de nouveaux impôts
Le travailleur, car alors sa conscience
Se révolterait contre tous ses bourreaux.
Ce que le père peut gagner à l’usine
Ça, c’est sacré ! Messieurs, n’y touchez pas !
Oui, votre impôt, c’est l’impôt d’ la famine
Et cette loi, Marianne, fiche-la en bas
Au lieu d’imposer l’ travailleur
Qui enrichit l’ gouvernement
Imposez plutôt les noceurs
Et qu’ils paient pour les pauvres gens
Gaston Mardochée Brunschwick, dit Montéhus (1872-1952)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montéhus, l'impôt sur les feignants | ![]() Facebook |
Facebook |
30/04/2012
Walt Whitman, dans Pierre Leyris, Esquisse d'une anthologie...

J'ai traversé un jour une ville populeuse...
J'ai traversé un jour une ville populeuse, gravant dans mon cerveau pour m'en servir un jour ses spectacles, son architecture, ses coutumes, ses traditions,
Or à présent de toute cette ville je ne me rappelle qu'une femme rencontrée là par hasard qui m'a retenu pour l'amour de moi.
Jour après jour, nuit après nuit nous restâmes ensemble, tout le reste je l'ai oublié depuis longtemps.
Je ne me rappelle, dis-je, que cette femme qui s'attacha à moi avec passion.
Et voici de nouveau que nous nous promenons, qu'à nouveau nous nous aimons, qu'à nouveau nous nous séparons,
À nouveau elle me tient la main : il ne faut pas que je parte,
Je la vois tout contre moi, lèvres muettes, triste et tremblante.
Once I pass'd through a populous city —
Once I pass'd through a populous city imprinting my brain for future use with its shows, architecture, customs, traditions,
Yet now of all that city I remember only a woman I casually met there who detain'd me for love of me,
Day by day and night by night we were together — all else has long been forgotten by me,
I remember I say only that woman who passionately clung to me,
Again wa wander, we love, we separate again,
Again she holds me by the band, I must not go,
I see her close beside me with silent lips sad and tremulous.
Pierre Leyris, Esquisse d'une anthologie de la poésie américaine du XIXe siècle, édition bilingue, Gallimard, 1995, p. 149 et 148.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walt whitman, pierre leyris, poésie américaine, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
29/04/2012
Jacques Roubaud, La forme d'une ville change plus vite, hélas....
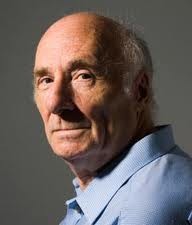
Dans cette ville que tu n'aimais pas
Dans cette ville que tu n'aimais pas
Où tu as passé tant de jours
Que les compter te fait vomir
Peur de ce que tu ne reconnais pas !
Peur de tout ce que tu as vu !
Croisant et recroisant les rues
Manières de neiges manières de boues
Manières de mutisme têtes de loup
Dans cette ville que tu n'aimais pas
Dont tu n'as jamais su te déruer
À cause de tout ce que tu ne sais pas
Travaillé de syllabes tous ces étés
Hébété de ces morts qui te sont morts là
Dans cette ville que tu n'aimais pas
Jacques Roubaud, La forme d'une ville change plus
vite, hélas, que le cœur des humains, 150 poèmes, 1991-1998,
Poésie /Gallimard, 2006 [1999], p. 102.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacque roubaud, la forme d'une ville... | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2012
Alain Veinstein, Scène tournante

À haute voix mon nom
impossible de le prononcer
Je me cache pour ne pas me faire prendre
J'ai l'impression que ses lettres vont être écartées
afin que son secret en soit extirpé
et jeté en pâture aux chiens,
sans aucune pitié.
Quelques lettres ici, tournent à la haine.
Chaque fois, aujourd'hui,
que je décline mon identité,
j'entends et aboiements
et voient des projecteurs lancer leurs poursuites
du haut de formes indistinctes
que je prends pour des miradors.
Alain Veinstein, Scène tournante, "Fictions et & Cie",
Seuil, 2012, p. 39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain vainstein, scène tournante, nom, identité | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2012
Hilda Doolittle, Le jardin près de la mer

Nuit
La nuit a séparé
l'un de l'autre
et recroquevillé les pétales
sur le dos de la tige
et dessous, en rangs crépus ;
dessous, sans défaillir,
dessous, jusqu'à ce que les peaux se fendent,
et sur le dos de la tige, jusqu'à ce que chaque feuille
s'en détache à force de pencher ;
dessous, avec sévérité,
dessous, jusqu'à ce que les feuilles
soient recourbées,
jusqu'à ce qu'elles tombent sur le sol,
courbées jusqu'à ce qu'elles soient brisées.
O nuit,
tu prends les pétales
des roses dans ta main,
mais tu laisses le cœur nu
de la rose
périr sur la branche.
Night
The night has cut
each from each
and curled the petals
back from the stalk
and under it in crisp rows ;
under at an unfaltering pace,
under till the rinds break,
back till each bent leaf
is parted from its stalk ;
under at a grave pace,
under till the leaves
are bent back
till they drop upon the earth,
back till they are all broken.
O night,
you take the petals
ot the roses in your hand,
but leave the stark core
of the rose
to perish on the branch.
H[ilda] D[oolittle], Le jardin près de la mer, traduit
de l'anglais et présenté par Jean-Paul Auxeméry,
Orphée / La Différence, 1992, p. 99 et 98.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ilda doolittle, le jardin près de la mer, la rose, la nuit, jean-paul auxeméry | ![]() Facebook |
Facebook |
26/04/2012
Paul Louis Rossi, Les Variations légendaires

L'Aile du scarabée
[...]
Il nous semble que le discours poétique s'est amenuisé à mesure qu'il poursuivait son élan, jusqu'à devenir ce flot de peu d'importance, rendu comme toute chose périssable, renouvelable à loisir, aussi précaire que les objets, les passions, espérances et désespérances qui agitent le monde et l'entourent d'un filet serré d'illusions et de convenances. Alors que notre civilisation doit affronter le nouveau millénaire, un quelconque Bulgare de Bulgarie, dans un cabaret de Sofia, peut énoncer cette phrase désolante : « Nous n'avons plus besoin de symboles. » Nous pouvons légitimement nous demander ce qu'en penserait Candide et même Pangloss.
D'ailleurs, à mon sens, la question n'est pas de savoir si nous devons céder à l'hédonisme contemporain, à l'indifférence des individus et des sexes, à l'espoir d'une communication généralisée et sans objet. Nous savons que les avant-gardes, autrefois, ont soutenu les totalitarismes, par besoin, par innocence souvent, cela exigeait alors une sorte de courage. L'avant-garde aujourd'hui ne soutient plus personne, elle suit aveuglément cette voie incontrôlée du progrès machinal.
Elle en reproduit les tares, les manipulations et les errements, elle donne sans discernement la main aux forces qui contribuent à la destruction du monde. Il s'agit pour nous seulement de savoir si cet ordre du monde nous convient. Il n'est pas question de sacraliser l'art ou de le désacraliser, il s'agit de savoir si le monde sans le sacré — privé de ses dieux innombrables — est plus enviable et vivable que le monde qui possède des espérances et des symboles et qui se préoccupe encore des possibles de son futur.
(1999)
[...]
Paul Louis Rossi, Les Variations légendaires, chroniques, Poésie / Flammarion, 2012, p. 17-18.
© Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, les variations légendaire, avant-garde | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2012
Place de la Sorbonne, revue annuelle, n° 2, mars 2012

On ne dit rien de remarquable quand on insiste sur le rôle essentiel des revues, quel que soit leur tirage (souvent modeste) et leur fréquence, pour la diffusion de la poésie : à côté d'auteurs bien connus, qui attirent l'acheteur, bien des auteurs nouveaux trouvent là un support indispensable. Leur diversité reflète la variété du paysage poétique en France, qu'elles soient pour l'essentiel consacrées à la poésie — Action poétique, Dans la lune, N4728, Nu(e), Rehauts, Triages, etc. — ou accordent une part plus ou moins importantes à d'autres formes de littérature, aux arts et à la lecture des œuvres — Conférence, L'Étrangère, Europe, Friches, Fusées, Il Particolare, Thauma, etc.1 Il faudrait ajouter la riche floraison de sites et blogs qui, sans les remplacer, complètent le rôle des revues papier.
En tout cas, l'arrivée d'une nouvelle revue ne peut que réjouir. Le second numéro de Place de la Sorbone, qui a pour sous-titre "Revue internationale de poésie de Paris Sorbonne", a vu le jour en mars. Son rédacteur en chef, Laurent Fourcaut, poète, est aussi un universitaire fin connaisseur de la poésie contemporaine, à laquelle une large pace est donnée (le 1/3 de la livraison), avec des poètes reconnus — de Marie-Claire Bancquart, Charles Dobzynsky à Jean-Pierre Verheggen —, d'autres beaucoup moins. Une large place est réservée à la poésie d'autres langues : Erich Fried pour l'allemand, Diane Glacy pour l'anglais des États-Unis, Rachel pour l'hébreu, David Rosenman-Taub pour l'espagnol du Chili ; les traductions, de qualité, sont toujours précédées du texte original, ce que ne font guère la plupart des revues.
Plusieurs rubriques prolongent ces deux ensembles. Dans cette livraison, Michel Collot, dont on connaît les travaux sur la poésie, donne des pistes pour s'y retrouver dans "le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" ; d'une manière fort différente, Lionel Ray éclaire lui aussi dans un entretien la situation de la poésie vivante, tout comme le font les réflexions sur la question du sens de Jean-Claude Pinson.
Il faut ajouter "Contrepoins" avec les picto-clichés de Roxane Maurer et leur lecture, "Vis-à-vis" où un poème (de Claude Ber) est commenté, et des notes de lecture qui ne privilégient pas des ouvrages récents mais s'apparentent, un peu trop, plus à de mini monographies qu'à des notes. La revue (372 pages) est éditée sur un beau papier, avec une mise en pages aérée, une typographie bien lisible, et son prix (15 €) est modique. Longue vie à cette Place de la Sorbonne !
Place de la Sorbonne, n° 2, revue annuelle, éditions du Relief, 15 €.
Cet article a paru dans Les carnets d'eucharis début avril 2012.
Conclusion de Michel Collot, "Le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" (p. 20-21)
(...) le paysage, qui appartient à une longue tradition, n'est pas pour autant un thème passéiste ou nostalgique : il participe pleinement de l'actualité littéraire, artistique et intellectuelle en France et dans beaucoup d'autres pays, où les questions d'environnement sont devenues un enjeu majeur, à la fois social et culturel. Dans le champ poétique, sa résurgence répond au besoin de dépasser la clôture du texte et de la subjectivité pour ouvrir le poème au monde, car le paysage le plus familier comporte un horizon par lequel il s'ouvre sur l'ailleurs, et il est déjà en lui-même une image du monde.
Renouer ainsi avec le monde, c'est peut-être aussi un moyen pour les poètes de retrouver le contact avec un public plus large. Après les stratégies de rupture ou de repli qui ont caractérisé les dernières décennies du XXe siècle, beaucoup ont ressenti le besoin de restaurer la communication poétique avec le monde et avec le lecteur en mettant en œuvre ce que j'appellerai avec Édouard Glissant une « poétique de la relation ».
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : place de la sorbonne, revue, laurent fourcaut, michel collot, erich fried, rachel | ![]() Facebook |
Facebook |
24/04/2012
Sylvia Plath, Arbres d'hiver, précédé de La Traversée

Appréhensions
Il y a ce mur blanc, au-dessus duquel le ciel se crée —
Infini, vert, totalement intouchable.
Les anges y nagent, et les étoiles, dans l'indifférence aussi.
Ils sont mon milieu.
Le soleil se dissout sur ce mur, il saigne ses lumières.
Un mur gris maintenant, griffé, ensanglanté.
N'y a-t-il aucune issue hors de l'esprit ?
Dans mon dos des marches descendent en spirale au fond d'un puits;
Il n'y a pas d'arbres ni d'oiseaux en ce monde,
Il n'y a qu'une aigreur.
Ce mur rouge se crispe continuellement :
Un poing rouge qui s'ouvre et se ferme,
Deux sacs gris, parcheminés —
C'est de cela que je suis faite, cela et une terreur
D'être emportée dans un lit roulant sous des croix et une plume
de pietà.
Sur un mur noir, des oiseaux non identifiables
Font pivoter leur tête et crient.
Il n'est pas question d'immortalité parmi ceux-là !
Un vide glacé vient à notre rencontre :
Il nous rejoindra vite.
There is this white hall, above which the sky creates itself —
Infinite, green, utterly untouchable.
Angels swim in it, and the stars, in indifference also.
There are my medium.
The sun dissolves on this wall, bleeding its lights.
A grey wall now, clawed and bloody.
Is there no way out of the mind ?
Steps at my back spiral into a well.
There are no trée orbirds in this world
There is only a sourness.
This red wall winces continually :
A red fist, opening and closing,
Two grey, papery bags —
This what I am made of, this and a terror
Of being wheeld off under crsses and a rain of pietas.
On a black wall, unindentifiable birds
Swivel their heads and cry.
There is no talk of immortality among them !
Cold blanks approach us :
They move in a hurry.
Sylvia Plath, Arbres d'hiver, traduit par Françoise Morvan, précédé de La Traversée, traduit par Valérie Rouzeau, présentation de Sylvie Doizelet, édition bilingue, Poésie / Gallimard, 1999, p. 147 et 149, 146 et 148.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, arbres d'hiver, la traversée, françoise morvan, valérie rouzeau | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2012
Jean-Luc Parant, Dix chants pour tourner en rond

Le chant du jour et de la nuit
Et s'il fait jour sur chacun de nous
C'est parce que nous nous sommes détachés les uns des autres
C'est parce que nous nous sommes éloignés de tout ce qui nous entoure
et que nous avons été expulsés de notre nuit
et nous sommes chacun l'infime éclat
l'infime éclat de l'explosion d'une immense nuit
et nous brillons
et depuis nous brillons dans le soleil
Et il y a ces vides entre nos images
ces vides qui sont les cassures de notre nuit
ces vides qui sont les cassures de notre nuit
les brisures de notre amour
les brisures de notre amour
et il y a cette lumière entre nous qui nous sépare
qui nous décolle les uns des autres
ce jour qui nous a laissés seuls sur la terre
ce jour qui nous a laissés seuls sur la terre
Et les rayons du soleil sont les fêlures qui ont ébranlé notre nuit
nous nous sommes aimés mais le feu a tout brûlé
nous sommes nés par cette blessure dans le ciel tout bleu :
le soleil recouvrit tout
les étoiles disparurent
l'infini n'exista plus
la lumière fut le sang qui nous fit naître
la lumière fut le sang qui nous fit naître
[...]
Jean-Luc Parant, Dix chants pour tourner en rond, éditions
de la Différence, 1994, p. 35-36.
© Photo Jacqueline Salmon.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc parant, dix chant pour tourner en rond, nuit, jour, soleil | ![]() Facebook |
Facebook |
22/04/2012
Georges Didi-Huberman, Écorces
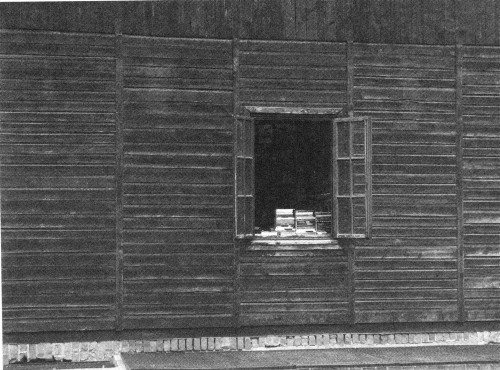
Ce baraquement du camp d’Auschwitz a été transformé en stand commercial : il vend des guides, des cassettes, livres de témoignage, des ouvrages pédagogiques sur le système concentrationnaire nazi. Il vend même une bande dessinée très vulgaire, qui semble raconter les amours d’une prisonnière et d’un gardien du camp. Il est donc un peu tôt pour se réjouir complètement. Auschwitz comme Lager, ce lieu de barbarie, a sans doute été transformé en lieu de culture, Auschwitz comme « musée d’État », et c’est tant mieux. Toute la question est de savoir de quel genre de culture ce lieu de barbarie est devenu le site exemplaire.
Il semble qu’il n’y ait aucune commune mesure entre une lutte pour la vie, pour la survie, dans le contexte d’un « lieu de barbarie » comme le fut Auschwitz en tant que camp, et un débat sur les formes culturelles de la survivance, dans le contexte d’un « lieu de culture » comme l’est aujourd’hui Auschwitz en tant que musée d’État. Il y a pourtant bien une commune mesure. C’est que le lieu de barbarie a été rendu possible — puisqu’il fut pensé, organisé, soutenu par l’énergie physique et spirituelle de tous ceux qui y travaillèrent à nier la vie de millions de personnes — par une certaine culture, une culture anthropologique et philosophique (la race, par exemple), une culture politique (le nationalisme, par exemple), voire une culture esthétique (ce qui fit dire, par exemple, qu’un art pouvait être « aryen » et qu’un autre était « dégénéré ». La culture, ce n’est donc pas la cerise sur le gâteau de l’histoire : c’est encore et toujours un lieu de conflits où l’histoire même prend forme et visibilité au cœur même des décisions et des actes, aussi « barbares » ou « primitifs » soient-ils.
Georges Didi-Huberman, Écorces, éditions de Minuit, 2012, p. 19-20.
© Photo Georges Didi-Huberman, p. 19.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, Écorces, auschwitz, culture, barbarie | ![]() Facebook |
Facebook |
21/04/2012
Jacques Dupin, Gravir

La soif
J'appelle l'éboulement
(Dans sa clarté tu es nue)
Et la dislocation du livre
Parmi l'arrachement des pierres
Je dors pour que le sang qui manque à ton supplice,
Lutte avec les aromes, les genêts, le torrent
De ma montagne ennemie.
Je marche interminablement.
Je marche pour altérer quelque chose de pur,
Cet oiseau aveugle à mon poing
Ou ce trop clair visage entrevu
À distance d'un jet de pierres.
J'écris pour enfouir mon or,
Pour fermer tes yeux.
Jacques Dupin, Gravir, Gallimard, 1963, p. 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, gravir, la soif | ![]() Facebook |
Facebook |
20/04/2012
Les montagnes, les rizières et la mer, Dodoïstu (traduction Alain Kerven)

Que les grenouilles
Coassent dans l'eau
Et se lèvent dans ma mémoire
Les jours anciens
Il fait nuit noire et pourtant
Si vous venez en cachette
L'odeur du bois d'aloès
Vous servira de guide
Libérant leurs gosiers
D'un mutuel assaut
Des oiseaux par milliers
Sur la route des îles
Les oiseaux à tue-tête
Et le soir peu à peu
Les cloches se répondent
D'un monastère à l'autre
La septième heure déclinant
À l'aube je sarcle la rizière
Est-ce la rosée des champs
Ou des larmes de fatigue ?
Les soirs où tombe la neige
Les soirs où l'on moud le thé
Si vous vous souvenez de moi
Oh, venez !
Les Montagnes, les rizières et la mer, 64 Dodoïstu,
préface, traduction, dessins de Alain Kerven,
éditions Calligrammes, 1984, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain kerven, dodoïstu, les montagnes, les rizières et la mer | ![]() Facebook |
Facebook |
19/04/2012
Jacques Bens, 41 Sonnets irrationnels

Amoureux
Tu dis oui, tu dis non, tu dis n'importe quoi,
Et tu me ris au nez, et moi je reste coi
Comme un enfant de chœur qui, pris de court, bafouille,
Tant l'eau de tes regards trouble et glace mon sang.
Au pied des mots brûlants, ma pauvre voix se rouille,
Rengainant ses plus tendres traits en son carquois
De peur de faire naître un sourire narquois
Sur tes lèvres dorées que mon baiser ne mouille.
Mais l'eau de tes regards trouble et glace mon sang.
Je blâme le crétin morose et languissant
Que je suis devenu sans bien m'en rendre compte,
Le front glacé, langue blanche et l'œil absent.
Comment pourrais-tu voir, en moi, plus qu'un passant ?
C'est ce qu'en gémissant, le soir, je me raconte.
Jacques Bens, 41 sonnets irrationnels, Gallimard, 1965, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques bens, 41 sonnets irrationnels | ![]() Facebook |
Facebook |
18/04/2012
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

I
Les cheveux et la gorge noués,
Un ruban bleu posé sur le front.
La petite fille trempe une araignée dans l'eau bouillante.
Jambes croisées,
à l'ombre d'un roseau,
elle jaunit de la tête aux pieds.
Ses crampes la reprennent.
Des mangues épluchées,
le noyau avalé par mégarde,
un rosbif cru.
C'est tout.
V
Au milieu de la pièce, elle recopie l'énoncé de la main gauche. Avec le dos strié, l'air triste.
Elle n'a pas mangé depuis deux jours. Les joues en feu (le banc est dur), les cheveux emmêlés, la dentelle sale.
Le repentir inscrit sur du papier de soie. Dédicace de l'enfant droite, assise au milieu d'une pièce. Lettres déliées, une boucle dans les yeux, elle éternue à la cinquième page.
Et se repend une dernière fois.
(Enfance d'une comtesse russe)
XII
(Cheveux de bataille)
Elles avaient le pied fin
Les idées claires
Se reposaient la nuit pour être en forme le jour
Buvant le jus d'une orange très sanguine
La manière forte pour ne pas trébucher
La mèche rebelle cingle dans la nuque
Enroulées
À trois
— Comme autrefois
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie / Flammarion,
1997, p. 11, 15 et 22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, enfance, poupée | ![]() Facebook |
Facebook |
17/04/2012
Pierre Reverdy, Les épaves du ciel, Main d'œuvre

La repasseuse
Autrefois ses mains faisaient des taches roses sur le linge éclatant qu’elle repassait. Mais dans la boutique où le poêle est trop rouge son sang s’est peu à peu évaporé. Elle devient de plus en plus blanche et dans la vapeur qui monte on la distingue à peine au milieu des vagues luisantes des dentelles.
Ses cheveux blonds forment dans l’air des boucles de rayons et le fer continue sa route en soulevant du linge des nuages – et autour de la table son âme qui résiste encore, son âme de repasseuse court et plie le linge en fredonnant une chanson – sans que personne y prenne garde.
Pierre Reverdy, Les épaves du ciel, Gallimard, 1924, p. 22.
Tête à tenir
Une large bouffée de flammes
Sur la frise en bas des forêts
Le brouillard échappé des larmes
Sous une écharpe de rosée
L’odeur rugueuse des cigares
Le feu caché des feuilles mortes
Rayons cassés qui tissent ton sourire
Le visage effacé sous son voile de peur
Il va il vient il se retire
Un rayon de miel dans la cire
Une larme amère à ton cœur
Amour reviens dans le silence
Le poids de la main sur ton front
Et toujours la mort entêtée
La mort vorace
Pierre Reverdy, Le Chant des morts, 1944-1948, dans
Main d'œuvre, poèmes (1913-1949), Mercure de France, 1949, p. 412.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, les épaves du ciel, main d'œuvre, la repasseuse | ![]() Facebook |
Facebook |





