29/06/2012
Louis Zukofsky, "A" 13

"A" 13, V
Nu assis, éveillé couché
Le silence non loin de la parole
Se dépassent l'un l'autre pour
Ne pas se marcher dessus
Souvent la nuit un sommet pointe
L'aube enveloppe des bouquets de feuilles
Quand brillent au soleil les contours
Même pénombre soir et matin
Traversant la persienne qui s'ouvre
Et qui éclaire la vue.
Des cinq fenêtres contigües d'un dixième étage,
Comme sur le pont d'un bateau
Tout le cycle solaire
Rappelle le désir innocent : de onze à quatre-vingt dix ans
Et laisse vieillir l'innocence
Se rappelle de la famille à ses débuts
De certains moments comme si c'était aujourd'hui
De quatre mains jointes sur les genoux
Scellées par le regard.
L'étreinte
Quand il est question d'enfants
Le désir observe, il voit
Un étage plus bas
Sur un toit voisin
La décoration un pignon à redan
Surmonté d'une licorne assise
Flanqué par quatre conduits
Formes chantournées _
Châteaux ou jeu d'échecs
Faits de la même pierre tendre
Comme les festons de pierre
D'un ridicule canasson
Gros sac à viande —
Pas moyen de deviner
Pourquoi c'est là
À moins de l'honorer
Comme curieuse esquisse
Du désir avant qu'il ne soit
Pulsion et grandisse non loin d'ici.
[...]
Louis Zukofsky, "A" (sections 13 à 18), traduction de Serge Gavronsky et François Dominique, Collection Ulysse Fin de siècle, éditions Virgile, 2012, p. 89-90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zukofsky, a 13, désir | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2012
Claudia Rankine, Si toi aussi tu m'abandonnes

Moi aussi j'oublie des choses. Ça me rend triste. Ou bien c'est ce qui me rend le plus triste. La tristesse c'est pas vraiment à cause de George W. ou de notre optimisme américain ; la tristesse c'est le fait d'admettre qu'une vie peut ne pas compter. Ou, comme il y a des milliards de vie, ma tristesse grandit avec la conscience que des milliards de vie n'ont jamais compté. J'écris cela sans que mon cœur se brise, sans sortir de mes gonds. C'est peut-être ça la vraie cause de ma tristesse. Ou peut-être, Emily Dickinson, mon amour, l'espoir n'a-t-il jamais été cette chose avec des ailes. Je ne sais pas, je m'aperçois seulement qu'à l'heure du journal télévisé, je change de chaîne. Cette nouvelle disposition pourrait révéler un effondrement de la personnalité : I. M. E. L'Incapacité à Maintenir l'Espoir, qui se traduit par une absence de foi innée dans les lois suprêmes qui nous gouvernent. Cornel West dit que c'est ce qui ne va pas avec les noirs aujourd'hui : trop nihilistes. Trop effrayés par l'espoir pour espérer, trop usés pour l'aventure, en fait trop près de la mort je pense.
Claudia Rankine, Si toi aussi tu m'abandonnes, Traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, "Série américaine", José Corti, 2010, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claudia rankine, si toi aussi tu m'abandonnes, tristesse, oubli, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2012
Yves Boudier, Consolatio
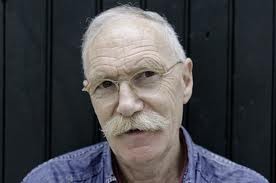
L'aube
toison gardienne
« Il pleut dans mes yeux... »
innocente le corps
de n'être que
vision indocile
du sexe vif
(aliénance des rêves)
je ne marche jamais seul
dans le sommeil
ce qui voile en moi
ne prouve rien
seulement dit
la jointure
l'humanité Janus
cette voie
vers
la nuit d'où naissent les enfants
Je ferme les yeux
cède
au cœur vigile
la présence animale
touche le seuil
désincarne
le verbe
la forêt gagne
et la mort passagère
découpe dans
les draps
au lever des chimères
Yves Boudier, Consolatio, postface de Martin Rueff,
"La mort au carré", Argol, 2012, p. 9-12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves boudier, consolatio, martin rueff, la nuit, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2012
André Suarès, Sur la vie

Suarès par Georges Rouault
Pensées du temps sans dates
Assurément, la poésie est un art en soi-même, et qui se suffit. De là, les surprises de la forme, les chefs-d'œuvre de l'expression et la beauté du métier : il peut être si fort ou si plaisant qu'on n'y résiste pas ; on cède à la fougue de l'artiste ou à son charme. Mais le métier le plus accompli ne donne pourtant pas cet accès aux sommets de l'âme, où est le lieu naturel de la grande poésie. Le rythme et la mélodie populaires ne sont pas plus la musique de Bach, que le plus savant contrepoint, si la pensée de Bach est absente. Pensée qui trempe toujours dans le sentiment.
Ni le métier seul ni la seule émotion ne font le grand poète. Il faut de la pensée, là comme ailleurs. Il n'est pas vrai qu'une citrouille bien peinte vaille l'École d'Athènes, mais il peut être vrai qu'un faux Raphaël d'Académie ne vaille pas une belle citrouille : c'est que les idées académiques ne sont pas plus vivantes, ni plus fécondes, ni plus propres à nous émouvoir et nous faire penser qu'une citrouille, une pipe au bord d'une table et une demi-guitare. On peut dire aussi de Chardin qu'il est plus peintre que Léonard de Vinci ou Rembrandt parce qu'il n'est que peintre. Rembrandt, Raphaël, Jean Fouquet sont de grands poètes qui s'expriment au moyen des couleurs et des lignes.
André Suarès, Sur la vie, essais, éditions Émile Paul, 1925, p. 287-288.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré suarès, sur la vie, poésie, peinture, bach, raphaël | ![]() Facebook |
Facebook |
25/06/2012
Nathalie Riera, Variations d'herbes

Rivière
À Axel
trouble du rythme à secouer le paysage le livre des eaux
je vais librement sur le chemin des mots serrés entre les dents
au vent gelé je vais où je n'ai pas encore écrit une ligne
laver le livre où je vais le plus vert de mon temps vous écrire la
force de vos naissances au plus proche de l'effroi mes défroques de phrase sans uniforme
je suis creusée au taraud pulsée par la beauté
évaporites au cœur je m'évapore de choses très équivoques
En permanence dans l'air, par terre, à contre-jour, les mots, aux pas vifs.
Escapades Escarpement Œil et Terre Corde harmonique Sauter en hauteur
Parce que tant de beautés qui dorment en arrière de soi Parce que toute espérance se trouve dans une poignée de terre, s'accroche à l'arçon de la selle.
À travers champs dans la variation des herbes. Poésie parmi les lampes et les plantes.
Nathalie Riera, Variations d'herbes, Béziers, Les éditions du Petit Pois, 2012, p. 16-17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie riera, variations d'herbes, rivière | ![]() Facebook |
Facebook |
24/06/2012
Pierre Reverdy, La vie fragile, dans La Guitare endormie

La vie fragile
Plus loin entre la plante grasse et le rideau
Dresser l'échelle
Les formes qui remuent dans le fond du jardin sont blanches
d'autres noires
Selon le mouvement brutal du réflecteur
Les maillots des arbres sont roses
Mais au premier plan une main tient la clef du cœur
Un couple ailé marche dans des couleurs qui changent
Celui qui vole bas c'est l'homme
Celui qui va à pied c'est l'ange
Les yeux luttent dans la lumière
La lampe fraîche du matin
Un fil cassé descend derrière
La tête nue s'incline et barre le chemin
Tout le reste est recouvert de feuilles mortes
Quant au ciel il s'ouvre par le fond et de côté mais en triangle
Pierre Reverdy, La Guitare endormie. [1919], dans Œuvres complètes I, édition préparée, présentée et annotée par Étienne-Alain Hubert, "Mille&unepages", Flammarion, 2010, p. 262.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, la vie fragile, la guitare endormie | ![]() Facebook |
Facebook |
23/06/2012
Danielle Collobert, Survie

Survie
je partant voix sans réponse articuler parfois les mots
que silence réponse à autre oreille jamais
si à muet le monde pas de bruit
fonce dans le bleu cosmos
plus question que voyage vertical
je partant glissure à l'horizon
tout pareil tout mortel à partir du je
à toutes jambes fuyant l'horizon
enfin n'entendre que musique dans les cris
assez assez
exit
entrer né sur débris à peine reconnu le terrain
émergé de vase salée le fœtus sorti d'égout
plexus solaire rongé angoisse diffusant poumons souffle haletant
_______________________________________
serré le cou par la corde réveil
tremblement réveil
brûlé consumé bonze
crève corps
hors des mains caresses
loin des lèvres bu
souvenir du corps
laissant aller présent l'instant survie
sans savoir sur quoi ouvrir l'énergie à l'imaginaire répondu
balbutiements à peine aux déchirures
les cris du bord des plaies non suffit
ploné noir dans le bain de sang
à travailler ses veines pour mots
je paroel s'ouvrir bouche ouverte dire je vis à qui
balancé au chaos sans armure
survivra ou non résistance aux coups la durée longue de vie
je parti l'exploration du gouffre
tâtonnant contre jour
déjà menottes aux mains les stigmates aux poignets
aux pieds les fers les chaînes
la distance d'un pas l'unité de mesure
je raclant mon sol avec ça
traîne le bruit dans l'espace
en premier sur la bande son du prométhée
le vautour dans la gorge
à coups de sang rabattu sans fin vers le silence
au milieu du front le plat désert futur
derrière caché peut-être le corps à s'agglomérer
______________________________________
[...]
Danielle Collobert, Survie, dans Emmanuel Hocquard, Raquel,
Orange Export Ltd, 1969-1986, Flammarion, 1986, p. 184-185.
Publié dans Akhmatova Anna | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, survie, orange export ltd | ![]() Facebook |
Facebook |
22/06/2012
Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d'abîme

Les allures à la mort
Quel monde aux fumées de la pluie
Les décombres du ciel et parfois
Comme un soupçon de clair pays
Là-haut sous la soie maigre sous la suie
(La lampe qui est basse un passereau
L'habite accroupi chante faux)
Mais écoute en ces jours l'âme s'épuise
À regravir la montagne du vieux printemps
Le soleil vole et ses eaux luisent
Dans la cendre des bords du temps
Puis c'est la tombe à fleurs de terre
Et les scabieuses d'une prière.
*
Entre les collets d'ombre et de la chaux feuillue
Le grave lumignon s'absorbe dans un mur
Et nul ne franchit plus les eaux qu'il eût fallu
Franchir aux fins heureuses ô blanc murmure
En l'air le ciel pourtant propage un chant
Mouillé d'étoiles inondant par pans
Le mont plus clair et cependant aride
Et c'est alors on ne sait quoi terriblement
Simple et beau qui tremble aux bords humides
En larmes l'âme ainsi qu'un rossignol dément
Mais nous éveillerait dans cette nuit de neige
Nous ouvrirait là-haut la vie le jour que sais-je ?
*
Pour n'avoir attendu le jour le vieux bruit
D'aller sur l'eau de l'âme remuement d'ombres
Sous le silence dans la vie l'instant sombre
Au pli des lampes d'achever l'autre nuit
C'est d'ici que s'est noué pour moi menace
D'une barque noire abordant la terrasse
Vivante et ne bougeant plus que je ne sois
Aventuré face à face la sinistre
La taciturne aux bras de buis et le poids
De la neige éternelle entre nous ô triste
Pensée d'une montagne où fut fait un feu
Pour vivre aux fins de cette cendre et cet adieu !
Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d'abîme, "Le Chemin", Gallimard, 1965, p. 17-18.
Publié dans Akhmatova Anna | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-philippe salabreuil, juste retour d'abîme, les allures à la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
Louise Labé, Sonnet III

Sonnet III
Ô longs désirs, ô espérances vaines,
Tristes soupirs & larmes coutumières
À engendrer de moi maintes rivières
Dont mes deux yeux sont sources & fontaines :
Ô cruautés, ô dur[e]tés inhumaines,
Piteux regards des célestes lumières :
Du cœur transi ô passions premières,
Estimez-vous croître encore mes peines ?
Qu'encor Amour sur moi son arc essaie,
Que nouveau feu me guette & nouveaux dards
Qu'il se dépite, & pis qu'il pourra face :
Car je s[u]is tant navrée en toutes parts,
Que plus en moi une nouvelle plaie,
Pour m'empirer ne pourrait trouver place.
Louise Labé, Œuvres, Lyon, chez Jean de Tournes, 1555, p. 113.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnet, amour, désir | ![]() Facebook |
Facebook |
21/06/2012
Pascal Commère, Tashuur. Un anneau de poussière

Herbes sèches. Comme joncs, du vent. Chevaux dépassant à peine, tiges hautes, moutons plus loin — combien ? À peine visibles entre les touffes. Deux bergers, et deux autres encore — plus jeunes. Ah si jeunes. Posent pied à terre, s'accroupissent sur les talons comme on le fait ici. Nous leur tendons une tranche de pain. Les bêtes se rapprochent, nez au sol parmi les hautes tiges jaunes. Elle dit : trente-cinq jours pour venir jusqu'ici, et cinq encore pour Ulaanbataar. Je demande pourquoi Ulaanbataar. Elle dit : industrie de la viande. En selle de nouveau, rejoignant le troupeau, l'entourant. J'ai cru qu'ils faisaient paître, mais non. Ils font route ensemble, j'en compte six ( en réalité neuf, à surveiller le troupeau jour et nuit, se relayant) qui poussent de leur fouet — manche dressé appuyé sur l'épaule — bœufs (une trentaine) et moutons (quatre cents, ils ont dit), l'immense troupeau bientôt rassemblé vers la rivière là-bas, plusieurs centaines de mètres d'ici on mesure mal avec les ombres. Un autre galope vers nous — le chef des bergers, elle dit. Genou à terre, la longe roulée à son poignet. Nous lui tendons un bol, raviolis de mouton (buuz). Quelques mot alors, et le vent — lèvres et doigts noircis. Ils viennent de Hövsgöl, tout au nord, près de la frontière russe. Huit cents kilomètres en quarante jours, elle traduit. Rapide calcul, vingt par jour. Elle dit oui, et quand ils sont à la recherche d'eau ils peuvent en faire jusqu'à trente-cinq...
Pascal Commère, Tashuur. Un anneau de poussière, Obsidiane,2012, p.107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal commère, tashuur. un anneau de poussière, mongolie | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2012
Jean-Claude Pinson, Habiter la couleur

Matisse
Époque de la couleur
Considérée dans la longue durée, la variabilité historique laisse apercevoir, comme autant de basses continues jouant leur ostinato, des époques de la couleur. On dira ainsi que l'âge moderne, celui que définit, selon Heidegger, la domination planétaire de la technique, est d'abord caractérisé par un relatif effacement des couleurs. L'avènement de la modernité scientifique et technique, ayant pour conséquence l'apparition et le développement de la grande industrie, engendre un monde qui est d'abord celui du noir et blanc.
Notre aujourd'hui, à l'inverse, voit la couleur triompher. Et ce triomphe témoigne de l'entrée dans une nouvelle époque, où l'image indéfiniment reproductible n'a cessé d'étendre son empire en même temps que le mode de vie consumériste s'étendait progressivement à toute la planète ou presque. Il témoigne d'un passage du moderne au post-moderne (du moins si l'on saisit cette césure sous l'angle de la logique culturelle du capitalisme tardif et en des termes plus civilisationnels qu'étroitement esthétiques). — Dans l'ordre non seulement olfactif mais dans celui du goût (en tant que marqueur essentiel d'un éthos) la massive substitution du tabac blond au tabac brun traduit de façon significative ce passage.
Toute proposition "épochale" est aventureuse, peu ou prou spéculative. Car sur quoi s'appuie-t-elle en dernier ressort, sinon sur une intuition, un sentiment d'époque, inévitablement subjectif et d'une factualité bien peu saisissable. Elle excède cependant la simple impression subjective, dès lors que le sentiment réfléchi sur lequel cette proposition se fonde procède d'une écoute de ce que Mandelstam appelait "le bruit du temps". « Je désire, écrit le poète russe dans le livre éponyme, non pas parler de moi, mais épier le siècle, le bruit et la germination du temps. » Alors peut-être entendra-t-on bruire, dans l'expérience individuelle et son vécu propre (Erlebnis) la rumeur d'une expérience commune et partageable (Erfahrung).
Jean-Claude Pinson, Habiter la couleur, suivi de De la mocheté, Nantes, éditions Cécile Defaut, 2011, p. 54-55.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, habiter la couleur | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2012
Les techniciens du sacré, anthologie Jérôme Rothenberg

Le dieu Dumuzi
Chant de la vulve d'Inana
je suis femme moi
qui dans cette maison
de lapis sacré
portant
dans mon sanctuaire dis ma
prière sacrée
moi qui suis femme moi
qui suis reine des cieux
que l'officiant
le psalmodie
que le chanteur le chante
& que mon nouvel époux
mon Dumuzi mon
taureau furieux me comble
que les mots tombent
de leurs bouches
ô chanteurs chantant
pour leur jeunesse
leur chanson qui s'élève
à Nippour offrande à faire
au fils de dieu
moi qui suis femme chante pour
le louer
l'officiant le psalmodie
moi qui suis Inana
lui donne le chant de ma vulve
ô étoile ma vulve de la Grande Ourse
vulve barque lancée des cieux
nouvelle lune beauté croissante vulve
désert mon labour vulve
chant des oies sauvages en jachère
où ma motte attend
d'être inondée par lui
colline ma
vulve béante
& la fille demande :
qui va la labourer ?
Vulve mouillée inondée
la mienne moi la reine
menant jusqu'ici ce bœuf
« femme il labourera pour toi
notre roi Dumuzi labourera pour toi
ô laboure ma vulve ô mon cœur
mes cuisses sacrées en sont
trempée ô mère sacrée »
[Sumer]
Les techniciens du sacré, anthologie de Jérôme Rothenberg, version française établie par Yves di Manno, José Corti, 2007, p. 354-355.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les techniciens dy sacré, jérôme rothenberg, yves di manno, sumer | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2012
Laurent Albarracin, Le Secret secret

Les armes découvertes
[...]
L'herbe on dirait un peigne mou
ondoyant dans la nuit du jour
étendant ses cils tactiles
aveugles et verts aquatiquement
sous la lune du soleil
On dirait un peigne fou, une houle très calme
comme des clés libres dans des pênes bleus
une échine se levant dans un poulpe du monde
un poil de la bête qui viendrait à la chose
des longes rebelles, un vent d'herbe, une tempête en herbe
et un soulèvement pour se rendre
L'herbe monte
dans les fins tuyaux capillaires —
marée du ciel
La tige déjà cueille la fleur
La tige déjà casse et tend
l'immobile fleur
Fougère foudre légère
poussée en son point d'impact
comme ne cravache de l'air
un harnais de cuir en pot
un fouet sage, la côte d'une cage
où naît l'oiseau du ciel
Laurent Albarracin, Le Secret secret, Poésie / Flammarion,
2012, p. 68-69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, le secret secret, l'herbe, la fougère | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2012
Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes

Une rumeur d'épouvante rôde en ville,
Se glisse dans les maisons comme un voleur.
Pourquoi ne pas relire, avant de s'endormir,
Le conte de Barbe Bleue ?
Comment la septième monta l'escalier,
Comment elle appela sa sœur cadette,
Et guetta, retenant son souffle,
Ses frères bien-aimés, ou la terrible messagère.
Une poussière s'élève comme un nuage de neige,
Les frères vont entrer au galop dans la cour du château,
Et sur la nuque innocente et gracile,
Le tranchant de la hache ne se lèvera pas.
Consolée à présent par cette cavalcade,
Je devrais m'endormir tranquille
Mais qu'a-t-il, ce cœur, à battre comme un enragé,
Et le sommeil, pourquoi ne vient-il pas ?
Hiver 1922
Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes, édition
bilingue, traduction par Marion Graf et José-Flore Tappy,
La Dogana, 2010, p. 85.
Publié dans Akhmatova Anna, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, l'églantier fleurit, barbe bleue | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2012
Jean Tardieu, Jours pétrifiés (1942-1944)
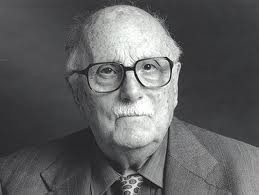
Regina terrae
À Albert Camus
Comme un souvenir
je t'ai rencontrée,
personne perdue.
Comme la folie,
encore inconnue.
Fidèle fidèle
sans voix sans figure
tu es toujours là.
Au fond du délire
qui de toi descend
je parle j'écoute
et je n'entends pas.
Toi seule tu veilles
tu sais qui je suis.
Le terre se tourne
de l'autre côté,
je n'ai plus de jour,
je n'ai plus de nuit ;
le ciel immobile
le temps retenu
ma soif et ma crainte
jamais apaisés,
pour que je te cherche,
tu les as gardés.
Sœur inexplicable,
délivre ma vie, laisse-moi passer !
Si de ton mystère
je suis corps et biens
l'instant et le lieu,
ô dernier naufrage
de cette raison,
avec ton silence
avec ma douleur
avec l'ombre et l'homme,
efface le dieu !
Faute inexpiable
je suis sans remords.
Dans un seul espace
je veux un seul monde
une seule mort.
Jean Tardieu, Jours pétrifiés, 1942-1944,
Gallimard, 1948, p. 77-79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, jours pétrifiés, regina terrae | ![]() Facebook |
Facebook |





