29/01/2020
Jean-Luc Sarré, La Part des anges
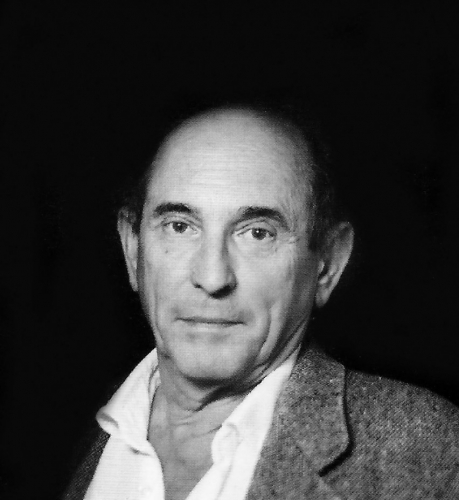
La fille qui s’affaire à l’évier
les manches retroussées jusqu’aux coudes
son bol ébréché fumant
sur une table de cuisine
et le bourdonnement des mouches.
On dirait d’une Normandie
que l’haleine chaude du siroco
aurait privée de sa mémoire.
Jean-Luc Sarré, La Part des anges,
La Dogana, 2007, p. 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, la part des anges, fille, mouche, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
24/04/2019
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, une lecture de Rimbaud

Acte III, I rouge
Scène 1
Forêts de la mémoire quel monstre masqué
Rôde sous vos futaies et sans cesse m’appelle
Et me tourmente à la fin du jour les dieux
Harassés s’en vont dans un exil sans retour
Ils annoncent en pleurant le deuil interminable
De l’amour et sur les pierres blanches d’un mur
Qui s’écroule les flammes des bougainvillées
S’empourprent une dernière fois avant la nuit
Triomphantes les cigales pleureuses ressassent
Leur mélopée funèbre et stridulante
Jean Ristat, Le théâtre du ciel, Une lecture de Rimbaud,
Gallimard, 2009, p. 61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, le théâtre du ciel, une lecture de rimbaud, mémoire, dieux, cigale | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2019
Étienne Faure, Tête en bas — rencontre, lecture

Étienne Faure et Jean-Baptiste Para pour la remise du prix Max Jacob 2019
Le mot Départ taillé dans la pierre
au fronton de la gare est resté
comme Liberté, Égalité, Fraternité
ou École de garçons il y a beau temps
devenue mixte, cris indécis,
simple inscription, vieil incipit
redoré ou repeint en rouge sang,
et ce départ incrusté fédère
dans les cœurs tous les départs forcés,
volontaires, oubliés qui défilèrent sous le linteau,
entrés par la face nord, ressortis plus tard
sous le pignon opposé annonçant Arrivée,
ces enfants de la patrie, déportés, communards,
sinistrés, réfugiés, revenus plus ou moins,
criant dans le heurt des bagages, sacoches, havresacs,
des mots entre-temps érodés, nullement gravés
en mémoire.
frontons
Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard, 2018, p. 116.
Étienne Faure a reçu le prix Max Jacob pour Tête en bas.
Les Éditions Gallimard organisent une rencontre lecture le
mardi 9 avril à 19 h
à la librairie Gallimard, Boulevard Raspail
La lecture rencontre sera animée par
Myrto Gondicas et François Bordes.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, tête en bas, mémoire, souvenir, gare, oubli | ![]() Facebook |
Facebook |
17/02/2019
Pierre Reverdy, La meule de soleil

Mémoire
Quand elle ne sera plus là
Quand je serai parti
Là-bas où il doit aussi faire jour
Un oiseau doit chanter la nuit
Comme ici
Et quand le vent passe
La montagne s’efface
Ces pointes blanches de la montagne
On se retrouvera sur le sable
Derrière les rochers
Puis plus rien
Un nuage marche
Par la fenêtre sort un cri
Les cyprès font une barrière
L’air est salé
Et tes cheveux sont encore mouillés
Quand nous serons partis là-bas derrière
Il y aura encore quelqu’un ici pour nous attendre
Et nous entendre
Un seul ami
L’ombre que nous avons laissée sous l’arbre et qui s’ennuie
Pierre Reverdy, La meule de soleil, dans Œuvres complètes, I,
Flammarion, 2010, p. 943-944.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, la meule de soleil, mémoire, ami, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
06/10/2018
Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque

(…) dans ces années d’enfance, (…- Auschwitz était encore proche dans les familles qui, tout en buvant du thé trop chaud au citron, ne cessaient de dénombrer ceux des leurs qui n’étaient jamais revenus.
Mais le fait est là. Auschwitz, c’était l’enfer, une autre planète, absolument, et un temps désormais hors d’atteinte pour une mémoire humaine. Inassimilable, ce passé ne cessait cependant jamais de recharger le présent. Ces intensités d’absence formaient une poche pleine d’oubli où nos existences puisaient leurs jours et leurs nuits.
Et l’enfant était pris dans une mémoire obligée aux images d’un feu blanc, inabordables.
Cependant, même sans contenu disponible, la mémoire est un instrument de deuil. Irrémédiablement liée à l’absence, à la mort et aux morts. La mémoire c’est même la seule chose qui nous reste de la mort d’autrui. Et de la mort on ne connaît que la mémoire des vivants. Mais cette mémoire-là, lieu où l’exercice quotidien s’accomplit à notre insu, n’a pas grand chose à voir avec la reconnaissance d’un passé historique. Elle est, cette mémoire, hantée par une absence fondatrice. Et de cette absence du mort à la mémoire il n’y a qu’un pas que vient combler l’oubli. Il porte alors nos existences.
Comment dire pourquoi il arrive qu’on puisse si bien se passer d’un vivant et tellement moins bien du mort ? Où a-t-on mal d’une absence qui est cette part de l’autre qui nous blesse ? La mémoire a beau être blanche, et même silencieuse, elle n’en demeure pas moins. Et elle persiste cette fraction intime qui nous anime tout en restant inassimilable.
Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque, ‘’La Librairie du XXIesècle, Seuil, 2017, p. 97-98.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice olender, un fantôme dans la bibliothèque, mémoire, oubli, absence, passéauschwitz | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2018
Anise Koltz, Galaxies intérieures

Dès notre naissance
nous avons flairé le sang
Les images du déluge
tapissent encore
notre mémoire
Nous marchons sans repères
suspendus au monde
par une épingle de sûreté
Anise Koltz, Galaxies intérieures,
Arfuyen, 2013, p. 50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anise koltz, galaxies intérieures, mémoire, déluge, repère | ![]() Facebook |
Facebook |
18/05/2018
Ether Tellermann, Éternité à coudre

Et dormir où
chacun pèse
un jour je voulus
mesurer le poids
d’un homme
l’invention de sa
chair
disperser sa rumeur.
Fallait-il suivre
le nerf
jusqu’à la mémoire
où poussent
de vieux alphabets ?
Alors vint un
espace à bâtir
un peu d’horizon
roule
invente
sa trace.
Esther Tellermann, Éternité à coudre,
éditions Unes, 2016, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, Éternité à coudre, mémoire, espace | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2018
Georges Perros, Œuvres (''Pour remplacer tous les amours...'')

Pour remplacer tous les amours
Que je n’aurai jamais
Et ceux que je pourrais avoir
J’écris
Pour endiguer le flux reflux
D’un temps que sillonne l’absence
Et que mon corps ne peut tromper
J’écris
Pour graver en mémoire courte
Ce qui défait mes jours et nuits
Rêve réel, réel rêvé
J’écris
Georges Perros, Œuvres, édition établie
et présentée par Thierry Gillybœuf,
Quarto/Gallimard, 2017, p. 1074.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, pour remplacer tous les amours, écrire, corps, temps, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
06/01/2018
Rachel Blau DuPlessis, Brouillons (choix de poèmes)
Brouillon 52 : Midrash, 14.

Les mots, est-ce cela qui manque ?
Est-ce la concentration ?
une page foisonne en sous-entendus et en apartés :
pluie, rouille, morne mort, morne vie.
Non. Il ne s’agit pas de ça,
mais le fait que les crocs d’argent des mots
ne peuvent rien contre de plus profonds silence, plus chargés de colère
rien contre la dislocation du désir de mémoire
rien contre d’infixables décombres.
Dès lors, le problème est « zu schreiben », d’écrire ?
D’écrire, voilà tout.
Trop, beaucoup trop de mots.
Apparaux d’auteur
amour propre
forme-matière première
et même, pitié-de-soi.
Vouloir un poème après Auschwitz
c’est —
compréhensible, inaccessible, intenable.
Quel poète pourrait bien vouloir ?
Rachel Blau DuPlessis, Brouillons, traduction et présentation par Auxeméry, avec la collaboration de Chris Tysh, Corti, 2013, p. 123-124.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rachel blau duplessis, brouillons, auxeméry, mot, mémoire, écrire, auschwitz | ![]() Facebook |
Facebook |
20/05/2017
Shoshana Rappaport-Jaccottet, Écrire c'est lier

Écrire c’est lier
Écrire, c’est lier. Comment ficeler le bouquet ? D’emblée, pouvoir contrarier les catégories, donner à voir une géographie du cœur, mouvante, pudique, sensible. Ingrédient décisif, il faut déposer en douceur quelques phrases choisie pour la circonstance. (Chronologie du présent.) Disposer d’un temps propice hors de l’inquiétude, de l’interrogation. Déjouer les effets d’attente. Pas d’évidence expressive. « Nous n’avons pas la verticale. » Soit. Dialoguer avec le monde, — dialogue fragile, fluide, nécessaire, être dans la vie, et donner un sens plus pur aux mots de la tribu. « C’est comme ça. » Comment toucher, remuer, atteindre ? Choses perceptibles, choses de la pensée. Asseoir le trouble, et penser à « l’a-venir » ? Déplorer les mots rompus à toutes les besognes. Merveilles, babioles. Aucune ne mord sur le réel. Ne pas passer à côté : offrande du jour festif, la fidélité donne de la mémoire. (Saisir la réflexion à sa racine, là où se réalise l’ample tessiture des registres, sa vocation à remonter les chemins. Dire et faire : avec quel lexique rendre l’immédiateté de la voix, du geste, de la vitalité libre ? Latéralité du regard. De ce regard-là qui fixe, évalue, désigne, discerne, construit tel cadastre à sa mesure. Posséder un lieu où se tenir debout, vaille que vaille, quel que soit le fond. Invention, méditation, et attention perceptive.
Shoshana Rappaport-Jaccottet, Écrire c’est lier, dans (Collectif) le grand bruit, pour fêter les 80 ans de Michel Deguy, Le bleu du ciel, 2010, p. 207.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shoshana rappaport-jaccottet, Écrire c’est lier, dialoguer, réel, mémoire, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
18/01/2017
T. S. Eliot, La terre vaine

Les hommes creux
(Un penny pour le vieux Guy)
I
Nous sommes les hommes creux
Les hommes empaillés
Cherchant appui ensemble
La caboche pleine de bourre. Hélas !
Nos voix desséchées, quand
Nous chuchotons ensemble
Sont sourdes, sont inanes
Comme le souffle du vent parmi le chaume sec
Comme le trottis des rats sur les tessons brisés
Dans notre cave sèche.
Silhouette sans forme, ombre décolorée,
Geste sans mouvement, force paralysée ;
Ceux qui s’en furent,
Le regard droit, vers l’autre royaume de la mort
Gardent mémoire de nous — s’ils en gardent — non pas
Comme de violentes âmes perdues, mais seulement
Comme d’hommes creux
D’hommes empaillés.
T. S. Eliot, La terre vaine, dans Poésie, traduction Pierre
Leyris, Seuil, 1969, p. 107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : t. s. eliot, la terre vaine, hommes creux, voix, silhouette, mémoire, âme | ![]() Facebook |
Facebook |
21/12/2016
Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l'immobilité de Douve
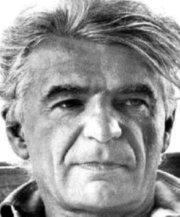
Vrai nom
Je nommerai désert ce château que tu fus,
Nuit cette voix, absence ton visage,
Et quand tu tomberas dans la terre stérile
Je nommerai néant l’éclat qui t’a porté.
Mourir est un pays que tu aimais. Je viens
Mais éternellement par tes sombres chemins.
Je détruis ton désir, ta forme, ta mémoire,
Je suis ton ennemi qui n’aura de pitié.
Je te nommerai guerre et je prendrai
Sur toi les libertés de la guerre et j’aurai
Dans mes mains ton visage obscur et traversé,
Dans mon cœur ce pays qu’illumine l’orage.
Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve,
Mercure de France, 1954, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, du mouvement et de l'immobilité de douve, désir, visage, voix, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2016
John Taylor, Hublots / portholes, peintures de Caroline François-Rubino
On pourrait sans difficulté relire une partie de la littérature française (pas seulement, mais soyons modestes) à partir du thème de la fenêtre, passage entre le dedans et le dehors. On se souvient du duc de Nemours voyeur, la nuit, de son aimée dans La Princesse de Clèves, et de l’invitation de Baudelaire, dans Le Spleen de Paris, à découvrir l’intime, également la nuit : « Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. » ("Les Fenêtres"). Aussi souvent la fenêtre ouvre sur le public, parfois l’inconnu, et l’on pense à la prison de Fabrice, aux Fenêtres de Mallarmé, à Emma Bovary, etc. Paul de Roux, à Paris, regardait de sa fenêtre le mouvement des nuages, la lumière, pour relire un poème d’ Apollinaire : « Tu soulèveras le rideau. Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre. (…) La fenêtre s’ouvre comme une orange. Le beau fruit de la lumière ». Le hublot est aussi une fenêtre, d’un genre particulier puisqu’elle n’est pas ouverture sur un dehors public.
Que voit-on ? Toujours : la mer, les infinies variations de l’eau, crêtes et creux des vagues, et ce qui s’y trouve : une île, un autre bateau ; ou, à l’approche de la terre, une falaise. Selon le moment, les formes changent, nettes sous le soleil, indistinctes, troubles, devenant confuses, s’effaçant presque avec la brume ou le soir venu ; les couleurs se transforment, du gris le plus profond au bleuâtre. Tous ces mouvements disparaissent avec la nuit et seuls les mots peuvent restituer cette absence et, tout aussi bien, ce qui est imaginé, qui prend aussi diverses formes.
C’est surtout cet imaginaire construit dans l’espace du hublot que peint Caroline François-Rubino. Ici pourra-t-on reconnaître la mer et ses mouvements, là le ciel et ses transformations selon l’heure, la saison, mais toujours les nuances et les arrangements du bleu qui laissent toute latitude pour inventer tous les paysages possibles. Ces peintures suggèrent que l’on peut, en laissant errer le regard, voir derrière le hublot des mondes inconnus, ce que dit le poème : il y a, aussi, une fenêtre pour revisiter le temps,
Le hublot
de la mémoire
cercler
teinter de bleu
ce qui est
un vide blanc
Poèmes et peintures conversent, se répondent, d’une certaine manière se commentent ; l’utilisation de la seule couleur bleue est en accord avec le caractère condensé des poèmes en anglais, fort bien adaptés en français. Ce lien très fort entre image et texte donne au livre une unité que n'ont pas toujours les "livres d’artiste".
John Taylor, Hublots portholes, peintures de Caroline François-Rubino, édition bilingue, traduction de Françoise Daviet, L’œil ébloui, 2016, 32 p., 13 €.
Cet article a paru dans Libr-critique.com, revue de Fabrice Thumerel, le 7 novembre 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, hublots portholes, caroline françois-rubino, fenêtre, mer, temps, mémoire, bleu | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2016
Joseph Joubert, Carnets, I

La mort remplira leur bouche de terre.
Une conversation ingénieuse avec un homme, c’est une mission. Avec une femme, c’est une harmonie, un concert. Il y a le rapport de l’octave à la basse. Vous sortez satisfait de l’une, vous sortez de l’autre enchanté.
Aux médiocres il faut des livres médiocres.
Évitez d’acheter un livre fermé.
La mémoire — qui est le miroir où nous regardons les absents.
Chacun se fait et a besoin de se faire un autre monde que celui qu’il voit.
Le spectacle a changé, mais notre œil est le même.
Joseph Joubert, Carnets, I, Gallimard, 1994.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, i, mort, lvre, conversation, mémoire, spectacle, médiocre | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2016
Paul Celan, Renverse du souffle

L’Écrit se creuse, le
Parlé, vert marin,
brûle dans les baies,
dans les noms,
liquéfiés
les marsouins fusent,
dans le nulle part éternisé, ici,
dans la mémoire des cloches
trop bruyantes à — mais où donc ?,
qui,
dans ce
rectangle d’ombres,
s’ébroue, qui
sous lui
scintille un peu, scintille, scintille ?
Paul Celan, Renverse du souffle, traduit
de l’allemand et annoté par Jean-Pierre
Lefebvre, Seuil, 2003, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, renverse du souffle, écrit, nom, mémoire, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |





