31/10/2018
Dominique Maurizi, Septième rive
Est-ce que je rêve quand je t’entends,
quand, comme ces cris au loin qu’on
perçoit, je devine une voix ?
Est-ce que je dors, est-ce que je rêve,
quand je ne vois que flocons de fumée,
et que seule dans le noir, rien ne pleure
avec moi ?
Est-ce que je rêve, est-ce que je rêve,
quand je t’entraîne avec les ombres, et
que tu passes dans le noir, comme ces
pas au loin qu’on entend ?
Dominique Maurizi, Septième rive,
la tête à l’envers, 2017, p. 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique maurizi, septième rive, dormir, rêver, ombre, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
30/10/2018
Peter Gizzi, Chansons du seuil
Voile grise
Si j’étais un bateau
Je chavirerais sans doute
Si j’étais une prière
Si j’étais une douelle de bouleau
Une barque de bouleau
Si j’étais un bouquin
Je chanterai dans la rue
Seul au milieu du trafic
Si j’étais une toge
Je pourrais être un héros
À la crinière fleurie
Si j’avais un bateau
Je mangerais un sandwich
Dans la lumière étourdissante
Je rendrais des visites
Tel un livre saint
Si j’étais un bateau
Si j’avais une prière
Peter Gizzi, Chansons du seuil, traduction
Sréphane Bouquet, Corti, 2017, p. 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter gizzi, chansons du seuil, stéphane bouquet, voile grise | ![]() Facebook |
Facebook |
29/10/2018
André Frénaud, HÆRES, poèmes 1968-1981

Les expressions de la physionomie
Celui qui sans raison prétend au sacrifice,
celui dont les dons ne valent plus,
celui qui s’entête, celui qui écourte,
celui qui fait la roue — qui fait semblant —
celui qui s’est détourné, qui est là encore
quand il sourit sans plus récriminer,
celui qui s’encourage par des billevesées
à défaut de mieux,
celui qui hurle parce qu’il ne sait plus dire,
celui dont le cri s’est étranglé,
celui qui s’entrouvrait à la rumeur
qu’il n’entend plus,
celui-ci, le même,
sous différents jeux de physionomie,
dans la bonne direction décidément,
et qui atermoie, qui atermoie,
conserve-t-il de la bonté, je le voudrais.
André Frénaud, HÆRES, poèmes 1968-1981,
Gallimard, 1982, p. 253.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hÆres, poèmes 1968-1981, expressions de la physionomie | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2018
Michel Leiris, Mots sans mémoire
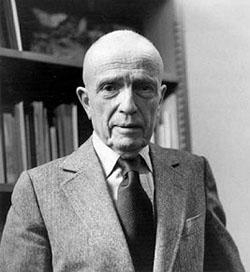
Bagatelles végétales
Absolu. Absalon.
Adages de jade :
Apprendre à parier pour la pure apparence.
Idées, édits. Édifier, déifier.
La manne des mânes tombe des tombes.
L’âtre est un être, les chaises sont des choses.
Le sang est la sente du temps. L’ivresse est le rêve et l’ivraie des viscères.
Ne rien renier. Deviner le devenir.
Pense au temps, aux taupes et à ton impotence, pantin !
Affirmer, affermir, affermer.
Afrique qui fit — refit — et qui fera.
Aimer le mets des mots, méli-mélo de miel et de moelle.
Michel Leiris, Mots sans mémoire, Gallimard, 1969, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, mots sans mémoire, anagramme, jeu de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
27/10/2018
Frantisek Halas (1901-1949), Alors quoi ?

La hantise du noir
Perdure sans même qu’on le voie
dans le drapeau amolli
mot volé
plus virginal que le feu
lâché dans le vertige
sous un absinthique arc de triomphe
sur les arrièes de la parole
Cette oiselle de Marie Bashkirtseff
en est morte
frileuse phtisique
sous un masque défensif d’engrossée
Ce sera sublime
comme la rencontre
des première et dernière Mères
à son retour
Il se traîne
semblable à la lionne de Ninive
la tombe des couchants
sous les paupières
Les agates déjà en combinent les couleurs
et la veilleuse nivéale
la nivéale éveillote
jette un œil de sous le surplis
Le retour se fera même
par le plus petit trou
même d’oreille percée
Éclatants et effrayants sont les yeux
bouts des fils de la vie
les yeux qui attendent
Et comme le sang monte à la tête
ainsi mes vers
cherchant à s’entendre
sur la polyglotte Poésie
sur ce
Frantisek Halas, Alors quoi ?, traduction du
tchèque Erika Abrams, Fissile, 2016, p. 13-14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frantisek halas, alors quoi ?, la hantise du noir | ![]() Facebook |
Facebook |
26/10/2018
Pierre Chappuis, Battre le briquet : recension
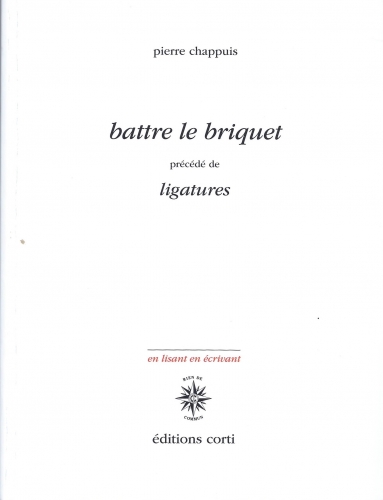
La collection « en lisant en écrivant » est indispensable pour qui veut comprendre les évolutions et les voies de la poésie contemporaine ; on y lit des réflexions et notes très diverses, d’Yves di Manno à Caroline Sagot Duvauroux, de Claude Dourguin à Philippe Beck. À côté de volumes de poésie, Pierre Chappuis a aussi nourri la collection, maintenant avec Battre le briquet.
Le livre s’ouvre avec des notes à propos de l’écriture, la poésie, la langue, la lecture, etc. ; parmi ces fragments qui ressemblent à des extraits d’un Journal — à la manière de Reverdy régulièrement évoqué —, certains touchent d’autres sujets, par exemple le suicide de Francis Giauque ou une démonstration d’Étienne Decroux. Cependant, les uns et les autres, relations de faits de la vie, ne s’éloignent guère d’une question essentielle pour Pierre Chappuis, le rapport à la langue, aux mots. Ainsi d’un souvenir d’enfance relaté. Jeune garçon, il ne put manger le poisson proposé et vomit ; or la scène se passait chez les parents de son père, sa mère ne mangeait jamais de poisson et il est probable qu’il était au menu pour cette raison : tout s’est passé comme si l’enfant, prenant en charge le dégoût de sa mère pour cet aliment, avait construit l’équivalence poisson / poison. Pour Étienne Decroux, il parvient dans son mime de la marche à « l’illusion parfaite », c’est à dire à la restitution de l’expérience vécue — ce que le poème s’efforce de faire. Etc. Le premier ensemble se poursuit par des réponses au poète Antonio Rodriguez sur la pratique de l’écriture : non plus des notes mais des réflexions plus développées. La seconde partie rassemble 18 articles, écrits depuis 1995, sous le titre Battre le briquet ; titre gardé pour le livre qui demande explication : avec les anciens briquets, il fallait à plusieurs reprises actionner la molette pour enflammer l’essence ; l’écriture exige des retours analogues et Pierre Chappuis, à propos de la nécessité de ne jamais se satisfaire d’un résultat, renvoie à Joubert dans le premier article de la série, avec lui il faut « s’interroger sans relâche sur les mots, la lecture, les livres, le langage poétique ».
Ce travail toujours à recommencer implique que l’écriture du poème n’est jamais spontanée. Il y a bien au départ un « sentiment », une « matière sauvage », sans quoi rien ne se passerait, « Affleure je ne sais quoi venu des profondeurs (et non du ciel), noté dans un calepin en cours de route ». C’est ce matériau qui est transformé, retouché, élagué jusqu’à trouver la forme la plus concise, débarrassée de tous oripeaux ; c’est encore suivre la leçon de Reverdy et, comme lui, faire « l’éloge du peu, un des enjeux majeurs de la poésie ». Pierre Chappuis dans son dialogue avec Antonio Rodriguez donne un exemple de ce qu’est la réécriture d’un poème — la première version ici ayant sans doute déjà été revue dans l’atelier :
Champs hersés sous une première neige :Champs hersés de frais (la première neige)
Sol clignotant, hiver vagabond.
En avant !
*
Champs hersés de neige (la première neige), scintillements au sol (vivement, zigzaguer) (vivement), hiver vagabond (vivement emboîter le pas).
*
Champs hersés de frais, hiver vagabond à fleur de neige. Vivement, emboîter le pas !
Il n’est pas nécessaire d’analyser longuement les modifications successives pour saisir la volonté de dépouillement, mais aussi pour comprendre que le poète n’a pas à privilégier à tout prix la transparence du sens. Si la recherche d’allègement aboutit parfois à un poème obscur, il faut comprendre que cette obscurité répond « à l’obscurité du monde, de tout être, toute chose dans sa singularité, de toute relation qui se noue, unique. » Pour le dire autrement, et Pierre Chappuis y revient plusieurs fois, le poème tente de combler la distance entre l’expérience et ce qui en est dit, entre les mots et les choses, tout en sachant qu’elle ne peut être abolie ; il permet au moins d’imaginer que nous sommes « en présence des choses » grâce à « la seule vertu des mots eux-mêmes, leurs couleurs, leur charge affective, par l’attraction qu’ils exercent les uns sur les autres ». C’est dire que la poésie, d’abord, est « rythme, sonorités, souffle », caractéristique essentielle qui donne sa place au lecteur.
La lecture, à sa manière, est aussi complexe que l’écriture ; l’une et l’autre ne peuvent jamais être linéaires, elles impliquent « Allers et retours, repentirs, détours, attentes vaines et raccourcis soudains ». Rencontre (comme avec une personne), la lecture exige du temps, elle est subjective, donc faite d’imprévus, et c’est pourquoi la lecture en ligne ne fait qu’introduire des manques. Le lecteur commençant à lire un livre de poèmes, qu’il en connaisse ou non déjà l’auteur, doit construire progressivement ses repères. On appréciera, dans Battre le briquet, le fait que Pierre Chappuis soit attentif à ce que peut être la réception autant qu’à l’écriture telle qu’il la pratique.
On appréciera également les citations ou les renvois aux écrivains qu’il lit, de Hölderlin à Montale, de Ponge à Esther Tellermann, de Reverdy à Beckett (au « chant âpre, délabré »), les discrètes allusions à des musiciens, Haydn ou Alban Berg (« Beau jusqu’à la souffrance ») et à la peinture, l’extrême attention à la langue n’étant pas séparée d’une relation à l’ensemble des arts. Lire, regarder et écouter les choses du monde pour écrire et pour lire.
Pierre Chappuis, Battre le briquet, Corti, 2018, 176 p., 18 €.Cette note de lecture a été publiée par Sitaudisle 28 septembre 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, battre le briquet | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2018
Édith Azam, Le temps si long

Parfois ça nous reprend
ce drôle de sanglot
tout bas
qui nous secoue la cage.
On n’y cède pas
non
ce serait déjà
beaucoup trop
beaucoup trop
être soi-même.
Ce serait beaucoup trop
accepter d’écouter
ce que nous dit la vie
du vide tout autour.
Alors alors…
On ferme à double tour
le corps
sa tentative.
On devrait lâcher prise
on se crispe
le mou !
Édith Azam, Le temps si long,
Atelier de l’agneau, 2018, p. 46.
©Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, le temps si long, sanglot, vide, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
24/10/2018
Pascal Quignard, Les Larmes
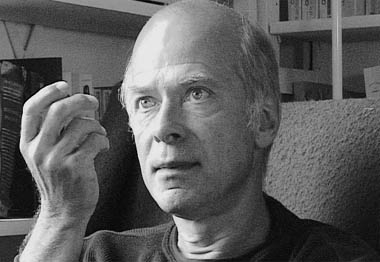
(…) Les hommes ôtent leurs différentes peaux le soir.
Puis ils approchent leur corps de la surface lisse de leur miroir. Ils s élavant le visage.
Ils nettoient leurs crocs avec de petits bouts de bois. Ils essuient une à une leurs griffes. Ils frottent la paume de leurs mains en sorte d’écarter la crasse qui y a imprimée le jour. Ils éteignent la lumière.
Nus — phosphorescents encore de la lumière qu’ils viennent d’anéantir — ils avancent dans le couloir puis pénètrent dans le noir de leur chambre.
Ils ouvrent leurs draps et s’y glissent.
Ils sont si pâles.
Ils sont comme des grenouilles sur les ries des rivières qui se détachent sur la mousse vête en écarquillant leurs grands yeux exorbités et étranges. Notre pauvre premier monde de têtards est une eau qui est sombre. Avant de naître et de découvrir le soleil nous avons connu un séjour à peu près complètement obscur où nous vivions sans jamais respirer ainsi que le font les carpes et les crabes les poulpes ou les anguilles.
Pascal Quignard, Les Larmes, Folio / Gallimard, 2018, p. 189-190.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les larmes, hommes, miroir, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
23/10/2018
Julien Gracq, Petite suite à rêver et autres inédits
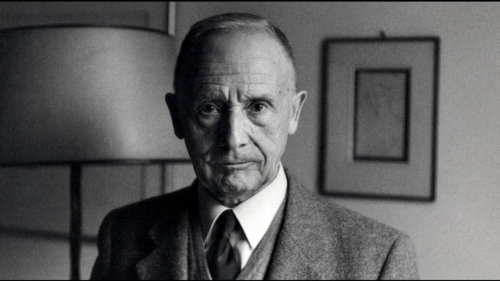
L’indicible n’a nullement affinité, comme nous tendons spontanément à le croire, avec l’infinitésimal : en fait de seuil d’élocution, la langue oscille plutôt grossièrement entre la paille et la poutre ; il est dans les paysages de l’esprit des cantons entiers et même des chaînes de montagne pour lesquels il ne dispose d’aucun pouvoir séparateur.
Autrement dit : Le langage est un outil pour délimiter et saisir tout ce qui ne nousenvahitjamais, et la poésie est en ce sens un contre-langage, parasite du premier, qi dérobe et pervertit au pris de mille ruses les armes de son adversaire : c’est pourquoi il y a peu de poésies de premier jet.
Julien Gracq, Petite suite à rêver et autres inédits, dans Europe, "Julien Gracq", mars 2013, p. 12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, petite suite à rêver et autres inédits, europe, langage, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/10/2018
Pierre-Yves Soucy, Reprises de paroles

XXXI
ce monde peut-il tenir d’autres voix
que tous morts seuls sans pain
la bouche dans la bouche tremblante
de prendre la forme d’un silence
le vertige vertical de la beauté
parvient toujours trop tard
la terre s’imprime de pas
que les pas effacent
la parole seule garde les accords
aussi improbables que décombres
elles s’aggravent entre vide et réel
Pierre-Yves Soucy, Reprises de paroles,
La Lettre volée, 2018, p 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-yves soucy, reprises de paroles, voix, silence, vertige, parole | ![]() Facebook |
Facebook |
21/10/2018
Charles Reznikoff, La Jérusalem d'or

58
Tu crois que tu es une femme
parce que tu as des enfants et des amants ;
mais dans la rue
quand il n’y a qu’Orion et les Pléiades pour nous voir,
tu te mets à chanter, tu joues à la marelle.
71
Lorsque le ciel est bleu, l’eau, sur fond de sable, est verte.
On y déverse des journaux, des boîtes de conserve,
un ressort de sommier, des bâtons et des pierres :
mais les uns, les eaux patientes les corrodent, les autres
une mousse patiente les recouvre.
Charles Reznikoff, La Jérusalem d’or, Unes, 2018, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles reznikoff, la jérusalem d’or, femme, amant, marelle, pollution | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2018
Cécile A. Holdban, Toucher terre

Autour d’elle
Des images se retournent dans l’ombre
Si simple la nuit assise au fond du corps
d’être pur langage, vérité d’une origine
inscrite.
Sortilège du son
on achève l’orage dans le creux d’une oreille
des chevaux mortellement blessés se brisent
entraînent dans les tranchées l’infini galop des mots
la lumière creuse plus profond dans ce rêve
en perles sur la peau d’une rosée nocturne
le temps chaviré du poème parmi
les interstices de la foudre.
Mais balbutiant il faudra tout reprendre
de la gorge au souffle, resserrer le jour et sa robe trop courte
comme un vêtement d’amour
sur les restes en pièces de la nuit.
Quelque chose tombait dans le silence. Un son de mon corps. Mon dernier mot fut je mais je parlais de l’aube lumineuse.(Alejandra Pizarnik)
Cécile A. Holdban, Toucher terre, Arfuyen, 2018, p. 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, toucher terre, image, souffle, rêve, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
19/10/2018
Fabiano Alborghetti, La rive opposée (dix ans plus tard) : recension
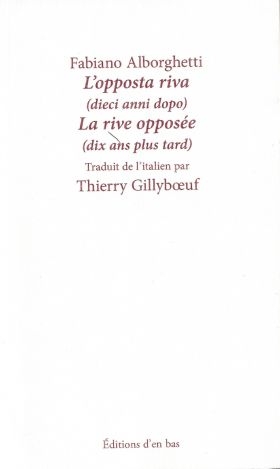
Il faudrait enseigner dès l’école primaire, et rappeler régulièrement à la radio, à la télévision, sur les réseaux dit "sociaux", que les Français sont un agglomérat de migrants pour le moins d’origine diverse, successivement installés sur le territoire depuis plus de deux millénaires — sans qu’il y ait jamais eu un "grand remplacement" qui n’est que la vision d’esprits fermés sur leurs peurs. LesGaulois, réfractaires ou non, désignent un ensemble de tribus (qui avaient seulement en commun leur origine) et ils ont été, eux aussi, des migrants, avant bien d’autres populations, et ce jusqu’au XXème siècle inclus. Aujourd’hui, dans un temps où il ne fait pas bon d’aider des migrants à survivre et à rester debout, la réédition de La rive opposéevient à point. Elle conforte dans l’idée, s’il en était besoin, qu’il y a des luttes à poursuivre, quotidiennement, et la littérature, la poésie, hier comme aujourd’hui, peut contribuer, si peu que ce soit, à penser ce qu’est notre société.
Dans ce livre publié en 2006, récrit dix plus tard, « chaque poème est une voix, chaque voix est une histoire » ; Fabiano Alborghetti a vécu, de 2001 à 2003, avec des sans-papiers, a partagé leur insécurité, leur misère, mais aussi ce qui est invisible aux yeux des "gens normaux" : il a apprécié leur dignité et leur espoir de vivre sans avoir à se cacher, et il a voulu écrire cette invisibilité. Les voix sont celles d’hommes qui ont fui, selon le cas, la guerre ou la misère ; ils venaient d’Europe (Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Kosovo, Macédoine, Albanie, Roumanie) et d’Afrique (Lybie, Somalie, Burkina Faso, Sénégal, Congo, Nigéria, Maroc, Tunisie, Algérie). En 1991, c’est d’Albanie que sont arrivés en Italie les premiers bateaux, ensuite l’émigration n’a pas cessé mais il n’y avait pas encore, au début du xxiesiècle, quand Fabiano Alborghetti a décidé d’écouter la voix d’émigrants, de bateaux chargés de femmes et d’enfants. Les éditions d’en bas (à Lausanne) ont choisi de donner le texte original et l’on pourra ainsi apprécier la traduction de Thierry Gillybœuf.
Beaucoup, aujourd’hui, fuient la misère, la faim, ce n’était pas le motif de la majorité des migrants au début des années 2000. Ceux venus des Balkans ne supportaient plus les massacres, les ruines, refusaient de tuer, de violer, d’être obligés comme cet homme de 23 ans en Bosnie-Herzégovine de regarder « les documents épars / autour des corps, les portefeuilles en vrac / après le repas du viol. Restes de chacals. » Il y eut dans cette partie de l’Europe des cadavres entassés, mis dans des fosses, des rues éventrées : ruines, vide, et des « destins qui jamais ne germeraient ». Ceux qui partaient le faisaient souvent sans rien emporter : « l’exode est moins outrageant que la sépulture ». Il y a dans ces témoignages récrits par Fabiano Alborghetti une grande pudeur ; aucun des migrants ne s’attend à être accueilli, chacun souhaite d’abord de pouvoir s’arrêter quelque part, sachant qu’aucun lieu ne peut remplacer celui qu’il a dû quitter et qui ne vivra désormais que dans la mémoire. « La fragilité n’est pas permise » pour ceux qui choisissent de s’éloigner de leurs maisons abattues, même s’ils n’ignorent pas que tout est à recommencer.
La vie continue, qui est rarement la vie que devrait avoir chaque homme. Celui qui traverse la Méditerranée, pour ne pas penser à la mort possible, rêve : « j’improvisais une vrai vie », mais ce qui l’attend dans le travail c’est « le bas de l’échelle », « à prendre ou à laisser ». Pourtant, la misère des migrants qui apparaît dans certains poèmes n’est peut-être pas ce qui arrête le plus le lecteur, c’est plutôt le mépris qu’ils connaissent trop souvent. Autrefois, se rappelle l’un d’entre eux avec dignité, « je savais dire mon nom / sans baisser les yeux », et c’est le refus que beaucoup vivent d’être perçus pour ce qu’ils sont qui est destructeur. Perte de l’identité, parce qu’est niée toute différence : « je suis un corps avec un nom » dit très simplement un migrant — mais, un autre, « on se trompait / en appelant mon nom », et un autre, « qui me vole mon identité ? » La misère, sans aucun doute, doit être secourue, mais les gouvernements européens devraient penser aussi aux atteintes à la dignité des migrants, quand ils cherchent le meilleur moyen de les répartir — cette dignité que rapporte dans de nombreux poèmes Fabiano Alborghetti , que ces exils recherchent ; qu’on écoute ces voix : « Je me perds dans le portrait de l’absence » et « quelle terre veux-tu que ce soit là où l’homme / cesse d’être un homme et devient un animal ».
Précisons qu’il n’y a pas de "bons sentiments" dans ces 60 poèmes, seulement d’un bout à l’autre un engagement pour faire un peu entendre des voix que bien peu écoutent. On ne peut s’empêcher de penser à ces campements dans les villes (à Paris, par exemple) quand on lit ce que pense un migrant de ce qu’ils sont, lui et ses proches, pour les Européens : « nous ressemblons au rebut ».
Fabiano Alborghetti, La rive opposée (dix ans plus tard), bilingue, traduction de l’italien Thierry Gillybœuf, Éditions d’en bas, Lausanne, 2018, 168 p., 17 €.Cette note a été publiée sur Sitaudis le 18 septembre 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabiano alborghetti, la rive opposée (dix ans plus tard), thierry gillybœuf, migrants, italie | ![]() Facebook |
Facebook |
17/10/2018
Jean Roudaut, Littérature de rêve
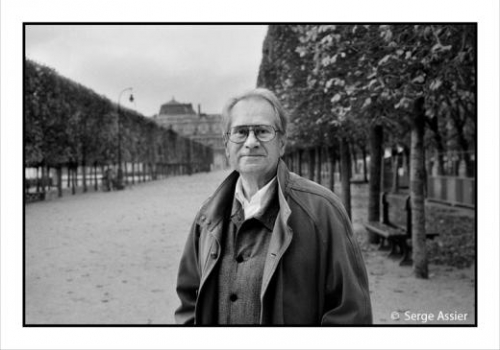
Vu d’ici
Les rêves rendent vaniteux. Jamais, éveillé, je ne serais capable de dessiner la nuit. Mais en rêve, je découvre, à mesure que je les fais, des fresques merveilleuses. Je construis des palais et des villes imprévisibles. La clarté du jour, partout où je me promène est plus douce qu’une peau de dame. De part et d’autres de la rue, hiératiques, se dressent en ancêtres, Atlante et Caryatide. Ils s’aimeraient, s’ils avaient encore des yeux pour voir. En veillant, ils dorment.
La même nuit, après le faux temps du changement de décor, de la fenêtre je vois à la rue une enfant immobile et attentive. Quand je la rejoins, elle est devenue aussi grande que moi. Elle porte des bottes cavalières, une robe légère, voile ou zéphyr, que le vent serre contre ses jambes. Malgré son chapeau à larges bords, je vois les yeux, siennois, le sourcil prolongé vers la tempe par un trait noir.
Je l’accompagne jusqu’au palais fermé, sa demeure royale.
Elle passe le portail, comme si elle le traversait,et disparaît entre les statues qui lui rendent les honneurs.
Une seconde fois perdue.
Jean Roudaut, Une littérature de rêve, fario, 2017, p. 24-25
*
ce jeudi 18 octobre, à partir de 19 h,
Soirée autour de Tête en bas d’Étienne Faure,
avec un hommage à Julien Bosc, éditeur et poète
librairie Liralire, 116, rue Saint-Maur, 75011, Paris.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean roudaut, une littérature de rêve, nuit, palais, statue | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2018
Claude Dourguin, Ciels de traîne

Il y a toujours plus de vérité dans la réalité passée par l’art, la peinture, la littérature, que dans son état brut, comme elle se livre à la perception. Tout est faux — au sens d’exactitude — chez Stendhal et nul comme lui pour nous apprendre l’italianité, l’opéra, la passion, évoquer la vie de province sous la Monarchie de Juillet, désigner la bêtise etc. Chardin en dit davantage sur la nature des fruits que ceux qui sont devant nous sur la table.
Qu’entendre par cette « vérité » ? La part profonde du mystère, de tremblement, d’obscurité, d’infini, approchés, suggérés ; l’au-delà de l’apparence dans chaque artiste saisit un fragment, différent chaque fois, une face nouvelle, sans que jamais il puisse être épuisé.
*
La langue ne parvient à cerner le réel en sa complexité, en sa totalité, en sa fragilité, mais elle donne autre chose que lui, son aura, sa part tremblante justement, ce qui le déborde, peut-être sa face voilée, incertaine qui le relie à un ailleurs sinon à une transcendance. Oui, la langue dans son effort de désignation, d’appréhension se charge de mystère, et ce n’est pas rien : même inadéquat, même insuffisant ce mouvement vaut qu’on le tente.
Claude Dourguin, Ciels de traîne, Corti, 20I1, p. 44-45 et 17.
* * *
Soirée autour de Tête en bas d’Étienne Faure,
avec un hommage à Julien Bosc, éditeur et poète,
le jeudi 18 octobre, à partir de 19 h,
librairie Liralire, 116, rue Saint-Maur, 75011, Paris.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, vérité, ciels de traîne, art, peinture, langue, stendhal | ![]() Facebook |
Facebook |







