15/10/2018
Étienne Faure, Tête en bas
Soirée autour de Tête en bas d’Étienne Faure,
avec un hommage à Julien Bosc, éditeur et poète,
le jeudi 18 octobre, à partir de 19 h,
librairie Liralire, 116, rue Saint-Maur, 75011, Paris.
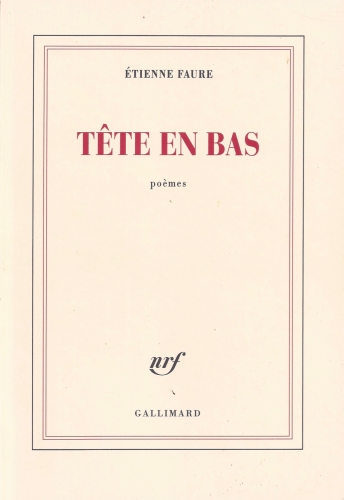
Parfois s’excusant, les livres
— d’avoir vécu, d’être jaunes —
chutent, obscurs,
soudain remarqués sur la planche
par leur absence — on les ramasse,
en relit quelques lignes, extraits de vie,
fulgurances, les adopte un temps
puis leur sens retombe, les mains les rangent
au plus haut, côté ciel, en réchappent
un dactyle, une fleur inhalée de longue date,
foin du monde où s’arrêta la lecture d’avant,
et des lettres d’amour recluses
autrefois parcourues en hâte, emmêlées avec
les mots du livre qui les protègent, les enveloppent,
les mots protégeant les mots jusqu’à la prochaine
lecture quand d’autres mots s’acclimatent
au noir des signes, qu’on y voie.
chutes
Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard, 2018, p. 81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, tête en bas, livre, lettre, souvenir, julien bosc | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2018
Images du ciel en automne (Périgord)




Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images du ciel en automne (périgord) | ![]() Facebook |
Facebook |
13/10/2018
Georges Didi-Huberman, Passer, quoi qu'il en coûte

(…) Après tout, les réfugiés ne font que revenir. Ils ne « débarquent » pas de rien ni de nulle part. Quand on les considère comme des foules d’envahisseurs venues de contrées hostiles, quand on confond en eux l’ennemi avec l’étranger, cela veut surtout dire que l’on tente de conjurer quelque chose qui, de fait, a déjà eu lieu : quelque chose que l’on refoule de sa propre généalogie. Ce quelque chose, c’est que nous sommes tous les enfants de migrants et que les migrants ne sont que nos parents revenants, fussent-ils lointains (comme on parle des « cousins »). L’autochtonie, que vise, aujourd’hui, l’emploi paranoïaque du mot « identité », n’existe tout simplement pas et c’est pourquoi toute nation, toute région, toute ville ou tout village sont habités de peuples au pluriel, de peuples qui coexistent, qui cohabitent, et jamais d’ « un peuple » autoproclamé dans son fantasme de « pure ascendance ». Personne en Europe n’est « pur » de quoi que ce soit — comme les nazis en ont rêvé, comme en rêvent aujourd’hui les nouveaux fascistes —, et si nous l’étions par le maléfice de je ne sais quelle endogamie pendant des siècles, nous serions à coup sûr génétiquement malades, c’est-à-dire « dégénérés ».
Georges Didi-Huberman, Niki Giannari, Passer, quoi qu’il en coûte, éditions de minuit, 2017, p. 31-32.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, niki giannari, passer, quoi qu’il en coûte, migrant, généalogie, identité | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2018
Pierre Vinclair, Terre inculte, Penser dans l'illisible : The Waste Land (recension)
Il fallait une connaissance approfondie de la poésie française et anglaise, une pratique solide des deux langues et, aussi, être poète (1)pour s’engager, après Pierre Leyris, dans la traduction du poème de T. S. Eliot, The Waste Land, réputé "difficile" depuis sa publication en 1922(2), pour ne pas dire "illisible". C’est justement ce qui retient Pierre Vinclair : puisque ce texte apparaît illisible, il se demande ce que l’on peut en faire : « L’illisibilité n’est-elle qu’un défaut de lisibilité, ou peut-elle ouvrir à d’autres pratiques, dont le jeu formerait une autre lecture, une « illecture » ? Un texte peut-il ne pas être compréhensible, et produire pourtant du sens ? » Les réponses sont l’objet du livre, qui propose une traduction étroitement liée à une interprétation, et une "élucidation" (terme d’Eliot), soit la relation entre le texte et ses sources intertextuelles.
La dernière des huit parties réunit les traductions du poème d’Eliot, présentées par fragments dans le livre, les autres sont construites de manière à dégager à chaque fois une « posture critique ». Il est exclu de rendre compte de l’ensemble du livre, très dense, et qui invite pour une vraielecture à souvent laisser la page en cours et à relire des passages de tel ou tel ouvrage dans sa bibliothèque. Mais si exigeante soit-elle, la lecture n’est jamais lassante, portée par l’enthousiasme de l’auteur et sa rigueur : il n’avance rien — il ne traduit rien — sans apporter au lecteur les éléments qui lui font choisir telle ou telle solution.
Commençons par le titre. Eliot a publié The Waste Landavec des notes ; il a indiqué dans la première que ce titre, le plan et, en partie, le symbolisme du poème venaient du livre d’une universitaire anglaise sur la légende du Graal et il en recommandait la lecture. Le lecteur est d’emblée invité à passer du titre à un livre qui en est éloigné et, de là, à un texte du Moyen Âge : Pierre Vinclair relève à juste titre que rien n’interdit de continuer la recherche de renvois culturels et de les multiplier — ce qui peut être agréable (on lit ou relit des œuvres auxquelles on ne pensait pas) mais n’explique pas grand-chose ; la note signifie d’abord, même si cela n’épuise pas son contenu, qu’aucun texte ne part de rien. Une seule traduction conserve le lien au monde médiéval avec un mot disparu, "gaste"(3)(l’ancien français gasta, en allant au-delà du latin, la même origine que waste), pourWaste ; ce choix n’éclaircit rien. Pierre Leyris traduit par "vaine", cet adjectif ayant eu le sens de « vide, inculte » en parlant d’une terre (cf vaine pâture) ; plus explicite, Pierre Vinclair choisit "inculte" en commentant ce qui lui semble le propos du livre : « pour Eliot, la culture européenne est à l’agonie (elle est désormais stérile, comme une terre inculte). Le poème qui l’énonce (The Waste Land) en est à la fois le produit paradoxal (puisque cette terre est inculte) et l’assassin : il l’achève. » Achever la culture pour mieux la faire renaître implique la destruction de ce qui la constitue, d’où la présence, abondante, de références culturelles. « Mais comme des déchets ».
Ce qui est fait pour le titre, est poursuivi pour l’exergue (extrait de Pétrone) et pour la dédicace à Ezra Pound, dont on sait le rôle qu’il a joué dans la poésie du xxesiècle et pour Eliot lui-même : il a suggéré des suppressions importantes dans The Waste Land, suggestions suivies. Ensuite, question de méthode, Pierre Vinclair consacre plusieurs pages au premier vers (April is the cruellest month, breeding) ; son étude donne l’occasion d’écarter l’excès de références intertextuelles qui ne font pas avancer d’un pas dans la compréhension et s’il retient, ce qui a souvent été signalé, la relation entre ce vers et le premier vers du Prologuedes Canterbury Tales(Quand Avril de ses averses douces)(4), ce n’est pas pour se limiter à son existence mais pour se demander ce que fait Eliot quand il retourne le vers de Chaucer. Ensuite, il interprète cruellestpar rapport à breeding, « c’est la terre morte[vers 2 : Lilas out of the dead land, mixing) remuée, qui souffre des lilas qui se réveillent et s’élancent en elle » — explication qui reporte le lecteur à l’exergue. Enfin, il essaie plusieurs traductions (aucune n’est conservée) en avouant l’échec à restituer le rythme de l’anglais et le jeu phonique.
De l’analyse minutieuse du vers, des leçons sont tirées. Avant de traduire, il a fallu rendre compte des références, les interpréter ; ensuite vient une proposition à propos de ce qui s’engage avec ce premier vers — « Le poète est (…) du côté de la mort ». Enfin, ce travail a obligé à quitter le texte pour lire les commentaires, (re)lire Chaucer, consulter des dictionnaires ; pour résumer : ce que rappelle Pierre Vinclair par sa pratique, c’est qu’un texte ne peut être vraiment lu, a fortiori s’il doit être traduit, que si l’on prend la peine d’en sortir pour mieux y revenir.
La traduction de The Waste Land, soit 433 vers, est menée avec la même rigueur que celle du premier vers, avec la même vivacité aussi et, toujours, avec le souci de discuter des hypothèses, d’aider le lecteur à repérer ce qui ne peut l’être que par une fréquentation répétée du poème — ainsi est-il suggéré (« On s’en souvient… ») de revenir en arrière pour mettre en rapport des passages éloignés : par exemple, quand une allusion au troubadour Arnaud Daniel (dans la dédicace à Pound) est à nouveau présente au vers 427, elle est mentionnée : « [voir chapitre I, partie 2, p. 13].
L’intérêt de ce livre ne se limite pas du tout à la lente et informée "leçon de lecture" qu’est l’interprétation-la traduction. Ce qui arrête, c’est que certaines propositions de Pierre Vinclair concernant la poésie contemporaine rejoignent celles d’autres poètes. Ainsi, à l’issue du bref quatrième chant de The Waste Land, il conclut que « le poème apparaît comme un nœud de relations qui vont dans tous les sens (…) [et] fait souffrir son récepteur », et il ajoute sous forme de question : la tâche de la poésie aujourd’hui « n’est-elle pas de faire sentir la souffrance née de l’impossibilité de la synthèse du sens ? ». Question du sens que l’on retrouve dans les toutes dernières pages, mise en relation avec ce qu’écrivait Wittgenstein sur ce sujet à la même époque. Question du sens au centre de la réflexion d’un poète comme Christian Prigent : « la dimension de l’illisibilité est intrinsèque à ce type de rapport particulier à la langue et au réel qu’on appelle littérature » (Du sens et de l’absence de sens, dans "Silo", sur le site des éditions P.O.L). Que Pierre Vinclair explore la question en aboutissant à une traduction nouvelle d’un poème majeur accroît le plaisir de la lecture.
1.Pierre Vinclair a publié récemment un roman, La Fosse commune(2016), un essai, Le Chamane et les phénomènes. La poésie avec Ivar Ch’Vavar(2017) et un livre de poèmes, Le Cours des choses(2018). On lira des poèmes, des essais et des traductions de Pierre Vinclair sur le site Poésie : Traduction / Critique(vinclairpierre.wordpress.com). Par ailleurs, co-responsable de la revue en ligne Catastrophesil y publie régulièrement des traductions de poètes de langue anglaise de Singapour.
- La première traduction en français est de Pierre Leyris, en 1947 ; elle a été rééditée et fournit les notes de T. S. Eliot, écrites pour l’édition anglaise, et celles J. Hayward pour l’édition française.
- La Terre gaste, traduction de Michèle Pinson (1995).
- Traduction du Prologuepar Louis Cazamian donnée par Pierre Vinclair.
Pierre Vinclair, Terre inculte, Penser dans l’illisible :The Waste Land, Hermann, 2018, 204 p., 22 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 18 septembre 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, terre inculte, penser dans l’illisible :the waste land, étude critique, illisibilité, t.s. eliot | ![]() Facebook |
Facebook |
11/10/2018
Niki Giannari, Des spectres hantent l'Europe

Des spectres hantent l’Europe
(lettre d’Idomeni)
(les migrants)
Se posent ici,
attendent et ne demandent rien,
seulement passer.
De temps en temps, se retournent vers nous
d’une réclamation incompréhensible,
absolue, hermétique.
Figures insistantes de notre généalogie oubliée,
délaissée, personne ne sait où et quand.
Dans ce vaste temps de l’attente,
nous enterrons leurs mort à la va-vite.
D’autres leur éclairent un passage dans la nuit,
d’autres leur crient de s’en aller
et crachent sur eux et leur donnent des coups de ped,
d’autres encore les visent et vont vite
verrouiller leurs maisons.
Mais ils continuent, eux, à travers la sujétion
dans les rues de cette Europe névrosée
qui « sans cesse amoncelle ruines sur ruines »
au moment même où les gens observent le spectacle,
depuis les cafés ou les musées,
les universités ou les parlements.
Niki Giannari, texte bilingue, dans Georges Didi-Huberman et N. G., Passer, quoi qu’il en coûte, éditions de Minuit, 2017, p. 13 et 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman et niki giannari, passer, quoi qu’il en coûte, des spectres hantent l'europe | ![]() Facebook |
Facebook |
10/10/2018
Pierre Reverdy, La guitare endormie

Panorama nocturne
Les étoiles sont près du toit et le reflet sur la façade
Un sillon tortueux creuse le sol autour de la colline
Du pavillon
Du temple
De la ville
Les trois chemins qui montent sont bordés de maisons
Des lampes éclatent en fruits lumineux entre les arbres noirs
Et les feuilles de bronze qui tombent du soleil
Là-haut il y a vraiment une tête et des épaules sous la neige
Mais tout le long des toits autour du cercle merveilleux
Des voix qui chantent
Pierre Reverdy, La guitare endormie, dans Œuvres complètes, I, Flammarion,
2010, p. 271.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, la guitare endormie, panorama nocturne, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
09/10/2018
Laurent Cennamo, L'herbe rase, l'herbe haute

À midi le poème
À midi le poème porte un mouchoir
sur la tête. Tu lisais sur le balcon. L’enfant
blond en été, la fleur de coquelicot qui dépasse
du muret de pierres sèches. Les grands chênes
poussiéreux à l’horizon, le Petit Salève
lavandière penchée au-dessus de son invisible
baquet d’où jaillit un nuage de papillons.
Tu lisais, toi aussi à l’envers. Écrire
Beaucoup plus tard serait comme traverser
Le miroir, écrire dans l’air, comme Tolstoï
Dans la petite gare, Kafka
sur la photographie fraiche contre le mur,
fourrure, épais manchon. Ton front brûlant,
comme le cygne plonge sa tête et son
long cou dans les eaux du lac,
éblouissantes. Tu es un enfant encore pour peu
de temps, bientôt le poème prend fin (il est
midi) le ciel bascule et le Petit Salève
comme une bille dans son château de bois
Laurent Cennamo, L’herbe rase, l’herbe haute,
Bruno Doucey, 2018, p. 47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent cennamo, l’herbe rase, l’herbe haute, lecture, enfance, miroir, kafka, tolstoï | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2018
Ingeborg Bachmann, Malina

Des livres ? Oui, j’en lis beaucoup, j’ai toujours beaucoup lu. Non, je ne sais pas si nous nous comprenons. Je lis de préférence par terre, ou sur mon lit, presque toujours couchée, non, les livres importent moins que la lecture, noir sur blanc, les lettres, les syllabes, les lignes, ces fixations inhumaines, ces signes, ces conventions fixes, ce délire issu de l’homme et figé dans son expression. Croyez-moi, l’expression en délire, elle provient de notre délire. Ce qui compte aussi, c’est le fait de feuilleter, de courir, de fuir d’une page à l’autre, d’être complice d’un épanchement délirant qui s’est coagulé ; ce qui compte, c’est la bassesse d’un enjambement, l’assurance de la vie dans une seule phrase, et la réassurance des phrases dans la vie. Lire est un vice qui peut se substituer à tous les autres pour nous aider à vivre, parfois ; c’est une débauche, une intoxication qui vous ronge.
Ingeborg Bachmann, Malina, traduction Philippe Jaccottet et Claire de Oliveira, Seuil, 2008 (1973), p. 77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, malina, philippe jaccottet et claire de oliveira, livre, lecture, vice | ![]() Facebook |
Facebook |
07/10/2018
Rémi Chechetto, Laissez-moi seul

(…) loin la mort, loin dans le pays laissé loin d’ici, loin dans le pays où je suis né, où nous sommes nés dans la lumière, la poussière, où nous portions les toits des maisons afin que la tranquillité habille et habite notre corps, où nous célébrions les fêtes, pleurions les défaites, où les terres portaient nos noms, où elles paraient nos noms de leurs pierres
et les feuilles des arbres s ‘élargissaient afin que l’ombre soit plus tendre, nous étions pain dans les chansons, et lune et robe et chemise et chemin solitaire, nous mêlions l’écho de nos voix aux voix de la colline, les dieux étaient les compagnons de nos veillées, ils nous servaient leurs mots, nous leur servions nos mets, nous pouvions tenter d’être ce que nous voulions, mettions nos pas dans ceux de l’avenir, ne levions les mains que pour accueillir et cueillir la pluie, et nous n’étions pas coupables d’être nés
d’être nés là
pas coupables
arriva la foudre, ou plutôt les bombes furent là, les fusils furent là, engendrant la foudre, prodiguant la foudre, la décuplant, comme arrivée de partout et partout là, partout, jusqu’à la présence de la foudre jusque sous ma peau, et la foudre me vola le soleil qui était mon pain, me vola le toit de ma maison, mes amandiers, mon chant, ma table, l’ombre tendre, mes mots en ordre et mes mots en désordre, ma famille, mes amis, ma boussole, mes blessures anciennes, me vola, décréta que ma terre ne portait pas mon nom et que mon nom était pire q’une quantité inutile, plus négligeable qu’un mégot
(…)
Rémi Chechetto, Laissez-moi seul, Lanskine, 2018, p. 8-9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rémi chechetto, laissez-moi seul, migrant, guerre, destruction | ![]() Facebook |
Facebook |
06/10/2018
Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque

(…) dans ces années d’enfance, (…- Auschwitz était encore proche dans les familles qui, tout en buvant du thé trop chaud au citron, ne cessaient de dénombrer ceux des leurs qui n’étaient jamais revenus.
Mais le fait est là. Auschwitz, c’était l’enfer, une autre planète, absolument, et un temps désormais hors d’atteinte pour une mémoire humaine. Inassimilable, ce passé ne cessait cependant jamais de recharger le présent. Ces intensités d’absence formaient une poche pleine d’oubli où nos existences puisaient leurs jours et leurs nuits.
Et l’enfant était pris dans une mémoire obligée aux images d’un feu blanc, inabordables.
Cependant, même sans contenu disponible, la mémoire est un instrument de deuil. Irrémédiablement liée à l’absence, à la mort et aux morts. La mémoire c’est même la seule chose qui nous reste de la mort d’autrui. Et de la mort on ne connaît que la mémoire des vivants. Mais cette mémoire-là, lieu où l’exercice quotidien s’accomplit à notre insu, n’a pas grand chose à voir avec la reconnaissance d’un passé historique. Elle est, cette mémoire, hantée par une absence fondatrice. Et de cette absence du mort à la mémoire il n’y a qu’un pas que vient combler l’oubli. Il porte alors nos existences.
Comment dire pourquoi il arrive qu’on puisse si bien se passer d’un vivant et tellement moins bien du mort ? Où a-t-on mal d’une absence qui est cette part de l’autre qui nous blesse ? La mémoire a beau être blanche, et même silencieuse, elle n’en demeure pas moins. Et elle persiste cette fraction intime qui nous anime tout en restant inassimilable.
Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque, ‘’La Librairie du XXIesècle, Seuil, 2017, p. 97-98.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice olender, un fantôme dans la bibliothèque, mémoire, oubli, absence, passéauschwitz | ![]() Facebook |
Facebook |
05/10/2018
Images d'été (Bretagne)


Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images d'été, bretagne | ![]() Facebook |
Facebook |
04/10/2018
Jacques Moulin, L'Épine blanche

Un mois sans toi
Sans feu ni lieu de toi
Sans mère ni voie
Cheval perdu
Sans voix sans toi
Corne de brume
Mouillure aux yeux
L’humeur des vitres après l’embrun
Du brou en gorge
L’automne des noix
Et coque vide
Jacques Moulin, L’Épine blanche, L’Atelier
contemporain, 2018, p. 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques moulin, l’Épine blanche, disparition, automne | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2018
Cioran, Syllogismes de l'amertume
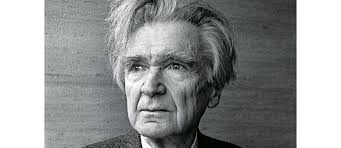
Pourquoi vous retirer et abandonner la partie, quand il vous reste tant d’êtres à décevoir ?
Ne me demandez plus mon programme, respirer, n’en est-ce pas un ?
On se découvre une saveur aux jours que lorsqu’on se dérobe à l’obligation d’avoir un destin.
Espérer, c’est démentir l’avenir.
Passé la trentaine, on ne devrait pas plus s’intéresser aux événements qu’un astronome aux potins.
Cioran, Syllogismes de l’amertume, Idées / Gallimard, 1976, p. 81, 83, 85, 89, 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, syllogismes de l’amertume, déception, destin, programme | ![]() Facebook |
Facebook |
02/10/2018
Olivier Domerg, En lieu et place

Doit-on et peut-on composer un chant avec les manquements, les corrosions, les destructions, les vétustés, avec ce qui fut négligé, brisé ou abîmé ? Avec les entorses, les substitutions, les détails malheureux ou malencontreux ? Doit-on et peut-on composer un chant avec tous ces éléments disparates ?
Peut-on chanter l’inachevé ? La fuite sans retour ? L’abandon du chantier ?
Peut-on distinguer ce qui aurait dû être de ce qui est ? Voir la trame du projet initial à travers la réalisation finale ? Et doit-on regretter ce qui ne vit pas le jour ? Ce qui reste à l’état de maquette et de croquis ?
La volonté défaite. L’incomplétude de l’œuvre. Le gouffre du temps long. La difficulté du ex nihilo. Le naufrage d’une telle entreprise dans la durée.
[…]
Olivier Domerg, En lieu et place, L’Atelier contemporain, 2018, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier domerg, en lieu et place, chant, inachevé | ![]() Facebook |
Facebook |
01/10/2018
Albert Cohen, Carnets, 1978
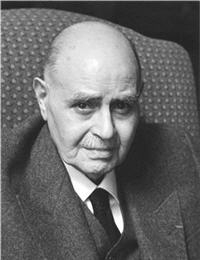
Lorsque je me couche sur ma droite et que je ferme les yeux pour m’endormir, j’ai peur de ma mort et je suis scandalisé. Je n’accepte pas de perdre mes yeux qui étaient une partie de mon âme. Mon âme n’est pas un impalpable ectoplasme à gogos. Mon âme, c’est moi. Ce n’est pas de la philosophie, cette filandreuse toile d’araignée toute de tromperies, mais une grenue et indestructible petite vérité tout à fait vraie. Oui, tout ce que vous voudrez, dites tout ce que vous voudrez, mais ma petite vérité est bon teint. Mon âme, c’est mon corps et non un magique souffle. Or, je n’accepte pas de ne plus bouger, moi dont la main droite en cette minute studieusement bouge. Je n’accepte pas que moi qui suis ne soit plus, et bientôt plus. Quelle aventure que ce mobile que je suis soit bientôt immobile et de toute éternité.
Albert Cohen, Carnets, 1978, Gallimard, 1979, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert cohen, carnets, 1978, sommeil, mort, âme, corps | ![]() Facebook |
Facebook |






