30/11/2018
Fresques du XVème siècle, église de Saint-Méard-de-Drône, Dordogne





29/11/2018
Shakespeare, Sonnet

Sonnet CXXXV
Chacune a ce qu’elle désire, toi tu as ton Oui,
et Oui en prime, et Oui encore plus ; plus
qu’assez je suis ce qui te vexe encore quand
ainsi je m’ajoute à ton doux Oui ; toi dont le
Oui est large et spacieux, m’accorderas-tu de
cacher mon Oui dans le tien ? En d’autres
Oui semblera digne et pour mon Oui pas
l’ombre d’un je veux bien ? La mer toute
d’eau reçoit bien encore la pluie qu’elle ajoute
abondante à son magasin ; toi riche en Oui
ajoute pareil à ton Oui ce Oui de moi qui
fera ton Oui plus large encore. Un « Non ! »
cruel est tuant pour les prétendants ; pense-
les tous un seul, et moi dans ce seul Oui.
Shakespeare, traduction Pascal Poyet, dans
Koshkonong, n° 15, automne 2018, p. 1.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnet cxxxv, pascal poyet, oui | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2018
Malcolm Lowry, Pas de compagnie hormis la peur (traduction Jean Follain)

Pas de compagnie hormis la peur
Comment tout a-t-il donc commencé
et pourquoi suis-je ici à l’arc d’un bar à peinture brune craquelée
de la papaya, du mescal, de l’Hennessy, de la bière
deux crachoirs géants
pas de compagnie sauf celle de la peur
peur de la lumière du printemps
de la complainte des oiseaux et des autobus
fuyant vers des lieux lointains
et des étudiants qui s’en vont aux courses
des filles qui gambadent les visages au vent,
pas de compagnie hormis celle de la peur
peur même de la source jaillissante.
Toutes les fleurs au soleil me semblent ennemies
ces heures sont-elles donc mortes ?
Malcolm Lowry, Poèmes inédits, traduction Jean
Follain, dans Les Lettres Nouvelles, ‘’Malcolm
Lowry’’, Mai-juin 1974, p. 229.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Lowry Malcolm | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : malcolm lowry, pas de compagnie hormis la peur, jean follain | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2018
Jean Tardieu, On vient chercher Monsieur Jean
Une bouteille à la mer
Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, c'est-à-dire jusqu'à ces moments privilégiés où un enfant commence à prendre conscience de lui-même et de ce qui l'entoure, il me semble avoir toujours entendu une certaine voix qui résonnait en moi, mais à une grande distance, dans l'espace et dans le temps.
Cette voix ne s'exprimait pas en un langage connu. Elle avait le ton de la parole humaine mais ne ressemblait ni à ma propre voix ni à celle des gens qui me connaissent. Elle ne m'était pourtant pas étrangère, car elle semblait avoir une sorte de sollicitude à mon égard, une sollicitude tantôt bienveillante et rassurante, tantôt sévère, grondeuse, pleine de reproches et même de colère.
Les moments où j'entendais cette voix étaient ceux où ma vie paraissait suspendue dans le vide, interrompue, arrêtée, comme une horloge dont on ne voit plus bouger les aiguilles et dont on n'entend plus le battement.
Cette expérience très ancienne, primitive, sauvage, surtout secrète (car je n'en parlais à personne), s'est reproduite souvent au cours de mon existence, mais jamais elle n'a été aussi expressive, aussi intense que pendant mon extrême jeunesse, car rien ne pouvait alors en fausser la signification : elle résonnait dans une étendue absolument vacante, absolument solitaire.
Jean Tardieu, On vient chercher Monsieur Jean, Gallimard, 1990, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, on vient chercher monsieur jean, une bouteille à la mer, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2018
Buson, le parfum de la lune

toute la nuit
sans un bruit la pluie
sur des sacs de graines
jour de pluie
loin de la capitale
une demeure dans les fleurs de pêchers
hésitant à le jeter
je pique le rameau de saule en terre
le son de la pluie
nuit courte
une averse
sur l’auvent en bois
au bord du chemin
des jacinthes d’eau arrachées fleurissent
la pluie du soir
Buson, le parfum de la lune, traduction Cheng
Wing fun et Hervé Collet, Moudarren,
1992, p. 39, 49, 53, 73, 80.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : buson, le parfum de la lune, plie, fleurs, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
25/11/2018
Jules Supervielle, Le Forçat innocent

Le miroir
Qu’on lui donne un miroir au milieu du chemin,
Elle y verra la vie échapper à ses mains,
Une étoile briller comme un cœur inégal
Qui tantôt va trop vite et tantôt bat si mal.
Quand ils approcheront, ses oiseaux favoris,
Elle regardera mais sans avoir compris,
Voudra, prise de peur, voir sa propre figure,
Le miroir se taira, d’un silence qui dure.
Jules Supervielle, Le Forçat innocent, dans Œuvres complètes,
édition Michel Collot, Pléiade / Gallimard, 1996, p. 280.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, le forçat innocent, miroir, cœur, vie, peur | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2018
Charles Reznikoff, La Jérusalem d'or : recension
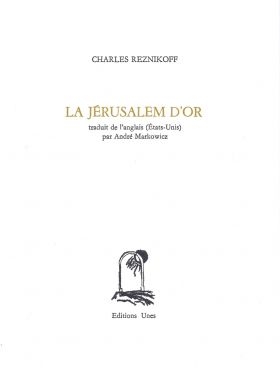
Longtemps ignoré en France, comme les autres poètes du mouvement objectiviste1(Louis Zukofky, George Oppen, Carl Rakosi notamment), Charles Reznikoff (1894-1976) est aujourd’hui largement traduit. The Golden Jerusalem l’a d’abord été partiellement par Jacques Roubaud en 1977 (8 poèmes), ensuite par Sabine Macher en 2000 (15 poèmes).2Publiés en 1934, les 79 poèmes, numérotés et parfois titrés — le dernier a le titre de l’ensemble —, sont de dimension très variable : un seul vers pour le 29ème, plus de trois pages pour le 75ème.
Le livre s’ouvre par des références à la tradition hébraïque, le nom de Sion et l’allusion au Cantique des cantiques avec le passage où Salomon chante l’amour de la Sulamite. Il est d’autres renvois au Tanakh, certains poèmes sont même construits à partir des livres sacrés ; à partir : cela signifie que Reznikoff les retient non pour un retour à un passé révolu mais pour vivre le présent. Ce qui importe par exemple dans le poème issu de Josué, XXIV, 13, c’est la mise en valeur du mouvement des Hébreux, chassés par leur dieu dès qu’ils commencent à se sédentariser ; dispersés, ils deviennent « citoyens des grandes villes, / parlant hébreu dans toutes les langues sous le soleil ». De même le théologien juif Luzzato a quitté Padoue où il vivait pour se rendre à Jérusalem, comprenant la nécessité de l’exil pour lire autrement les textes de la tradition, « j’ai perdu ma patience devant ce que disent les rabbins », lui fait dire Reznikoff. Presque toutes les évocations de la tradition mettent l’accent sur la nécessité de garder en mémoire ce qui appartient à une culture et, en même temps, de penser le passé par rapport à aujourd’hui ; écrire avec ce qui nous a précédés : un poème, titré "Les Anglais en Virginie, avril 1607" est accompagné d’une note pour préciser qu’il a emprunté des données aux « Œuvres du capitaine John Smith publiées par Edward Arber ». Si l’on revient aux premiers poèmes du livre, on construit le passage de la tradition à la vie contemporaine, ainsi des vers sur la « lune dévergondée » « montrant son sein de rose et d’argent / à la ville tout entière, » précèdent une allusion à des « rois David » aux affaires aujourd’hui et à une Bethsabée au bain. Ainsi, après les vers relatifs à la destruction d’Israël — les Hébreux ayant négligé leur Dieu, préoccupés par des choses futiles (« envoyer des baisers à la lune ») — le narrateur s’interroge : « que doit-il m’arriver / à moi qui regarde la lune, les étoiles et les arbres ? »
Il n’arrivera rien au marcheur dans la ville — Reznikoff vivait à New York —, sinon toujours rencontrer la lune lors de ses errances, nocturnes ou non, la lune et ce qui appartient auss à la vie d’une ville : les changements visibles de saison, la neige de l’hiver puis sa disparition et, alors, « les haies ont reverdi, les arbres sont verts. » Au cours de ses marches survient l’inattendu, un moineau seul au milieu de la rue qui finit par s’envoler « dans un arbre poussiéreux ». L’irruption d’éléments de la nature dans le monde urbain y introduit parfois des caractères à la limite du fantastique ; un jour, deux chevaux, l’un noir l’autre blanc qui tirent une charrette « semblent fabuleux », un autre jour, le narrateur rencontre un cheval présenté comme s’il était seul, « Que fais-tu dans notre rue au milieu des voitures, cheval ? Comment vont tes cousins, le centaure et la licorne ? » La présence de la nature dans la ville, avec les feuilles et les fleurs, est signalée à plusieurs reprises ; ici, on arrive à un « arbre blanc de fleurs », là, « Sur le chemin du métro, ce matin / le vent nous souffle des poignées de pétales blancs ».
Ce n’est pas dire que la ville est un lieu de vie idéal ; on voit des mouettes blanches voler, mais c’est au-dessus du fleuve « où les égouts déversent / leurs vaguelettes lentes », la fumée des pots d’échappement d’un « bleu brouillé » figure des fleurs, mais des « fleurs puantes ». Cependant, pour le marcheur, c’est le métro, évoquant le monde souterrain de la mythologie grecque avec Héphaïstos, qui représente ce que la ville a de plus détestable : image d’une forêt, mais « bois de piliers d’acier », « terre stérile », « lumière sans crépuscule », et partout poussière, bouts de papiers. Les papiers ne sont certes pas rares dans la rue, ils n’ont pourtant pas le même aspect, « pas un morceau qui n’ait souffle de vie ». Ce qui domine, dans la vision du marcheur, c’est la capacité des éléments naturels à absorber et transformer les détritus rejetés dans le fleuve par les hommes :
Lorsque le ciel est bleu, l’eau, sur fond de sable, est verte.
On y déverse des journaux, des boîtes de conserve,
un ressort de sommier, des bâtons et des pierres :
mais les uns, les eaux patientes les corrodent, les autres
une mousse patiente les recouvre.
La ville est aussi un milieu où l’amour a sa place. Reznikoff approuve les pratiques simples, anciennes pour dire le sentiment amoureux : « le cœur et les flèches — les soupirs, les yeux embués ; et les vieux poèmes — je les crois vrais ». La pauvreté d’une partie importante de la population dans les années 1930 des États-Unis pourrait expliquer la forme choisie des échanges amoureux, mais il y a aussi fortement le refus du paraître dans leur expression : offrir un café plutôt qu’une fourrure, apprécier la beauté des réverbères plutôt que celle d’un autre pays, sont de vraies marques d’amour, et l’aimée ne s’y trompe pas, « c’est bien assez, disait-elle ».
Il n’est pas toujours aisé de lire Reznikoff, il me semble que la traduction, au plus près du texte, nous y aide : elle restitue avec justesse son écriture sans apprêt et il appartient alors au lecteur de reconstruire un contexte. Il y a dans La Jérusalem d’or un souci constant de ne pas hiérarchiser les cultures, de ne pas se figer sur un moment du temps — le dernier poème commence avec "Le livre de Juda", continue avec "Le bouclier de David", puis "Spinoza" et s’achève avec "Marx". Un souci également d’insister sur la valeur du mouvement, de l’exil même, pour s’ouvrir aux choses du monde sans préjugé.
__________________________________________________________________
1 À lire, la conférence de P. Blanchon et É. Giraud, Des objectivistes au Black Mountain College, La Nerthe, 2014.
2 Europe, juin-juillet 1977 pour les traductions de Jacques Roubaud, reprises dans Traduire, journal, NOUS, 2018 ; If, n 16 ; 2000, pour celles de Sabine Macher.
Charles Reznikoff, La Jérusalem d’or, traduction André Markowicz, édition unes, 2018, np, 15 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 20 octobre 3018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles reznikoff, la jérusalem d’or, traduction andré markowicz, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2018
Jacques Moulin, Sauvagines

Regard de clairière
Paupières feuillues
Œil de lynx
Oreilles sylvestres
Nez en l’air jusqu’à terre
Nez en flair avec
L’humus l’humeur des vents
L’ardeur des fumées
L’honneur du poil ou de la plume
Mains moussues
Corps tendu vers l’attente l’accueil
Il avance sans appareil photo
— l’appareil ne l’appareille jamais
Il avance toutes antennes offertes
Live sauvagement live
Il ne vient pas faire photo
Gonfler l’album thésauriser le cliché
Jouer la montre la démonstration
Il vient comprendre attendre entendre
Goûter à l’espace apprécier les lieux
Se dissoudre en eux
Garantir sa communion avec le vivant
Il est vivant au sein du vivant
Comme la pierre il est posé là
Dans le mitan du monde
Un coup de sécateur — sa dentition sauvage
Et il attend il observe il écoute il respecte
Il est à l’affût il s’affûte corps et esprit
[…]
Jacques Moulin, Sauvagines, éditions la clé à molette, 2018, p. 27-28.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques moulin, sauvagines, image, jeu de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2018
Figures de l'art roman




Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2018
Ana Tot, mottes mottes mottes

l’éternel détour
expulsé s’entend
sans retour
définitif pourtant
qu’est-ce que c’est
le déversé est absorbé
le répandu évaporé
une seule plongée
dans la même eau
pas davantage
mais la rivière l’ignore
au demeurant s’écoule
et s’écoulant demeure
irréversible est vue d’esprit
qu’espoir et désespoir
à parts égales égarent
le ponctionné quand on y pense
si ça nous chante o l’y reverse
dans le cours d’eau ou d’autre chose
ou dans le cours tout court des choses
Ana Tot, mottes mottes mottes, le grand os,
2018, p. 54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, mottes mottes mottes, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2018
Basho, seigneur ermite

Cette eau de source,
est-ce la pluie printanière
s’égouttant des cimes des arbres ?
Séparons-nous maintenant
comme un bois de cerf se ramifie
au premier nœud
Pieds lavés,
je m’endors pour une courte nuit
tout habillé
À l’extrémité de la feuille
au lieu de tomber
la luciole s’envole
Ruines d’un château —
je visite en premier
l’eau limpide de l’ancien puits
Basho, seigneur ermite, l’intégrale des haïkus,
édition bilingue Makoro Kemmoku et
Dominique Chipot, La Table ronde,
2012, p. 168, 172, 175, 177, 180.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : basho, seigneur ermite, pluie, séparation, luciole, château | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2018
Jean-Luc Sarré, Bardane

Feuilles mortes
(il en reste)
vieux chiffons
déchets
on fourre on entasse
on bourre
mais pas trop
on brûle en face
au fond d’une cour
dans un bison rouillé
l’hiver dont les volutes s’élèvent
entre la mer et ce balcon
où je disperse les mietets
d’un poème fragile
Jean-Luc Sarré, Bardane, farrago,
2001, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2018
Jean Tardieu, Da capo
Le procès de la mante religieuse
Mais oui ! Messieurs les juges
J’ai mangé mon mari
Mas oui je l’ai mangé
Elle rabâche elle balance
Ses antennes de télégraphe
Gauche droite elle vacille végétale
Elle tangue bateau sans ses voiles
Triangle cornu
Implacable et nu
Pourquoi me punir
Je n’ai rien fait de mal
J’obéis à ma loi
Qui échappe au tribunal
Mais oui je l’ai aimé
Voilà pourquoi
Je l’ai mangé
Elle se dandine
Longues cuisses vertes
La force la forfaiture
Et la démente nature
Et si vous continuez
Messieurs les juges
Je vais manger vos hermines
Comme di je vous aimais
Je suis la veuve éternelle
Jean Tardieu, Da capo, Gallimard, 1995, p. 48-49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, da capo, le procès de la mante religieuse | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2018
Guillaume Apollinaire, Calligrammes

L’avenir
Soulevons la paille
Regardons la neige
Écrivons des lettres
Attendons des ordres
Fumons la pipe
En songeant à l’amour
Les gabions sont là
Regardons la rose
La fontaine n’a pas tari
Pas plus que l’or de la paille ne
[s’est terni
Regardons l’abeille
Et ne songeons pas à l’avenir
Regardons nos mains
Qui sont la neige
La rose et l’abeille
Ainsi que l’avenir
Guillaume Apollinaire, Calligrammes, avril
1918, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 300.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume apollinaire, calligrammes, avenir, rose, abeille, guerre | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2018
Jean Tortel, Du jour et de la nuit
Dure prairie
Table de joie
Le muscle épie
Votre cassure.
Vous immobile
Vous retenez
Comme un lutteur
Sa défaillance
Ce qui remonte
Des profondeurs
Et vous disperse.
Jean Tortel, Du jour et de la nuit,
Jean Vigneau, 1944, p. 93.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tortel, du jour et de la nuit, prairie, force | ![]() Facebook |
Facebook |






