05/12/2018
Cécile A. Holdban, Toucher terre : recension
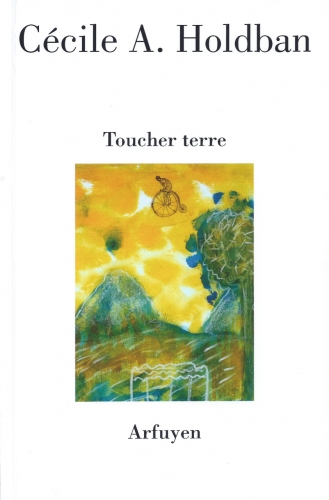
On ne peut qu’être attentif au titre du dernier livre de Cécile A. Holdban : c’est aussi celui de la quatrième partie (après "Labyrinthe", "Demeure" et "Voix") et du poème qui termine l’ensemble. Ce motif mis en avant du lien étroit à la nature (arbres, fleurs, oiseaux, ruisseau, soleil) est une ouverture après un parcours où la mélancolie est très présente, même si l’introduction d’autres voix que la sienne la tempère. En effet, à côté de citations de Celan, Pizarnik et (en anglais) de Poe, d’un titre de poème tiré de Rimbaud ("C’est la mer allée avec le soleil"), C. A. H. introduit, sur le même plan que ses textes, ses traductions de poètes des États-Unis (Linda Pastan, Howard McCord) et de Hongrie (János Pilinszky, Sándor Weöres)(1).
Très souvent, la narratrice évolue dans un monde étouffant qui n’offre guère d’échappées — « il y a des murs de tous côtés » —, où la nuit semble ne jamais finir : elle génère le trouble, parfois l’angoisse quand elle est vécue comme « une soupe épaisse tournant autour du gouffre ». Si pour certains romantiques la nuit était le moment favorable au rêve et aux visions fantastiques, pour d’autres c’était plutôt le moment du retour sur soi, de la solitude, le moment souvent d’une détresse que rien ne pouvait apaiser, et c’est ce côté sombre que l’on retrouve dans Toucher terre. Le « ciel obscur » emporte « tous nos repères » et contribue ainsi à ce que le sujet ne sache plus ce qu’il est, comme s’il lui fallait toujours la lumière et une image de lui pour se reconnaître comme tel. Il y a avec la nuit comme un effacement de la personne dans la mesure où elle ne se perçoit plus au milieu des choses : « Dans la nuit parfois nos mains tremblent et tâtonnent / sans jamais saisir qui nous sommes » (à un autre endroit du texte ce sont les doigts qui tremblent) — tremblement qui ne peut assurer une relation aux choses autour de soi.
Les figures d’une identité difficile à construire, ce sont un Jonas sans mémoire, une Ophélie dont l’O du nom — l’eau de la disparition, du sommeil de la mort — est la métaphore de l’oubli. Ce sont aussi les poupées russes ; dans un poèmes titré "Matriochkas", la narratrice quitte le présent pour tente de saisir des moments du passé, c’est-à-dire ce qui n’est plus susceptible de changement, « Miroir, devant toi je me déplie / cherchant l’image de ce que je fus ». Sans doute peut-on écrire que ce temps de l’enfance était celui où seul l’avenir comptait (« je suis encore la fillette qui s’élance »), mais sans illusion : l’image d’une autre qui existait dans le labyrinthe du passé, reconstruite, n’empêche pas de se dire « tu avais oublié que grandir fait mal ». L’enfance a disparu et la tentative de revenir en arrière n’aboutit qu’à mettre provisoirement entre parenthèses le présent, moment terrible puisqu’il implique la suppression de l’Autre et de soi, « je me retourne je t’oublie je m’oublie disparition ».
Un des poèmes traduits, "Labyrinthe droit" (János Pilinszky), dit par l’oxymore de son titre que l’issue consiste seulement à suivre le « couloir brûlant » jusqu’à la chute. N’y aurait-il rien autre qu’une « Vie constellée de pierres mornes et sans relief », pierres qui, selon Howard McCord « ne chantent jamais » ? La narratrice donne l’image saisissante de la photographie d’un paysage que l’on a voulu conserver sur un mur : avec le temps, le papier glacé est « troué percé en lambeaux ».
Dans ce qui apparaît de toutes parts désaccordé, sortir du tragique ne peut se faire que par le désir de « toucher terre », de vivre en accord avec les choses du monde. Ainsi, regarder les eaux du torrent apaise un peu puisqu’elles sont toujours semblables à elles-mêmes, « Le temps dont nous manquons ne manque plus, métamorphoses liquides ». Ainsi l’enfance retrouvée l’est par une relation à un arbre, « résine, miel amer, l’enfance toute entière / dans une goutte », et la reconnaissance de soi ne passera plus par une image du passé mais par l’effort de s’interroger dans le présent, et il n’est pas indifférent que ce soit la métaphore du berger et de la marche qui l’introduise :
berger sans bâton ni carte
je marche en moi-même
pour puiser ce qui me constitue
sans l’aide du miroir
Une relation heureuse est établie avec les oiseaux qui symbolisent l’envers de la matière pesante ; ils sont nombreux dans Toucher terre : hirondelle, mouette, martinet, bruant, chouette…, présents même métaphoriquement, liés à l’enfance (« Les oiseaux de ses mains rappellent la clarté et le froid de l’enfance »), à l’écriture (« des oiseaux palpitants dans les mots ») et ils figurent aussi une liberté rêvée : « mon destin d’oiseau ». Ces oiseaux sont toujours, comme celui de Prévert, dans « le vert feuillage, la fraîcheur du vent, la poussière du soleil », tout à fait contraires au « chant désaccordé de l’orage », et seul vrai remède à la mélancolie.
———————————————————————————————
1. Cécile A. Holdban a publié des traductions de poètes hongrois (Sándor Weöres, József Attila, Karinthy Frigyes) et, avec Thierry Gillybœuf, de Howard McCord.
Cécile A. Holdban, Toucher terre, Arfuyen, 2018, 120 p., 14 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 5 novembre 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, toucher terre, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2018
Cécile A. Holdban, Toucher terre

Autour d’elle
Des images se retournent dans l’ombre
Si simple la nuit assise au fond du corps
d’être pur langage, vérité d’une origine
inscrite.
Sortilège du son
on achève l’orage dans le creux d’une oreille
des chevaux mortellement blessés se brisent
entraînent dans les tranchées l’infini galop des mots
la lumière creuse plus profond dans ce rêve
en perles sur la peau d’une rosée nocturne
le temps chaviré du poème parmi
les interstices de la foudre.
Mais balbutiant il faudra tout reprendre
de la gorge au souffle, resserrer le jour et sa robe trop courte
comme un vêtement d’amour
sur les restes en pièces de la nuit.
Quelque chose tombait dans le silence. Un son de mon corps. Mon dernier mot fut je mais je parlais de l’aube lumineuse.(Alejandra Pizarnik)
Cécile A. Holdban, Toucher terre, Arfuyen, 2018, p. 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, toucher terre, image, souffle, rêve, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |





