01/06/2023
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride
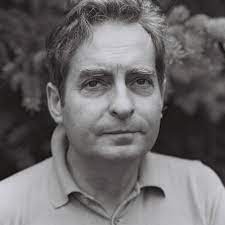
Il faut gagner — phobie de vieillir, de dépérir, névrose : je me désagrège. C’est le remords qui me corrode, un faux remords, comme d’une folie dont je dois (pas de futur) disposer, tenir le haut du papier
pavé
Sans perte de vitesse à la hauteur de ce cahier que je ferme avec un bruit sec, de la voiture qui démarre, du départ, et de tous les emballements, plus simplement à la hauteur de toutes les déceptions. Moyen de ne pas les provoquer.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le bruit du temps, 2011, p. 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
31/05/2023
Cédric Demangeot, Obstaculaire

Oui, rien ne me suit,
me précède et me tient.
Verdeurs, verdures,
salopes journalières
connaissent ma dent.
Connaissent l’impatience :
au loin ma face fuse
et j’entre dans les ânes
à pas un contre cent.
Cédric Demangeot, Obstaculaire,
L’Atelier contemporain, 2022, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, obstaculaire, suivre, manger | ![]() Facebook |
Facebook |
30/05/2023
Cédric Demangeot, Obstaculaire
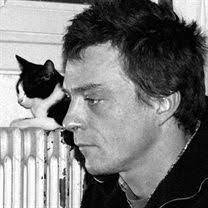
À la barre donc
du blanc d’une orée
vient un homme :
il n’a pas ses pas.
Sans ses pas il va
penser — épuiser
quel temps de parole
et contre quel quai.
Quoi chavirer
lance-t-il au juge
si j’ai des jambes
qu’elles pendent.
Et si j’ai des villes
qu’elles brûlent :
on n’a pas mon nom.
Cédric Demangeot, Obstaculaire,
L’Atelier contemporain, 2022, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, obstaculaire, parole, nom | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2023
Cédric Demangeot, Promenade et guerre

l’accordée caresse à l’angoisse
qu’est la peau
la paume la paupière pour
apaisement
le manteau dévasté de la paix
du détruit
la peau ce n’est pas elle
qui parle
oh les beaux
animaux de l’effroi
: cambrés, cri
blés de balles
ignorantes de leur fuselage
Cédric Demangeot, Promenade et guerre,
Poésie/Flammarion, 2021, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demandent, promenade et guerre, peau, paix | ![]() Facebook |
Facebook |
28/05/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités
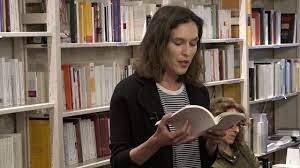
Brève histoire au regard de l’infini mouvement des astres, des cendres jetées au croisement d’une mer & et trois océans, par exemple, repoussent au loin la décomposition, alors
Si elle porte ses fruits & s’il y a quelque chose de caché entre ses feuilles, un dépôt, une masse en lévitation, le « A » de quelque choses, tracé sur la poitrine de celle qui
Garde à l’ombre ce tout petit ceci que nous avons de commun, en somme le sujet ne sera pas traité du pont de vue de la science, ni de l’anecdote, ni du sentiment, nous nous en tiendrons au matérialisme le plus tendre
De même qu’après la discussion portant sur l’existence d’une semence féminine, un sang rouge coule sur le sol & à l’endroit où il a coulé pousse une fleur également rouge.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Éric Pesty éditeur, 2023, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, vanités, mouvement, discussion | ![]() Facebook |
Facebook |
27/05/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités
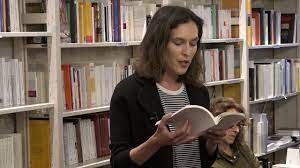
« Fleurs » : j’ai dit ce mot par prudence, mais il importe peu. Tout ce qui bat et s’agite, cherche refuge.
On l’appelle aussi « petite chose », comme on le dit d’une personne hors de portée, aspirant l’air par les pieds
Plutôt que de prendre racine, nous passons ; construire une maison n’est plus notre propriété
Où nos pas nous portent, nous allons les pas chargés d’indices, suivant les lignes futures d’un mystère probable.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Érid Pesty éditeur, 2023, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, vanités, fleur, mouvement, avenir | ![]() Facebook |
Facebook |
26/05/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités

Un monde vit sous ce monde, dedans, dessus, invisible& dans l’air, mêlé à nos liquides, circule en nous, inaperçu
Tout existe à l’état mélangé & caché, dispersé en mille particules, sous la terre, peu importe dans quelle région de l’univers où tu te situes
Coquillage, génération dorée des paons, insecte géant qu’on appelle cerf-volant, parfum de myrrhe, saveur de vanille, débris blancs, coques, antennes, proues, nymphes, expression d’une multitude imbriquée
Choses nombreuses & qui errent, rebondissant sans fond à travers le vide, agitées d’accords & de désaccords, changent de route, en tous sens.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Éric Pesty éditeur, 2023, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie e quatrebarbes, vanités, mélange, dispersion, contraires | ![]() Facebook |
Facebook |
25/05/2023
Lorand Gaspar, Gisements
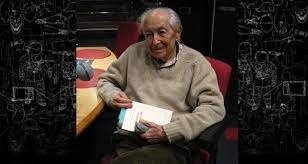
Et plus insoutenable encore le bonheur
Et le reproche cinglant du visage qui sait
Indubitablement ce seul indubitable
Celui qui nu
Détaché comme une poutre d’un incendie
Continue ce déplacement insensé et joyeux
Sans ornements d’espoir
Sans la moindre explication cohérente
Ayant mis tout son calme
Sa précision dans la folie.
Lorand Gaspar, Gisements, Poésie/Flammarion,
1968, p. 62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lorand gaspar, bonheur, espoir | ![]() Facebook |
Facebook |
24/05/2023
Lorand Gaspar, Gisements
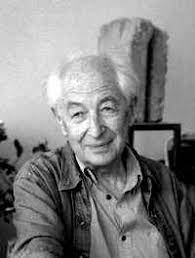
Les mots nous gardent. Et nous perdent.
C’est l’heure d’automne d’un lent dimanche
Un peuple gris tombe lourd et loin
(Est-ce toujours la même distance qui nous écarte ?)
Comme si tout le gris et tout le noir
Était quelque part
Déjà compris.
Des bancs de poissons souples et prestes
Traversent la peau et riant d’écailles
Se tournent sur le dos
Dans les chambres où se fait noir le sang
Il y a ces rapides éclairs de mots blancs.
Et je voudrais tout dire, tout,
Voici des sons du fil et des aiguilles
Voici un piano et des instruments à vent ;
On joue le plus doucement possible
Et déjà on n’entend plus rien.
Lorand Gaspar, Gisements, Poésie/Flammarion,
1968, p. 52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lorand gaspar, gisementsmot, sang | ![]() Facebook |
Facebook |
23/05/2023
Lorand Gaspar, Sol absolu
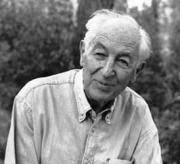
Impatients à briser l'horizon pour un autre
le même plus loin, plus loin le pays
où plus rien n’est secourable.
Et votre chute sans fin de même couleur que l’air
en ce vide médian de l’attente de l’arbre
l’oiseau s’est posé quelque part dans l’espace :
regarde comme il congédie la proue des hauteurs !
A l’endroit des mots
ce ravin de la danse qui chaque jour
défait les rayons de la roue.
Lorand Gaspar, Sol absolu, Gallimard, 1972 , p. 50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lorand gaspar, sol absolu, horizon | ![]() Facebook |
Facebook |
22/05/2023
Philippe Jaccottet, Le dernier livre de Madrigaux
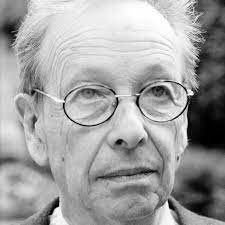
Tous les blés flambent
et la brève alouette est un fragment ascendant de ce feu.
Elle ne gravit tous les paliers de l’air
que parce que le sol est trop brûlant.
Il est une beauté que les yeux et les mains touchent
et qui fait faire au cœur un premier degré dans le chant.
Mais l’autre se dérobe et il faut s’élever plus haut
jusqu’à ce que nous autres ne voyions plus rien,
la belle cible et le chasseur tenace
confondus dans la jubilation de la lumière.
Philippe Jaccottet, Le dernier livre de Madrigaux,
Gallimard, 2021, p. 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, le dernier livre de madrigaux | ![]() Facebook |
Facebook |
21/05/2023
Jean Follain, Appareil de la terre
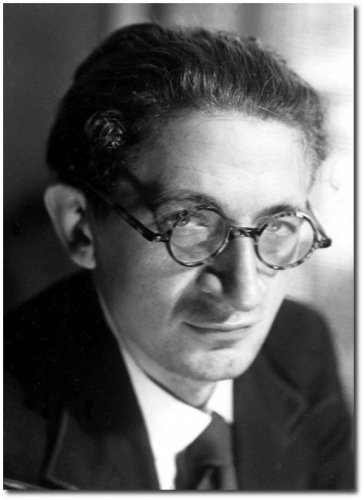
Solitaires
Toujours leur porte s’ouvre mal
derrière eux s’endort la bête
couleur de feu
au seul pas d’homme ou de femme
ils reconnaissent qui passe
sur la route tournante
regardent un instant
pendant du plafond noir
la lampe ornée
une plante verte ocellée meurt pleure un enfant perdu
sous le vaste ciel bas
puis il neige enfin.
Jean Follain, Appareil de la terre, Gallimard, 1964, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Follain Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, appareil de la terre, solitaires | ![]() Facebook |
Facebook |
20/05/2023
Jean Follain, Appareil de la terre
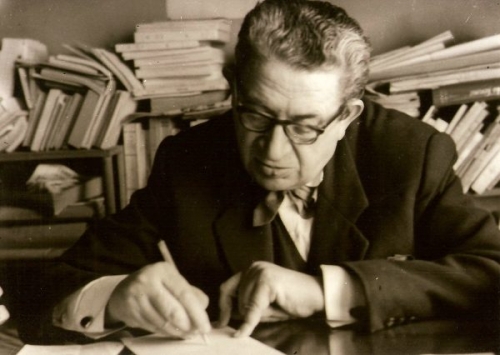
Une fille penchée
Une fille à traits purs
se penche sur des chaudrons.
Le paisible entre ddans la cour
près du seuil lavé
à grandes eaux
tousse pour avertir
des lueurs voguent
autour des pieds féminins
restés nus.
Les volailles à peine s’effarent
sans besoin de consolation
dans le soleil levant.
Jean Follain, Appareil de la terre,
Gallimard, 1964, p . 56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Follain Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, appareil de la terre, ue fille penchée | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2023
Jean Follain, Usage du temps

Fouilles d’’enfance
Les enfants qui vont fouiller dans les greniers où sont les mannequins noirs les oignons, les issues le sac de papier brun où reste de l’anis étoilé connaîtront un jour les tracas et sauront ce qu’il en coûte de rechercher les voluptés et d’épouser la courbe délicieuse.
Jean Follain, Usage du temps, Poésie/Gallimard, 1984, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Follain Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, usage du temps, fouilles d'enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
18/05/2023
Jean Follain, Usage du temps
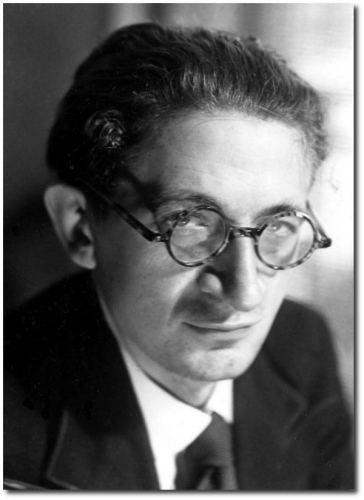
Pain de nuit
Au fond de certains songes est un gros pain de chair bise volé un jour de neige mais là, cette nuit de la femme était totale sans étoiles avec un pain étroit émietté de minute en minute et porté jusqu’à sa bouche mauve et tout un chacun disait d’elle : il faut lui tenir la dragée haute.
Dérision, ô dragées jetées aux enfants assistés et dont l’amande éclate sous leurs dents par le triomphal matin d’un printemps qui ne revient pas !
Jean Follain, Usage du temps, Poésie/Gallimard, 1983, p. 171.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Follain Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, usage du temps, pain de nuit | ![]() Facebook |
Facebook |





