24/02/2023
Pascal Quignard, La barque silencieuse
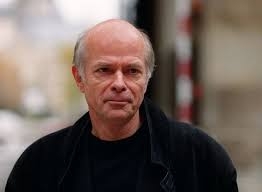
Nul ne peut se plaindre de vie : elle ne retient personne. Cet argument se trouve répété dans les œuvres des deux Sénèque, père et fils, sous Tibère et sous Néon. L’argument prend aussi cette autre forme à Rome : la seule raison de louer la vie est qu’elle nous offre avec elle la possibilité de nous en extraire. On ne peut pas parler de servitude quand l’émancipation est donnée avec elle. L’insoumission et la soumission sont offertes d’un même mouvement. Les vieillards se pendant au bras de leur fauteuil dans les hôpitaux à l’aide de la ceinture de leur robe de chambre.
Pascal Quignard, La barque silencieuse, Folio/Gallimard, 2011, p. 86-87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal guignard, la barque silencieuse, suicide | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2023
Jude Stéfan, Pandectes (ou le neveu de Bayle)

Autocritique
Forme moderne de l’Inquisition (Sciascia). C’est toujours le Père, la peur.
Bavards
Massacreurs du silence et de la parole vraie.
« Loquaces, muti sunt » (Confessions, I, 4) : ils ont beau parler, ils ne disent rien.
Célibat
Honneur de l'individu.
L’art est incompatible avec le mariage. Mozart prouve le malentendu. Gauguin, l’obligation de rompre. Schubert l’heureuse exception. Blake l’humble vérité.
Critique
La moindre œuvre mineure est plus estimable que la meilleure critique usuelle — celle des noteurs parasites.
Jude Stéfan, Pandectes (ou le neveu de Bayle), Gallimard, 2008, p. 35, 40, 53, 76.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, pandectes (ou le neveu de bayle), critique, célibat, bavard | ![]() Facebook |
Facebook |
22/02/2023
Jude Stéfan, Povrésies ou 63 poèmes autant d’années
Le dernier numéro de la revue Europe publie un dossier consacré à Jude Stéfan.
Il a été préparé par Gérard Cartier

la mer encore formée
les mérules qui moisissent tes murs
elle vous ouvre son gîte, la femme
au sourire de victoire
(toasts & médailles sous les arbres fleuris)
le père repeignait le mur blanc trente
ans près le fils chiait son sang
né un Mardi pour guerrier
et de la marche du Sel
à cinq heures les oiseaux
en mai Lumière,
tu me suffis
au jardin tapis s’égoutte
chemise s’agite
assez de vos voix, vos abois
peine, ombre
autant de titres, autant de tombes
Jude Stéfan, Povrésies ou 63 poèmes
autant d’années, Gallimard, 1997, p. 29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, povrésies ou 63 poèmes autant d’années | ![]() Facebook |
Facebook |
21/02/2023
Jude Stéfan, Laures

et Louise Labé
tant nous aurons nos deux purs corps
médité debout et nous congratulant
pis lascivement aux caresses jou-
ant avant de succomber à la courte
gloire de n’être plus nous-mêmes sur
même couche d’amour et de mort
car hors toi ma passion fut l’ennui
qui mine ma vie comme tu l’illumines
si chaude et blanche et profanable
présence sous chairs ô rite nu
tant nous aurons à deux mimé l’amour
perdu — tels vent caressant fustigeant
la mer nos mains et yeux étrange pays
de lichens et de lianes
Jude Stéfan, Laures, Gallimard, 1984, p. 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, laures, mer, louise lab, mime | ![]() Facebook |
Facebook |
19/02/2023
Jude Stéfan, Laures

laure VIII
j’ai embrassé ta voix
ma rose carnée
envoûté par les larges boucles de fleuves
comme les amants dans leur coma et qui rêvent
s’apprendre le gin et le cidre
entrecaressés dans la nuit
les plis de ta pitié les râles de ton merci
et tes larmes d’abîme
d’absence qui tombe en froid en deuil
délivre-moi du vomi
tiens-moi de tes rubans
des oiseaux meurent des oiseaux sont tués
dans le lilas des murailles
Jude Stéfan, Laures, Gallimard, 1984, p. 44.
Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, laures, rose, lilas | ![]() Facebook |
Facebook |
animaux de la campagne

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : animaux de la campagne | ![]() Facebook |
Facebook |
18/02/2023
Jude Stéfan, Prosopées
le noir, sa couleur d’élégance
au vert dans le jardin aux merles
le rouge sang des chevillards
à favoris
le rouge beauté
le jaune des urines et saris
le bleu des rixes et des îles
les gares dans les aubes grises
cendres et ardoises
le violet de ton bas, tes perles
le blanc de chair cadavérique
l’orange des soifs et des becs
le rose de la rose et des porcins
Jude Stéfan, Prosopées,
Gallimard, 1995, p. 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, prosopées, couleur | ![]() Facebook |
Facebook |
17/02/2023
Jude Stéfan, Que ne suis-je Canule
Stéfan est mort
et Jude aussi
pour les Amis épars
avecque lui mourra Emma
sa jeune ou belle égérie
(ne furent qu’
étang gelé
- un datura ouvert –
phare isolé
en fausses métaphores)
pauvres hères dans nos campagnes
qui l’hiver vous pendiez
à raison
Vous nous communiez
vous nous en conjurez
Ne Plus Écrire
Jude Séfan, Que ne suis-je Catulle,
Gallimard, 2010, p. 97.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, que ne sis-je catelle, ne plus écrire, passé, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
16/02/2023
Jude Stéfan, Aux chiens du soir
les yeux d’Emma
ocre fougère bistre clairière
amande noisette et verdissants
au soir ou tristes éblouis de
liesse absents vacants il y
a tout dans les yeux de ton nom
dans le nom de tes yeux le non
de ta promesse aime et âme et elle
aima souverains offensés bruns
et lus par cœur où sont-ils en-
volés où s’égrène ton rire avec ?
trois fois je suis passé devant
ta maison vide sans leur flamme
Jude Stéfan, Aux chiens du soir,
Gallimard, 1979, p. 79.
Photo T. H., 2012
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
15/02/2023
Jude Stéfan, À la Vieille Parque
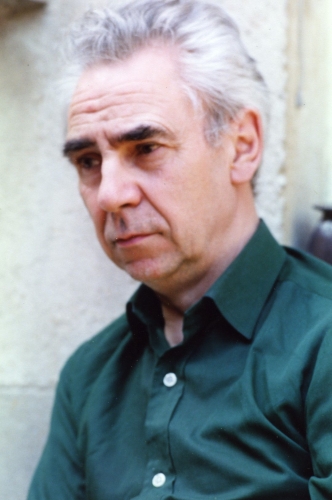
à h.m. †
dans la nuit, la nuit (qui) remue
les souvenirs les brasse en rêves réveils
les meubles bâillent
déjà ils veillent
massifs, profonds miroirs, avec leurs bras
attendant le gisant
cerné de portraits dans l’ombre qui fixent
ses pieds cirés
qui crient au silence et au meurtre
dans les cloisons dégringolent les rats
un Espoir au passé une morne Consolation
deux bougies vacillent
au-dessus des tapis sanctifiant les pas
perdu le temps du cœur
qu’il repose en chose
les chaises vaquent le livre a oublié
Celui qu’il fallait lire en maître zen
Jude Stéfan, À la Vieille Parque, Gallimard,
1989, p. 30.
Photo T. H., 1991
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, à la vieille parque, hommage à henri michaux | ![]() Facebook |
Facebook |
14/02/2023
Jude Stéfan, Laures
Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020
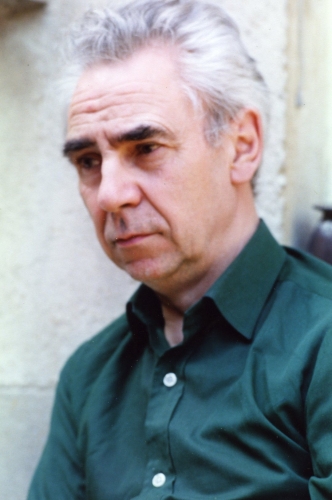
laure VIII
j’ai embrassé ta voix
ma rose carnée
envoûté par les larges boucles de fleuves
comme les amants dans leur coma et qui rêvent
s’apprendre le gin et le cidre
entrecaressés dans la nuit
les plis de ta pitié les râles de ton merci
et tes larmes d’abîme
d’absence qui tombe en froid en deuil
délivre-moi du vomi
retiens-moi de tes rubans
des oiseaux meurent des oiseaux sont tués
dans le lilas des murailles
Jude Stéfan, Laures, ‘’Le Chemin’’/Gallimard,
1984, p. 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, laures | ![]() Facebook |
Facebook |
13/02/2023
Cavafy, Poèmes
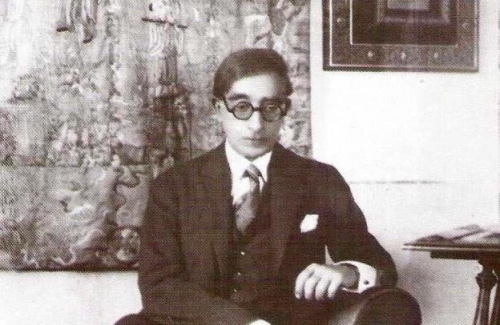
Lustre
Dans une chambre vide et petite — seuls quatre murs
couverts d’étoffes toutes vertes —
un lustre superbe brûle et flambe ;
et dans chacune de ses flammes s’embrase
une lascive passion, un lascif élan.
Dans la petite chambre qui étincelle,
éclairée du feu violent du lustre,
point familière est cette lumière qui en sort ;
ni faite pour des corps timides
la volupté de cette chaleur.
Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis, Les Belles Lettres, 1977, p. 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, poèmes, lustre, volupté | ![]() Facebook |
Facebook |
12/02/2023
Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant

HAÏ-KAÏ
La nuit du 1er septembre 1923 entre Tokyo et Yokohama
À ma droite et à ma gauche il y a une ville qui brûle mais la Lune entre les nuages est comme sept femmes blanches.
La tête nue sur un rail mon corps est mêlé au corps de la terre qui frémit. J’écoute la dernière cigale.
Sur la mer sept syllabes de lumière une seule goutte de lait.
Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant, Poésie/Gallimard, 1974, p. 198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, suivi de l’oiseau noir dans le soleil levant, haïkaï | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2023
Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant

La maison suspendue
Par un escalier souterrain je descends dans la maison suspendue
de même que l’hirondelle, entre l’ais et le chevron maçonne l’abri de sa patience et que la mouette colle au roc son nid comme un panier, par un système de crampons et de tirants et de poutres enfoncées dans la pierre, la caisse de bois que j’habite est solidement attachée à la voûte d’un porche énorme creusé à même la montagne. Une trappe ménagée dans le plancher de la pièce inférieure m’offre des commodités ; par là, tous les deux jours, laissant filer mon corbillon au bout d’une corde, je le ramène pourvu d’un peu de riz, de pistaches grillées et de légumes confits dans la saumure.
Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant, Poésie/Gallimard, 1974, p. 123-124.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, la maison suspendue | ![]() Facebook |
Facebook |
10/02/2023
Armand Robin, Lemonde d'une voix

Premier amour
Moi
Je ne vous prendrai même pas la main. J’ai besoin seulement de vous faire une déclaration d’amour… non pas d’amour dans le ciel ni sur terre… d’amour dans le néant qui suivra mon cœur arrêté, d’un amour que trente ans je ne sentirai même pas, d’un amour que seul un peu de cœur éphémère imagera d’éternité.
Elle
Je ne suis qu’une pauvre fille. Je ne fus jamais que cruelle envers vous et je sais que jamais je ne pourrais être que cruelle envers vous.
Je suis une créature comme toutes les autres.
Moi
Mais votre voix muettement est douce.
Elle
Je ne veux pas de l’apparence que l’imagination me donne.
Armand Robin, Le monde d’une voix, Gallimard 1968, p. 86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, premier amour, incompréhension | ![]() Facebook |
Facebook |












