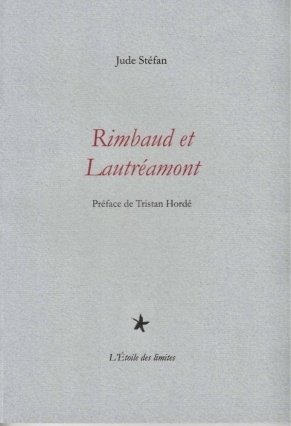23/07/2023
Elizabeth Browning, Sonnets from the Portuguese

Quand le soleil monta pour la première fois
Sur ton vœu de m’aimer, j’attendis avec hâte
Que la lune dénoue cette union immédiate,
Trop vite scellée pour une durable foi.
Cœur, pensai-je, aimant vite, aussi vite haïra,
Et, en me regardant, me jugeais trop ingrate
Pour l’amour d’un tel homme ; en viole indélicate,
Usée, avec laquelle un bon chanteur sera
Furieux de gâcher sa chanson, et qui, saisie
Hâtivement, est reposée dès que se joue
Une fausse note. Or, plus qu’à moi, je te fis
Injure à toi : les accords parfaits volent sous
Les mains d’un maître, aussi d’instruments défraîchis :
La grande âme aime et crée en un unique coup.
Elizabeth Browning, Sonnets from the Portuguese (1850), dans Le Chaos dans 14 vers, anthologie bilingue du sonnet anglais, choix et traduction Pierre Vinclair, éditions Lurlure, 2023, p. 207.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elizabeth browning, sonnets from the portuguese | ![]() Facebook |
Facebook |
22/07/2023
Gerard Manlay Hopkins, Sonnets terribles

Pire, non : rien. Degré de l’au-delà des peines,
Maux neufs nourris aux maux anciens, serrent plus forts,
Grande consolatrice, où est ton réconfort ?
Mère nôtre, ô Marie, ton soulagement vienne !
Mes cris jappent, en harde, accolés à leur chef,
Mal cosmique — à l’enclume archaïque il bruit, gri-
Mace — se calme, arrête. La furie glapit :
« Vite ! Et que je sois cruelle ! Le fort fait bref. »
Ô l’esprit ! il a ses montagnes ; ses écorces
D’à-pics inouïs, inhumains. Ni ne peut tel abîme
Contenir notre esprit limité. Là ! pécore,
Rampe, sous l’aise agit l’ouragan : toute vie
Mort achève et tout jour meurt de sommeil aussi.
Gerard Manley Hopkins, « Terribkes sonnets », 1885-1886¡, dans Le Chaos dans 14 vers, anthologie bilingue du sonnet anglais, traduction Pierre Vinclair, éditions Lurlure, 2023, p. 265.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gerard manlay hopkins, sonnets terribles, consolation, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
21/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

Nous sommes tous de vieux enfants plus ou moins graves, plus ou moins remplis de nous-mêmes.
Il me semble beaucoup plus difficile d’être un moderne que d’être un ancien.
L’histoire doit être la peinture d’un temps, le portrait d’une époque. Lorsqu’elle se borne à être le portrait d’un homme et la peinture d’une vie, elle n’est qu’à demi histoire.
Quand je luis… je perds mon huile.
Amour. Avec quel soin les anciens évitaient tout ce qui pouvait en rappeler tous les plaisirs mais du moins le mécanisme, le jeu.
Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 436, 438, 445, 447, 458.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, enfance, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
20/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

Tout ce qui pleure est innocent dans ce moment.
Chacun se fait et a besoin de se faire un autre monde que celui qu’il voit.
Une pensée est une chose aussi réelle qu’un boulet de canon.
Beaux ouvrages. Le génie les commence, mais le travail seul les achève.
Tout critique de profession, homme médiocre par nature.
Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, ). 383, 398, 424, 429, 434.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, innocence, médiocrité, imagination | ![]() Facebook |
Facebook |
19/07/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités
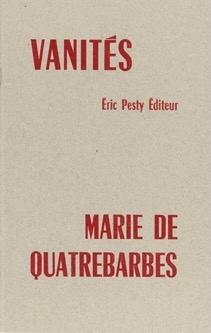
« Plutôt que de prendre racine, nous passons »
Le pluriel Vanités renvoie à une période de l’histoire de la peinture, la première partie du XVIIe siècle, pour l’essentiel à des natures mortes évoquant le caractère éphémère de la vie, parfois avec la présence d’un crâne : on rencontre aussi dans le livre cet objet — « Ce crâne, regardez-le, né de la roche et son greffon de lierre, entremêlé aux bois du cerf » —, mais le thème de la brièveté de l’existence n’a ici rien de religieux : le contexte associe le minéral, le végétal et l’animal. Pas de prière, de méditation pour se préparer à mourir, seulement savoir que le temps défait tout ce qui est et le projet est clair, « nous nous en tiendrons au matérialisme le plus tendre ». Ce qui est immédiatement lisible : la mort est la condition de la vie et s’il est une éternité elle est dans le fait que tout recommence sans cesse.
Le livre s’ouvre avec la reprise du texte en frontispice d’Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, présentant Démocrite occupé à disséquer des cadavres pour reconnaître le siège de la mélancolie ; l’annonce en regard se présente comme en relation avec cette activité, mais avec un objet plus large : « Ceci est un livre d’histoire naturelle, décrivant les formes élémentaires par lesquelles commence la nature ». On verra comment se développe ce projet a priori fort ambitieux. Ces deux pages ne sont pas paginées, pas plus que l’ensemble des poèmes qui suivent, numérotés de 1 à 36, toujours de strophes de quatre vers, puis 361/2 pour le dernier de deux vers. On note que d’emblée un récit est annoncé et les premiers poèmes mettent en scène Épicure, « un mathématicien épris de gymnastique » (Thalès de Milet), Platon : l’Antiquité et ses savants inscrivent le livre dans l’histoire longue mais sont laissés au profit « à présent de l’avenir ».
L’avenir, et le présent, ce sont les multiples transformations des êtres vivants, et en particulier de la fleur, métamorphoses (qui lient d’ailleurs le livre à l’Antiquité) dont l’abondance font de Vanités un étrange kaléidoscope dans lequel on verrait les êtres et les choses se défaire et se reconstruire dans un mouvement incessant. S’il est une éternité, ce n’est pas du côté de la religion qu’il faut la chercher : c’est celle du recommencement — même si des mots semblent sortis d’un traité de l’époque classique, « squelette vivant, nudité et ordure ». La vie naît et se développe à partir de la mort, « le genêt pousse dans la ruine », « les corps se dissolvent (…) puis tout recommence », « le tombeau [de la fleur] est le berceau de l’arbre », etc. — on recopierait une partie du livre si l’on relevait toutes les occurrences de ce mouvement. La métamorphose se produit à tous les niveaux, les formes s’emboîtent, vouées à la disparition et, de là, apparaissent d’autres formes ; la fleur devient fruit, puis graines qui se séparent de la plante, se dispersent et d’autres fleurs trouvent leur place. Métamorphose généralisée qui emporte tout, « de toutes parts un mouvement léger fait pirouetter les masses ». La distinction entre l’inerte et le vivant n’est elle-même plus de mise, au moins pour le regard qui confond le minéral et le vivant, on voit « les scarabées pierres mobiles », ailleurs « les rochers pourrissent » et le végétal semble prendre des caractères du vivant mobile (« les yeux tuméfiés du mimosa ») (1).
Mais comment rendre compte de ce qui, presque toujours, échappe au regard ? Marie de Quatrebarbes choisit notamment l’énumération de noms pour restituer le foisonnement des éléments sujets à la métamorphose ; parmi d’autres :
On aperçoit au sol des miniatures, aiguilles, chatons de pins usés, minés, foudroyés, mollusques & huîtres, limaçons gélatineux, élastiques, hannetons, lentilles, moules, mouches du rosier, trente-six fragments de feuilles et demi »
Comment également introduire un semblant d’unité dans ce qui est donné pour échapper à tout ordre ? Dans une partie importante du livre, reviennent dans chaque poème l’adjectif « petit », un de ses dérivés ou un mot connotant la petitesse : « petit », le mieux représenté, seul ou non (« son tombeau était petit » opposé à « esprit large », « petites morsures »), « brève histoire », « insecte », « petitesse, « miniature », « imperceptibles », « microscopes ». Une figure insolite, celle de l’enfant, fréquente dans les livres de Marie de Quatrebarbes, est introduite avant le premier poème numéroté, entrant dans la série des contraires par son jeu : « L’enfant éteint la lumière, il l’allume » ; Il apparaît ensuite régulièrement, lié à la nature (« l’enfant se contemple dans le miroir de la nature »), se transformant (« l’insecte-enfant ») avant d’entrer dans le mouvement du recommencement à la fin du livre : « Parfois s’animent dans le visage du mourant les traits du nouveau-né & réciproquement ». Certains procédés rhétoriques s’ajoutent, comme la répétition de mots, pour unifier les contenus, avec aussi des jeux d’assonances (or dans une strophe : morsure, mort, ornée, sorte) et d’allitérations, ainsi avec la reprise d’un titre de livre de Paul Éluard, « le dur désir de durer ».
Il suffirait peut-être de dire que Vanités est un livre original sur l’idée de recommencement dans la nature. Le livre, cependant, apparaît plus complexe. La citation donnée supra s’achève par « trente-six fragments de feuilles et demi » : comment ne pas y reconnaître le numéro de la dernière page ? Si l’on s’attarde à quelques allusions dispersées, comme « reprendre la phrase encore » et, dans le dernier poème, « La page ne dit pas où elle va », à des allusions littéraires (par exemple à Louis Zukofsky), on relit aussi l’ensemble comme une métaphore de ce qu’est l’écriture et tout peut s’organiser alors autrement, qu’il s’agisse du thème du recommencement, de la répétition, de la mort et de la naissance, du passé et de l’avenir, etc. La fin de l’avant-dernière strophe et celle de la dernière confirment la possibilité de cette lecture, « On n’y voit rien, suivez mon regard » et « il n’est jamais trop tard pour détourner sa fin ». Ajoutons qu’il est d’autres lectures qui ne contredisent pas celles proposées ; ainsi, Vanités est, peut-être, dans le fil de Voguer un livre autour de la mémoire.
- On sait que l’on emploie "œil" pour désigner le bourgeon.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Eric Pesty éditeur, 2023, 38 p., 10 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 30 mai 2023.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de), RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie sz quatrebarbes, vanités, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
18/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

« Sommes-nous condamnés à nous ignorer toujours ? » dit Voltaire. Oui. Il pouvait ajouter : Et à nous étudier sans cesse.
La politesse est l’art de s’ennuyer sans ennui ou (si vous l’aimez mieux) de supporter l’ennui sans s’ennuyer.
« Il faut que le son fasse écho avec le sens. » Cette expression est de Pope. Elle est fort belle.
Parler avec son imagination, mais penser avec sa raison.
Jouer sur les sons (ou les mots) lorsqu’il ne résulte de ce jeu aucune confusion dans le sens, mais qu’au contraire il s’en ensuit de la clarté, ce jeu-là plaît.
Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 356, 363, 371, 373, 379.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carté, jeu des mots, politesse | ![]() Facebook |
Facebook |
17/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

Toutes ces règles, ces méthodes apprennent bien à en parler, mais elles ne les donnent pas.
Il y a dans le visage quelque chose de lumineux qui ne se trouve pas dans les autres parties du corps.
…Ils aiment mieux qu’on leur donne à croire qu’à comprendre.
Il n’y a dans ce que les hommes ont pensé que quelques sommets, quelques points dominants. Le reste n’est que leur échelle, échelle que le temps a mise en pièces ; et les pièces en sont perdues, anéanties. Quand même on les retrouverait, qu’en ferait-on, qu’un échafaudage ?
Et cependant la faculté d’aimer, de voir…, se forme en s’essayant sur ces nuées que l’imagination se forge.
Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 311, 324, 325, 327, 351.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, méthode, visage, croire, comprendre, imaginer | ![]() Facebook |
Facebook |
16/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

Toute inconstance est un tâtonnement.
Il est impossible d’aimer deux fois la même personne.
Ils prennent l’art pour la nature.
Le beau, c’est l’intelligence rendue sensible. Ainsi un son même n’est beau que lorsqu’il est tel qu’il n’a pu être produit que par l’intelligence et non par le hasard.
Dans la vieillesse on ne vaut plus que par des qualités de réflexion. On les garde en dépit de l’âge parce que notre intérêt perpétuel est de les avoir.
Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 143, 253, 300, 307, 309.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, inconstance, vieillesse, art | ![]() Facebook |
Facebook |
15/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

Il faudrait alléguer aux gens des raisons non seulement bonnes pour nous, mais aussi bonnes pour eux.
Le caractère du poète est d’être bref, c’est-à-dire parfait, absolutus, comme disaient les Latins.
Il faut faire du bien lorsqu’on le peut et faire plaisir à toute heure, car à toute heure on le peut.
Qu’est-ce qu’un diamant, si ce n’est un peu de boue lumineuse ?
Illusions. Évaporations, fumées. Que le monde est plein de fumées.
Joseph Joubert, Carnets, , Gallimard, 1994, p. 189,197, 213, 235, 245.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, illusion plaisir | ![]() Facebook |
Facebook |
14/07/2023
Jude Stéfan, Rimbaud et Lautréamont
Parution Juin 2023
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
13/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

Ce monde me paraît un tourbillon habité par un peuple à qui la tête tourne.
Ne coupez pas ce que vous pouvez dénouer.
Le monde intellectuel est toujours le même. Il est aussi facile à connaître aujourd’hui qu’au commencement, et il était aussi caché au commencement qu’il l’est aujourd’hui.
Pensez aux maux dont vous êtes exempt.
La mémoire — qui est le miroir où nous regardons les absents.
Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 211, 213, 215, 217, 240.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, mémoire, permanence, maladie | ![]() Facebook |
Facebook |
12/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

S’il y a un manche à un couteau, pourquoi le prendre par la lame ?
Le penchant à la destruction est un des moyens employés pour la conservation du monde.
Dans les festins, il suffit d’être joyeux pour être aimable.
Compenser l’absence par le souvenir.
Les passions sont aux sentiments ce que la pluie est à la rosée, l’eau à la vapeur.
Nos amours et nos aversions sont deux grands ressorts dont la providence se sert.
Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 183,188, 195, 196, 207, 207.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, providence, passion, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
11/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

Et se précipiter dans la mort comme dans un fleuve, où s’engloutissent tous les soins et où l’on boit l’oubli des maux.
La liberté. C’est-à-dire l’indépendance de son corps.
Les enfants veulent toujours regarder derrière les miroirs.
Personne ne voulait être le second.
Ne pas juger les gens par leurs affaires.
Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 152, 155, 165,173, 183.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, mort, liberté, miroir | ![]() Facebook |
Facebook |
10/07/2023
Joseph Joubert, Carnets

L’oubli ! Comment ce mot est-il si doux !
Vous ne semez là que des ronces. Elles porteront ses épines.
On a besoin pour vivre, de peu de vie. Il en faut beaucoup pour aimer.
L’histoire est bonne à oublier ; c’est pour cela qu’elle est bonne à savoir.
Les passions viennent comme une petite variole et défigurent cette beauté originelle.
Joseph Joubert, Carnets, Gallimard, 1994, p. 131, 137, 145, 149, 171.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, morale | ![]() Facebook |
Facebook |
09/07/2023
Shakespeare, Sonnets et autres poèmes

154
Le petit dieu de l’Amour s’était endormi,
Posant près de lui le tison qui enflamme les cœurs,
Tandis que des nymphes toutes vouées à la chasteté
Étaient accourues ; mais dans ces mains virginales
La plus belle vestale s’empara de ce feu
Qui avaient échauffé des milliers de cœurs purs ;
Et c’est ainsi que le chef de l’ardent désir
Fut dérangé par une main pure dans son sommeil.
Ce tison fut plongé dans l’eau froide d’un puits,
Lequel fut échauffé par le feu de l’Amour,
Se transformant en bain et en précieux remède
Pour les malades ; mais moi, victime de ma maîtresse,
J’y vins pour m’y soigner, et constatai ce fait :
L’amour échauffe l’eau, l’eau n’éteint pas l’amour.
Shakespeare, Sonnets et autres poèmes (Œuvres complètes, VIII), Pléiade / Gallimard, 2021, p.555.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Shakespeare William | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnets et autres poèmes, amour, soins | ![]() Facebook |
Facebook |