22/10/2023
Étienne Faure, La vie bon train.
La nuit quand le train va si vite
qu’on ne voit rien
rouler perd tout son sens
— il n’est plus sûr alors qu’une gare attende,
à l’autre bout fasse un trajet qui relie les deux lieux
ordonnancés un départ une arrivée,
car nul retour, aucun aller n’est visible,
à regarder par la vitre envahie de noir :
miroir vide où suis-je ?
Voici l’hiver aux jours réduits, qui emporte le corps
engendré vite autrefois, le moral au noir fixe,
dans un état pour une éternité transitoire
d’aucune utilité car jamais abouti
(et donc de ton sperme personne ne sera né)
maillon sans chaîne, wagon désormais sans attache
ni ascendance, ni hoirs, ni rien d’approchant.
voici l’hiver
Étienne Faure, La vie bon train (proses de gare),
Champ Vallon, 2013, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etienne faure, la vie bon train, solitude, voyage | ![]() Facebook |
Facebook |
21/10/2023
Étienne Faure, Horizons du sol
Longtemps condamné au lit comme à l’internement,
il scrutait fixement dans les papiers peints
des motifs d’évasion, lignes de fuite,
des baies en auréole où s’embarquer
pour l’infini l’espace d’une heure,
les yeux ronds d’étonnement que la vie s’y cache,
tapissée au gré des saisons de nymphes
aux blancheurs de gel
— les corps aussitôt peints devenant des nus —
ou bien des fleurs insistantes,
exhalant quoique fanées depuis longtemps
un même enfermement dans la torpeur
spectrale — non pas sommeil —
à flotter en surface aux côtés de son propre corps,
dépouille, non, remuement que le soir
dément.
trouble du soir
Étienne Faure, Horizon du sol,
Champ Vallon, 2011, p. 44.
Photo Chantal Tanet, 2011
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, horizons du sol | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2023
Étienne Faure, Vues prenables
À chaque alliance, premier lit, remariage,
la peau des murs avait changé,
ici offrant l’illusion du feuillage
d’une toile de Jouy inspirée des fêtes
à la campagne où le motif s’organise
en chemins, en rivières,
où court une tige fleurie sur un fond picoté
que les fabricants avaient reproduit maintes fois,
au bout du siècle effeuillé près du lit.
Parmi les vases, cassolettes, chandeliers, lampes,
on vivait volets tirés dans la pénombre
pour ne pas abîmer les tentures
et que les papiers peints ne passassent
trop vite
il y avait bien cachés dans les ramures
des souvenirs au matin réveillés, tête lourde,
en lés répétés où dormait le pavot
et les vies imprimées là, sans raccords.
la peau des murs
Étienne Faure, Vues prenables,
Champ Vallon, 2009, p. 83.
Photo T.H., 2012
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, vues prenables, nostalgie | ![]() Facebook |
Facebook |
19/10/2023
Étienne Faure, Légèrement frôlée
Où est l’exil
en sueur, en train jadis accompli
si le avions, presque
à la vitesse du mensonge, nous déposent
en des lieux prémédités de loin,
transmis par la parole, des papiers
traduits ou rédigés dans la langue des mères,
où est l’exil, un écart temporel
réduit à rien — espace crânien
où l’on revient sur ses pas pour retrouver
l’idée perdue en route —
heure de seconde main aujourd’hui effacée
devant l’entrée des morts, ou le seuil,
par politesse ultime de la mémoire
ici trahie, en creux, quand l’avion atterrit
qui ne comblera donc rien, jamais
l’amplitude intime de la perte.
il revient les mains vides
Étienne Faure, Légèrement frôlée,
Champ Vallon, 2007, p. 90.
photo Chantal Tanet, 2011
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, exil, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
18/10/2023
Paul Verlaine, Chair

Les méfaits de la lune
Sur mon front, mille fois solitaire,
Puisque je dois dormir loin de toi,
La lune, déjà maligne en soi
Ce soir jette un regard délétère.
Il fit ce regard — pût-il se taire !
Mais il prétend ne pas rester coi,
Qu’il n’est pas sans toi de paix pour moi ;
Je le sais bien, pourquoi ce mystère,
Pourquoi ce regard, oui, lui, pourquoi ?
Qu’ont de commun la lune et la terre ?
Ha, reviens vite, assez de mystère i
Toi, c’est le soleil, luis clair sur moi !
Paul Verlaine, Chair, dans Poésies complètes,
Bouquins/Robet Laffont, 2011, p. 840.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul verlaine, chair, éloignement, lune | ![]() Facebook |
Facebook |
17/10/2023
Paul Verlaine, Parallèlement

La dernière fête galante
Pour ne bonne fois séparons-nous,
Très chers messieurs et si belles mesdames.
Assez comme cela d’épithalames,
Et puis là, nos plaisirs furent trop doux.
Nul remords, nul regret vrai, nul désastre !
C’est effrayant ce que nous nous sentons
D’affinités avecque les moutons
Enrubannés du pire poétastre.
Nous fûmes trop ridicules un peu
Avec nos airs de n’y toucher qu’à peine.
Le Dieu d’amour veut qu’on ait de l’haleine ,
Il a raison ! Et c’est un jeune dieu
Séparons-nous, je vous le dis encore.
Ô que nos cœurs qui furent trop bêlants
Dès ce jourd’hui réclament trop hurlants,
L’embarquement pour Sodome et Gomorrhe !
Paul Verlaine, Parallèlement, dans Poésies complètes,
Bouquins/Robert Laffont, 2011, p. 446-447.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul verlaine, parallèlement, la dernière fête galante, sodome, gomorrhe | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2023
Paul Verlaine, Jadis et naguère

Paysage
Vers Saint-Denis c’est bête et sale la campagne,
C’est pourtant là qu’un jour j’emmenai ma compagne,
Nous étions de mauvaise humeur et querellions.
Un plat soleil d’été tartinait ses rayons
Sur la plaine séchée ainsi qu’une rôtie.
C’était pas trop après le Siège : une partie
Des « maisons de campagne » était à terre encor.
D’autres se relevaient comme on bisse un décor,
Et des obus tout neufs encastrés au pilastre
Portaient écrit : SOUVENIR DES DÉSASTRES.
Paul Verlaine, Jadis et naguère, dans Poésies complètes,
Bouquins/Robert Laffont, 2011, p. 299-300.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul verlaine, basis et nager, paysage, campagne | ![]() Facebook |
Facebook |
15/10/2023
Paul Verlaine, La bonne chanson

Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux formes ont tout à l’heure passé.
Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
Et l’on entend à peine leurs paroles.
Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux spectres ont évoqué leur passé.
— Te souvient-il de notre extase ancienne ?
— Pourquoi voulez-vous donc qu’il m’en souvienne.
— Ton cœur bat-il toujours à mon sel nom ?
Toujours vois-tu mon âme en rêve. — Non.
— Ah ! les beaux jours de bonheur indicible
Où nous joignions nos bouches ! — C’est possible.
— Qu’il était bleu, le ciel, et grand l’espoir !
— L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.
Tels ils marchaient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles.
Paul Verlaine, La bonne chanson, dans Poésies complètes,
Bouquins/Robert Laffont, 2011, p. 108.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul verlaine, la bonne chanson, passé, regrets, oubli | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2023
Paul Verlaine, L'espoir luit...

L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable.
Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou ?
Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.
Que ne t’endormais-tu, le coude sur la table ?
Pauvre âme pâle, au moins cette eau du puits glacé,
Bois-la. Puis dors après. Allons, tu vois, je reste,
Et je dorloterai les rêves de ta sieste,
Et tu chantonneras comme un enfant bercé.
Midi sonne. De grâce, écartez-vous, madame,
Il dort. C’est étonnant comme les pas de femme
Résonnent au cerveau des pauvres malheureux.
Midi sonne. J’ai fait arroser dans la chambre.
Va, dors ! L’espoir luit comme un caillou dans un creux.
Ah, quand refleuriront les roses de septembre !
Paul Verlaine, Sagesse, dans Œuvres poétiques,
Bouquins/Robert Laffont, 2011, p. 203.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verlaine, ssgesse, espoir | ![]() Facebook |
Facebook |
13/10/2023
Lorine Niedecker, Cette condenserie : recension
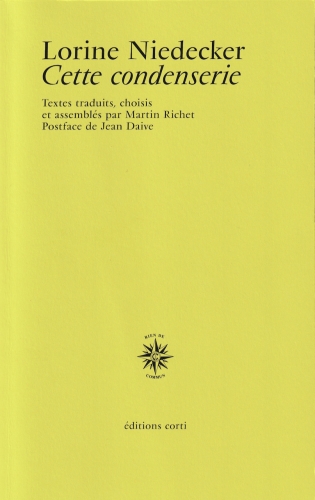
Martin Richet, traducteur de l’anglais américain, a choisi pour ce volume des lettres de Lorine Niedecker envoyées, pour la plus grande partie, à Louis Zukofsky (pas toutes conservées et parfois censurées) et à Cid Corman. La correspondance est suivie de deux essais à propos de ces deux poètes — le second, aussi éditeur, publiait la revue Origin —, puis d’un récit de voyage, précédé de notes. Par ces choix, Martin Richet a voulu mettre en lumière « plusieurs mouvements de condensation : « comment la vie devenue lettre se fait matériau d’un poème ; comment la lecture se densifie en poétique ; comment le document et le savoir informent l’expérience et l’écriture. » Le livre se termine par une brève étude de Jean Daive, ouverture à la lecture de Lorine Niedecker.
Lorine Niedecker et Louis Zukofsky furent très proches et le mariage de l’écrivain n’interrompit pas, pendant longtemps, leur correspondance. Dans ses lettres, Lorine Niedecker décrit souvent avec beaucoup de détails l’espace dans lequel elle vit, la faune et la flore qu’elle ne se lasse pas d’observer ; par exemple, pour les oiseaux, le grand héron, l’engoulevent, le nid de kildirs, et elle parcourt trente kilomètres « pour voir des nids d’hirondelles comme des bouteilles ou des gourdes de boue sur les flancs d’une grange ». C’est là la matière de ses poèmes. Elle se sent si proche du milieu humide qui l’entoure — les marais, le lac Koshkonong proche — qu’elle a le sentiment d’en être un élément (« je pourrais presque me croire de l’eau de mer dans les veines ») ; vivant dans ce milieu, elle imagine qu’elle peut contribuer à son développement, en y créant elle-même : ainsi elle arrache de très jeunes saules, les emporte jusqu’à la maison pour [s]a propre création du monde ». Cette image de monde premier est régulière, jusqu’à écrire, quand elle doit se mêler aux occupations de ses contemporains, « j’ai surgi de ma boue primordiale ». C’est dans une cabane, au confort des plus sommaires (sans eau ni électricité), près du bord d’une rivière, qu’elle a vécu longtemps avec sa mère et qu’elle abandonnera dans la dernière partie de sa vie : « Comme j’aimerais être libre de cette sinistre affaire qu’est la propriété », écrira-t-elle. C’est là aussi qu’elle écrivait et lisait.
Elle lisait beaucoup, dans plusieurs domaines, et elle énumérait parfois dans une lettre un achat de livres (par exemple : D. H. Lawrence, Goethe, Edith Hamilton, Rilke, Henri James, Conrad, une étude concernant Emily Dickinson) ou précisait ce qu’elle appréciait (« J’aime les poèmes de Robert Creeley », « Ce livre [de Cid Corman]) rentre dans mon armoire spéciale ». Elle n’hésitait pas à noter ses réticences et ses mises à l’écart ; estimant encore un peu Ginsberg, elle regrettait son comportement, « pourquoi faut-il que ces manifestations de vitalité passent par la misère, la crasse, le sexe. ». Elle donnait son sentiment à ses correspondants à propos de telle ou telle œuvre, tout en ne se jugeant pas capable de lecture critique, « j’apprécie, je ne critique pas et je cite comme [Marianne Moore] mais sans sa perspicacité ». L’étude sur la poésie de Zukofsky est en effet pour l’essentiel un montage de citations du poète.
Lorine Niedecker ne mettait jamais en avant ce qu’elle écrivait, ce qu’elle était ; elle a gagné son pain en faisant des ménages et ne tenait pas à ce que l’on sache qu’elle publiait des poèmes, mais elle n’avait aucun doute sur la nécessité pour elle d’écrire, « Il n’y a rien de plus important dans ma vie que la poésie », écrivait-elle à Jonathan Williams. C’est cette nécessité qui la conduisait à toujours reprendre ses poèmes, rarement satisfaite. L’écriture avait toujours pour elle comme point de départ ce qu’elle avait vu, entendu, vécu ; pour garder une de ses images, la phrase lui venait comme une crue de printemps mais, ensuite, acceptant le conseil de Zukofsky, le « sentiment suivant a toujours été de « condenser, condenser ». » Commentant une lettre de Cid Corman, qui pensait ses poèmes trop « écrits », elle se donnait cette tâche de condenser, « il faut que je travaille à me faire plus dense, plus nette et pourtant plus distante, comme dans l’imagination pure ». Cette volonté l’a éloignée de l’enregistrement de ses poèmes ou de leur lecture en public. Cette solitaire pensait que les poèmes s’adressaient au lecteur et devaient être « lus en silence », ce qui n’empêchait pas pour elle d’être constamment attentive aux sons, « Quand on a l’oreille affutée on fait sonner ses poèmes dans le silence ». Tout se résumait à s’éloigner de la prose, c’est-à-dire à l’abondance de mots dans un poème qui aurait abouti à « perdre une poésie parfaite, serrée ».
.
Ses notes de voyage sont faites d’observations, mais aussi de lectures sur l’histoire de la venue des Français dans la région du Lac Supérieur. Elle a écrit sa passion pour les pierres, et dans son compte rendu de voyage elle a noté : « Le panneau de la Boutique à Agates je ne l’ai pas raté » : elle y a acheté, en plus d’une agate, « une pierre bleue, une sodalite et une cornaline ». On lit cette importance de la pierre dans un poème, Voyageurs, qui précédant la postface de Jean Daive, s’ouvre ainsi : « Dans la moindre partie du moindre être vivant / est une matière qui a un jour été pierre / devenu terreau. »
Jean Daive est allé jusqu’à la cabane où vivait Lorine Niedecker — elle appréciait beaucoup sa poésie — et la revue qu’il dirige, K.O.S.H.K.O.N.O.N.G., nom du lac proche de la cabane, témoigne d’une proximité avec une manière de penser la poésie. Sa brève étude demanderait à être largement commentée, retenons-en un passage sur la complexité de l’œuvre : « En lisant textes, journaux, lettres et poèmes, je pense souvent aux fresques de Giotto à Assise où les récits de rêves et les changements d’échelle culbutent notre regard et ses logiques parce que la narration surdimensionnée s’en trouve malmenée. »
Lorine Niedecker, Cette condenserie, Textes traduits, choisis et assemblés par Martin Richet, Postface de Jean Daive, éditions Corti, série américaine, 2023, 274 p., 21 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 22 septembre 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lorine niedecker, cette condenseriez : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2023
Eugène Savitzkaya, Au pays des poules aux œufs d'or

L’une était renarde et l’autre était héron sans avoir jamais choisi le poste qu’ils occupaient dans les classifications établies depuis belle lurette par des hommes en bésicles apparentés aux universités du monde. L’une pratiquait l’anglais avec facilité et le russe avec plaisir. L’autre ne connaissait qu’une seule langue dont il usait avec modération. Les deux vénéraient le soleil et la lune, son déflecteur de roche usée. Il portait les nuages et elle traînait les nuées.
Comment s’étaient-ils acoquinés ? Le glapissement d’une renarde n’attire pas d’ordinaire les hérons errants. Le claquement d’un bec long et fin d’un héron n’émoustille pas plus que ça une renarde.
Mais les temps varient et les cœurs changent comme varient les cieux et changent les formes des nuages.
Eugène Savitzkaya, Au pays des poules aux œufs d’or, Les éditions de minuit, 2020, p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, au pays des poules aux œufs d’or | ![]() Facebook |
Facebook |
11/10/2023
Eugène Savitzkaya, Fraudeur

Les champs secs ou le parc brumeux.
Il a toujours aimé l’eau mais adore le grattement du chaume contre ses chaussures, l’odeur et le chant des tuyaux de paille dorée. D’un côté la croupe argileuse, de l’autre le limon d’une rivière er de son affluent. Entre deux fossés, remblais de terre herbeuse, un chemin creux ancien comme le village dont il s’éloigne. Entre deux haies d’ifs, une allée vers le château qu’il laisse pour demain, pour plus tard. Plus tard les jeunes filles aux jambes nues sur la pelouse descendant vers l’étang. Aujourd’hui, préfère l’ornière au fond de laquelle se tapit le lièvre au poil clair quand le vent du nord souffle transportant le vacarme d’un train de marchandises.
Un été torride, le parc ouvrait ses grilles et le garçon suivit le ruisseau d’eau pure et vit le poisson d’or nageant sur un fond de coquilles vides blanches comme nacre ou onyx. Ce poisson avait la forme et la délicatesse d’un pied d’enfant ; ses nageoires s’agitaient comme des voiles d’un mouvement régulier et souple. Le poisson nageait contre le courant, se déplaçait latéralement, se couchait sur le flanc, actif et lumineux
Eugène Sawitzkaya, Fraudeur, éditions de Minuit, 2015, p. 58-59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzakaya, fraudeur, parc | ![]() Facebook |
Facebook |
10/10/2023
Eugène Savitzkaya, Alain Le Bras, Quatorze cataclysmes

Au printemps, de la cime d’un arbre, araucaria, on voit le merveilleux quartier de la maison nouvelle avec les couloirs sonores, les escaliers à marche de pierre et un seul mur, debout, quelques tranquilles murets pour s’appuyer et pour poser les plans, de sèches bergeries et de nombreuses étables vides, certaines spacieuses, d’autres minuscules pour les minuscules animaux à cornes, ces derniers bâtiments pourvus de surprenantes entrées et issues. Les lapins auront peut-être des maisonnettes en terre truffées de cristaux, de pépites et de débris de coquillages laiteux et les colombes , des tourelles en roche très veinée, en marbre et en craie que l’on pourra creuser à la cuiller et manger pendant les famines.
Eugène Savitzkaya,, Alain Le Bras, Quatorze cataclysmes, Le temps qu’il fait, 1985, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzakaya, alain le bras, quatorze cataclysmes | ![]() Facebook |
Facebook |
09/10/2023
Eugène Savitzkaya, Rules of solitude

Chaque visage est une fontaine
nouvelle qui s’écoule dans le vide et
l’obscurité. Le haut est léger et froid.
Le bas est noir et tiède. Le large
s’étend. Le long s’étire. Le vaste s’ouvre
et l’infini se referme. La nuit est
tellement parfumée.
Eugène Savitzkaya, Rules of solitude,
Quale Press, 2001, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, rules of solitude, visage, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2023
Lucie Taïeb, L'art de panser les plaies : recension
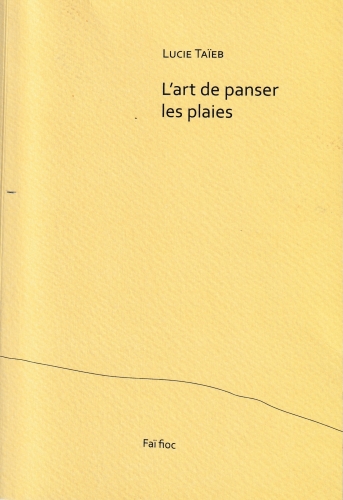
L’art de panser les plaies est aussi le titre du premier poème, suivi de "Est-ce une prière", "Nos corps nos pierres", "Où sont les cerfs ?", "Parmi les gravats" et "Thomas". Quand on a lu le Nouveau Testament, on lit immédiatement la relation entre le poème d’ouverture et le dernier, mais c’est l’ensemble du livre qui est construit autour du motif du corps blessé, du monde blessé, de la violence. On relie aussi le texte à Ambroise Paré (1509 ?-1590), cité justement dans le poème liminaire, chirurgien qui avait mis au point une "manière de panser les plaies" provoquées par les arquebuses pour éviter l’amputation.
On ne sait à qui s’adresse, dans le poème liminaire, un "je", féminin, qui, sur le ton de la confidence, rapporte avoir « arraché de [s]es dents l’oreille d’un amant », oreille aussitôt avalée. À ce début de destruction du corps répond, rapportée par le même "je", ou un autre, la mention de morsures, reçues sans que le lecteur sache qui en est l’auteur. Le récit prend alors une autre voie, celle des règles morales — religieuses : « on m’a appris qu’il fallait réparer ses fautes / ou tenter de le faire » ; ces règles sont accompagnées de ce qui définit le savoir-vivre pour une femme selon certains usages sociaux : une tenue et un maquillage corrects, se tenir droit, ne pas pleurer en parlant, etc. Le retour à la violence dans un second temps du poème est directement lié au Christ.
La (une) narratrice rêve qu’un homme lui ouvre le flanc d’un coup de lame de rasoir, blessure qu’elle lui inflige à son tour : « cet homme est mon frère et moi » ; étrange figure du double, et les sangs se mêlent pour atteindre l’unité, comme auparavant une partie du corps était absorbée. Cette tentative fantasmée de l’Un retrouvé est suivie d’un récit de démembrement construit à partir de l’intrigue de La confrérie des mutilés, roman de Brian Evenson : un détective ne peut progresser dans son enquête, et connaître la vérité, qu’en acceptant des mutilations successives, le chef de la confrérie étant un « homme tronc / ne reste que la tête / plus de langue ». Chaque fois on peut lire une initiation cependant impossible à vivre, ce que, semble-t-il, la forme pour le rapporter donne à lire.
Le premier poème commence par introduire une narratrice, « Je ne vous cacherai pas que mon chagrin est grand », et il est question ensuite de la fureur qui l’habite et la conduit à la violence physique. La phrase est d’abord reprise partagée en deux vers, puis seul le premier membre est maintenu dans une des parties du poème, les différentes affirmations niées (« ne pas te blesser / ne pas te panser (…) cette fureur n’en est plus une ») la blessure christique (« la seule qui m’émeuve ») est évoquée. Une proposition (« je ne sais plus ce que je dis ») remet en cause ce qui précède ou s’applique à l’amorce de récit qui suit : image d’une décollation qui ne serait dans la joute amoureuse que « les doigts enserrant la nuque ». Dans la clôture du poème, reste « Je ne vous cache pas » qui embraye sur des phrases verbales où le lecteur retrouve des mots phares (sang, chagrin), la désorganisation de la syntaxe, mime de celle du corps (« ne vous / non / mon chagrin ») et la fin exclut l’idée d’une pause, « trembler trancher chuter / ce monde mon chagrin ».
Comment relancer le poème quand tout semble détruit ? La narratrice souhaiterait une relation au monde apaisée, où l’écoute, donc l’échange, serait possible, souhait qui suscite une cascade de questions, la venue d’un "nous" et le constat d’une immense faiblesse, « Nous serons désarmés, nous n’aurons plus rien à défendre, nous serons nus, exposés à la morsure, à la blessure, et seuls, » — seuls avec de multiples questions sans réponses. La solitude acceptée, soit le retrait du monde, entraîne la perte de ce qu’implique l’échange : le nom, la conscience de son corps. De là, après tant de questions qui ne résolvent rien, la référence à Hölderlin : sa leçon conduit à clore avec une question-réponse qui rompt avec le retrait : « ne crois-tu pas qu’à craindre la blessure notre corps dépérisse, rabougri, desséché, car plus rien ne lui vient de l’extérieur ? »
C’est encore la relation à l’Autre, la solitude et la violence qui sont au cœur de "Nos corps nos pierres" ; avec la pierre qui blesse l’œil de la narratrice et, d’emblée, avec le retour de la parole empêchée : dans le premier poème, la narratrice souhaitait « pouvoir parler sans qu’on [lui] coupe la parole », maintenant « c’est tout ce qu’on ne peut pas dire » qui est difficile à vivre, l’empêchement, d’ordre social, concernant le corps, l’intime, la sexualité. Mais que la narratrice indique à l’Autre — existe-t-il ? — ce besoin de dire, ne changera rien à la solitude de chacun : tout se passe comme si les conventions interdisaient une rencontre des corps ; elle ne pourrait se produire qu’en renonçant à l’identité sociale que donne le nom ou en acceptant tout de l’autre, « je prends ton corps non pas dans la réalisation de sa puissance mais lorsqu’il se décharge, s’altère, déraille, je prends tout ce qui vient de toi ». Mais est-il possible d’échapper au chaos ?
Le poème "Où sont les cerfs" est fondé sur une comptine de ce titre ; à la question qui ferme les deux strophes, « Faut-il les tuer ? », est répondu NON, puis OUI, mais reprise deux fois à la fin du poème elle reste sans réponse. On pense au mythe d’Actéon et Artémis quand dans l’évocation d’une fuite un homme devient cerf et une femme chasseresse ; on pense aussi à la symbolique du cerf dans la chrétienté, où il représente la résurrection. D’un côté la mort, de l’autre la renaissance, ce qui s’accorde avec l’attente de la narratrice, "qu’un rêve advienne où tu parais, peu importe le nom et le visage ». Rêve bien éloigné dans "Parmi les gravats…" où s’impose la violence d’État, « une entreprise de destruction du monde tel que nous l’avions connu », où une main coupée est présente. Cependant, « une main est toujours en attente d’une autre main » contre la violence.
Le lien est visible avec le dernier poème, "Thomas". C’est l’apôtre qui rapporte sa rencontre avec le Christ, répétant son invite — « approche-toi, donne-moi ta main » et la commentant. Il reste en retrait (« Tu es revenu, je le vois, je n’ai pas besoin de te toucher »), malgré l’insistance du Christ.
Comme si rien n’était à attendre puisque, pense Thomas, « comme tu dois être seul parmi nous désormais, blessé, intact, vivant et mort ». Le Christ ne peut sauver personne, pas plus que l’Autre, quel qu’il soit, ne peut sauver la narratrice. Le monde semble n’être qu’un chaos où l’instance qui pourrait proposer des règles pour une vie sociale paisible, n’est qu’une source de violence. Que faire ? Peut-être « Désarticuler toute logique de domination et de soumission, en commençant par soi. » Vision tragique de la société contemporaine et de l’individu.
Lucie Taïeb, L'art de panser les plaies, Faï fioc, 2022, 64 p., 12 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 août 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucie taïeb, l'art de panser les plaies | ![]() Facebook |
Facebook |









