30/11/2011
Buson, le parfum de la lune
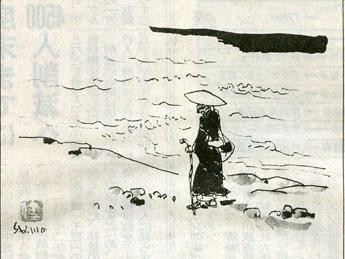
Buson
l'automne est arrivé
il faut bien l'admettre
quelqu'un a éternué
début de l'automne
dans une maison une lampe
à la tombée du jour
un chemin sur la lande d'automne
quelqu'un marche
derrière moi
les montagnes s'assombrissent
confisquent leur vermillon
aux feuilles rouges
le vent d'automne le chahute
puis passe son chemin
ah ! l'épouvantail
la tempête d'automne s'est calmée
la lumière filtre à une porte
au bout du village
Buson, le parfum de la lune, poèmes traduits du japonais par Cheng Wing fun et Hervé Collet, calligraphie de Cheng Wing fun, Moudarren, 1992, p. 106, 108, 112, 116, 118, 126.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : buson, le parfum de la lune, haïku, l'automne | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2011
François Rannou, là-contre

l'exactitude ne se plante qu'à la frontière
est-ce une terre promise : la précision peut-elle nous enseigner la vérité ? quelle vérité ?
ne vaut pas plus qu'une mouche (bombine la poésie sur la vitre lisse de nos mots-mots-mots) c'est sa valeur ajoutée : le charme du chat se dissout promet de nous montrer l'énigme à nu sur les étals
terre d'ailleurs dont la géographie n'a trace (cartes fluctuantes) que lorsque la paume qu'on ouvre montre le revers des paroles intraduisibles
précision des couleurs (vert, jaune) que distingue quelle légende
à quelle image impossible se raccrocher ?
sa précipitation noircit la bouche
j'ai tort de vouloir ?
l'appel : ô mémoire bousculée
rameutée
mais la justesse c'est sans appui savoir laisser venir à soi les références à mesure qui se perdent
en transit sans papiers c'est-à-dire croulant sous les fauxvrais récits les paysages dits les guerres avenues, les solitudes
(la main sur la tête l'autre dont l'index pointe la ligne de séparation)
noircit la bouche : personne à qui s'adresse notre requête (on est dans la zone, oui, nous, celle de la simple vérité qui a cours impératif après contrôle) qu'on loue (à taux variable selon le fret) et qui condamne (cela dépend des pays mais ceux traversés, oui, ceux-là)
[...]
François Rannou, là-contre, éditions le cormier, 2008, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fançois rannou, là-contre | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2011
Sappho, fragment 31
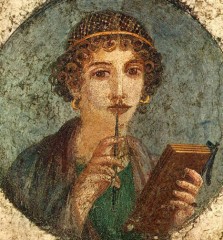
Mes yeux sont éblouis : il goûte le bonheur des dieux
cet homme qui, devant toi,
prend place, tout près de toi, captivé,
la douceur de ta voix
et le désir d'aimer qui passe dans ton rire. Ah ! c'est bien pour cela,
un spasme étreint mon cœur dans ma poitrine.
Car si je te regarde, même un instant, je ne puis
plus parler,
mais d'abord ma langue est brisée, voici qu'un feu
subtil, soudain, a couru en frissons sous ma peau.
Mes yeux ne me laissent plus voir, un sifflement
tournoie dans mes oreilles.
Une sueur glacée ruisselle sur mon corps, et je tremble,
tout entière possédée, et je suis
plus verte que l'herbe. D'une morte j'ai presque
l'apparence.
Mais il faut tout risquer...
Sappho, fragment 31, dans Yves Battistini, Lyra erotica, VIe siècle de notre ère, IXe siècle avant Jésus-Christ, Imprimerie nationale éditions, 1992, p. 263-264.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sappho, yves battistini, lyra erotica | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2011
Michel Leiris, Le Ruban au cou d'Olympia

À main droite
ma manie de manipuler,
démantibuler,
désaxer et malaxer les mots,
pour moi mamelles immémoriales,
que je tète en ahanant.
Murmure barbare, en ma Babel,
tu me tiens saoul sous ta tutelle
et, bavard balourd, je balbutie.
À main gauche, mes machins,
mes zinzins,
mes zizanies,
les soucis (chichis et chinoiseries) qui me cherchent noise,
mes singeries, momeries et moraleries.
Ô gagâchis qu'agacé j'ai sagacement jaugé et tout de go gommé,
jugeant superfétatoirement enquiquinant son chuchotis ?
Au milieu
le mal mou qui me moud,
me mord,
me lime, m'annule,
m'humilie
et que, miel amer, je mettrais méli-mélo à mille lieues mijoter,
mariner,
macérer.
N'a-t-il dit que ce monde dément demande un démenti,
le démon qui m'enmantèle, m'enmêle et me démantèle.
Qu'est-ce que, pratiquement, je poursuis ?
— La combinaison de mots, phrases, séquences, etc., que je suis seul à pouvoir bricoler et qui — dans ma vie pareille, comme toute autre, à une île où les conditions d'existence ne cessent d'empirer — serait mon vade-mecum de naufragé, me tenant lieu de tout ce qui permet à Robinson de subsister : caisse d'outils, Bible, voire Vendredi (si je dois finir dans une solitude à laquelle je n'aurai pas le cœur d'apporter le catégorique remède).
... Ou plutôt ce qui me fascine, c'est moins le résultat, et le secours qu'en principe j'en attends, que ce bricolage même dont le but affiché n'est tout compte fait qu'un prétexte. Au point exact où les choses en sont au-dedans comme au dehors de moi, quoi d'autre que ce hobby pourrait m'empêcher de devenir un Robinson qui, travaux nourriciers expédiés, ne ferait plus que se glisser vers le sommeil, sans même regarder la mer ?
Michel Leiris, Le Ruban au cou d'Olympia, Gallimard, 1981, p. 176-177 et 195.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, le ruban au cou d'olympia, jeu de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2011
Pierre Dhainaut, Plus loin dans l'inachevé – Vocation de l'esquisse

Oiseaux d'ici
Rieuses, dit-on, de ces mouettes
tête noire et bec rouge,
d'autant plus blanches
lorsque les ailes se déploient
sur la digue, sur le port,
sans trêve, le vent,
le vent est favorable
à la véhémence
de la trajectoire, à l'acuité
du cri : elles gravissent l'air,
elles s'y précipitent, là même
où nous ne voyons rien,
quelle était
leur victime ? cette clameur
de vagues qui s'abattent
nous rattrape, nous blesse
jusque dans les rêves.
Pierre Dhainaut, Plus loin dans l'inachevé, Arfuyen, 2010, p. 49.
Viatique pour l'hiver
L'espace, comme à l'entrée d'une terre sans arbres
ou sur les pentes d'un ravin, abrupt,
au carrefour des rues, ce n'est qu'un spectacle,
quelle est notre place, ici, ici et donc ailleurs ?
On s'arrête, on recule, on se résigne,
l'épaule s'y refuse, à la lisière qui chancelle
on reste à recevoir les souffles,
à les interpréter : ils disent « vigilance ».
« rien d'inaccessible », disent-ils encore. Qu'une voix
les regroupe, elle appartient à l'air
dont elle prend le relais pour le rendre,
et pour elle, avec elle, on accomplit
un premier pas toujours par temps de gel sonore,
l'espace clairvoyant sera notre hôte.
Pierre Dhainaut, Vocation de l'esquisse, encres d'Isabelle Raviolo,
La dame d'Onze heures, 2011, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre dhainaut, plus loin dans l'inachevé, vocation de l'esquisse | ![]() Facebook |
Facebook |
25/11/2011
Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue
 Qu'un mot puisse être perdu, cela veut dire : la langue n'est pas nous-mêmes. Que la langue en nous est acquise, cela veut dire : nous pouvons connaître son abandon. Que nous puissions être sujets à son abandon, cela veut dire que le tout du langage peut refluer sur le bout de la langue. Cela veut dire que nous pouvons rejoindre l'étable ou la jungle ou l'avant-enfance ou la mort.
Qu'un mot puisse être perdu, cela veut dire : la langue n'est pas nous-mêmes. Que la langue en nous est acquise, cela veut dire : nous pouvons connaître son abandon. Que nous puissions être sujets à son abandon, cela veut dire que le tout du langage peut refluer sur le bout de la langue. Cela veut dire que nous pouvons rejoindre l'étable ou la jungle ou l'avant-enfance ou la mort.
En jouant sur le mot qui se tient sur le bout de la langue, je ne joue pas sur les mots. Je ne tire pas par les cheveux de cette femme la tête érigée en l'air, étendant le bras dans un suspens comparable aux gestes des patriciennes effrayées devant le phallus voilé de la Villa des Mystères. La non-domination du souvenir d'un nom néanmoins connu ou d'une idée qu'on ressent en l'absence de ses signes — qu'on ne ressent pas vraiment mais qui brûle : «Je brûle ! Je brûle ! » — est la non-domination de soi et est l'ombre portée de la mort pour peu qu'on ne remette pas la main sur le mot qui fuit. C'est cette main dans le silence. C'est cette prédation silencieuse. Écrire, trouver le mot, c'est éjaculer soudain. Ce sont cette rétention, cette contention, cette arrivée soudaine.
C'est approcher non par le feu — « Je brûle ! » — mais le foyer central où le feu prend sa flamme.
Le poème est ce jouir. Le poème est le nom trouvé. Le faire-corps avec la langue est le poème. Pour procurer une définition précise du poème, il faut peut-être convenir de dire simplement : le poème est l'exact opposé du nom sur le bout de la langue.
Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue, P. O. L, 1993, p. 60, 76-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, le nom sur le bout de la langue | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2011
Pierre Silvain & Jean-Claude Pirotte, Les chiens du vent
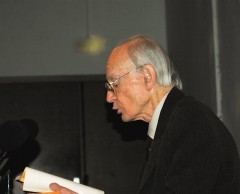
Sous la poussière il retrouve
L'ardoise d'enfance fêlée
Avec les griffures intactes
Proclamant sa détresse d'être
Celui qui toujours demeure
Au seuil du monde déchiffrable
Dans l'attente d'une aveuglante
Révélation ou d'un anéantissement
Rien n'a changé
Tout continue de se refuser
Là derrière
Lueur tremblante et louche
Au fond de la nuit d'encre
C'est la fenêtre du logis
De l'ogre perdu dans les bois
Vers quoi conduisant la fratrie
Résolu même sans
Les cailloux en poche
Poucet avance
Pierre Silvain, Les chiens du vent, encres et pastels de Jean-Claude Pirotte, Cadex éditions, 2002, p. 62, 40.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, jean-claude pirotte, les chiens du vent | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2011
James Sacré, Un paradis de poussière (note de lecture)
James Sacré voyage en s'installant dans une région : il la parcourt sans hâte, observe les paysages, les manières de vivre de se déplacer et d'habiter les lieux, le travail des hommes, et il se nourrit avec les uns et les autres. Ce n'est pas dire qu'Un Paradis de poussières serait un ouvrage d'ethnologue..., c'est bien un livre de poète, construit avec une alternance d'ensembles consacrés au voyage et aux rencontres (18), et des parties lyriques (14) titrées chaque fois "Geste parlé", qui sont des adresses amoureuses à l'Autre.
Il n'est pas nécessaire de connaître l'œuvre de James Sacré pour accueillir cette nouvelle plongée dans le Maroc de Sidi Slimane. On en sort pour des moments à Larache pour la tombe de Jean Genet, un voyage jusqu'à Sakiet Sidi Youssef en Tunisie pour se recueillir en pensant au bombardement de l'armée française le 8 février 1958 ; on revient en France à l'Institut du Monde Arabe ou, à Toulouse, pour un hommage au grand écrivain Edmond Amran El Maleh. Le lecteur des précédents livres ne se retrouvera pas dans du "déjà lu", mais reconnaîtra des motifs propres à ce qui, au fil du temps, est devenu une œuvre : le discours amoureux, la tendresse pour les animaux et les hommes, le questionnement sur la mémoire et sur l'écriture1, les tentatives de nouer les noms de couleur comme sur une toile — ce qui se résout provisoirement par une rencontre avec le peintre Khalil El Ghrib2 —, et sans doute le plus apparent ; le plaisir d'écrire une certaine manière de renaître lors de chacun des séjours au Maroc.
On entre d'emblée dans le livre comme s'il s'agissait d'une relation de voyage. On débute par des notations sur «l'activité marchande» avec «toutes sortes de petites silhouettes», «des camions pleins de couleurs». C'est le jeu des couleurs de ces camions qui arrête le regard, la juxtaposition et l'entrelacement du rouge, du vert, de l'orange, du blanc, du jaune..., « ça fait / Beaucoup de couleurs, et des formes, qui échappent aux mots ». Ce sont les mouvements des uns et des autres, petits marchands d'eau, de figues de barbarie, de beignets, d'escargots, vendeurs de menthe, enfants, chalands oisifs qui sont croqués, et « À vrai dire on pourrait écrire sans fin ». La description ne peut qu'être indécise, toujours à reprendre, à rectifier pour tenter de restituer quelque chose du vivant : une couleur, une forme, un mouvement, des bruits de la rue. Dans chaque "geste parlé", c'est encore la difficulté de parler à l'autre (et de l'entendre vraiment) qui apparaît : « On finit par s'inventer des formules qui ont l'air de dire / Mais on ne sait pas ce qu'elles disent ».
Les deux temps du livre, le récit et le geste parlé, pourraient être perçus comme nettement séparés si l'on se tenait aux titres ; on passe par exemple de "Un soir on a sorti deux chaises devant la porte" à "Ce qu'on mêle en échangeant des mots", ou de "Les gens sont là, pas loin" à "Le mot rien dans le mots vivant". Cependant, dans chaque temps on retrouve une tension analogue : il y a d'une part le désir de "donner à voir", d'autre part celui d'exprimer simplement la complexité d'une relation amoureuse, et le doute de parvenir à noter quelque chose de la réalité telle qu'elle est ou telle qu'elle a été vécue. Dans cette interrogation sur la portée du regard attentif ou amoureux, le lecteur est même introduit dans un poème : « C'est trop descriptif ton poème que tu diras, / Ces vagues mots sur la misère de l'endroit » ; réponse est faite à ce lecteur pour qu'il lise autrement et attache moins d'importance au récit qu'à l'émotion qui en est à la source :
Le poème n'est-il que des mots ? Pour les disposer ainsi, selon un rythme et des arrangements divers,
N'a-t-il pas fallu quelque transport de cœur, fût-ce
Dans le plus grammatical déguisement des phrases ?
Écrire
C'est toujours plus qu'écrire.
Ce qui ne peut venir dans le poème, c'est l'homogène, l'unité de sens. Peut-être l'écrit aide-t-il à ce que le lecteur « s'imagine un peu » ce qui a été vu, mais il ne peut ignorer que le "monde", le rapport à l'Autre n'entrent pas dans les mots. James Sacré ne parvient pas plus à saisir avec la photographie ce qu'il sait devoir toujours lui échapper, il regrette d'ailleurs que ses photographies soient « le plus souvent mal prises ». Ce qui reste, c'est toujours « De la poussière de mots, un poème », la « poussière du poème ». La réalité s'enfuit, même quand est noté ce qui est regardé, et bien plus fragiles encore sont les images du passé : autre poussière, « Poussière du temps, tamis / De la mémoire ». Des moments de la campagne marocaine, des gestes du travail, une couleur de la terre dérangent la durée vécue et rapportent à un temps aboli :
On comprend mieux tout d'un coup que la campagne est pas loin,
Pas si loin non plus (qu'est-ce qui s'en va ?)
Celle que labourait mon père
Avec la même sorte de petit tracteur [...]
C'est aussi le souvenir du village natal en Vendée, le jardin près de la maison, la sieste de la mère qui resurgissent, et les bruits entendus dans la vilel marocaine lui semblent « comme un prolongement des jours de foire aux bestiaux à Coulonges-sur-l'Autize » — « la drôle de charpie que c'est le temps », mais seul 'écrit permet d'évoquer ce « paradis dans la bouche » qu'est le couscous partagé dans un village. Les mots sont « une couture au temps » ; ce sont les mots de l'enfance, régionaux ou appartenant à des techniques anciennes qui viennent à propos des choses du Maroc : "ranche", "cenelle" ou "dorne" : « [...] comme si la terre / Ouvrait sa dorne [= son giron] remplie d'une histoire [...] ».
Sans doute le livre est toujours à faire puisque le poème est là pour « remettre de l'ordre dans le monde »...
James Sacré, Un paradis de poussière, Marseille, André Dimanche, 2007.
Publié dans MARGINALIA, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, un paradis de poussière | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2011
Yosa Buson, Haïku (traduction Joan Titus-Carmel)
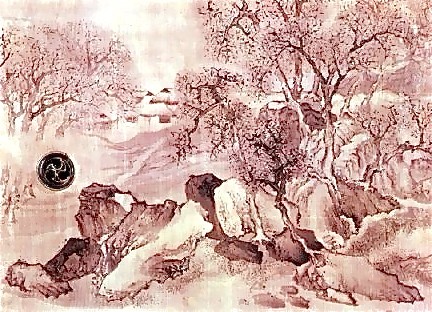
Buson : Paysage
La pauvreté
m'a saisi à l'improviste
ce matin d'automne
Près d'un poirier
je suis venu solitaire
contempler la lune
Le batelier —
sa perche arrachée des mains
tempête d'automne
Il brama trois fois
puis on ne l'entendit plus
le cerf sous la pluie
Une solitude
plus grande que l'an dernier
fin d'un jour d'automne
Le mont s'assombrit
éteignant le vermillon
des feuilles d'érables
Yosa Buson, Haiku, traduits du japonais et
présentés par Joan Titus-Carmel, Orphée/
La Différence, 1990, n.p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yosa buson, haïku, joan titus-carmel | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2011
Édith Azam, Devant la porte, un paillasson : la parole
 Devant la porte, un paillasson : la parole...
Devant la porte, un paillasson : la parole...
Nous avons eu jadis, peut-être, la parole.
Nous sommes dupes de nous-mêmes, de ce foutu langage qui nous dévisse la bouche, y voyons une forme de supériorité animale qui se résume, au bout du compte, à calfeutrer nos phantasmes les plus, non, les mieux lubriques croyant nous éloigner de la bête mais... nous sommes des brutes, des barbares.
Nous nous mentons depuis la langue, depuis cette épine molle et gluante qui nous creuse en quotidien la bouche ce toute la mort qu'on lui a fait.
Nous, en permanence, violons de la langue dans une bêtise abjecte qui nous sabote tout le squelette tant est si mal que, à défaut de marcher debout nous : nous rampons du gosier.
Nous nous traînons plus bas que taire, persuadés que le langage relèvera un peu les choses mais.., nous ignorons les massacres dont nous sommes les seuls responsables et qui fait le défaut de langue majeur : son mensonge.
Nous, à cause de cela, sommes devenus l'imbécile jouet du langage.
Nous ne comprenons rien, ne voyons pas le point où la pensée s'em-pute dressant la langue contre nous, et ne faisons rien du langage si ce n'est : le corrompre, le brûler, sans discontinuité altérer ce pour quoi il est fait.
Nous ne sommes pas capables — veulerie, sabotages, pleutres, bouffons, narcisses — de faire qu'une parole soit un acte.
Nous avons dévoyé la langue, nous l'avons salopée : Nous, massacreurs du langage, nous nous baisons tous d'abord par la bouche, d'abord par la bouche oui : de bouche à bouche, nous nous dévorons de la langue.
[...]
Édith Azam, Devant la porte, un paillasson : la parole..., dans Action Poétique, n° 204, juin 2011, p. 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, devant la porte un paillasson : la parole | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2011
Jacques Prévert, Fatras - Choses et autres
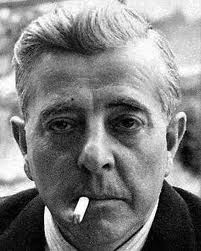
La fête secrète
Au carrefour impossible de l'immobilité
une foule d'objets inertes
ne cesse de remuer de frémir de danser
Et les facteurs du vent
comme ceux de la marée
éparpillent le courrier
Chaque chose sans doute est destinée à quelqu'un
ou à quelque chose peut-être
La plume de l'oiseau
comme l'écaille de l'huître
la croix de la légion d'honneur
comme l'étoile de mer
ou la patte du crabe et l'ancre du navire
la grenouille de fer vert
et la poupée de son
et le coller du chien
Et dans ce paysage où rien ne semble bouger
sauf la bougie du naufrageur dans la lanterne rouillée
c'est la fête secrète
la fête des objets.
Jacques Prévert, Fatras, "Le point du jour", Gallimard, 1966, p. 237.
Ne rêvez pas
(L'ordinateur)
Ne rêvez pas
pointez
grattez vaquez marnez bossez trimez
Ne rêvez pas
l'électronique rêvera pour vous
Ne lisez pas
l'électrolyseur lira pour vous
Ne faites pas l'amour
l'électrocoïtal le fera pour vous
Pointez
grattez vaquez marnez bossez trimez
Ne vous reposez pas
le Travail repose sur vous
Jacques Prévet, Choses et autres, "Le point du jour",
Gallimard, 1972, p. 234.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques prévert, fatras, choses et autres | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2011
Bernard Noël, Sur un pli du temps
Pour l'anniversaire de Bernard Noël
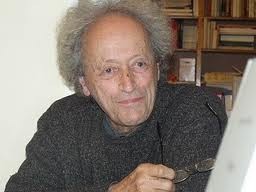
Toujours le plus
aura manqué
la langue a touché
trop d'ombre
trop compté
les lettres du nom
une fois
cent fois
mille fois
les mains
ont rebâti
la statue des larmes
mot
tombé
d'un mot
l'être
a roussi
dans le souffle
quelle fin
la bouche
troue
un visage
l'ombre
gouverne
sous les yeux
une pierre
pousse
entre nous
toujours en pays nain
la métamorphose
aura manqué
un gué
pour passer la salive
vers le tu
poussière
de sucre
dans la pluie
l'aile y bat
vainement
on s'est vêtu
de presque
de encore
on a dit
viens
le mot cœur
battait
de ne pas
battre
on touchait
le masque
pour le sang
la trace
de l'haleine
le pli
de la paupière
décousu
[...]
Bernard Noël, Sur un pli tu temps, dans La Chute des temps,
Poésie/Gallimard, 1993, p. 225-227.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, sur un pli du temps, la chute des temps | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2011
Giorgo Manganelli, Centuries, cent petits romans-fleuves
Trente neuf
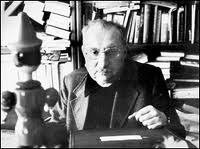 Rapide, une ombre court le long des barbelés, à travers les tranchées, près des silhouettes des armes qui se découpent dans la nuit : le messager est pris d'une grande hâte, une furie heureuse le guide, une impatience sans répit. Il porte un pli qu'il doit remettre à l'officier responsable de la place forte, lieu de morts nombreuses et de quantité de clameurs, de lamentations, d'imprécations. Le messager agile traverse les grands méats de la longue guerre. Ça y est, il a rejoint le commandant : un homme taciturne, attentif aux bruits nocturnes, aux fracas lointains, aux éclairs rapides et insaisissables. Le messager salue, le commandant — un homme d'un certain âge déjà, au visage rugueux — déplie le message, l'ouvre et lit. Ses yeux relisent, attentifs. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demande-t-il curieusement au messager, étant donné que le texte de la dépêche est écrit noir sur blanc, et que clairs et communs sont les mots employés. « La guerre est finie, mon commandant », confirme le messager. Il consulte sa montre : « Elle est finie depuis trois minutes.» Le commandant relève la tête, et c'est avec une infinie stupeur que le messager aperçoit sur ce visage quelque chose d'incompréhensible : une impression d'horreur, d'effroi, de fureur. Le commandant tremble, il tremble de colère, de rancœur, de désespoir.
Rapide, une ombre court le long des barbelés, à travers les tranchées, près des silhouettes des armes qui se découpent dans la nuit : le messager est pris d'une grande hâte, une furie heureuse le guide, une impatience sans répit. Il porte un pli qu'il doit remettre à l'officier responsable de la place forte, lieu de morts nombreuses et de quantité de clameurs, de lamentations, d'imprécations. Le messager agile traverse les grands méats de la longue guerre. Ça y est, il a rejoint le commandant : un homme taciturne, attentif aux bruits nocturnes, aux fracas lointains, aux éclairs rapides et insaisissables. Le messager salue, le commandant — un homme d'un certain âge déjà, au visage rugueux — déplie le message, l'ouvre et lit. Ses yeux relisent, attentifs. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demande-t-il curieusement au messager, étant donné que le texte de la dépêche est écrit noir sur blanc, et que clairs et communs sont les mots employés. « La guerre est finie, mon commandant », confirme le messager. Il consulte sa montre : « Elle est finie depuis trois minutes.» Le commandant relève la tête, et c'est avec une infinie stupeur que le messager aperçoit sur ce visage quelque chose d'incompréhensible : une impression d'horreur, d'effroi, de fureur. Le commandant tremble, il tremble de colère, de rancœur, de désespoir.
« Fiche-moi le camp, charogne !» ordonne-t-il au messager ; celui-ci ne comprend pas, le commandant se lève et, de la main, il le frappe au visage. « Décampe ou je te tue ! » Le messager s'enfuit les yeux pleins de larmes, d'angoisse, comme si l'effroi du commandant s'était emparé de lui. Donc, pense le commandant, la guerre est finie. On en revient à la mort naturelle. Les lumières vont s'allumer. Il entend des voix lui parvenir des positions ennemies ; on crie, on pleure, on chante. Quelqu'un allume une lanterne. Partout la guerre est finie, il ne subsiste aucune trace de guerre, les armes précises et rouillées sont définitivement inutiles. Combien de fois l'ont-ils pris en mire pour le tuer, ces hommes qui chantent. Combien d'hommes a-t-il tué et fait tuer dans la légitimité de la guerre ? Car la guerre légitime la mort violente. Mais à présent ? Le visage du commandant est inondé de larmes. Ce n'est pas possible : il faut que l'on comprenne immédiatement, une fois pour toutes que la guerre ne peut pas finir. Lentement, péniblement, il soulève son arme et vise les hommes qui chantent, là-bas, qui rient et s'embrassent, les ennemis pacifiés. Aucune hésitation, il commence à tirer.
Giorgio Manganelli, Centurie, cent petits romans-fleuves, traduit de l'italien par Jean-Baptiste Para, prologue de Italo Calvino, éditions W, 1985, p. 89-90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giogio manganelli, jean-baptiste para, centurie, roman-fleuve | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2011
Pierre-Yves Soucy, Traques

Que prise qui ne soit pas ruse
mais
veille au travers et traquée
dès que l'œil témoin de cécité
prévient du monde
chaque séquence s'attache
à l'incidence des événements
et la lisière des ombres
sépare
que sans baisser les yeux
au milieu du réel vulnérables
nous sommes en chemin
rompus aux ferments de l'opacité
à tenir nulle part ailleurs
qu'aux limites
et cherchons à tendre
le nerf de l'étau
pour le rompre...
*
... qu'à l'état singulier de la tranche
de toute pause
se découpe l'ombre
au défaut de chaque jour
ce qui attend
exaspère le désarroi
jusqu'au bleu du ciel
jusqu'au fil des dalles le pari
que l'on abandonne
que la durée dresse et arrime
à l'éclat aveuglant de chaque façade
et que du sol imaginons l'écoute
échouant dans la poitrine
lorsque le cercle des corps
à l'instant disparaît
et disparaissent
les semences séparées..
Pierre-Yves Soucy, Traques, extraits de Fragments de veilles, dans le revue
il particolare, "Pierre-Yves Soucy", n° 23, 2010-2011, p. 134-135.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-yves soucy, traques, fragments de veilles, il particolare | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2011
Pierre Chappuis, Muettes émergences, proses
De près comme de loin
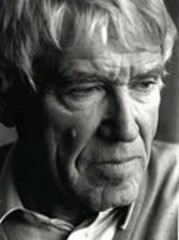 [...] Air vif, sur les hauts rejoints ce matin. Respiration élargie aux dimensions de l'espace. Allégresse et appréhension intimes — promesses, les fausses promesses de l'écriture —, comme qui se retrouverait dans un territoire sien. Déambulations par des sentes à peine marquées qui mènent d'un pâturage à l'autre à la faveur d'étroits passages quand il ne faut pas, ces murets doublés d'une clôture de barbelés, les enjamber au risque de tomber sur une pierre branlante.
[...] Air vif, sur les hauts rejoints ce matin. Respiration élargie aux dimensions de l'espace. Allégresse et appréhension intimes — promesses, les fausses promesses de l'écriture —, comme qui se retrouverait dans un territoire sien. Déambulations par des sentes à peine marquées qui mènent d'un pâturage à l'autre à la faveur d'étroits passages quand il ne faut pas, ces murets doublés d'une clôture de barbelés, les enjamber au risque de tomber sur une pierre branlante.
Aujourd'hui laissés par endroits à l'abandon, à demi écroulés, furent, ancestraux, élaborés, entretenus, périodiquement relevés. Autochtones absolument. Humble consécration de l'ici dans sa modestie de tous les jours. Auront de tous temps été faits de pierres arrachées au sol où la roche, à nu, sort de terre (ces affleurements, muettes émergences) et, patience et lenteur, disposées avec soin : parfois, lorsque rétives à toutes mise en rang, entassées grossièrement.
Mon passé couturé au jour le jour, pluriel et uniforme. Appelé à se ternir. Qui peu à peu s'est ensauvagé. Plus rares se font les fleurs des herbiers de l'enfance qui émaillaient prairies et pâturages, aujourd'hui en voie de disparition ou tant s'en faut (l'effet d'engrais, d'ensemencements nouveaux) comme le thym, la raiponce, l'esparcette et, volontiers voisine du géranium champêtre, celle communément appelée, dans nos régions, le compagnon*.
Pierre Chappuis, Muettes émergences, proses, José Cori, 2011, p. 83-84.
* Le compagnon (blanc, rouge), nom assez répandu, est aussi appelé silène (T. H.)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, muettes émergences, murets | ![]() Facebook |
Facebook |






