18/10/2016
Raymond Queneau, Le chien à la mandoline

Pour un art poétique (suite)
Prenez un mot prenez-en deux
faites–les cuir’ comme des œufs
prenez un petit bout de sens
puis un grand morceau d’innocence
faites chauffer à petit feu
au petit feu de la technique
versez la sauce énigmatique
saupoudrez de quelques étoiles
poivrez et puis mettez les voiles
où voulez-vous en venir ?
À écrire
Vraiment ? à écrire ?
Raymond Queneau, Le chien à la mandoline,
Gallimard, 1965, p. 65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, art poétique, mot, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/08/2016
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, cinq
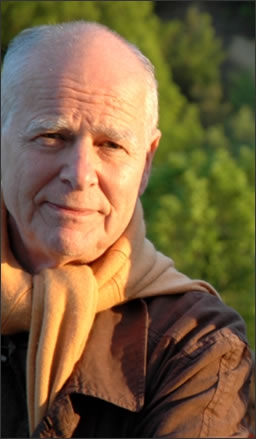
Écrire : la même chose sauf l'instant,
la même force spontanée moins la surprise
plus celle d'une seule fois les mots ensemble
il n'y a pas de sursis dans la prairie, ni en prose
pas de jaune sans herbe exacte
ni transport
conjointement, la colline se raréfie
la couleur durcit sa cruauté adjective
le même iceberg sous les jupes de la phrase
...
dans le bois de genêts, il y eut
la fuite du très aigu et du très affluent
ce mélange de vie parfaite et de silence actif
j'en invente la mémoire avec la même stupeur
le même jaune excellent
sur cette terre où abonde le palpable et le vertigineux,
verbe est le grand désirant
l'animiste
hameçonneur de jouissance, de morsures
constater en quoi le jaune des genêts est semblable à
celui-ci
en ce moment de marbre
en cette gravure d'amour
avec ses définitions à même l'écorce
austères, techniques,
et tellement chaudes à vivre
là où ça bruisse, sur la pente connectée
où la citronnade rétracte
[...]
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, cinq,
André Dimanche, 2008, p. 131-132.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord du juliau, cinq, écrire, mémoire, jaune | ![]() Facebook |
Facebook |
04/08/2016
Laurine Rousselet, nuit témoin

quelque chose ajoute à la piqûre
une densité
qui ressort de la douleur
le chemin dans le rêve
voiles
claquements
cruauté
la limite en suspens
la tête sur l’oreiller
écrire creuse
ce qui me reste de cœur
fuir avec eux
deux petits
*
le temps sur le cœur ravale
la puissance cogne sur l’aspérité
la ventre a volonté d’ébranlement
derrière la tête rien n’est fixe
à loin il y a l’immédiat accolé
le trou
l’odeur dessine la rencontre
le regard de l’autre
le sexe brûlant joue courbure
une fracture où mourir s’effondre
Laurine Rousselet, nuit témoin,
Isabelle sauvage, 2016, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurine rousselet, nuit témoin, écrire, temps, sexe | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2016
Virginia Woolf, Journal d'un écrivain

Lundi 13 septembre 1925, peut-être
C’est une honte. Il est dix heures du matin, et j’écris ceci au lit, dans la petite chambre qui donne sur le jardin. Le soleil est déjà haut. Les feuilles de la vigne sont d’un vert transparent, et celles du pommier si luisantes que, tandis que je prenais mon petit déjeuner, j’inventais une petite histoire sur un homme qui écrivit un poème, les comparant je crois à des diamants, et les toiles d’araignées (qui apparaissent et disparaissent de façon si surprenante) à ceci ou cela. Ce qui m’amena à penser à Marvell et à ce qu’il écrit sur la vie à la campagne, et de là à Herrick et à cette idée que leur œuvre dépendait pour une grande part, et par réaction, des plaisirs de la ville. Mais j’ai oublié les faits. J’écris cela, d’une part pour mettre à l’épreuve le pauvre paquet de nerfs noués sur ma nuque (tiendront-ils ? céderont-ils, comme ils l’ont fait si souvent, car je suis toujours amphibie, moitié couchée moitié levée ?) d’autre part pour apaiser ma démangeaison d’écrire. C’est à la fois un grand soulagement et une malédiction.
Virginia Woolf, Journal d’un écrivain I, traduction Germaine Beaumont, Éditions du Rocher, 1977
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, journal d'un écrivain, écrire, soulagement, malédiction | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2016
Georges Perros, Papiers collés, III

Ces artistes qui se refusent à connaître l’œuvre de leurs contemporains par craintes d’être influencés, c’est un peu comme si un homme ne voulait voir aucune femme par crainte de tromper la sienne.
La réponse n’est pas hors du texte ou dans le texte. Elle est le texte.
Écrire, pouvoir écrire, c’est, d’une certaine manière, se venger. Remettre l’éternité en marche. Ou tenter d’éliminer le futur.
Le drame : on se fait des idées. La poésie, c’est le contraire. Poésie de nulle part de n’importe où de partout.
Georges Perros, Papiers collés, III, Gallimard, ‘’L’Imaginaire’’, 1994, p. 90, 95, 104, 108.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, papiers collés, iii ; artiste, œuvre, texte, écrire, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2016
Pascal Quignard, Mourir de penser
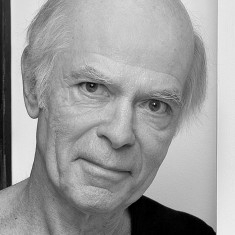
L’origine de l’activité psychique intellectuelle se fait en solo. Elle est, comme la fantasmagorie qui poursuit dans le jour la rêvée, radicalement masturbatoire. Elle est de nature antiparentale autant qu’antiproductricve. C’est pourquoi l’intelligence devient antifamiliale. C’est pourquoi la pensée s’assume d emanière de plus en plus antisociale. Son interrogation s’étend de façon incontrôlable, sur un mode inapaisable. Elle s’arrache à la société orale, à la voix prescriptrice, à la sagesse, aux dieux, aux interdits, aux proverbes, aux oracles.
[...]
Écrire est cet étrange parcours par lequel la masse continue de la langue, une fois rompue dans le silence, s’émiette sous forme de petits signes non liés et dont la provenance se découvre extraordinairement contingente au cours de l’histoire qui précède la naissance. Cet alphabet est déjà en ruine Par cette mutation chaque « sens » se décontextualise. Tout signal devenant signe perd son injonction tout en perdant le son dans le silence. Tout signe se décompose alors et devient littera morte, non coercitive, interprétable, transférable, transférentielle, transportable, ludique.
Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio / Gallimard, 2016, p. 217 et 218.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, intellectuel, solitude, écrire, signe | ![]() Facebook |
Facebook |
24/01/2016
Fernando Pessoa, Pour un ''Cancioneiro"

On dit que je feins ou mens
Tout ce que j’écris. Mais non,
Moi, simplement, je sens tout
Avec l’imagination.
Je ne me sers pas du cœur.
Tout ce que je rêve ou éprouve,
Ce qui me manque ou m’accomplit,
est comme une terrasse
Sur autre chose encore.
C’est cette chose qui est belle.
C’est pourquoi j’écris au milieu
De ce qui n’est pas à côté,
Délivré de tous mes émois,
Sérieux de tout ce qui n’est pas.
Sentir ? C’est au lecteur de sentir !
Fernando Pessoa, Pour un ‘’Cancioneiro’’,
traduction Patrick Quillier, dans Œuvres
poétiques, Pléiade / Gallimard, 2001, p. 176.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, pour un cancioneiro, écrire, imagination, rêve, sensation | ![]() Facebook |
Facebook |
10/01/2016
Agnès Rouzier, À haute voix, dans Change
Tout vouloir dire et ne pouvoir rien dire, quand on dit. Cette distance invincible qui fait effectivement que la parole ne serait valable que si elle pouvait être, en même temps, une forme de fête. Parce que quand on écrit, elle est fête, ou faite pour la fête, très exactement, oui, faite pour la fête. Mais la fête n’arrive jamais. Alors l’écriture est silence, et c’est dans cet intervalle : être faite pour la fête et ne devenir que silence, qu’il faut la situer, comme si dans cet intervalle le silence devenait : une fête, une sorte de fête, une fête, difficile de trouver le mot : ce n’est pas défaillant, ce n’est pas triste, une fête à part, une autre fête, une fête qui est redoublement du silence, peut-être que le silence, alors, devient quelque chose d’insolent, je ne sais pas. Je ne comprends pas bien. Je crois qu’il serait très important de définir, de chercher à comprendre ce que peut contenir cette forme de silence, ce qui le rend possible, ce qui rend cette parole-silence possible.
Agnès Rouzier, ‘’À haute voix’’, Change, ‘’La machine à conter’’, n° 38, octobre 1979, p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, ‘’À haute voix’’, change, ‘’la machine à conter’’, écrire, fête, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
31/10/2015
Rainer Brambach (1917-1983), Cinq poèmes

La prudence serait de rigueur
Qu’est-ce qui te pousse à écrire des vers ?
Pourquoi ne vends-tu pas du sel,
des maisons, des fusils, du tabac ?
La prudence serait de rigueur, tu le sais, car bientôt
reviendront les corbeaux — noirs prédicateurs
sans huile dans la voix — pour brailler ta misère
alors que toi tranquille encore tu te promènes.
Quand les glaçons prendront au bec des fontaines,
te restera pour logis la salle d’attente
où se faisant écho en de multiples langues
s’unissent l’adieu et l’arrivée.
Rainer Brambach, Cinq poèmes, traduit de l’allemand par Marion Graf, dans La revue de belles lettres, 2014, I, p. 17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer brambach, cinq poèmes, marion graf, écrire, vers, corbeaux, misère | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2015
Emmanuel Laugier, 27 fois — et suivantes : Jacques Dupin

27 fois — et suivantes : Jacques Dupin
papier de riz cassant le rêve
où sa jambe revenue
ouvre la garrigue
au son rêche des tissus
une écharde orpheline fait assez simple ra-
ccord persistant
la jambe harassée
où le nerf court et brûle
le long de la colonne du souffle
si l’écrire
le détachait de son corps
la semence de la voix
soufflée
là même où il répond
et s’en va
la suffocation à travers laquelle
il ne respire plus
est nœud gordien
logé au rappel de sa voix ici même
où le champ s’ouvre et se consume dans une fumée âcre
[...]
Emmanuel Laugier, 27 fois — et suivantes : Jacques Dupin,
dans Koshkonong, n°8, été 2015, p. 16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel laugier, 27 fois — et suivantes : jacques dupin, corps, femme, voix, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
14/07/2015
Caroline Sagot Duvauroux, 'j : recension

« nous voici séparés mais c’est écrire »(1)
Le titre, imprononçable, annonce l’impossibilité d’articuler "je", comme s’il y avait une disparition du sujet. Une apostrophe après le j implique, appelle un verbe, soit un engagement dans le monde, et c’est ce monde, difficile à vivre maintenant, dont le déplacement symbolique de l’apostrophe garde la trace. C’est que ’j est un poème du deuil, comme le furent Nous deux encore (Henri Michaux, 1948) et Quelque chose noir (Jacques Roubaud, 1986).
Le livre, d’une façon différente dans ses trois séquences, est entièrement construit sur le motif de l’absence, celle de l’aimé. Il s’ouvre par un fragment de phrase, « L’absence peut-elle », avant le premier ensemble où il est répété page de gauche, complété page de droite de sorte qu’une question chaque fois est posée, mais la liminaire les contient toutes, « L’absence peut-elle / ce que la présence, étrange, accomplit ? », et la dernière clôt toute question sur la relation entre présence et absence, une seule réponse, attendue, « L’absence peut-elle / arraisonner la présence ? ».
L’absence ne peut se vivre ici qu’en rappelant la présence, parce que le "je" s’est construit avec elle, dans ce qui est sans cesse mouvement, le lieu "je-tu", maintenant aboli ; il y a nécessité de la « présence étrangère » pour qu’existe en même temps « l’étranje ». Et quand « Tu s’est tu » — "tu sais tu" disparu —, ce qui est survenu devant le "je" peut être dit faille, fracture, seulement si l’on comprend qu’il n’est rien à combler, l’équilibre perdu n’était pas d’être sur l’autre bord mais "je-tu" du même côté.
Sans doute retrouve-t-on le thème de l’élégie, et la douleur s’exprime d’ailleurs aussi par le biais de l’interjection grecque classique, « o popoi ». Mais cette reprise est peut-être aussi une manière de (re)construire une assise, comme les diverses allusions littéraires, de Sophocle et la tragédie grecque à Genet, même si elles ont également une autre fonction dans le texte. Indissolublement lié au motif élégiaque est développé le questionnement sur ce qu’est le "je" par rapport au "tu" dans le passé et aujourd’hui. Hors la difficulté à penser autrement que dans un ici qui ne peut être que remémoré (« Nous n’étions qu’ici »), ce qui revient et s’écrit, c’est l’étreinte, la présence de la chair vivante dite sans détours par les verbes baiser, branler en ouverture de la seconde séquence. C’est là encore savoir, par l’évocation de l’amour des corps, que "je" fut autre, que la question « T’aimer sans toi ? » ne peut faire sens et que le "je" d’aujourd’hui dans une réelle mutilation ne peut se reconnaître. L’équivalence « tu = toujours » peut s’écrire, cependant la mort interdit que puisse se dire maintenant « je t’ », alors même qu’il n’est qu’une seule copule, « je t’aime », tout en contraignant à (ré)inventer une orientation — un ici maintenant —, en écrivant jusqu’au ressassement que le passé ne fut pas confusion, mais accomplissement du je, de son étrangeté.
Il faudrait s’attarder sur la manière, variée, dont la perte irréparable et ce qu’elle entraîne s’exprime dans ’j. Ce qui est le plus remarquable à mes yeux, c’est que l’expression écrite du deuil, ici, restitue avec force ce qu’éprouve toute personne vivant la mort de l’aimé(e). D’abord un ensemble de questions dont aucune n’a réellement de réponse, chacune ne faisant que renvoyer à la solitude maintenant vécue — « Tu ne seras pas là je n’étais pas là / Je ? là ? qu’est-ce ? / Nous n’étions qu’ici «. Ensuite, l’ordre du monde défait se dit par la mise en pièces des règles convenues de la syntaxe : phrases inachevées ou réduite à très peu de mots, à un mot, comme si la trituration de la langue pouvait aboutir à comprendre l’incompréhensible qu’est la disparition. Enfin, surtout dans la dernière partie, des énoncés bien détachés par des blancs qui, sans former une suite continue pour le sens, aboutissent à la nécessité de continue à écrire l’indicible, ce que reprend la quatrième de couverture. Cette nécessité achève le long cheminement qui commence de façon très négative — « Je n’aime pas Rabat » — et se termine dans la ville culturelle marocaine : « Prends place, narrateur, je l’altéré définitif nous débouche une bouteille à Tanger ».
Caroline Sagot Duvauroux, ’j, éditions Unes, 2015, 64 p., 16 €. Recension publiée dans Sitaudis le 18 juin 2015.
________________________________
1. Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado, "Le Refuge en Méditerranée", centre international de poésie Marseille, 2014, np.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, 'j : recension, deuil, douleur, écrire, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
21/06/2015
Francis Cohen, Les choses que nous savons

Crasse
(Peut-être... Écoutez... Vous avez commencé la lecture de la traduction écrite. La voix qui vous parle où il n’y a rien.
Il a écrit ceci.
Il vous parle, il écrit : Non, je n’ai pas vu ceci, je suis en train.
Je suis en train d’écrire ?)
Où suis-je ?
Un dossier.
Ils savent en venir à bout.
Vous savez ce que c’est, chaque jour suffit, en quelques minutes, en musique.
Il y a beaucoup à dire à leur propos. Exactement tout ce qu’ils ne peuvent raconter jusqu’à leur disparition complète.
Quand il n’existe plus, elle meurt de confusion.
Il gobe l’air, inerte. Ils abusent de l’eau, d’ailleurs les mains ne ferment pas les yeux. Point de réaction entre les doigts — soit une bave nacrée.
Oui. Amorphe si bien qu’elle danse sans fin. Ils l’épuisent pour des mains plus propres.
Se ride, se fendillent. Les peurs fendent l’oubli.
[...]
Francis Cohen, Les choses que nous savons, NOUS, 2015, p. 64-65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis cohen, les choses que nous savons, écrire, peur, crasse, danse | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2015
Jean-Pierre Burgart, Gris lumière

L’encre des signes
Ignorant de ma fin et de mon commencement, j’écris aveuglément
pour apprendre de l’encre des signes
ce qui ordonne et croise
la trame des images et la chaîne des mots
j’écris pour que la blancheur irrévocable
qui ajoure et cerne les mots saisis par l’encre
se souvienne du souffle qui les assemble
en les mêlant à l’air qui me traverse.
Je veux qu’entraîné par la nappe de silence
qui sourd et s’étend quand la page se détache de moi
soient abolis regrets, désirs, attente
et que, même fragment, l’écrit s’achève
dans le deuil blanc qui le suit, alors
je serai libre, écrire serait naître.
Jean-Pierre Burgart, Gris lumière, La Lettre volée, 2014,
p. 46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre burgart, gris lumière, l'encre des signes, écrire, naître | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2015
Alain Veinstein, Dix pas avant les ruines

[...]
Pour commencer, je tourne le dos au passé, à l’enfance où il y a la mort...
Hors de ses jambes, pour que la phrase ne se referme pas...
Ce n’est pas le dernier jour... Au début, il faut écrire sans amour...
Pas question de décrire les lieux, les personnages... Pas trace d’affaire d’homme... Je refuse l’aide d’une description de la terre... Je ne tire pas profit d’une scène... d’un concours de circonstances qui m’aurait permis de franchir un grand pas... D’un trait de plume, j’écarte les événements : personne, rien... Je ne m’appuie sur personne et sur rien...
De la précarité, je fais un théâtre... Enfance encore... Difficile de s’arracher ces lambeaux d’enfance... Et cette haine qui me tient... Face au personnage féminin, je puise dans la haine mon désir de l’ouvrir... Je rêve de mise à nu, de sang... Ce n’est pas une violence mauvaise... C’est mon amour, de très loin, hors de portée des lèvres... Je dis mon amour, étourdi encore, désarmé par le bruit d’un pas... Désarmé comme par le fracas, plus haut, de la caisse... J’ai fait un pas et, à chaque pas, s’enfonce une dernière demeure.
J’ai fait un pas et rêve d’un autre pas comme au début de la vie... Presque la force d’écrire à bout portant...
Je parle du premier pas à partir de la mort... Un temps lointain... Quelques arpents de terre où j’aurais trouvé ma nourriture... Toute une histoire... Je me souviens de quelques pas perdus... Et de la peur, rencontrée à chaque coin de phrase...
[...]
Alain Veinstein, Dix pas avant les ruines, dans L’introduction de la pelle, Seuil, 2014, p. 357-359.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, dix pas avant les ruines, enfance, écrire, peur, récit, personnage | ![]() Facebook |
Facebook |
10/03/2015
Isabelle Garron, Corps fut

Variations 2
[...]
là. enfant .tu évoques l'épreuve d’un texte
aux confins d’une île. ici l’empreinte
d’origine ses contours traduits
dans la neige
la fatigue de l’image .d’une femme
sa condition .et le ventre
les soubresauts et les
expectorations
lire noté à maintes reprises
je ne raconterai point
j’écrirai
sous une nuit l’attente fêlée
d’une voix dans la ruelle
en contrebas
les nuages dans la vallée
la crainte aussi
d’un retour du froid
Isabelle Garron, Corps fut, Flammarion,
2011, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle garron, corps fut, enfance, origine, femme, lire, écrire, voix, froid | ![]() Facebook |
Facebook |





