29/09/2012
Jacques Dupin, L'embrasure

Ce qu'une autre m'écrivait
comme avec une herbe longue et suppliciante
toi, toute, en mon absence, là,
dans le pur égarement d'un geste
hostile au gerbier du sang,
tu t'en délivres
tel un amour qui vire sur son ancre, chargé
de l'ombre nécessaire,
ici, mais plus bas, et criant
d'allégresse comme au premier jour
et toute la douleur de la terre
se contracte et se voûte
et surgit en une chaîne imprévisible
crêtée de foudre
et ruisselante de vigueur
*
Malgré l'étoile fraîchement meurtrie
qui bifurque
— c'est sa seule cruauté le battement
de ma phrase qui s'obscurcit
et se dénoue —,
il est encore capable, lui, de soutenir
la proximité du murmure
Jacques Dupin, L'embrasure, Gallimard, 1969,
p. 32 et 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, l'embrasure, amour, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2012
Henri Thomas, La joie de cette vie
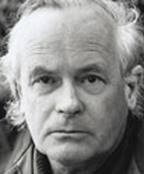
J'écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages, comme Paulhan, où l'on disparaît quand la machine se modifie pour votre mort.
Je quitte tout, presque tout, pour la route des mots.
Si la mort est la solution forcée du problème appelé la vie, nous ne comprenons pas plus le problème que la solution, et si nous pouvons constater cela, c'est grâce au langage, que nous ne comprenons pas davantage.
Je n'ai pas vécu ce que j'écris maintenant ; je le vis, je le découvre, en l'écrivant — sur le mode de l'écriture, comme on dit en croyant par cette formule expliquer quelque chose.
Je n'ai, pour répondre de moi, que mes livres, que j'ai oubliés, après m'y être absorbé, peut-être résorbé. Ils sont pareils en cela aux amours, dont on n'a plus guère que le titre : un nom, un prénom, une couleur dominante ; le reste a disparu comme l'herbe des champs, comme les lignes écrites il ya six mois ou dix ans.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 21, 28, 29, 30, 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, écrire, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2012
Guy Goffette, Épilepsie force douze

I
La parole
Un seul soir ivre
Le petit ramoneur ne passera plus
Demandez le matin
La logique où est la logique
Elle boit un verre
au café de la gare
La mer vomit pas loin
contre un poteau indicateur
Si seulement les tickets
L’antipode dit que c’est l’heure
périodiquement
XI
Écrire ah
La tête que font les gens pressés
dans les vitrines
Combien en voulez-vous
Un peu de mou pour vos chats Madame
Le sergent de ville passe
dans les portefeuilles
L’identité du bonhomme de neige
est confuse
Glisser dans le Moyen Âge
est une question de souplesse
Quant à écrire
la putain se méfie
Guy Goffette, Épilepsie force douze, dans Traversées, n° 46, printemps 2007, p. 4 et 14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy goffette, Épilepsie force douze, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
16/03/2012
Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l'eau

J'écris parfois dans l'allégresse
parfois dans les douleurs du doute
bénignes certes mais réelles, physiques
maux d'estomac mauvais sommeil
je me lève en aveugle me cogne
vais dans mon bureau, dérange un papillon de nuit
nerveux palpite contre des feuilles blanches
tourne des pages, les rature
trouve un goût de vin frelaté à mes vers
ai bien envie de tout laisser en plan
alors j'ouvre des livres
cherche des modèles, des mots qui fusent
cailloux lancés par une fronde,
goûte des vers puis les recrache
m'essaie à jouer les sommeliers :
« ça, insipide, trop fade venaison
vers ennuyeux à faire fuir
les déjà peu nombreux lecteurs de poésie
ça par contre superbe, à la fois subtil et corsé :
Réda dont il faudrait pouvoir prendre la roue
mais comment faire ? compter sur l'alchimie
de quelques verres de vin ? autant que l'univers
c'est un entier mystère impossible à percer
même avec le secours de l'or d'un Mercurey
versé dans de nombreux ballons
qu'un jour à quelques-uns nous partageâmes à Lyon »
la tête en feu je tente à nouveau de dormir
comptant sur l'alambic de la nuit
pour qu'au matin mes vers soient à peu près buvables
filent moins lourdement qu'ici la métaphore
Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l'eau, Champ Vallon,
1993, p. 46-47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, laïus au bord de l'eau, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
29/01/2012
Guillevic, Art poétique
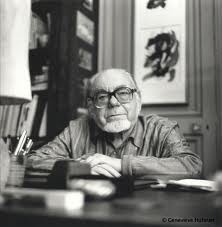
Écrire le poème
C'est d'ici se donner un ailleurs
Plus qu'ici auparavant.
Un travail : créer
De la tension
Entre les mots.
Faire que chacun
En appelle un
Ou plusieurs autres.
Ils ne tiennent
Pas tellement à venir
De leur plein gré.
Quand ils arrivent
Ils sont arrimés
Irrévocablement
Par un silence
Qui ne sera
Jamais rompu.
Le poème
Nous met au monde.
Forcé d'écrire ?
Je n'en ai pas envie.
J'aimerais
Rester là, immobile.
À regarder le ciel,
Il n'y a pas plus bleu.
Et de temps en temps
L'horizon et ses approches.
Je voudrais
Me passer des mots.
Guillevic, Art poétique, précédé de Paroi et suivi de Le Chant, Préface de Serge Gaubert, Poésie / Gallimard, 2001, p. 260, 280, 291, 294.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, art poétique, écrire, les mots | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2011
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts
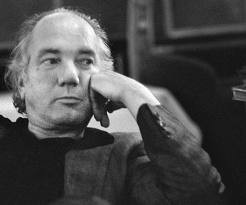 Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
De toute ma vie je ne me suis jamais libéré par l’écriture. Si tel avait été le cas, il ne resterait rien. Et que ferais-je de la liberté que j’aurais obtenue ? Je ne suis pas du tout partisan de la délivrance. Du cimetière peut-être. Mais non, je ne crois pas à cela non plus, parce qu’alors il n’y aurait rien.
Je n’ai pas besoin d’inventer quoi que ce soit. La réalité est bien pire. Par le biais de mes relations avec les gens de ce village, je sais ce qu’ils endurent, je sais à quelle heure ils dorment, ce qu’ils mangent, et quand leur cancer se déclare. Il y a beaucoup de fabriques de papier dans ce secteur, et un bon nombre d’estropiés auxquels les machines ont coupé les doigts, les bras ou un bout d’oreille. Peu à peu les machines leur coupent tout. Ou bien vous roulez à motocyclette sur les rails. Et vous y laissez une jambe. C’est ce qui est arrivé à l’ancien propriétaire de cette ferme. C’était un travailleur posté. J’ai chauffé la maison avec des jambes de bois. Lui en avait fait une grande consommation.
L’être humain refuse d’admettre que la nature est plus grandiose qu’un battement de cœur. Une prairie en fleurs est une chose si prodigieusement fondamentale que la gorge se serre rien qu’à y penser. Mais tout sera perdu, hormis pour quelques créatures un peu demeurées. Peut-être verra-t-on naître alors quelque chose de véritablement nouveau.
Pour que ça vienne avec fraîcheur, j’alterne toujours : après la prose, une pièce de théâtre. Le principal attrait du théâtre, ce sont les gens avec lesquels vous travaillez. Lorsque vous écrivez de la prose, vous êtes seul. Vous envoyez le manuscrit à l’éditeur, vous recevez bientôt de sa part une lettre stupide, puis vous n’avez plus aucune nouvelle, jusqu’à ce que vous parvienne un livre imprimé à la va-comme-je-te-pousse, truffé de ces fautes que vous vous étiez escrimé à corriger, ensuite, après un long silence, les critiques entrent en scène, le cauchemar, et en plus vous ne gagnez presque rien. En revanche, travailler pour le théâtre, c’est du stress. Au bout de quelques semaines, ça me tape sur les nerfs, tous ces acteurs effroyables. Je suis alors content quand une nouvelle prose démarre pendant ce temps-là. Et je supporte de traverser des mois en solitaire.
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts, traduit de l’allemand par Jean-Baptiste Para, dans Europe, n° 959, mars 2009, p. 19, 19, 19-20, 21, 21-22.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, prose et théâtre, écrire, jean-baptiste para | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2011
Giorgio Manganelli, Discours de l'ombre et du blason
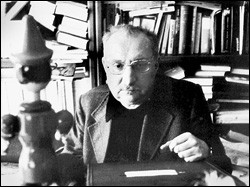 Un écrivain ne cesse jamais d’écrire, jamais ne cesse de lire ; un lecteur jamais ne cesse de lire, jamais ne cesse d’écrire. Les mots ignorent les hiatus, lacunes, haltes, parkings, sommeils ; leur magie n’a pas de cesse, le miracle est la règle, la continuité le prodige, le chaos est un ordre, la fureur une paix, la nuit étincelle, le jour est peuplé des images du rêve. Les mots parlent, les mots n’ont rien à dire, donc ils parlent. Aucune horloge ne scande leur temps, aucune loi ne les emprisonne, aucune prohibition ne les concerne. Aucun désir ne les retient. Vous avez lu : la littérature a tué la nature. Vous auriez dû lire : la parole a, dans le même instant, créé et tué la nature ; avant la parole, il n’y avait pas de nature, et le big bang ne fut rien d’autre que l’explosion d’un dictionnaire. Avoir affaire aux mots est une condition sans remède ; ils exercent sur nous avec indifférence un chantage qui n’admet aucun compromis, et toute concession accroît leurs exigences, et nos tortures. Soyons clairs : je ne parle pas d’exigence de perfection ; ni de style. On ne peut pas perfectionner ses rêves, mais on peut perfectionner sa dépendance à l’égard des rêves, se faire oniromane, s’intoxiquer de logos, de words, words, words, et en ce sens il est facile d’atteindre à l’extrême imperfection, de se dégrader, de se dégrader absolument devant la parole. La dégradation est nécessaire. Je suis désolé, mais je ne peux en distinguer personne, même pas les pères de famille. Un coup de téléphone m’a interrompu. J’aurais pu ne pas répondre, mais voyez-vous, la seule éventualité qu’il y ait des mots — au sens que l’on a dit — m’entraîne au vice. Je devrais dire maintenant : où en étions-nous restés ? Mais je sais aussi qu’il n’y a aucun lieu où rester ; tout lieu est structurellement identique à tout autre ; où que j’aille, je suis « ici ». L’ « ici » me possède, il te possède, tu n’as aucun moyen de t’en libérer, il ne t’est même ni permis ni possible de vouloir t’en libérer. Rien ne rassure davantage que la dégradation. Horrible est le moment où notre dignité se redresse en censeur des mots ; les mots alors se dispersent en riant ; et nous ne distinguons plus le double de la parole. Le double se joue de nous, se déguise en parole. Notre dignité ne cesse de s’accroître au contact de la parole, parole feinte qu’il suffirait de mettre devant un miroir, ou d’exposer à la violente lumière de midi ; car le double n’a pas d’image dans le miroir, et ne donne pas d’ombre ; c’est en cela probablement que le miroir fait allusion au blason.
Un écrivain ne cesse jamais d’écrire, jamais ne cesse de lire ; un lecteur jamais ne cesse de lire, jamais ne cesse d’écrire. Les mots ignorent les hiatus, lacunes, haltes, parkings, sommeils ; leur magie n’a pas de cesse, le miracle est la règle, la continuité le prodige, le chaos est un ordre, la fureur une paix, la nuit étincelle, le jour est peuplé des images du rêve. Les mots parlent, les mots n’ont rien à dire, donc ils parlent. Aucune horloge ne scande leur temps, aucune loi ne les emprisonne, aucune prohibition ne les concerne. Aucun désir ne les retient. Vous avez lu : la littérature a tué la nature. Vous auriez dû lire : la parole a, dans le même instant, créé et tué la nature ; avant la parole, il n’y avait pas de nature, et le big bang ne fut rien d’autre que l’explosion d’un dictionnaire. Avoir affaire aux mots est une condition sans remède ; ils exercent sur nous avec indifférence un chantage qui n’admet aucun compromis, et toute concession accroît leurs exigences, et nos tortures. Soyons clairs : je ne parle pas d’exigence de perfection ; ni de style. On ne peut pas perfectionner ses rêves, mais on peut perfectionner sa dépendance à l’égard des rêves, se faire oniromane, s’intoxiquer de logos, de words, words, words, et en ce sens il est facile d’atteindre à l’extrême imperfection, de se dégrader, de se dégrader absolument devant la parole. La dégradation est nécessaire. Je suis désolé, mais je ne peux en distinguer personne, même pas les pères de famille. Un coup de téléphone m’a interrompu. J’aurais pu ne pas répondre, mais voyez-vous, la seule éventualité qu’il y ait des mots — au sens que l’on a dit — m’entraîne au vice. Je devrais dire maintenant : où en étions-nous restés ? Mais je sais aussi qu’il n’y a aucun lieu où rester ; tout lieu est structurellement identique à tout autre ; où que j’aille, je suis « ici ». L’ « ici » me possède, il te possède, tu n’as aucun moyen de t’en libérer, il ne t’est même ni permis ni possible de vouloir t’en libérer. Rien ne rassure davantage que la dégradation. Horrible est le moment où notre dignité se redresse en censeur des mots ; les mots alors se dispersent en riant ; et nous ne distinguons plus le double de la parole. Le double se joue de nous, se déguise en parole. Notre dignité ne cesse de s’accroître au contact de la parole, parole feinte qu’il suffirait de mettre devant un miroir, ou d’exposer à la violente lumière de midi ; car le double n’a pas d’image dans le miroir, et ne donne pas d’ombre ; c’est en cela probablement que le miroir fait allusion au blason.
Les anciens savaient que chaque mot a un double, et que ce double a un destin qui n’est pas celui du mot. Écho est le double de la parole, qui témoigne pour elle quand elle a passé outre. Ce que nous lisons, écoutons, pensons, est parole, mais ce qui reste en nous est le double sous la forme d’Écho, c’est l’image de la parole « reflétée », mais le reflet n’a pas de reflet. Dans cette triste et gracieuse histoire, Écho se prend d’amour — « Je me suis désespérément prise d’amour » — pour Narcisse, lui-même amoureux, non pas de son double, mais de son image renversée. Il s’ensuit que c’est l’Écho qui permet à la parole de demeurer ininterrompue, car si elle n’avait pas ce double à sa disposition elle finirait par tomber, comme Narcisse, dans un amour spéculaire, porteur de mort comme le sont toutes les tentatives qu’on fait pour se posséder soi-même.
[…]
Giorgio Manganelli, Discours de l’ombre et du blason, ou du lecteur et de l’écrivain considérés comme déments, traduit de l’italien par Danièle Van de Velde, Fiction & Cie, éditions du Seuil, 1987, p. 122-124.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, discours de l'ombre et du blason, rêve, écrire, lire | ![]() Facebook |
Facebook |
03/08/2011
Jean-Louis Giovannoni, Pas japonais
 On ne peut écrire qu'en perdant
On ne peut écrire qu'en perdant
le corps de ce que l'on nomme.
Tu parles, tu écris pour que les choses
ne coïncident plus avec elles-mêmes.
On n'écrit pas pour donner aux choses une
place, on écrit pour faire de la place ;
pour que l'arbre ne vienne jamais dans son
nom et que la pierre se taise dans ce qui la
désigne.
Écrire, c'est apporter de l'eau à une source
pour qu'elle découvre sa soif.
Écrire, c'est appeler, appeler surtout pour
que rien ne vienne.
Tu parles, tu écris pour ne pas perdre pied,
pour te tenir dans la distance de
toute chose.
Comment continuer à écrire en sachant
qu'aucun mot ne peut contenir le corps
de ce qu'il nomme.
Écrire, c'est chercher sans cesse un point d'appui.
Écrire, pour lire sa voix dans la voix
des autres.
Peut-être que nos mots sont la seule
terre où l'on peut s'établir ?
Écrire, c'est se tenir à côté de ce qui
se tait.
Écrire, c'est maintenir l'appel,
n'être que le lieu de cet appel.
Jean-Louis Giovannoni, Pas japonais, dans Ce lieu que les pierres regardent, suivi de Variations, Pas japonais, L'Invention de l'espace, préface de Gisèle Berkman, éditions Lettres vives, 2009 (Pas japonais avait été publié en 1992, éditions Unes), p. 93, 95, 95, 96, 96, 98, 100, 100, 101, 103, 104, 106.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, pas japonais, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
17/07/2011
Samuel Beckett, L'innommable
 Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça des questions, des hypothèses. Aller de l’avant, appeler ça aller de l’avant, appeler ça de l’avant. Se peut-il qu’un jour, premier pas va, j’y sois simplement resté, où au lieu de sortir, selon une vieille habitude, passer jour et nuit aussi loin que possible de chez moi, ce n’était pas loin. Cela a pu commencer ainsi. Je ne me poserai plus de questions. On croit seulement se reposer, afin de mieux agir par la suite, et voilà qu’en très peu de temps on est dans l’impossibilité de plus jamais rien faire. Peu importe comment cela s’est produit. Cela, dire cela, sans savoir quoi. Peut-être n’ai-je fait qu’entériner un vieil état de fait. Mais je n’ai rien fait. J’ai l’air de parler, ce n’est pas moi, de moi, ce n’est pas de moi. Ces quelques généralisations pour commencer. Comment faire, comment vais-je faire, que dois-je faire, dans la situation où je suis, comment procéder ? Par pure aporie ou bien par affirmations et négations infirmées au fur et à mesure, ou tôt ou tard. Cela d’une façon générale. Il doit y avoir d’autres biais. Sinon ce serait à désespérer de tout. Mais c’est à désespérer de tout. À remarquer, avant d’aller plus loin, de l’avant, que je dis aporie sans savoir ce que ça veut dire. Peut-on être éphectique autrement qu’à son insu ? Je ne sais pas. Les oui et non, c’est autre chose, ils me reviendront à mesure que je progresserai, et la façon de chier dessus, tôt ou tard, comme un oiseau, sans en oublier un seul. On dit ça. Le fait semble être, si dans la situation où je suis on peut parler de faits, non seulement que je vais avoir à parler de faits, non seulement que je vais avoir à parler de choses dont je ne peux parler, mais encore, ce qui est plus intéressant, que je, ce qui est encore plus intéressant, que je, je ne sais plus, ça ne fait rien. Cependant, je suis obligé de parler. Je ne me tairai jamais. Jamais.
Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça des questions, des hypothèses. Aller de l’avant, appeler ça aller de l’avant, appeler ça de l’avant. Se peut-il qu’un jour, premier pas va, j’y sois simplement resté, où au lieu de sortir, selon une vieille habitude, passer jour et nuit aussi loin que possible de chez moi, ce n’était pas loin. Cela a pu commencer ainsi. Je ne me poserai plus de questions. On croit seulement se reposer, afin de mieux agir par la suite, et voilà qu’en très peu de temps on est dans l’impossibilité de plus jamais rien faire. Peu importe comment cela s’est produit. Cela, dire cela, sans savoir quoi. Peut-être n’ai-je fait qu’entériner un vieil état de fait. Mais je n’ai rien fait. J’ai l’air de parler, ce n’est pas moi, de moi, ce n’est pas de moi. Ces quelques généralisations pour commencer. Comment faire, comment vais-je faire, que dois-je faire, dans la situation où je suis, comment procéder ? Par pure aporie ou bien par affirmations et négations infirmées au fur et à mesure, ou tôt ou tard. Cela d’une façon générale. Il doit y avoir d’autres biais. Sinon ce serait à désespérer de tout. Mais c’est à désespérer de tout. À remarquer, avant d’aller plus loin, de l’avant, que je dis aporie sans savoir ce que ça veut dire. Peut-on être éphectique autrement qu’à son insu ? Je ne sais pas. Les oui et non, c’est autre chose, ils me reviendront à mesure que je progresserai, et la façon de chier dessus, tôt ou tard, comme un oiseau, sans en oublier un seul. On dit ça. Le fait semble être, si dans la situation où je suis on peut parler de faits, non seulement que je vais avoir à parler de faits, non seulement que je vais avoir à parler de choses dont je ne peux parler, mais encore, ce qui est plus intéressant, que je, ce qui est encore plus intéressant, que je, je ne sais plus, ça ne fait rien. Cependant, je suis obligé de parler. Je ne me tairai jamais. Jamais.
Samuel Beckett, L’innommable, éditions de Minuit, 1953, p. 7-9 (L’innommable est aussi disponible en Poche/Minuit).
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, l'innommable, parler, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
01/07/2011
André du Bouchet, La lampe dans la lumière aride (2)
 (Poésie : se rappeler la nuit le matin)
(Poésie : se rappeler la nuit le matin)
Deux poètes, deux poésies :
celle qui s’élabore tandis que le héros reste muet, les mots du silence, celle qui emboîte la parole au héros.
Le courage, la volonté d’écrire, n’est autre que de se résigner à se décider à se servir de ces mots défaillants, sans y voir d’avantage ou d’issue immédiate. La mémoire, seule, si faible, dit que ce labeur servira.
les mots défaillants
tous défaillants, tremblants, comme moi,
comme ce bras à nouveau saisi de paralysé
Je me suis assis sur un rocher habituellement écrasé par le jour. Rocher trempé d’aurore. Maculé de ces taches de bleu vif orange qui éclaboussaient l’horizon. Lichen encore visible le jour, comme ces végétations marines, adhérant aux roches qui attendent l’heure de la marée pour s’épanouir. Un champ de nuages collait aux mêmes rochers, de disques noirs et blancs enchevêtrés, durement échoués comme ces tas de nuages pavés, durement tassés, écrasés les uns contre les autres, très bas. Le plafond bas du ciel. L'écorce du ciel qui se fendille. Le rocher brillait extraordinairement. Comme un bloc de ciel. Criblé de lichen orange. Dans le village, au départ. Pierraille.
pan de pierres écroulées. Mur dur sourd aveugle au-dessus du bol de feu, muet, de la grande tasse d’eau de l’aube.
Le soc rougi qui laboure la terre.
Lumière aigre de la première lampe au fond du village
au centre des toits.
La poésie tire son obscurité de cet effort de transvaser les qualités des choses dans le langage — refusant de les évoquer directement — comme si elles pouvaient exister en dehors de celui qui parle.
Écrire
Parler de la terre. Parler aux hommes, parler, autant se parler à soi-même. On ne sort pas de l’homme. Le reste passe. Et pourtant les seuls êtres différents de soi que l’on puisse concevoir, ce sont les hommes.
Poésie : quand la réalité commence à déserter les images qu’elle a charroyées, et qu’elles apparaissent nues et seules.
Les images nues qu’il faut ramener à la réalité,
légèrement différentes de la réalité première.
Les faits de la réalité trouvent, s’ils sont bien observés, de merveilleuses sonorités dans les mots.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 67, 80, 82-83, 91, 93, 96, 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, poésie, écrire, la lampe dans la lumière aride | ![]() Facebook |
Facebook |
21/06/2011
Béatrice Bonhomme, Cimetière étoilé de la mer

Femme de tulle et de pierre posée sur du papier
pour Serge Popoff
1 - Si je devais commencer à écrire, je commencerais par la blessure, la déchirure, je répèterais la blessure, la déchirure, éternellement, le retour à la mère, le retour à son ventre de plume et de limon, à son ventre de ciel.
2 - Elle étend la main au-dessus des lions d’étoile, elle étend une main protectrice ou vengeresse au-dessus des lianes de silence, femme de filigranes ou d’empreintes, femme de traces, femme posée sur l’étroitesse tramée d’un sillon, travail d’un graveur sur le ventre veiné bleu de la pierre au plus profond d’une naissance de roche.
3 - Traces, territoire interdit du tissu, de la toile, araignée d’étoile filante, elle est devenue points d’empreinte et de nuit, vierge de pierre et protège dans la roche l’enfance éparpillée du monde. Mère première, matière, archétype de sources et de lignes, femme taillée, arrachée à la pierre, déesse au bras dressé, elle montre une terre promise dans la prophétie des traces.
4 - Griffe de l’encre, tache, marque laissée par son corps sur une surface. En creux, l’effigie d’un prophète ouvre la terre, ouvre les voies, ouvre les bavures de l’étampe sur la plaque sensible restée toujours sensible de la blessure, comme la frappe du cachet reproduit le creux de l’entaille ou le calque de la douleur sur un visage.
5 - Stigmates se trouvant dans le corps d’un papier et que l’on peut voir en transparence, sillon douloureux de l’eau-forte, pli, pliure en miroir, petits signes de gravure, une main pointée, une main qui montre, scellée dans la pierre, et comme le cataclysme d’un message sur un peuple éperdu, recroquevillé dans les plis de pierre de la robe, enfants perdus, échevelés devant l’imminence d’un désastre et brisant leur blessure dans les plis brisés d’une robe de pierre.
6 - Scissure, sillons du cœur, strie de la valvule, fente pleine de larmes, silice pur, de pierre transparente, cristallisée dans la souffrance d’une estampille, au cilice des douleurs, blessures, cicatrices. Avancée rigide comme un bas-relief de douleur percluse, chemise, ceinture de crin ou l’étoffe rude que l’on porte sur la peau par mortification de blessure.
7 - reproduction inversée, surface polie d’un cilice où celui-ci posé fait le plus mal.
Si je devais finir d’écrire, je finirais par la blessure, la déchirure, éternellement, le retour à la mère, à son ventre d’acide et de brûlure, à ce bleu ardent, acidulé comme les brûlures de l’eau-forte, à son ventre de ciel.
Béatrice Bonhomme, Cimetière étoilé de la mer, Versets 1995-2003, Avant-propos de Claude Louis-Combet, éditions Melis, 2004, p. 17-18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : béatrice bonhomme, cimetière étoilé de la mer, écrire, la blessure | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2011
Eugène Savitzkaya, entretien, poèmes
 Quand on vous lit depuis longtemps, on a l’impression d’un texte sans fin en passant d’un livre à l’autre.
Quand on vous lit depuis longtemps, on a l’impression d’un texte sans fin en passant d’un livre à l’autre.
Ce sont toujours les mêmes rêves qui agitent le sommeil, les mêmes frayeurs qui me font suer, et les éléments qui composent la formule quasi chimique du bonheur sont quasiment invariables et peu nombreux. Mes livres ne sont chaque fois que des charnières. Ils contiennent à la fois le partiel éclaircissement de préoccupations survenues dans l’un des livres précédents et le surgissement d’autres préoccupations.
Écrire, ce qui occupe une bonne partie de votre vie — et puis ?
Autre chose qu’écrire. De plus en plus de choses — lire, tailler les arbres fruitiers, marcher, semer, planter. Tant de choses… À tel point que je ne sais plus très bien si toutes ces activités sont assujetties à l’écriture ou le contraire. À tel point que je ne sais plus si j’écris pour rendre compte de ce que je fais ou si les autres activités ne sont pratiquées que pour amener l’eau au moulin. Une salutaire et peu confortable confusion.
Lire : quels sont vos points de repère ?
Mes contemporains. Beckett, Guyotat, Pinget, Stéfan, Genet, Izoard, Parant, Pérec, Cela, Leiris, Char, Ponge.
Quelques points de repère : Fable (Pinget), Paulina 1880 (Jouve), Premier amour (Beckett), Le palais des très blanches mouffettes (Arenas), Tombeau pour cinq cent mille soldats (Guyotat), Le Journal du voleur (Genet), Vie de mon frère (Stéfan), Mrs Caldwell parle à son fils (Cela), Souvenirs d’enfance (Tagore), Illuminations (Rimbaud), Office des ténèbres (Cela), N’entre pas sans violence dans cette bonne nuit (Thomas), Aux chiens du soir (Stéfan), La patrie empaillée (Izoard), Notes de chevet (Sei shônagon), Cavalerie rouge (Babel), La Révolte des Tartares (Thomas de Quincey)…, livres tous lus au bon moment.
Quels animaux, si présents dans vos livres… ?
D’abord j’ai toujours adoré les noms qui les désignent : hérisson, ours, tortue, loup, lion, fourmi, lapin, koala. Ils ont toujours été pour moi des fragments de terre animée, les véritables esprits du monde, innombrables et la plupart du temps invisibles.
... tout comme l’enfance.
C’est une mine d’images et de figures parfaites et éternelles : un dindon perché sur le toit le plus haut de la maison, mon petit frère sur le dos du jars le plus agressif, un lapin perdant ses viscères sur l’herbe du verger, les pommiers géants, etc. Figures et images qui ont une valeur d’étalon. Et une intime connaissance du pire et du meilleur.
Mongolie plaine sale, Plaisirs solitaires, Couleurs de boucherie,… : qu’en est-il des titres ?
C’est très difficile de donner un titre à quelque chose qui demeure toujours informe, pas vraiment achevé. Mais c’est une pratique à laquelle j’ai fini par me faire. La plupart du temps, je donne le titre après avoir clos le livre. Une façon de me détacher de ce que je viens d’écrire, de prendre une certaine distance et d’imposer en même temps au lecteur une lecture possible, tout en espérant qu’il s’en moque. J’ai une confiance aveugle dans la totale liberté du lecteur, dans son infinie fantaisie.
Ce texte reprend avec quelques variantes un entretien publié dans la revue Recueil, n° 20, décembre 1991 (éditions Champ Vallon).
Souillée de lait, comme le loup avide, comme
le cygne, dépouillée, lourde comme l’eau de la mer,
le bras du boucher, la jambe de la salie,
la tête du rat, souillée, comme les pattes du héron,
le frère et la sœur, l’ogre matinal éveillant
ses poussins, pourpre et bleue, masquée, veule,
mêlée aux feuilles, aux baies, aux pépins,
petite morveuse près du limon, sur les braises,
sur les coussins brodés, dans la soie, puante,
dans le linge nouveau, brûlée, décapitée, comme
les tournesols, comme le frère et la sœur,
le garçon, le souffleur, le palmier,
à la main blanche, paume de la main froite mordue,
ventre peint, pied blessé dans le piège, dans le sac,
petit soleil de ma journée, trou, tréfonds, salie
la morte qui engloutissait, qui lapait, criant,
ouvrant œil de mercure, anus rose, au bord du gouffre,
salie de cendre, éclaboussée de plumes, tournée
vers le centre de la terre, distribuant les pestes,
perdue, jetée, déchirée, ouverte, envahie, habitée,
tombée sur les graviers.
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit, 1986, p. 35.
Combien de porcs sous les chênes,
combien de chênes dans la forêt, quelle forêt,
qui tient la hache et par quel bout, où, où,
où, où, mon coucou ? en mon sternum entre les
seins se fiche la corne et de mon cul
coule le sang, je suis vierge et perdue,
liée à l’horloge, licorne sans tête têtue,
mon index sur les plis de ma bouche, silence,
je prends rien au fond de ma poche et je jette
rien qui retombe en crépitant sur
les feuilles mortes.
Eugène Savitzkaya, Cochon farci, éditions de Minuit, 1996, p. 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : savitzkaya, lire, écrire, animaux, bufo, cochon | ![]() Facebook |
Facebook |
02/06/2011
Etienne Faure, entretien - Horizon du sol
Étienne Faure vient de publier aux éditions Champ Vallon Horizon du sol, après Légèrement frôlée (2007) et Vues prenables (2009) chez le même éditeur.
Comme on sort de la ville,
d’un quartier loin du cœur,
l’été longeant les rues ombragées, il arrive
la frôlant — la mort et ses fragrances —
qu’on en garde ombre et parfum mêlés,
de ces jardins, le sombre pressentiment
d’un jour d’été, noir à l’idée de mourir tout à l’heure
bien avant les fleurs grillagées,
en plein contraste ayant senti,
belle ironie du nez, la mort venir
dans le mélange des parfums de fleurs
qui font desséchées à cette heure
une espèce de pot-pourri
—vite évanoui, car le jaune agressif au nez
d’un champ de moutarde inhalée
bientôt l’efface, campagne
où la route est tracée, éperdument ne laissant qu’un lacet dans la tête.
frolée
Horizon du sol, p. 25.
 Commençons par une question bien classique : quand as-tu commencé à écrire ?
Commençons par une question bien classique : quand as-tu commencé à écrire ?
À l’adolescence. J’ai bien eu le goût de faire quelques petits écrits plus tôt, mais c’était lié à la confection de livres, je fabriquais des livres et il fallait donc les remplir, raconter des histoires... Au début, j’ai commencé par écrire des sonnets, c’était cela qui me semblait la forme la plus pertinente, la plus seyante... Ensuite, il y a eu le contact un peu foudroyant avec le surréalisme. J’ai essayé de pratiquer l’écriture automatique, le cadavre exquis … tout ce que l’on peut explorer pour amplifier la découverte…C’était intéressant pour sortir d’un carcan un peu classique. Les choses sont parties comme cela, mais moderato cantabile. Je suis peu à peu entré dans d’autres problématiques, par exemple l’importance de l’étymologie, de son poids dans le texte, tout ce que recèlent les mots, et bien sûr leur mouvement via la syntaxe. La langue est un grand étonnement…Parallèlement je lisais beaucoup de poètes, français, étrangers, anciens ou contemporains, mais aussi beaucoup de prose (les auteurs russes, allemands, tchèques, polonais….). Au fond je progressais dans la trilogie indivisible de la langue « lue, parlée, écrite » qu’on inscrit dans son curriculum vitae pour aller se vendre sur le marché du travail. « Lue, parlée, écrite » est aussi le titre d’une des parties de Légèrement frôlée.
Le principe du poème est de créer une contrainte. J’ai traversé une période où le blanc était fortement dominant, dans les années fin 1970 et 80, le blanc avait une grande autorité, et j’ai fréquenté cette poésie-là. Il faut tout lire, y compris les auteurs dont on se sent le plus éloigné par la façon ou le regard, cela sert de poil à gratter… Ensuite j’ai eu besoin de retrouver une forme plus compacte avec des contraintes. L’usage du blanc entraînait un démantèlement qui ne m’allait pas, même si je restais très intéressé par les travaux où les mots montent en charge, prennent du poids, résonnent très fortement. Cela me parlait plus qu’un simple désossement sur la page – je parle un peu ardemment ! – qui ne m’allait pas. Je voulais retrouver du corps dans le texte. Cela dit, il y a énormément de poèmes, de diverses époques, où le blanc est grandement présent, et qui me parlent beaucoup.
Avant tes deux premiers livres, Légèrement frôlée et Vues prenables, tu as été abondamment publié dans des revues ?
Oui, c’est une chance de rencontrer un lectorat différent d’une revue à l’autre, en passant de La NRF à Conférence, à Théodore Balmoral, Rehauts, Europe, Le Mâche-Laurier... Ce sont des revues d’un ton et d’un parti pris différents qui incluent pour certaines des appareils critiques, de la prose, des traductions avec une recherche de composition parfois très élaborée. Et puis il y a également le plaisir de se retrouver en présence d’autres auteurs – parfois même déjà morts – dans le grand atelier contemporain où la poésie se fabrique. Les textes peuvent ainsi gagner à attendre, à être un peu remâchés, ne pas mimer la logique marchande qui met en circulation tout et tout de suite… Ne pas craindre les ratures…ou de ne pas être lu immédiatement sitôt qu’on a pondu…
Le revers de l’affaire, c’est qu’au bout d’un moment on a le sentiment d’être un auteur un peu émietté, un peu disséminé. Il fallait donc franchir le seuil et arriver au livre avec la difficulté souvent soulevée par certains auteurs de dépasser le simple assemblage, de constituer un peu plus qu’un recueil pour parvenir à un ensemble, à un livre. La question de l’homogénéité de Légèrement frôlée et de Vues prenables résulte d’un travail de tamis, d’élimination de textes qui me paraissaient un peu courts, dans toutes les acceptions du terme, où souvent prédominaient un esprit un peu grinçant et un humour qui ne collaient pas vraiment avec le reste. Je m’étais aperçu que cela mettait les ensembles un peu de guingois quand on laissait ces petits textes à côté des autres. Il y a donc une forme de sélection qui s’est opérée.
Mais l’humour s’est maintenu dans certains poèmes de tes deux livres.
Tu es le premier à me le dire... On m’avait jusqu’alors parlé d’une ironie ou d’un ton caustique. L’humour est une chose délicate, a fortiori en poésie où il faut faire léger, mais j’espère qu’il est un peu apparent. C’est quelque chose que j’essaie de conserver.
Je pense par exemple à un jeu sur le sens d’une expression — « à ravir » — dans le vers : la robe allait à vous ravir.
Il y a cette tentation de détourner, de décaler un petit peu le sens ; c’est par excellence le travail sur l’écriture, ce n’est pas nouveau, mais j’essaie de réprimer un peu cette tendance parce qu’elle pourrait apparaître comme un amusement anecdotique qui, à certains moments, pourrait sonner un peu faux dans le reste du texte.
On lit aussi dans tes textes un autre travail de l’écriture, qui aboutit à détourner l’attention de ce qui peut être grave par ailleurs, par exemple avec les derniers vers de "les langues de sable", dans Légèrement frôlée :
partout zone de cabotage clapotis charabia
le remuement aux mille langues
vers qui écartent le motif de la mort très présent dans le poème.
C’est un peu ce qui est suggéré dans le titre, Légèrement frôlée, une manière d’alléger la gravité, très souvent présente chez moi, de faire en sorte de ne pas trop s’y attarder pour ne pas s’enliser dans un pathos de mauvais aloi. Donc la forme ici permet d’alléger, par effet de contraste ; c’est une propension fréquente, un peu comme si l’on avait le pas lourd : j’essaie d’y introduire un peu de contrariété pour que le pas soit un peu moins scandé, un peu moins pesant, le tempo plus alerte. Si la forme était trop solennelle, eu égard au propos, cela ferait trop mastoc.
On me renvoie toujours au fait que la mort est extrêmement présente dans mes poèmes, mais il me semble qu’il y a la mort et le rire, que ce sont deux déclencheurs importants. La difficulté est de les faire cohabiter par un écrit pas trop sombrement teinté ; et puis d’essayer de passer autre chose à autrui en évitant d’en rester à une simple singularité.
En dehors de l’humour, il y a un travail tout autre dans la langue. On relèverait quantité de fragments du type :
car ignorant / à tout coup tout de la géographie [...].
C’est sans doute la marque d’une défiance au regard de l’éloquence, c’est clair, et aussi du « bien tourné », de la chose qui tombe trop bien comme un pli de pantalon sur une chaussure, vous savez… Sans doute faut-il conserver une petite fêlure, une rupture, non pas pour à tout prix chercher l’incongru, le saugrenu, mais pour arriver à être audible différemment, peut-être pour surprendre le lecteur quant à ce qu’il pensait découvrir après le virage du vers, qu’il y trouve autre chose.
(à suivre)
Entretien publié en 2009, revu et augmenté.
© Photo Chantal Tanet, 27 mai 2011
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ENTRETIENS, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etienne faure, écrire, humour, syntaxe | ![]() Facebook |
Facebook |





