06/11/2021
Antoine Emaz, Jours
24.03.07
et quoi vient
dans la nuit blanche du corps
quel rat grignote
entre douleur et malaise
comme si
importait
ce tas d’atomes
de fait oui
il crisse
et on supporte mal
*
douleur seule
« capitale »
c’est beaucoup dire
on n’a pas vraiment de mots
sur ce qui fait mal
à qui le dire ou quoi
ça soignerait
on attend que le grain de sable
le papier de verre qui raie
dans l’épaule et la tête
s’en aille
le reste flotte
comme d’habitude
(...)
Antoine Emaz, Jours / Tage,
Éditions En Forêt / Verlag im Wald,
2009, p. 23 et 25.
Photo T.H., 2007
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, jours, douleur, nuit blanche | ![]() Facebook |
Facebook |
05/11/2021
Antoine Emaz, Soirs
30.01.98
accorder la langue
sur peu de choses
là ce soir
seul
avec
le jour en vrac
tout est passé
*
restent l’herbe
quelques feuilles tordues sèches
le froid clair encore le mur
entre l’herbe et le mur
la lumière glace
à chaque fois renvoie
une paroi de froid
à la fin le crépi
craque gris
dans le soleil qui baisse
voilà
Antoine Emaz, Soirs,
Tarabuste, 1999, p. 74-75.
Photo T. H., 2007
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, langue, solitude, mur | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2021
Antoine Emaz, De l'air
Froid ((5.12.04)
dans le gris de l’hiver comme feutre
devenir d’un coup très vieux
des couches de lumière pâle
les unes sur les autres
jusqu’à ce gris flottant
entre ce qui se passe
et celui qui regarde
grand calme là
s’enliser sans fin
dans le terne
*
jour court
et rabot lent du froid
on ne s’habitue pas
un jardin de fer
le géranium finit son rouge
le pan de ciment non peint
à travers les branches du prunus
un ciel d’étain
bloque la neige
tout est gourd
Antoine Emaz, De l’air, le dé bleu,
2006, p. 56-57.
Photo T.H., 2010
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, de l'air, froid, hiver, gris | ![]() Facebook |
Facebook |
03/11/2021
Marie de Quatrebarbes, Les vivres
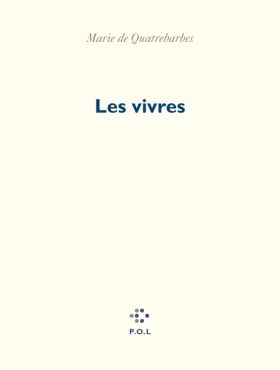
Marie de Quatrebarbes, d’un livre à l’autre, explore des formes. Avec Les vivres, elle choisit de revisiter celles du Journal. On sait bien que Stendhal et Kafka ne tenaient pas un Journal en vue de la publication, les choses ont changé quand le Journal a été édité du vivant même de son auteur, que l’on pense à Gide ou Julien Green hier, aujourd’hui à Charles Juliet ou Pierre Bergounioux : le Journal est devenu un genre littéraire. Traditionnellement, il s’agit d’un écrit autobiographique en prose dont l’auteur est le narrateur, qui est le personnage principal. Il implique une écriture à peu près régulière, même si toujours fragmentaire. Les vivresprésentent un Journal tenu pendant cinquante-six jours de juillet à décembre et toujours ouvert le 1er de chaque mois ; suivent des notations pendant quelques jours, qui s’espacent ensuite ou disparaissent. L’année n’est pas indiquée mais mention est faite à la fin du livre de la publication d’extraits à partir de 2014 et il est précisé que le texte du mois d’août a été écrit « en écho » au séminaire de Georges Didi-Huberman de 2014-2015, ce qui laisse penser à un décalage entre l’écriture de juillet et d’août et renforce l’idée d’un jeu avec le genre, confirmé par une brève adresse au lecteur en août : « Si vous lisez ceci ».
La subjectivité est bien présente avec le « je » et si d’autres pronoms apparaissent (tu, elles) qui peuvent l’inclure (on, nous), aucune figure n’a de consistance en dehors de celle dont est indiquée la disparition évoquée par une notation au passé le 1er juillet — le mot est employé le 2 —, et qui semble annoncée par l’extrait de Zanzotto choisi en exergue, « Je serai lointaine, mais je ne t’abandonnerai pas ». Si l’on prend Les vivres aussi comme un jeu avec un genre, il importe peu que la disparition soit, dans la réalité, celle de la grand-mère de l’auteure comme quelques indices plus ou moins précis le laissent entendre, par exemple « Je ne suis pas là lorsqu’elle me quitte » et, en septembre, « Se peut-il être, un de ces jours terrestres, la disparition hâtive d’un lien ? ».
De nombreuses images de l’enfance sont attachées à cette disparition tout au long du livre et sont un des éléments solides de son unité, depuis en juillet « l’enfant que je fus » à « les enfants savent lorsqu’il faut jouer désespérément » en décembre. Tout un passé de moments perdus émerge ici et là, à peine suggérés, comme s’ils composaient seulement une « jeunesse fictive », mais les traces dispersées aident cependant à reconstruire des étapes, depuis « mustela » (produit de soins pour bébé) à « poupée », à « ça crie des chambres d’enfants » et à l’annonce d’une autonomie, « Bientôt nous serons seules comme des grandes » et, enfin, à la photographie dans un médaillon ; il est aussi question de l’ennui des enfants », toujours présent chez l’adulte qui chante « pour tromper l’ennui ». Ces indications toujours discrètes esquissent pour le lecteur l’idée d’un autre temps avec lequel il y eut rupture (« Puis l’enfant quitta sa cage et s’excusa d’un oubli »), suffisamment forte pour qu’elle ait conservé un rôle (« Je me promène sans doute dans cet oubli-là »).
Si la disparition importe, c’est aussi parce qu’elle révèle l’incohérence du monde réel et ce qui remonte de l’enfance ne peut aider à rétablir un ordre acceptable ; les notations sont dispersées, fragmentaires, et leur retour échoue à construire une continuité. Comme si un récit ne pouvait être que fiction : « Une fiction s’achemine : l’après-midi, les enfants... fiction à laquelle on ne peut répondre qu’en hochant la tête ». La perte de repères liée à la disparition laisse devant une réalité peu avenante à tous les niveaux (« les grèves, les tempêtes »), où il faut trouver sa/une place — « Remets-toi au monde et plante-toi dans le décor, à nouveau » —, alors même que cette instabilité trouble jusqu’à l’usage de la langue.
On sait bien que rien n’impose dans un vrai Journal d’écrire des énoncés compréhensibles pour un lecteur autre que son auteur ; il suffit de lire celui de Kafka pour s’en convaincre, on y rencontre des phrases obscures, des allusions difficilement interprétables. Marie de Quatrebarbes, jouant avec le genre, ne se prive pas de ces incidents dans la rédaction qui ne peuvent que renforcer l’impression d’authenticité, bien plus que les pages ordonnées et lisses des Journaux écrits pour être publiés. Aussi trouve-t-on maints énoncés déconcertants pour le lecteur mais que l’auteure d’un vrai Journal n’aurait pas besoin d’expliciter, comme la juxtaposition de phrases sans rapport entre elles (« Tu parles d’une image aux chaussettes tirebouchonnées. La faïence n’a pas de prix. »), l’emploi de mots abrégés (« Se peut-il que lui-même soit abs. ext. air ? »). D’autres énoncés semblent plutôt refléter le désordre du monde, son absence de sens : un schéma syntaxique simple est brisé, un nom ne pouvant être en même temps complément et sujet dans une phrase (« Si je la cueille et la place dans ma main brille »), la compatibilité sémantique entre les mots est absente (« On ne ruse pas avec elle. Et si elle tombe, on la confie à des abeilles. »).
Rien de complètement obscur, le lecteur peut toujours inventer un contexte pour que les textes deviennent acceptables ; cependant, on lit des énoncés qui, littéralement, semblent dérailler, par exemple quand une phrase qui ouvre une page du Journal est reprise pour l’achever, ce que l’auteure commente, « Je ne fais que répéter ». On peut rapprocher ce type de reprise d’un rêve d’emboîtement des phrases à la manière des poupées russes, rêve d’un discours qui n’aurait pas de fin, de figures multipliées (« C’est toi peut-être en plus petit ? ») comme celles d’un « théâtre de cire ». Il y a toujours dans Les vivres un double mouvement ; si « frêne » entraine « réfrénez », presque aussitôt après cette paronomase vient : « Nous n’irons plus au bois », comme s’il fallait que les « lieux communs [soient] mille fois traversés ».
Ce qui traverse aussi le livre, propre à l’univers de Marie de Quatrebarbes, ce sont les références au cinéma, par des mots (gros plan, photographie, focal), le nom d’un acteur réalisateur (Clint Eastwood) et des allusions plus ou moins repérables à des films, par exemple « le reflet de l’œil grossi à la loupe » renvoie-t-il au Chien andalou de Bunuel ou à Peeping Tom (Le Voyeur) de Michael Powell — ou le lecteur invente-t-il ce qui lui convient ? Le titre lui-même n’est pas immédiatement lisible ; il ouvre la journée du 3 septembre : « Ce qui se mange : les vivres » et « vivres » est repris deux fois en novembre (« nous manquons à nos vivres » et « ils débarquent nos vivres ») : dans ce balancement du manque et de la présence, on est tenté de reconnaître en vivres une nourriture spirituelle, ce dont on se souvient, ce qui s’écrit et se lit — vivres si proche de livres. Trouble toujours : la force de ces proses souvent dérangeantes conduit heureusement à quitter ses certitudes de lecteur.
Marie de Quatrebarbes, Les vivres, P.O.L, 2021, 96 p., 12 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 5 octobre 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, les vivres, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
02/11/2021
Maël Guesdon, Mon plan

II
On vous pose quelque part (vous n’avez rien demandé). C’est quand même quelque chose d’un peu inquiétant puisqu’au tout début, vous êtes légèrement balbutiant. On vous lance là. Et chaque fois que vous ouvrez la bouche, c’est par inadvertance ou pour manger.
Comme tous les matins, les oiseaux et les couleurs criardes qui vont avec m’empêchent d’ouvrir complètement les yeux. Je ne supporte pas les dégradés, je tente d’ignorer ce calme affreux qui terminer la nuit en m’imaginant qu’aucune des choses que j’entrevois n’a de nom ni de fonction. Mais ce sont des choses que je connais et je crois bien que, dans cette clarté naissante, elles manifestent le mouvement où je me précipite en même temps qu’elles se reflètent sur les bords qui nous servent de supports.
Maël Guesdon, Mon plan, Corti, 2021, p. 15-16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, mon plan, enfannorancecee, ig | ![]() Facebook |
Facebook |
01/11/2021
Quelques paysages au fil des ans






Photos T. H.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : quelques paysages au fil des ans | ![]() Facebook |
Facebook |
31/10/2021
Maurice Blanchot, Le pas au-delà
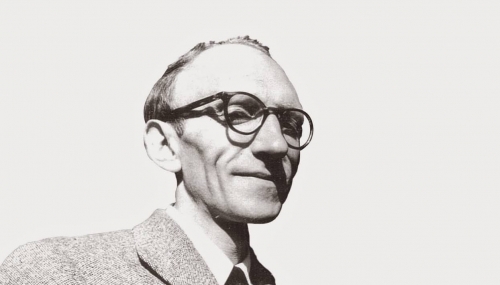
Mourir : comme si nous ne mourions jamais qu’à l’infinitif. Mourir : le reflet sur la glace peut-être, le miroitement d’une absence de figure, moins l’image de quelqu’un ou de quelque chose qui ne serait pas là qu’un effet d’invisibilité qui ne touche à rien de profond et serait seulement trop superficiel pour se laisser saisir ou voir ou reconnaître. Comme si l’invisible se distribuait en filigrane, sans que la distribution des points de visibilité y soit pour quelque chose, non pas donc dans l’intimité du dessin, mais trop à l’extérieur, dans une extériorité d’être dont l’être ne porte aucune marque.
Maurice Blanchot, Le pas au-delà, Gallimard, 1973, p. 130-131.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice blanchot, le pas au-delà, mourir, miroir, visible | ![]() Facebook |
Facebook |
30/10/2021
Franck Delorieux, Quercus suivi de Le séminaire des nuits

La nuit engendre un silence de poix
Que percent seuls les vents durs
Dans les feuillages aux clochettes
De plomb et les cris épris de folie
D’une chouette effraie dont les yeux
Brillent pour traquer une proie la nuit
Meurt dans les bruits revenus elle
S’effrange fragile en attendant
L’aube et ses lumières en lames
D’argent oxydé qui tombent dru
Comme le hachoir d’un boucher
Qui frappe sans discontinuer la terre
Les rocs la flore la faune et l’homme
Seul dans sa nudité de pluie froide
Déjà un chien aboie dans le lointain
Tandis que le coq se casse la gorge
En un cri comme un bris de coquille
Chante beau coq à crête rouge solaire
Chante trois fois et je renie la nuit
Franck Delorieux, Quercus suivi de Le
séminaire des nuits, Gallimard, 2021, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck delorieux, quercus suivi de le séminaire des nuits, chouette effraie, cri | ![]() Facebook |
Facebook |
29/10/2021
Homère, L'Odyssée : recension
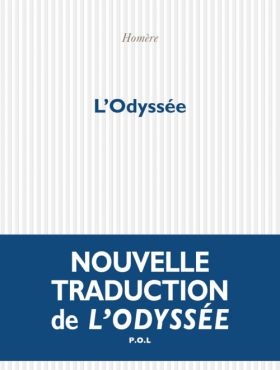
Mais pourquoi donc traduire une fois de plus Homère ? Il existe de nombreuses éditions de L’Odyssée qui restituent l’épopée en vers blancs, en décasyllabes, en alexandrins, en prose, depuis 1604 (Salomon Certon) jusqu’au XXe siècle avec, notamment, la traduction de Victor Bérard (1931) reprise dans la bibliothèque de la Pléiade, et celle de Philippe Jaccottet (1955) republiée en format de poche. La question n’a de sens que si l’on oublie que toute traduction, d’un auteur contemporain et, plus encore peut-être, d’une œuvre ancienne plusieurs fois traduite et souvent enfouie sous les commentaires, implique de la part du traducteur un choix de lecture.
Emmanuel Lascoux, helléniste, explique précisément dans un long "Prélude" ce qui sous-tend sa lecture d’Homère. D’abord, L’Iliade n’est pas un commencement de l’épopée — Homère ne surgit pas du vide — et il y a au moins une autre Odyssée après L’Odyssée. Ensuite, il est nécessaire de se souvenir, ou de savoir, que « la langue d’Homère n’a jamais été parlée par personne d’autre qu’Homère, c’est-à-dire les aèdes ». C’est là un point essentiel, ce qui est désigné aujourd’hui par "grec ancien" était un ensemble complexe de divers dialectes, la langue épique n’ayant aucune unité et, jusqu’à un certain point, reste intraduisible. En outre, dans l’antiquité grecque, dès l’épopée, « la musique réglait tout, jusqu’à la politique », aussi l’aède était-il « le premier polyphoniste, l’homme-orchestre ».
Ce vertige épique de l’écartèlement entre la singularité du vers et son addition indéfinie, cette corde qui tient, où l’on marche, sans pourtant toujours savoir si elle est lâche ou très tendue, c’est la haute voix qui le donne, qui la sent. Raison première qui m’interdisait de traduire. (Lascoux)
Les difficultés résumées, comment restituer le bruit des voix, passer du grec d’Homère, des aèdes au français ? Victor Bérard emploie l'alexandrin, équivalent pour la longueur de l’hexamètre grec, mais un alexandrin souple qui enjambe « sur la rime » et « peut avoir toutes les tailles » ; la rime « étant supprimée, il aboutit à une prose qui permettrait d’obtenir en français un rythme équivalent à celui du texte homérique », retrouvant quelque chose de ce qu’il nomme la « diction épique ». La démarche d’Emmanuel Lascoux est différente, il ne propose pas une traduction comme les diverses éditions disponibles de L’Odyssée le prétendent, mais une "Version française" (en page titre, sous le titre L’Odyssée), en partant du principe qu’il est nécessaire de restituer quelque chose de la voix de l’aède, de « l’esthétique de la bigarrure » de L’Odyssée.
Il supprime le « regard chronologique » en employant, à quelques exceptions près, le présent de narration. Pour que les personnages ne soient pas fixés dans un registre, il mêle les manières de s’exprimer, faisant ainsi passer quelque chose de la polyphonie ; on peut comparer la manière dont est restitué dans différentes éditions, par exemple celui où la déesse Calypso répond à une proposition d’Ulysse (V, 182) :
Lascoux : Eh bien, tu ne manques pas de culot, ça non, ni d’esprit, il est vrai.
Bérard : Le brigand que tu fais ! Tu connais la prudence !
Jaccottet : Tu es injuste, ami, mais non point sans malice.
Il est toujours possible de s’adapter au contexte et, plutôt que de traduire par un seul mot, développer par une périphrase, comme dans l’ouverture de L’Odyssée :
Certon (1604) : Muse, raconte moy l’homme fin et rusé
Leconte de Lisle (1871) : Dites-moi, Muse, cet homme subtil
Jaccottet : Muse, conte-moi l’aventure de l’inventif
Lascoux : Muse, dites-moi l’homme aux détours, l’homme aux ruses
Dans le même esprit, Lascoux varie la traduction des épithètes et, par ailleurs, quand il rencontre un calembour étymologique (Ulysse — haïr) il l’adapte à notre langue à la manière de Bobby Lapointe (cf I, 52, « pourquoi telle haine, Zeus, que tu l’y sacrifies ») ; Jaccottet, lui, le laisse de côté « pour ne pas tomber dans la jonglerie », en ajoutant : « Les Grecs aimaient sûrement ces tours ; ils n’en sont pas moins rares dans l’épopée » — le calembour est également absent dans la traduction de Leconte de Lisle. Lascoux accompagne la voix des personnages par celle du conteur, donc ajoute des éléments au texte : « Écoutez alors ce qu’il lui dit : » (IV, 803), « Voyez-le debout (...) » (XXII, 332), etc. S’ajoutent des onomatopées pour rendre présents les bruits (paf ! boum ! pff !, etc.) et des appuis de discours, nombreux, qui aident le lecteur à saisir le caractère parlé de l’épopée (tiens, va !, vois-tu, ça y est, etc.) — on peut trouver trop fréquents le retour de oui et de pardi(un peu vieillot ?) : « Il n’aura qu’à le surveiller, pardi » (X, 444), « il suit, pardi : hé, c’est qu’il aura eu peur » (X, 448). Cette voix à côté est déjà présente dans le Prélude, mais cette fois Lascoux s’adresse au lecteur : « Homère (...) nous balance, vlan !, ses deux fragments géants, oui, d’un tout qui n’existe pas » (p. 44).
Voilà des remarques trop sommaires pour présenter cette « Odyssée parlée, jouée familière », revisitée avec bonheur ; on peut commencer à la lire avec près de soi une ou deux autres traductions, non pour comparer — on ne préfère pas Bérard, Leconte de Lisle ou Jaccottet à Lascoux, chacune a ses particularités —, mais pour lire autrement. On se plonge ensuite entièrement dans cette tentative heureuse d’approcher la mélodie de l’épopée et on la goûtera d’autant mieux que l’on écoutera Lascoux, performeur jouant le texte grec, accompagné de Pierre Baux pour la partie française (Maison de la poésie, sur Youtube).
Homère, L’Odyssée, nouvelle traduction d’Emmanuel Lascoux, P.O.L, 2021, 496 p., 23, 90 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 24 septembre 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : homère, l'odyssée, emmanuel lascoux | ![]() Facebook |
Facebook |
Boris Pasternak,
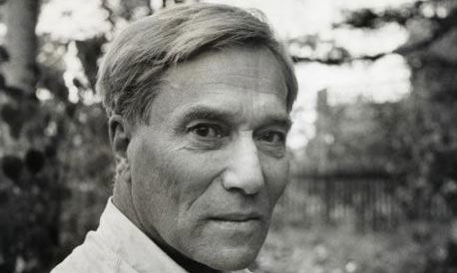
La ville
Chanson du coq, de la tempête,
Dans la cuisine... Cet hiver
On en a par-dessus la tête,
C’est un navet par torp amer.
Et les congères nous isolent,
La mortt,le songe... Il neige tant,
Que ce n’est pas un temps, parole,
Mais le trépas, la fin des temps.
La glace colle aux marches lisses,
Le puits est pris dans ses anneaux.
Par un tel froid, c’est pur délice,
De vivre à la ville et au chaud !
Tandis que, de toute évidence,
L’hiver est invivable aux champs,
La ville est toute indifférence
Aux incommodités du temps.
De ses palais en kyrielles,
Le froid a fui, et pour toujours.
Ce n’est qu’une ombre immatérielle
Dont les esprits font leur séjour.
La nuit, sur la voie de garage,
Toutes les bûches sont d’accord :
Ce n’est rien d’autre qu’un mirage
Brûlant au loin comme une aurore.
Adolescent je me rappelle
Que son orgueil m’avait charmé.
Tout le passé n’était pour elle
Qu’ébauche tout juste entamée.
Hâtant des astres le désastre,
Versent son or à pleines mains,
Elle éclipsa jusqu’au ciel vaste
Dans tous mes rêves de gamin.
Boris Pasternak, Les Trains du petit jour,
traduction collective, dans Œuvres, Pléiade/
Gallimard, 1990, p. 166-167.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boris pasternak, les trains du petit jour, la ville | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2021
Marie Stuart, Onze sonnets et un sizain

Mon amour croît et de plus en plus croîtra
Tant que vivrai, et tiendra à grand heur
Tant seulement d’avoir part en ce cœur
Vers qui enfin mon amour paraîtra
Si très à clair que jamais n’en doutra,
Pour lui je ceux faire tête au malheur,
Pour lui je veux rechercher la grandeur,
Et faire tout que de vrai connaîtra
Que je n’ai bien, heur ni contentement
Qu’à l’obéir et servir loyaument
Pour lui j’attends toute bonne fortune.
Pour lui je veux garder santé et vie,
Pour lui vertu de suivre j’ai envie,
Et sans changer me trouvera toute une.
Marie Stuart, Onze sonnets et un sizain,
Arléa, 2003, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie stuart, onze sonnets et un sizain, constance, bonne fortune | ![]() Facebook |
Facebook |
26/10/2021
Cécile A. Holdban, Pierres et berceaux

Paysage avec un cheval penché
Une carte relie une ville à l’autre.
On dort, les yeux mi-clos,
les cils filtrent les rayons
comme la pensée filtre les mots.
Le corps, goutte à goutte
infuse le soleil et le transmue
des trains filent à travers le ciel
s’entrecroisent et tournoient.
Le monde est fendu à jamais
deux oiseaux parcourent l’espace
pour coudre des points lumineux
à son visage.
Cécile A. Holdban, Pierres et berceaux,
éditions Potentille, 2021, p. 5.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, pierres et berceaux, paysage avec un cheval penché | ![]() Facebook |
Facebook |
Images de la Sauve Majeure (Gironde)
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images de la sauve majeure, gironde | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2021
André Frénaud, Hæres
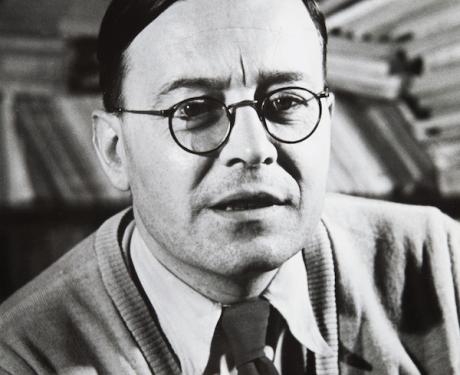
Rumination du paysan
Je veux grossir pour défendre ma vie.
Contre la mort il faut prendre du poids,
il me faut boire des six litres
et pisser,
pour ma santé,
pour honorer ma santé et ma vie.
Il me faut vivre pour accroître mon bien,
peser les bêtes, arroser les clôtures,
renforcer les semences, affûter les outils,
bourrer le temps,
— Mais le dimanche on peut fanfaronner
avec l’alouette et la violette.
André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, rumination du paysan, alouette, violette | ![]() Facebook |
Facebook |
24/10/2021
André Frénaud, Hæres
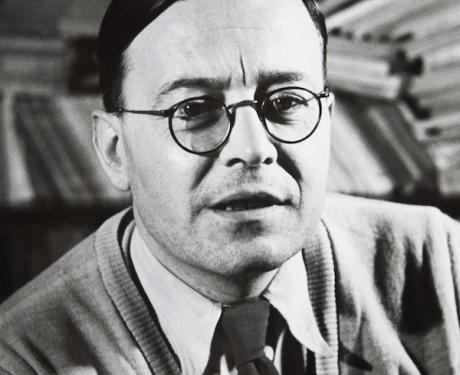
L’orateur
(d’après Picasso)
S’effilochaient tous les blasons
en bouts de ficelle — amulettes et allumettes.
Le rayon de miel affleure à la bouche,
la plus haute entaille sur le cep vieil.
Le peuple est là, qui parle de ses lèvres têtues,
berger des agneaux affamés
en marche vers les banlieues en détritus,
manteau de laine antique en carton ondulé,
il talonne fort la terre, il appelle à l’aide,
il crie le tocsin, épouvantail pour les maîtres prédateurs,
innocent innocent
Qui se croit l’avenir.
André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 261.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, l'orateur, picasso, innocent | ![]() Facebook |
Facebook |












