05/12/2021
Paul Valéry, Cahiers, II, Littérature
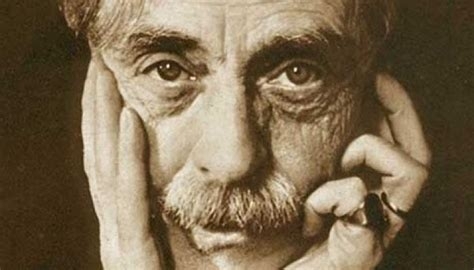
Pour faire des romans, il faut considérer les hommes comme des unités ou éléments bien définis.
Il fit ceci. Elle dit cela.
On oublie aisément que c’est fit et dit, ceci et cela qui définissent et construisent Il et Elle dans tous les cas possibles.
Paul Valéry, Cahiers II, Littérature, Pléiade/Gallimard, 1975, p.1206.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers ii, littérature, roman | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2021
Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie
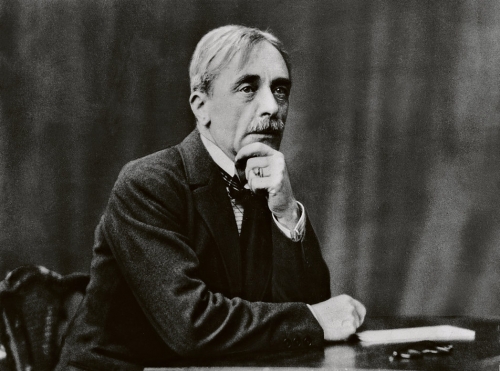
Je ne puis séparer mon idée de la poésie de celle de formations achevées — qui se suffisent, dont le son et les effets psychiques se répondent, avec un certain « indéfiniment ».
Alors, quelque chose est détachée, comme un fruit ou un enfant de sa génération et du possible qui baigne l’esprit — et s’oppose à la mutabilité des pensées et à la liberté du langage fonction.
Ce qui s’est produit et affirmé ainsi n’est plus de quelqu’un mais vomme la manifestation de propriétés intrinsèques, impersonnelles, de la fonction composée. Langage — se dégageant rarement dans des conditions aussi rarement réunies que celles qui font le carbone diamant. (1942)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, -cahiers, ii, poétique, langage, pensée | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2021
Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie
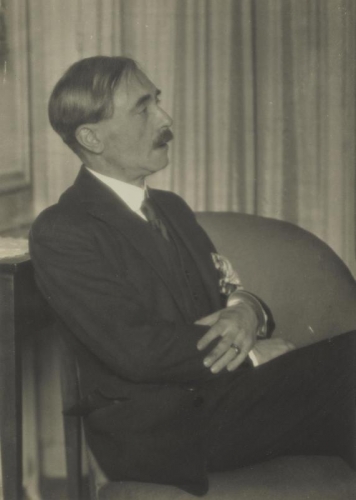
Des vers du poème, les uns furent trouvés, les autres faits.
Les critiques disent des sottises qui parlent sur ce poème comme d’un tout, et qui ne considèrent pas la position de l’auteur : combiner, appareiller les vers de ces deux espèces.
Le travail du poète est de faire disparaître cette inégalité originelle ; d’ailleurs, tout travail intellectuel consiste à mettre d’accord pour un but, ce qu’on trouve, et des conditions données d’autre part.
Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie, Pléiade/Gallimard, 1974, p. 1066.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers, ii, poésie, trouver, faire | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2021
Marie-Laure Zoss, D'ici qu'à sa perte

hors du crâne avant peu, la sciure des chiffres, tel au plancher le bois moulu, taraudeurs, capricornes bouffeurs d’aubier, et on n’y peut pas grand-chose, on le sait bien, dans la pelle de fer on a beau en ramasser de cette farine, poignée d’or pâle à peine mesurable dans la poussière de charbon, la balayer sur les ardoises, échancrée la raison laisse filer pêle-mêle des syllabes clouées sans ordre ; coques vides et nom des chemins ;
nous les rafistolés, les trébuchants, on épelle nos morts devant la cave — lequel le premier, un mort pour un autre, on les distribue tous azimuts — à pleurer ce cafouillis sans queue ni tête, et s’enchevêtre l’alphabet des heures, de la sorte on les enfile dans le courant d’un matin de mai.
Marie-Laure Zoss, D’ici qu’à sa perte, Faï fioc, 2021, p. 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-laure zoss, d’ici qu’à sa perte | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2021
Robert Desnos, Choix de Poèmes

Le veilleur du Pont-au-Change
Je suis le veilleur de la rue de Flandre,
Je veille tandis que dort Paris.
Vers le nord un incendie lointain rougeoie dans la nuit.
J’entends passer des avions au-dessus de la ville.
Je suis le veilleur du Point du Jour.
La Seine se love dans l’ombre, derrière le viaduc d’Auteuil,
Sous vingt-trois ponts à travers Paris.
Vers l’ouest, j’entends des explosions.
Je suis le veilleur de la Porte Dorée.
Autour du donjon le bois de Vincennes épaissit ses ténèbres.
J’ai entendu des cris dans la direction de Créteil
Et des trains roulent vers l’est avec un sillage de chants de révolte.
Je suis le veilleur de la Poterne des Peupliers.
Le vent du sud m’apporte une fumée âcre,
Des rumeurs incertaines et des râles
Qui se dissolvent quelque part, entre Plaisance et Vaugirard.
Au sud, au nord, à l’est, à l’ouest,
Ce ne sont que fracas de guerre convergeant vers Paris.
Je suis le veilleur du Pont-au-Change
Veillant au cœur de Paris, dans la rumeur grandissante
Où je reconnais les cauchemars paniques de l’ennemi,
Les cris de victoire de nos amis et ceux des Français,
Les cris de souffrance de nos frères torturés par les Allemands d’Hitler.
Je suis le veilleur du Pont-au-Change
Ne veillant pas seulement cette nuit sur Paris ,
Cette nuit de tempête sur Paris seulement dans sa fièvre et sa fatigue,
Mais sur le monde entier qui nous environne et nous presse.
Dans l’air froid tous les fracas de la guerre
Cheminent jusqu’à ce lieu où, depuis si longtemps, vivent les hommes.
(...)
Robert Desnos, Choix de poèmes, collection L’Honneur des Poètes (dirigée par Paul Éluard, éditions de Minuit, 1946, p. 103-104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, choix de poèmes, le veilleur du pont-au-change | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2021
Robert Desnos, Domaine public
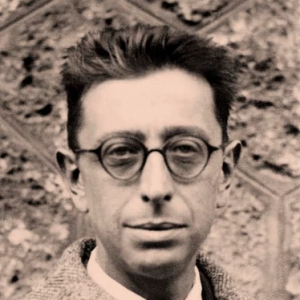
Les sources de la nuit
Les sources de la nuit sont baignées de lumière.
C’est un fleuve où constamment
boivent des chevaux et des juments de pierre
en hennissant.
Tant de siècles de dur labeur
aboutiront-ils enfin à la fatigue qui amollit les pierres ?
Tant de larmes, tant de sueur,
justifieront-ils le sommeil sur la digue ?
Sur la digue où vient se briser
le fleuve qui va vers la nuit,
où le rêve abolit la pensée.
À rebrousse-poil, à rebrousse-chemin,
Étoile, suivez-nous, docile, `
et venez manger dans notre main,
Maîtresse enfin de son destin
et de quatre éléments hostiles.
Robert Desnos, Domaine public, Le point
du jour/Gallimard, 1953, p. 307.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, les souces de la nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2021
Robert Desnos, Domaine public
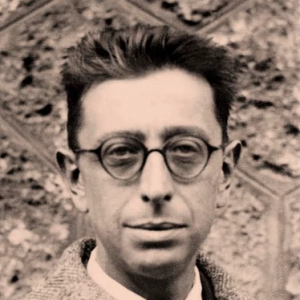
Comme une main à l’instant de la mort
Comme une main à l’instant de la mort et du naufrage se dresse comme les rayons du soleil couchant, ainsi de toutes parts jaillissent tes regards.
Il n’est plus temps, il n’est plus temps peut-être de me voir,
Mais la feuille qui tombe et la roue qui tourne te diront que rien n’est perpétuel sur terre,
Sauf l’amour,
Et je veux m’en persuader.
Des bateaux de sauvetage peints de rougeâtres couleurs,
Des orages qui s’enfuient,
Une valse surannée qu’emportent le temps et le vent durant les longs espaces du ciel.
Paysages.
Moi je n’en veux pas d’autres que l’étreinte à laquelle j’aspire,
Et meure le chant du coq.
Comme une main à l’instant de la mort se crispe, mon cœur se serre.
Je n’ai jamais pleuré depuis que je te connais.
J’aime trop mon amour pour pleurer.
Tu pleureras sur mon tombeau,
Ou moi sur le tien.
Il ne sera pas trop tard.
Je mentirai. Je dirai que tu fus ma maîtresse
Et puis vraiment c’est tellement inutile,
Toi et moi nous mourrons bientôt.
Robert Desnos, Domaine public, Le point du jour/ Gallimard,
1953, p. 103-104.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, amour, mort, étreinte, paysage | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2021
Robert Desnos, Domaine public

Les gorges froides
À la poste d’hier tu télégraphieras
que nous sommes bien morts avec les hirondelles
Facteur, triste facteur, un cercueil sous ton bras
va-t’en porter ma lettre aux fleurs à tire d’elle.
La boussole est en os, mon cœur tu t’y fieras.
Quelque tibia marque le pôle et les marelles
pour amputés ont un sinistre aspect d’opéras.
Que pour mon épitaphe un dieu taille ses grêles !
C’est ce soir que je meurs, ma chère Tombe-Issoire,
ton regard le plus beau ne fut qu’un accessoire
de la machinerie étrange du bonjour.
Adieu ! je vous aimai sans scrupule et sans ruse,
ma Folie-Méricourt, ma silencieuse intruse.
Boussole à flèche torse annonce le retour.
Robert Desnos, Domaine public, Le point du
jour/Gallimard, 1953, p. 343.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, les gorges froides | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2021
Emily Dickinson, Je cherche l'obscurité

Un grand Espoir est tombé
Tu n’as rien entendu
La Ruine était intérieure
Oh Naufrage rusé
Qui n’a conté aucune Histoire
Et n’a admis aucun Témoin
L’esprit fut bâti pour de lourdes Charges
Planifié pour de terribles occasions
Si souvent sombrant en Mer
Soi disant, sur Terre
Emily Dickinson, Je cherche l’obscurité, traduction
François Heusbourg, éditions Unes, 2021, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, je cherche l’obscurité, espoir, ruine | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2021
Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous

sursis d’été à
l’heure d’hiver roux
trois rouges-gorges
jouent à la guéguerre
avant l’aurore
écrire toute une vie
sans autre connaissance
que — la perte —
des chants et des fleurs)
*
Puis la mousse se gorge quand le tilleul lâ
che tout
Toute la forêt détone entre les sabots
des bêtes
Une langue se tend du plexus à leurs yeux
mi-clos
Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous,
éditions Héros-Limite, 2021, p. 27-28.
©Photo Ianna Andréadis
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, ce qui reste de nous, été, hiver, rouge-gorge, bête | ![]() Facebook |
Facebook |
25/11/2021
Pierre Chappuis, En bref, paysage
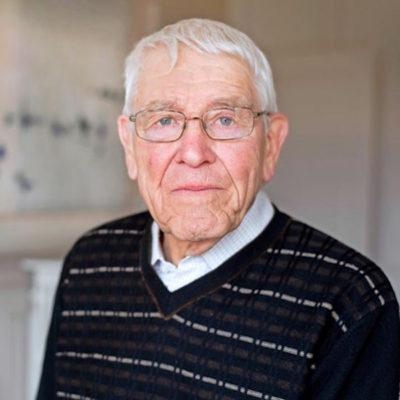
Les arbres et leurs ombres : imbriqués mais droits
— des sapins —, rangs serrés, à gagner, regagner du
terrain sur la neige.
À la nuit reprendra ses positions avancées.
Ciel bas, assombri, lourd à nos épaules — si tant est
que... —
Me tient captif, de si loin, cette prairie enneigée
resserrée sur elle-même, si haut juchée à flanc de
coteau.
Pierre Chappuis, En bref, paysage, Corti, 2021, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, en bref, paysage, neige, sapin | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2021
Pierre Chappuis, La nuit moins profonde
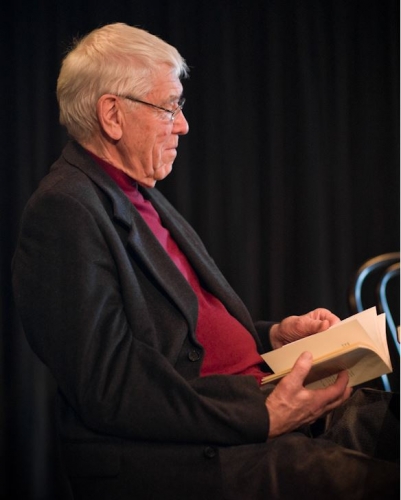
L’ombre
L’ombre des chênes (son épaisseur), là (y fûmes-nous ?), serrés, solidaires (à poings fermés), cœur même de la plénitude de l’été.
Y fûmes-nous vraiment ?
Que ne nous sépare pas...
Que ne nous sépare pas, insensible abîme, le moindre écart.
Ce que nous étions ; ce que nous sommes. N’ayant point souvenir des massifs d’ombre côtoyés, mouvants, dont les senteurs portaient à la tête.
Un courant de transparence insensiblement nous porte : aurore, démarcation nulle.
Pierre Chappuis, La nuit moins profonde, éditions Empreintes, 2021, p. 64-65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la nuit moins profonde, ombre, séparation | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2021
Pierre Chappuis, La nuit moins profonde
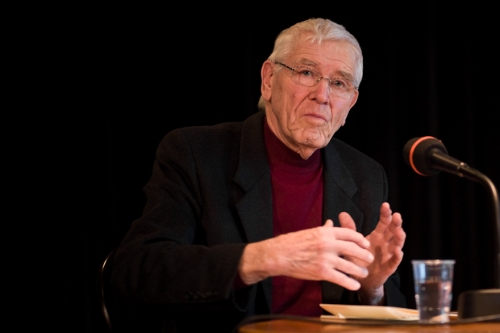
Une photographie
Retour sur image, celle, panoramique, accrochée au mur depuis bien des années, à l’écart.
La mer, basse, a laissé le fond de l’anse à nu. Partout une lumière égale, riante, plane. Bonheur ! Il n’est que de céder, insoucieux, au sentiment d’immensité sans rencontrer d’autre obstacle que, moindre éminence, celui de l’îlot voisin vers lequel tu t’avances dans la tiédeur d’une fin d’après-midi de juillet, minuscule tache rouge et blanche (jupe et corsage) à quoi un œil non averti ne prêterait aucune attention.
Tu ne te retourneras pas. Le temps, inexorablement, est au beau fixe.
Pierre Chappuis, L’espace que rien ne borne, dans La nuit moins profonde, éditions Empreintes, 2021, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la nuit moins profonde, espace, photographie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2021
Aragon, Les Poètes
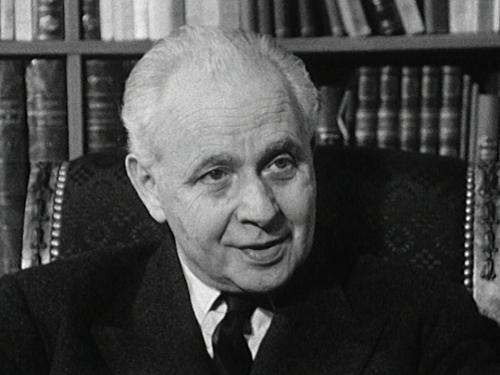
Le discours à la première personne
3
J’entends j’entends le monde est là
Il passe des gens sur la route
Plus que mon cœur je les écoute
Le monde est mal fait mon cœur las
Faute de vaillance ou d’audace
Tout va son train rien n’a changé
On s’arrange avec le danger
L’âge vient sans que rien se passe
Au printemps de quoi rêvais-tu
On prend la main de qui l’on croise
Ah mettez les mots sur l’ardoise
Compte qui peut le temps perdu
Tous ces visages ces visages
J’en ai tant vu des malheureux
Et qu’est-ce que j’ai fait pour eux
Sinon gaspiller mon courage
Sinon chanter chanter chanter
Pour que l’ombre se fasse humaine
Comme un dimanche à la semaine
Et l’espoir à la vérité
J’en ai tant vu qui s’en allèrent
Ils ne demandaient que du feu
Ils se contentaient de si peu
Et avaient si peu de colère
J’entends leurs pas j’entends leurs voix
Qui disent des choses banales
Comme on en lit sur le journal
Comme on en dit le soit chez soi
[...]
Aragon, Lex Poètes, dans Œuvres poétiques
complètes, II, Pléiade/Gallimard, 2017, p. 451-452.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, lex poètes, le discours à la première personne, chanter | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2021
Aragon, Les Chambres

VI
Toutes les chambres de ma vie
M’auront étranglé de leurs murs
Ici les murmures s’étouffent
Les cris se cassent
Celles où j’ai vécu seul
À grands pas vides
Celles
Qui gardaient leurs spectres anciens
Les chambres d’indifférence
Les chambres de la fièvre et celle que
Que j’avais installée afin d’y froidement mourir
Le plaisir loué Les nuits étrangères
Il y a des chambres plus belles que blessures
Il y a des chambres qui vous paraîtront banales
Il y a des chambres de supplications
Des chambres de lumière basse des
Chambres prêtes à tout sauf au bonheur
Il y a des chambres à jamais pour moi de mon sang
Éclaboussées
Toutes les chambres un jour vient que l'homme s'y
Écorche vif
Qu'il y tombe à genoux qu'il demande pitié
Qu'il balbutie et se renverse comme un verre
Et subit le supplice épouvantable du temps
Derviche lent le temps est rond qui tourne sur lui-même
Qui regarde d'un œil circuklaire
L'écartèlement de son destin
Et le petit bruit d'angoisse avant les
Heures les demies
Je ne sais jamais si cela va sonner ma mort
Toutes les chambres sont chambres de justice
Ici je connais ma mesure et le miroir
Ne me pardonne pas
Toutes les chambres quand enfin je m'endormis
Ont été sur moi la punition des rêves
Car je ne sais des deux le pis rêver ou vivre
Aragon, Les Chambres, dans Œuvres poétiques complètes, II, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 1113-1114.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, les chambres, rêver, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |





