08/12/2022
Paul Celan, La Rose de personne
Avec toutes les pensées je suis sorti
hors du monde : tu étais là,
toi, ma silencieuse, mon ouverte, et —
tu nous reçus.
Qui
dit que tout est mort pour nous
quand notre œil s’éteignit ?
Tout s’éveilla, tout commença.
Grand, un soleil est venu à la nage, claires,
âme et âme lui ont fait face, nettes,
impératives, elles lui ont tu
son orbe.
Sans peine,
ton sein s’est ouvert, paisible,
un souffle est monté dans l’éther,
et ce qui s’est nué, n’était-ce pas,
n’était-ce pas forme, et sortie de nous,
n’était-ce pas
pour ainsi dire un nom ?
Mit allen Gedanken ging ich
hinaus aus der Welt : da warst du,
du meine Leise, dumeine Offne, und —
du empfingst uns.
Wer
sagt, dass uns alles erstarb,
da uns das Aug brach ?
Alles erwachte, alles hob an.
Gross kam eine Sonne geschwommen, hell
standen ihr Seele und Seele entgegen, klar,
gebieterisch schwiegen sie ihr
ihre Bahn vor.
Leicht
tat sich dein Schoss auf, still
stieg ein Hauch in den Äther,
und was sich wölkte, wars nicht,
wars nicht Gestalt und von uns her
wars nicht
so gut wie ein Name ?
Paul Celan, La Rose de personne (Die Niemandsrose), édition bilingue, traduction de Martine Broda, Le Nouveau Commerce, 1979 (S. Fischer Verlag, 1963), p. 31 et 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, la rose de personne | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2022
Bernard Vargaftig, Éclat & Meute
Ô parole indivisible
Est-ce l’herbe des charniers
L’immobilité d’un mur
Ou la mort criblée d’images
L’aveu même d’être là
Comme l’énumération
D’un étang et d’un village
Tourbe neige cuivre école
Jusqu’au nom de chaque jour
Dans le signe sur les portes
Bernard Vargaftig, Éclat & Meute,
action poétique, 1977, p. 39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, Éclat & meute | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2022
Pierre Vinclair, Bumboat : recension
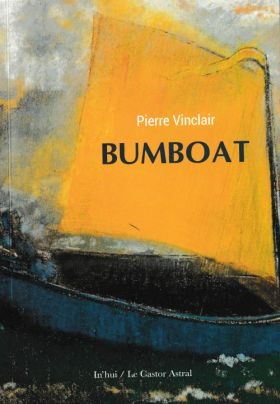
Le lecteur angliciste se trouve d’emblée avec le titre dans un ailleurs. Rien de surprenant s’il a lu le récent L’Éducation géographique : Pierre Vinclair voyage et ses poèmes sont construits à partir du réel vécu. Ici, Singapour est le lieu et le sujet de l’écriture, les poèmes sont précédés d’un plan de son centre-ville, où il a séjourné ; des chiffres y sont inscrits correspondant aux dix ensembles de poèmes, chacun lié à un espace. On peut lire le livre en ignorant tout de Singapour (c’est mon cas), ou suivre les douze pages de notes qui renseignent le lecteur à propos de la ville et des noms cités et développent également des points relatifs à la poétique de Pierre Vinclair1.
Laissons l’étymologie de bumboat de côté ; après avoir été un petit bateau utilisé autrefois « par les chiffonniers et ferra illeurs voguant sur la rivière [la Singapore River] » (4ème de couverture), il l’est aujourd’hui pour promener les touristes — loin de l’illustration retenue, "La barque mystique" d’Odilon Redon. D’autres bateaux circulent, la rivière étant un lieu de vie, et écrire leurs noms (tongkank, twakow) satisfait le plaisir des langues de l’auteur. Il s’adresse d’emblée à un "tu" (« accroche-toi / ça recommence »), au lecteur explicitement ensuite, « lecteur sois mon beau touriste naïf », l’invitant à suivre aussi bien une visite de Singapour que des incursions dans le passé et des parenthèses à propos de littérature, de politique, etc. : il s’agit bien de restituer quelque chose du chaos de la vie. L’adresse au lecteur est ici proche, ce que note l’auteure des notes2, d’une autre adresse, à Clémence, l’épouse (et première lectrice ?), qui intervient plus loin dans le livre, le soir, « (sur le balcon, les filles sont couchées) ». D’autres voix sont présentes et rapportent des fragments de leur histoire — Tan Kim Seng, un marchand du XIXème siècle, qui s’adresse aux lecteurs (« Ah beaux modernes / écoutez mon histoire »).
Le livre accumule les références littéraires, de Tan Kim Seng à William Carlos Williams et Alice Oswald, mais ce qui pourrait apparaître dispersé ne l’est pas, l’ensemble des noms et des œuvres cités constitue une unité que l’on peut désigner par "littérature" ; il faut ajouter les nombreux fragments que Vinclair intègre, devenus matériaux du poème, depuis les inusables « A noir E blanc » ou « il y a quelque chose de pourri [ici « dans le monde »] » à « la forme d’une ville », du « chemin du milieu / de la vie d’après Alighieri » et à l’inscription du nom d’Ivar Ch’Vavar. On lit aussi, clin d’œil malicieux, le nom de Thomas Piketty, économiste, près de celui de Tzvetan Todorov, historien des idées.
Quand les quartiers de la ville sont parcourus, ce n’est pas pour décrire leurs monuments : ils sont prétexte à revenir au passé, au « hoquet de l’histoire », par exemple à l’occupation japonaise, à l’immigration chinoise ancienne en Malaisie, à celle des « domestiques philippines » ou à la fondation de Singapour par Sir Thomas Stamford Raffles. Les éléments à propos de la vie contemporaine donnent l’image d’une ville analogue à bien des capitales économiques ; on y fait « fructifier l’argent », y abondent les banques, les marchands et les prostituées, une exposition y annonce l’avenir, rassemblant des « handymade ready-mades », le monde urbain est climatisé, empli de chiffres, le port reçoit des marchandises de toute l’Asie, « murs et enclos du monde / passant en pièces détachées / la vie de milliards d’hommes / empaquetée / déplacée par la bigue aveugle ».
Pierre Vinclair renvoie dans le cours du livre à son propre texte (« voir chant 1 »), soulignant ainsi son unité, et propose à la fin d’un ensemble de lire comme s’il s’agissait d’un feuilleton : après quelques questions, comme « Vais-je aboyer ? grogner ? », il assure au lecteur, « vous le saurons, nous le saurez / si vous restez branché. », le lecteur n’en saura pas plus après ce jeu des conjugaisons qui évoque Jean Tardieu. Bumboat a des rapports plus évidents avec le théâtre : à côté de Pierre Vinclair de nombreux personnages interviennent, les uns et les autres avec un discours sur les réalités qu’ils connaissent : la ville elle-même, le bateau, Clémence, Alice Oswald, un batelier, des fantômes, Ivar Ch’Vavar, etc., foule hétéroclite qui se presse, chacun tenant à dire son mot. Cette diversité des voix est restituée en prose et en vers en partie comptés, avec une préférence pour l’hexasyllabe — sa brièveté s’accorde avec le caractère vif des propos.
Les jeux avec la forme, nombreux, renvoient aussi bien aux licences de la poésie d’hier (« encor », « avecque ») qu’aux facilités contemporaines maintenant banales, les coupes en fin de vers en respectant la morphologie (« où les travailleurs de la fi / nance) ou non (« (...) le père cha /rge l’enfant »). Une suite de 9 vers porte la même rime (« grogner/banquier/ bleutée/galbé/relaxé/ U.V./surdétaxées/Saurez/branché ») ; « Java » rime avec « java », ensemble suivi de « ha ha » : soulignement du goût du jeu que l’on retrouve avec les paronomases (« bonzes »/« bronzes ») et les rapprochements comme « raffles, raft, craft).
Et la poésie là-dedans ? Pierre Vinclair a devancé le lecteur surpris par un texte qui, lu trop vite, semble partir dans tous les sens ; faut-il, se demande-t-il, « rester là derrière / l’ordi à comp/composer de la po —/j’allais dire la poésie/mais qui peut croire/qu’il s’agit là de po ? » La réponse peut se lire au début de cette sixième partie, où deux hexasyllabes encadrent cinq heptasyllabes dont les paronomases à la rime énumèrent les thèmes traités à propos de Singapour : « aurions-nous continué/pour le plaisir des mots/je voulais dire des morts/ je voulais dire des monts/ je voulais dire des ponts/ je voulais dire des ports/à effeuiller la ville ». Voilà un livre débordant d’énergie qui suit la rivière traversant la ville ; quand « le voyage est fini », on débouche sur l’océan et ses vagues contre la côte
« splash splash » /// et nous recouvre /// splash »
__________________
1 Claire Tching, auteure des notes, est membre de la Sing Lit Station qui a accueilli Pierre Vinclair en résidence en 2018.
2 Claire Tching traduit une analyse en anglais de Vinclair à propos de l’adresse au lecteur (pp. 69-70).
Pierre Vinclair, Bumboat, In’hui / Le Castor Astral, 2022, 85 p., 12 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 8 novembre 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, bumboat | ![]() Facebook |
Facebook |
05/12/2022
Bernard Vargaftig, Le monde le monde
Encore un versant d’acacias
Une route presque une syllabe
La clairière s’est dénouée
Ciel tout à coup et nudité voici comme
La ressemblance disparaît
La plage sans désolation
Sable éraflé un mouvement
Dans les profonds paysages qui s’étendent
Jardin et lointain emportés
Et hâte dont l’immensité nomme
Et le trou autour de l’aveu
Le cri le linge les dahlias d’être épars
Chaque fois l’alouette après
L’alouette est-ce où tout dérapait
L’ombre m’abandonne entre enfance
Et frémissement que le silence fuit
Bernard Vargaftig, Le monde le monde, André Dimanche, 1994, p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, le monde le monde | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2022
Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements
La fugacité disparaît
Toujours la même déflagration je t’aime
La hâte obstinément éclaire
Ton souffle où je tombe encore une fois
Quel dénuement n’ai-je pas dit
Un souvenir sans souvenir aucun ciel
N’a l’étendue de l’abandon
Un cri l’impudeur pensive
Le sens et l’effacement bougent
Le désir avec les oiseaux qui respirent
Tellement le jour était vaste
Comme quand l’aveu n’a plus d’ombre et roule
Quand la ressemblance sans cesse
Si ensevelie se sépare de moi
L’enfance changée en pitié
Dans les rochers que l’apaisement forme
Bernard Vargaftig, Dans les soulèvements, André Dimanche, 1996, p. 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, dans les soulèvements | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2022
Andrea Zanzotto, Idiome

Ascoltando dal
Insiste il dito annichilito sul tasto
in una nota sempre sbagliata
eppure disumanamente giusta
al di là di ogni esempio azzeccata
Una nota fino a che sangue è il dito
e poi si azzoppa in uno sbagliato
movimento di trillo
al di là di ogni esempio
tuttavia riazzeccato
Un’infinita, irraggiante da tutto, offerta
arriva su quella nota, su quel dito
innervosito, anzi da tempo annichilito,
che vuol farsene carico, dar credito
a un possibile universale spartito
riversare da un nastro registrato
a un altro
non meno mitico instrumento
Un indirizzo o un’una dichiarazione di mittente
come becco di popicchio insistito
è in quel dito cha batte l’offerta
sua-unica, da-nulla, che nulla alletta
e che scavando per sempre in quel tasto
e sbagliandolo sempre, nella deserta
realtà che per altro come mattina s’affina,
la sua ostinazione contro ogni perché,
il suo per chi per che non mai esauribile
né esistibile assesta, indovina
Écoutant
depuis le pré
Sur la touche, le doigt anéanti insiste
sur une note toujours ratée
et pourtant inhumainement juste
au-delà de tout exemple réussie
Une note, jusqu’à ce que sang soit le doigt,
puis, il s’estropie, en un mouvement
de trille raté
au-delà de tout exemple
néanmoins reréussi
Rayonnant depuis toute chose, une offre infinie
parvient sur cette note, sur ce doigt
énervé, et d’ailleurs depuis longtemps anéanti,
qui veut la prendre en charge, donner crédit
à une partition universelle possible,
déverser d’une bande enregistrée
dans une autre
non moins mythique instrument
Une adresse ou une déclaration d’expéditeur
insistante comme bec de pic-vert,
c’est sur ce doigt que tape l’offre,
sienne-unique, de rien-du-tout, qui n’allèche rien,
et, toujours creusant sur cette touche,
et toujours la ratant, dans la déserte
réalité, qui par ailleurs s’affine comme matin,
son obstination contre tout pourquoi,
son inépuisable ni existible pour qui, pour quoi,
ajuste, devine
Andrea Zanzotto, Idiome, traduction de l’italien, du dialecte haut-trévisan (Vénétie) et préface par Philippe Di Meo, José Corti, 2006, p. 36 et 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idiome | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2022
Buson, Le parfum de la lune
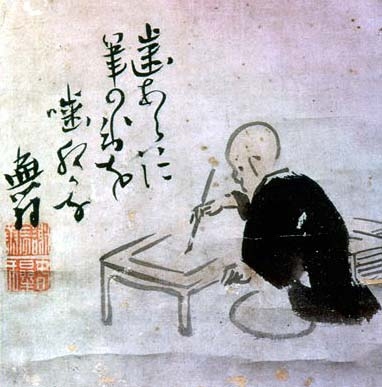
les journées lentes
s'accumulent
si loin autrefois
le poirier en fleurs
sous la lune
une femme lit une lettre
je marche, je marche
songeant à des choses et à d'autres
le printemps s'en va
au bord du chemin
des jacinthes d'eau arrachées fleurissent
la pluie du soir
la nuit, des voix d'hommes
irriguant les champs
la lune d'été
la nuit voilée
les grenouilles brouillent
l'eau et le ciel
Buson (1716-1783), Le parfum de la lune,
traduction Cheng Wing fun et Hervé
Collet, Moundarren, 1992, p. 55, 59,
68, 80, 90, 93.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bison, le parfum de la lune | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2022
Louise Warren, Bleu de Delf : archives de solitude
Commencement
L’été, alors qu’enfant j’allais à la campagne, j’aimais franchir ce lieu interdit que nous appelions tantôt le château, tantôt les ruines, mais jamais la maison brûlée. Une vaste demeure, qui, construite en retrait de notre avenue, semblait reculer tout au fond du paysage. Le sol et les murs de plusieurs pièces de cette maison avaient été recouverts de mosaïque turquoise, vertes ou bleues, ainsi que de grands miroirs, puisque nous trouvions partout de ces éclats de feu que nous ne cessions de retourner au soleil. Tout m’apparaissait possible pour cette maison qui laissait entrer les mauvaises herbes, les chats et chiens errants, le ciel et les enfants. Elle correspondait à la maison de mes rêves. Une maison où l’intérieur et l’extérieur habitent ensemble, où les framboises poussent dans le salon. Un lieu plein d’étrangeté et où le paysage se berce doucement dans les tiroirs, où les escaliers ne mènent nulle part ailleurs que devant soi.
Les années passaient et, dans ce fouillis de mauvaises herbes, on ne voyait plus rien briller que les guêpes. Il n’y eut bientôt ni entrée ni escalier, les ruines furent rasées pour faire place à une série de maisons basses, chacune collée à un jardinet de banlieue. J’ai longtemps établi un lien entre ces ruines, les maisons en démolition du centre-ville, mon appartement brûlé de la rue Hutchinson, et la poésie. Un fil sacré qui déterminerait un périmètre dans l’imaginaire. La poésie a cette force de traversée, celle de commencer par les ruines.
Louise Warren, Bleu de Delf : archives de solitude, éditions Trait d’union, Montréal, 2003, p. 28.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise warren, bleu de delf : archives de solitude, enfance, imaginaire | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2022
Erich Fried, Es ist was es ist
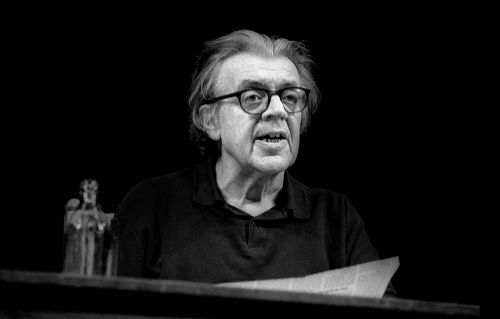
Par la pensée
Te penser
et penser à toi
et penser à toi toute entière et
penser au te-boire
et penser au t’aimer
et penser à l’espérer
et espérer et encore
et toujours plus espérer
le te-revoir-toujours
Ne pas te voir
et par la pensée
non seulement te penser
mais aussi déjà te boire
et déjà t’aimer
Et alors seulement ouvrir les yeux
et par la pensée
d’abord te voir
et puis te penser
et puis de nouveau t’aimer
et de nouveau te boire
et puis
te voir de plus en plus belle
et puis te voir penser
et penser
que je te vois
Et voir que je peux te penser
et sentir ta présence
quand bien même
je ne peux te voir avant longtemp
Quoi ?
Qu’es-tu pour moi ?
Que sont pour moi tes doigts
et tes lèvres ?
Qu’est pour moi le son de ta voix ?
Qu’est pour moi ton odeur
avant l’étreinte
et ton parfum
pendant l’étreinte
et après ?
Qu’es-tu pour moi ?
Que suis-je pour toi ?
Que suis-je ?
Erich Fried, Es ist was es ist, traduction Chantal Tanet et Michael Hohmann.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2022
Erich Fried, Es ist was es ist
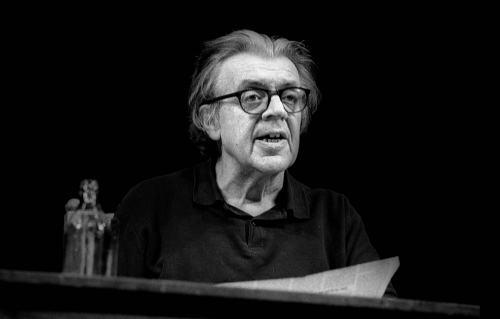
Une nuit à Londres
Garder les mains
devant le visage
et laisser clos
les yeux
ne voir qu’un paysage
montagnes et torrent
et dans la prairie deux animaux
bruns sur le versant vert clair
qui monte jusqu’à la forêt plus sombre
Et commencer à sentir
l’herbe fauchée
et tout en haut au-dessus des pins
en cercles lents un oiseau
petit et noir
sur le bleu du ciel
Et tout
absolument paisible
et si beau
que l’on sait
que cette vie vaut la peine
parce que l’on peut croire
que tout ça existe
Erich Fried, Es ist was es ist, Verlag Klaus Wagenbach, 1983, traduction Chantal Tanet et Michael Hohmann.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2022
Erich Fried, Es ist was es ist
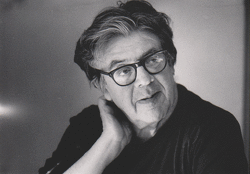
Une sorte de poème d’amour
Qui te désire
quand je te désire
Qui te caresse
quand ma main te cherche ?
Est-ce moi
ou les vestiges de ma jeunesse ?
Est-ce moi
ou les prémices de ma vieillesse ?
Est-ce ma rage de vivre
ou ma peur de la mort ?
Et pourquoi mon désir
devrait-il avoir du sens pour toi ?
Et que t’apporte mon expérience
qui n’a fait que m’attrister ?
Et que t’apportent mes poèmes
où je ne fais que dire
combien c’est devenu difficile
de donner ou d’exister ?
Et pourtant dans le jardin au vent
le soleil brille avant la pluie
et l’air embaume l’herbe agonisante
et le troène
et je te regarde et
ma main part à ta recherche
Attente
Ta voix lointaine
toute proche au téléphone –
et bientôt je l’entendrai de tout près
plus lointaine
parce qu’alors elle devra emprunter
le long chemin
qui mène de ta bouche à mes oreilles
en passant entre tes seins
franchir ton nombril
et le petit mont
en suivant tout ton corps
que tu regardes d’en haut
jusqu’à ma tête en contrebas
dont le visage
est enfoui entre tes cuisses soulevées
dans ta toison
et dans ton ventre
Erich Fried, Es ist was es ist, traduits de l’allemand par Chantal Tanet et Michael Hohmann
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2022
Erich Fried, Es ist was es ist
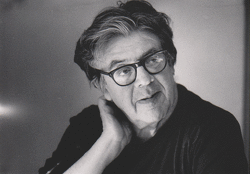
Merci et pardon
(50 ans après l’arrivée au pouvoir d’Hitler)
Beaucoup trop accoutumés
à hocher la tête d’indignation
devant les crimes
de l’époque de la croix gammée
nous oublions
d’être un peu reconnaissants
à nos prédécesseurs
pour ce que leurs actions
pourraient nous aider encore
à reconnaître à temps
le forfait infiniment plus grand
que nous préparons aujourd’hui
Dankeschuld
(50 Jahre nach der Machteinsetzung Hitlers)
Viel zu gewohnt
uns vor Entrüstung zu schütteln
über die Verbrechen
der Hakenkreuzzeit
vergessen wir
unseren Vorgängern doch ein wenig
dankbar zu sein
dafür dass uns ihre Taten
immer noch helfen könnten
die ungleich größere Untat
die wir heute vorbereiten
rechtzeitig zu erkennen
Conversation avec un survivant
Qu’as-tu fait jadis
que tu n’aurais pas dû faire ?
« Rien »
Qu’est-ce que tu n’as-tu pas fait
que tu aurais dû faire ?
« Des choses et d’autres
ceci et cela :
certaines choses »
Pourquoi ne les as-tu pas faites ?
« Parce que j’avais peur »
Pourquoi avais-tu peur ?
« Parce que je ne voulais pas mourir »
D’autres sont-ils morts
parce que tu ne voulais pas mourir ?
« Je crois
que oui »
As-tu autre chose à ajouter
sur ce que tu n’as pas fait ?
« Oui : Te demander
Qu’aurais-tu fait à ma place ? »
Cela je ne le sais pas
et je ne peux pas te juger.
Il n’y a qu’une chose que je sache :
Demain aucun d’entre nous
ne restera en vie
si nous aujourd’hui
recommençons à ne rien faire
Gespräch mit einem Überlebenden
Was hast du damals getan
was du nicht hättest tun sollen ?
„Nichts“
Was hast du nicht getan
was du hättest tun sollen ?
„Das und das
dieses und jenes :
Einiges“
Warum hast du es nicht getan ?
„Weil ich Angst hatte“
Warum hattest du Angst ?
„Weil ich nicht sterben wollte“
Sind andere gestorben
weil du nicht sterben wolltest ?
„Ich glaube
ja“
Hast du noch etwas zu sagen
zu dem was du nicht getan hast ?
„Ja : Dich zu fragen
Was hättest du an meiner Stelle getan ?“
Das weiß ich nicht
und ich kann über dich nicht richten.
Nur eines weiß ich :
Morgen wird keiner von uns
leben bleiben
wenn wir heute
wieder nichts tun
Erich Fried, Es ist was es ist, Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte, traduction inédite Chantal Tanet et Michael Hohmann.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2022
Erich Fried, Es ist was es ist
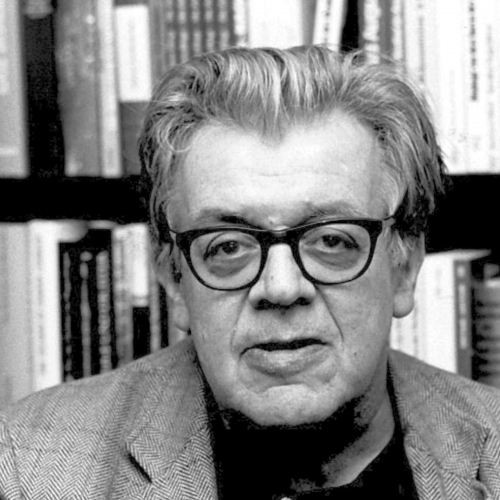
Car
Car
il y a l’alpha
et l’oméga
Car au commencement
Car j’ai faim
Car j’ai peur
Car je suis là
Car je veux vivre
Car j’aime
Car à mi-chemin
demande
« Encore combien de temps ? »
Car à mi-chemin
demande
« A quoi bon tout ça ?»
Car à la fin
ne dira pas même
« Eh bien meurs donc »
Denn
Denn
ist das Alpha
und das Omega
Denn am Anfang
Denn ich habe Hunger
Denn ich habe Angst
Denn ich bin da
Denn ich will leben
Denn ich liebe
Denn in der Mitte
fragt
„Wie lange denn noch ?“
Denn in der Mitte
fragt :
„Wozu denn das alles ?“
Denn am Ende
wird nicht einmal sagen
„So stirb denn
Les derniers seront les premiers
Parce que les choses passées ne sont pas encore
précisément examinées, il se tourne
l’homme de conscience
vers les choses qui les ont précédées
Mais l’homme sans conscience
se sert déjà de poignées artificielles
pour se saisir des choses à venir
et de celles qui suivront
L’homme de conscience
a découvert entretemps
que la clé
qui donne accès aux choses qui les ont précédées
se trouve dans des choses antiques
qui existaient encore avant ces choses
ou plus profondément encore
au sein de leurs conditions préexistantes
Mais l’homme sans conscience
fait des progrès plus rapides. Aussi
se pourrait-il que nous tous
et également l’homme de conscience
il nous conduise
aux dernières extrémités, bien avant
que l’homme de conscience
ait remonté
aux causes premières
jusqu’aux ultimes racines du mal
qui avait rendu sans conscience
l’homme sans conscience
Die Letzten werden die Ersten sein
Weil die vorigen Dinge noch nicht
genau untersucht sind, wendet
sich der Gewissenhafte
den vorvorigen zu
Doch der Gewissenlose
übt schon Kunstgriffe, um die nächsten
und übernächsten Dinge
in den Griff zu bekommen
Der Gewissenhafte
hat mittlerweile entdeckt
dass der Schlüssel
zu den vorvorigen Dingen
in älteren Dingen liegt
die noch vor diesen Dingen waren
oder noch tiefer in deren
Vorvorbedingungen
Der Gewissenlose aber
macht raschere Fortschritte. Deshalb
wird er vielleicht uns alle
und auch den Gewissenhaften
schon zu den letzten Dingen
gebracht haben, lange bevor
der Gewissenhafte
die tiefsten Wurzeln des Übels
das den Gewissenlosen
gewissenlos werden liess
zurückverfolgt hat
bis zu den ersten Dingen
Erich Fried, Es ist was es ist, Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte, traduction inédite Chantal Tanet et Michael Hohmann.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist, liebesgedichte angstgedichte zorngedichte | ![]() Facebook |
Facebook |
L'étrangère : Dossier Esther Tellermann

Deux dossiers ont déjà été consacrés à l’œuvre d’Esther Tellermann* ; depuis elle s’est enrichie, notamment d’un récit (Première version du monde), d’un recueil d’essais autour de la poésie (Nous ne sommes jamais assez poète). Il était bon de reprendre l’étude : le dossier compte 9 articles il est suivi de poèmes inédits et d’une bibliographie. On retiendra ce qui semble quelques lignes de force de l’œuvre, sans chercher à détailler le contenu de chaque contribution : la lecture de la revue, la lecture des uns et des autres complète heureusement le long entretien préparé par François Rannou, coordonnateur de la livraison.
On soulignera d’abord la position d’Esther Tellermann vis-à-vis de son activité d’écriture. Quand on lit des notices biographiques, on découvre que tel ou telle se présente d’abord comme "poète" et, secondairement, comme "professeur de lettres" ou "contrôleur des contributions" ; sans insister sur le caractère étrange de cette manière de se situer dans la société, on préfèrera la position d’E. T., qui se refuse à attribuer un statut social à l’activité de poète, « nous ne sommes poètes que lorsque nous écrivons », affirme-t-elle et, par ailleurs, un livre achevé n’implique pas pour elle qu’un autre viendra. De ce choix découle le fait qu’on ne désire pas être écrivain, poète, mais qu’existe, peut exister le « simple désir d’écriture », « l’ouverture à une subjectivité perméable à la division de l’inconscient ».
Il est bon de rappeler également que l’écriture, hors le biographique, est ancrée dans la mémoire d’une histoire, celle des textes du passé comme des contemporains : E. T. a organisé des livres collectifs à propos de Michel Deguy, Antonin Artaud, Bernard Noël, du peintre François Rouan et elle se réclame de Celan. Étudiant des carnets rédigés au cours de voyages en Égypte (carnets déposés à la Bibliothèque Nationale), C. Barnabé analyse les relations entre lectures, voyage et écriture, le mouvement constant de l’extérieur, du réel vers l’intérieur ; les noms suscitent alors l’écriture par leur pouvoir d’évocation, sans pour autant entraîner de descriptions. D’une manière générale, les mots peuvent être choisis autant pour leur son que pour leur sens. Comme le rappelle A. Battaglia, il y a une poésie du nom qui « souvent se refuse à nommer — qui (s’)expose en (se ) dérobant et qui par conséquent demande que nous apprenions à la fois à lire et à « dé-lire » ».
Ce qui est perçu et saisi de l’instant dans la poésie est transformé par le langage, sachant que le poème s’écrit aussi avec la mémoire de rythmes, de prosodies. Saisie de l’instant dont il faut tenter de restituer « l’éclat » : certes, le poème prend toujours sa source dans le réel, non pour le re-présenter, immaîtrisable qu’il est, toujours énigmatique, seulement pour restituer une « expérience subjective ». C’est dire que l’écriture, la lecture de la poésie est toujours découverte d’une langue, une confrontation à l’inconnu — E. T. y voit une analogie avec le désir de l’amour. Ce faisant, le poème défait le sens, la subjectivité présente n’a aucun rapport avec ce que les habitudes rangent sous ce nom, le Sujet ne peut être défini, rangé dans une case comme sujet psychologique, social, etc. Dans les poèmes d’E. T., quand le lecteur passe du "je" au "tu", au "nous" ou au "vous", il fait peut-être l’épreuve, selon P.-Y. Soucy, d’une « pluralité ontologique » qui lui apparaît « sous une multitude de plis et replis d’identités ». Il lit aussi dans cette multiplicité le thème de la dispersion des êtres comme des choses.
Le monde dans la poésie d’E. T. apparaît toujours dans l’éparpillement, ne se saisit que par bribes, le désir d’unité toujours présent étant su impossible. La tentative toujours répétée d’y parvenir introduit une tension, vers « l’Autre du langage », peut-être vers un « abolissement du chant » (T. Augais), la destruction des signes étant toujours une menace — ce n’est pas hasard si E. T. exprime son admiration pour Samuel Beckett dont on sait que les dernières œuvres étaient écrites avec un nombre très restreint de signes. La poésie cependant ne va pas vers le vide ; si les corps sont en effet éparpillés, il faut penser qu’ils sont réunis dans le poème, séparés certes mais dans le même espace ; on peut lire alors le "nous" comme un « antidote de la séparation » (N. Krastev-Mckinnon). Le poème est donc un espace où est exposé, visible, un monde brisé et, en même temps, la division provoquée par le temps qui détruit les corps est interrompue.
La poésie lyrique d’Esther Tellermann met sans cesse en avant notre finitude et notre solitude, mais elle tend du même mouvement à « restaurer l’humain dans le langage », à reconstruire un lien perdu entre le langage et le monde, ce qui se lit clairement dans un des poèmes inédits en fin de volume :
Sans savoir
si
sous la langue
sommeillent
les horizons
longtemps je lisais
la déchirure
les hivers retenus
ou des terres
que nouent
le gel
la promesse
de paroles
où faire halte
* Revue Nu(e), 2008, revue Europe, n° 1026, octobre 2014. On lira pour une synthèse un livre récent, Aaron Prevosts, Esther Tellermann : énigme, prière, identité, 2022.
L'étrangère, n° 56, premier semestre 2022, Dossier Esther Tellemann, Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 octobre 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'étrangère, dossier esther tellermann | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2022
Julia Lepère, Par elle se blesse

Sur la rive
Je suis entre deux
Hommes comme sur un couteau j’efface
Tout. Pleine d’eux
Au milieu de ces vies qu’on cherche pour se taire
Il faudra bien que la vitesse nous
Fasse disparaître
Nous aussi
Nuée de plomb
Dans ce film pourquoi
TU à l’approche me blesse-t-il autant tu la filmes
Si lentement
Je ferme
À côté de moi quelqu’un s’endort
Je pourrais être à lui, comme à n’importe qui — un instant
Imaginer le suivre
Agitée
Et repartir
Julia Lepère, Par elle se blesse, Poésie/Flammarion,
2022, p. 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julia lepère, par elle se blesse, double amour | ![]() Facebook |
Facebook |





