28/11/2022
Erich Fried, Es ist was es ist

Une sorte de poème d’amour
Qui te désire
quand je te désire
Qui te caresse
quand ma main te cherche ?
Est-ce moi
ou les vestiges de ma jeunesse ?
Est-ce moi
ou les prémices de ma vieillesse ?
Est-ce ma rage de vivre
ou ma peur de la mort ?
Et pourquoi mon désir
devrait-il avoir du sens pour toi ?
Et que t’apporte mon expérience
qui n’a fait que m’attrister ?
Et que t’apportent mes poèmes
où je ne fais que dire
combien c’est devenu difficile
de donner ou d’exister ?
Et pourtant dans le jardin au vent
le soleil brille avant la pluie
et l’air embaume l’herbe agonisante
et le troène
et je te regarde et
ma main part à ta recherche
Attente
Ta voix lointaine
toute proche au téléphone –
et bientôt je l’entendrai de tout près
plus lointaine
parce qu’alors elle devra emprunter
le long chemin
qui mène de ta bouche à mes oreilles
en passant entre tes seins
franchir ton nombril
et le petit mont
en suivant tout ton corps
que tu regardes d’en haut
jusqu’à ma tête en contrebas
dont le visage
est enfoui entre tes cuisses soulevées
dans ta toison
et dans ton ventre
Erich Fried, Es ist was es ist, traduits de l’allemand par Chantal Tanet et Michael Hohmann
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2022
Erich Fried, Es ist was es ist

Merci et pardon
(50 ans après l’arrivée au pouvoir d’Hitler)
Beaucoup trop accoutumés
à hocher la tête d’indignation
devant les crimes
de l’époque de la croix gammée
nous oublions
d’être un peu reconnaissants
à nos prédécesseurs
pour ce que leurs actions
pourraient nous aider encore
à reconnaître à temps
le forfait infiniment plus grand
que nous préparons aujourd’hui
Dankeschuld
(50 Jahre nach der Machteinsetzung Hitlers)
Viel zu gewohnt
uns vor Entrüstung zu schütteln
über die Verbrechen
der Hakenkreuzzeit
vergessen wir
unseren Vorgängern doch ein wenig
dankbar zu sein
dafür dass uns ihre Taten
immer noch helfen könnten
die ungleich größere Untat
die wir heute vorbereiten
rechtzeitig zu erkennen
Conversation avec un survivant
Qu’as-tu fait jadis
que tu n’aurais pas dû faire ?
« Rien »
Qu’est-ce que tu n’as-tu pas fait
que tu aurais dû faire ?
« Des choses et d’autres
ceci et cela :
certaines choses »
Pourquoi ne les as-tu pas faites ?
« Parce que j’avais peur »
Pourquoi avais-tu peur ?
« Parce que je ne voulais pas mourir »
D’autres sont-ils morts
parce que tu ne voulais pas mourir ?
« Je crois
que oui »
As-tu autre chose à ajouter
sur ce que tu n’as pas fait ?
« Oui : Te demander
Qu’aurais-tu fait à ma place ? »
Cela je ne le sais pas
et je ne peux pas te juger.
Il n’y a qu’une chose que je sache :
Demain aucun d’entre nous
ne restera en vie
si nous aujourd’hui
recommençons à ne rien faire
Gespräch mit einem Überlebenden
Was hast du damals getan
was du nicht hättest tun sollen ?
„Nichts“
Was hast du nicht getan
was du hättest tun sollen ?
„Das und das
dieses und jenes :
Einiges“
Warum hast du es nicht getan ?
„Weil ich Angst hatte“
Warum hattest du Angst ?
„Weil ich nicht sterben wollte“
Sind andere gestorben
weil du nicht sterben wolltest ?
„Ich glaube
ja“
Hast du noch etwas zu sagen
zu dem was du nicht getan hast ?
„Ja : Dich zu fragen
Was hättest du an meiner Stelle getan ?“
Das weiß ich nicht
und ich kann über dich nicht richten.
Nur eines weiß ich :
Morgen wird keiner von uns
leben bleiben
wenn wir heute
wieder nichts tun
Erich Fried, Es ist was es ist, Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte, traduction inédite Chantal Tanet et Michael Hohmann.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2022
Erich Fried, Es ist was es ist

Car
Car
il y a l’alpha
et l’oméga
Car au commencement
Car j’ai faim
Car j’ai peur
Car je suis là
Car je veux vivre
Car j’aime
Car à mi-chemin
demande
« Encore combien de temps ? »
Car à mi-chemin
demande
« A quoi bon tout ça ?»
Car à la fin
ne dira pas même
« Eh bien meurs donc »
Denn
Denn
ist das Alpha
und das Omega
Denn am Anfang
Denn ich habe Hunger
Denn ich habe Angst
Denn ich bin da
Denn ich will leben
Denn ich liebe
Denn in der Mitte
fragt
„Wie lange denn noch ?“
Denn in der Mitte
fragt :
„Wozu denn das alles ?“
Denn am Ende
wird nicht einmal sagen
„So stirb denn
Les derniers seront les premiers
Parce que les choses passées ne sont pas encore
précisément examinées, il se tourne
l’homme de conscience
vers les choses qui les ont précédées
Mais l’homme sans conscience
se sert déjà de poignées artificielles
pour se saisir des choses à venir
et de celles qui suivront
L’homme de conscience
a découvert entretemps
que la clé
qui donne accès aux choses qui les ont précédées
se trouve dans des choses antiques
qui existaient encore avant ces choses
ou plus profondément encore
au sein de leurs conditions préexistantes
Mais l’homme sans conscience
fait des progrès plus rapides. Aussi
se pourrait-il que nous tous
et également l’homme de conscience
il nous conduise
aux dernières extrémités, bien avant
que l’homme de conscience
ait remonté
aux causes premières
jusqu’aux ultimes racines du mal
qui avait rendu sans conscience
l’homme sans conscience
Die Letzten werden die Ersten sein
Weil die vorigen Dinge noch nicht
genau untersucht sind, wendet
sich der Gewissenhafte
den vorvorigen zu
Doch der Gewissenlose
übt schon Kunstgriffe, um die nächsten
und übernächsten Dinge
in den Griff zu bekommen
Der Gewissenhafte
hat mittlerweile entdeckt
dass der Schlüssel
zu den vorvorigen Dingen
in älteren Dingen liegt
die noch vor diesen Dingen waren
oder noch tiefer in deren
Vorvorbedingungen
Der Gewissenlose aber
macht raschere Fortschritte. Deshalb
wird er vielleicht uns alle
und auch den Gewissenhaften
schon zu den letzten Dingen
gebracht haben, lange bevor
der Gewissenhafte
die tiefsten Wurzeln des Übels
das den Gewissenlosen
gewissenlos werden liess
zurückverfolgt hat
bis zu den ersten Dingen
Erich Fried, Es ist was es ist, Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte, traduction inédite Chantal Tanet et Michael Hohmann.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist, liebesgedichte angstgedichte zorngedichte | ![]() Facebook |
Facebook |
L'étrangère : Dossier Esther Tellermann

Deux dossiers ont déjà été consacrés à l’œuvre d’Esther Tellermann* ; depuis elle s’est enrichie, notamment d’un récit (Première version du monde), d’un recueil d’essais autour de la poésie (Nous ne sommes jamais assez poète). Il était bon de reprendre l’étude : le dossier compte 9 articles il est suivi de poèmes inédits et d’une bibliographie. On retiendra ce qui semble quelques lignes de force de l’œuvre, sans chercher à détailler le contenu de chaque contribution : la lecture de la revue, la lecture des uns et des autres complète heureusement le long entretien préparé par François Rannou, coordonnateur de la livraison.
On soulignera d’abord la position d’Esther Tellermann vis-à-vis de son activité d’écriture. Quand on lit des notices biographiques, on découvre que tel ou telle se présente d’abord comme "poète" et, secondairement, comme "professeur de lettres" ou "contrôleur des contributions" ; sans insister sur le caractère étrange de cette manière de se situer dans la société, on préfèrera la position d’E. T., qui se refuse à attribuer un statut social à l’activité de poète, « nous ne sommes poètes que lorsque nous écrivons », affirme-t-elle et, par ailleurs, un livre achevé n’implique pas pour elle qu’un autre viendra. De ce choix découle le fait qu’on ne désire pas être écrivain, poète, mais qu’existe, peut exister le « simple désir d’écriture », « l’ouverture à une subjectivité perméable à la division de l’inconscient ».
Il est bon de rappeler également que l’écriture, hors le biographique, est ancrée dans la mémoire d’une histoire, celle des textes du passé comme des contemporains : E. T. a organisé des livres collectifs à propos de Michel Deguy, Antonin Artaud, Bernard Noël, du peintre François Rouan et elle se réclame de Celan. Étudiant des carnets rédigés au cours de voyages en Égypte (carnets déposés à la Bibliothèque Nationale), C. Barnabé analyse les relations entre lectures, voyage et écriture, le mouvement constant de l’extérieur, du réel vers l’intérieur ; les noms suscitent alors l’écriture par leur pouvoir d’évocation, sans pour autant entraîner de descriptions. D’une manière générale, les mots peuvent être choisis autant pour leur son que pour leur sens. Comme le rappelle A. Battaglia, il y a une poésie du nom qui « souvent se refuse à nommer — qui (s’)expose en (se ) dérobant et qui par conséquent demande que nous apprenions à la fois à lire et à « dé-lire » ».
Ce qui est perçu et saisi de l’instant dans la poésie est transformé par le langage, sachant que le poème s’écrit aussi avec la mémoire de rythmes, de prosodies. Saisie de l’instant dont il faut tenter de restituer « l’éclat » : certes, le poème prend toujours sa source dans le réel, non pour le re-présenter, immaîtrisable qu’il est, toujours énigmatique, seulement pour restituer une « expérience subjective ». C’est dire que l’écriture, la lecture de la poésie est toujours découverte d’une langue, une confrontation à l’inconnu — E. T. y voit une analogie avec le désir de l’amour. Ce faisant, le poème défait le sens, la subjectivité présente n’a aucun rapport avec ce que les habitudes rangent sous ce nom, le Sujet ne peut être défini, rangé dans une case comme sujet psychologique, social, etc. Dans les poèmes d’E. T., quand le lecteur passe du "je" au "tu", au "nous" ou au "vous", il fait peut-être l’épreuve, selon P.-Y. Soucy, d’une « pluralité ontologique » qui lui apparaît « sous une multitude de plis et replis d’identités ». Il lit aussi dans cette multiplicité le thème de la dispersion des êtres comme des choses.
Le monde dans la poésie d’E. T. apparaît toujours dans l’éparpillement, ne se saisit que par bribes, le désir d’unité toujours présent étant su impossible. La tentative toujours répétée d’y parvenir introduit une tension, vers « l’Autre du langage », peut-être vers un « abolissement du chant » (T. Augais), la destruction des signes étant toujours une menace — ce n’est pas hasard si E. T. exprime son admiration pour Samuel Beckett dont on sait que les dernières œuvres étaient écrites avec un nombre très restreint de signes. La poésie cependant ne va pas vers le vide ; si les corps sont en effet éparpillés, il faut penser qu’ils sont réunis dans le poème, séparés certes mais dans le même espace ; on peut lire alors le "nous" comme un « antidote de la séparation » (N. Krastev-Mckinnon). Le poème est donc un espace où est exposé, visible, un monde brisé et, en même temps, la division provoquée par le temps qui détruit les corps est interrompue.
La poésie lyrique d’Esther Tellermann met sans cesse en avant notre finitude et notre solitude, mais elle tend du même mouvement à « restaurer l’humain dans le langage », à reconstruire un lien perdu entre le langage et le monde, ce qui se lit clairement dans un des poèmes inédits en fin de volume :
Sans savoir
si
sous la langue
sommeillent
les horizons
longtemps je lisais
la déchirure
les hivers retenus
ou des terres
que nouent
le gel
la promesse
de paroles
où faire halte
* Revue Nu(e), 2008, revue Europe, n° 1026, octobre 2014. On lira pour une synthèse un livre récent, Aaron Prevosts, Esther Tellermann : énigme, prière, identité, 2022.
L'étrangère, n° 56, premier semestre 2022, Dossier Esther Tellemann, Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 octobre 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'étrangère, dossier esther tellermann | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2022
Julia Lepère, Par elle se blesse

Sur la rive
Je suis entre deux
Hommes comme sur un couteau j’efface
Tout. Pleine d’eux
Au milieu de ces vies qu’on cherche pour se taire
Il faudra bien que la vitesse nous
Fasse disparaître
Nous aussi
Nuée de plomb
Dans ce film pourquoi
TU à l’approche me blesse-t-il autant tu la filmes
Si lentement
Je ferme
À côté de moi quelqu’un s’endort
Je pourrais être à lui, comme à n’importe qui — un instant
Imaginer le suivre
Agitée
Et repartir
Julia Lepère, Par elle se blesse, Poésie/Flammarion,
2022, p. 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julia lepère, par elle se blesse, double amour | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2022
Juan Rodolfo Wilcox, Les Jours heureux

Je porte un chiffre sur le cœur, un sceau
de t’aimer comme si le silence s’était inscrit
dans la chair profondément ; et j’ai parcouru
des galeries de feuilles passionnées, des chemins
qui s’ouvraient au soleil hurlant, s’arrachant,
se râpant jusqu’à l’âme. Ô s’il m’était donné
de ne pas te voir apparaître, immuable,
là où l’amour naît, comme une image
au fond de l’eau !
Joan Rodolfo Wilcox, Les Jours heureux, traduction Silvia
Baron Supervielle, Orphée/La Différence, 1994, p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joan rodolfo wilcox, les jours heureux, traduction silvia baron supervielle | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2022
Erich Fried, es ist was es ist

Mais alors
La vie
serait
peut-être plus simple
si je ne t’avais
pas du tout rencontrée
Moins de tristesse
chaque fois
que nous devons nous séparer
moins d’appréhension
de la prochaine séparation
et de la suivante
Et pas non plus
quand tu n’es pas là
tant de ce vain désir
qui ne réclame que l’impossible
et l’immédiat
dans l’instant même
et qui ensuite
parce qu’il ne peut s’accomplir
en est troublé
et respire avec peine
La vie
serait peut-être
plus simple
si je ne t’avais
pas rencontrée
Mais alors
elle ne serait pas ma vie
Quoi ?
Qu’es-tu pour moi ?
Que sont pour moi tes doigts
et tes lèvres ?
Qu’est pour moi le son de ta voix ?
Qu’est pour moi ton odeur
avant l’étreinte
et ton parfum
pendant l’étreinte
et après ?
Qu’es-tu pour moi ?
Que suis-je pour toi ?
Que suis-je ?
Toi
Toi
te laisser être toi
entièrement toi
Voir
que tu n’es toi
que lorsque tu es tout
ce que tu es
la tendresse
et le sauvage
ce qui veut se détacher
et ce qui veut se blottir
Celui qui n’aime que la moitié
ne t’aime pas à moitié
il ne t’aime pas du tout
celui-là veut te tailler sur mesure
t’amputer
te mutiler
Te laisser être toi
est-ce difficile ou facile ?
Cela ne dépend pas de la dose
de calcul et de bon sens
mais de la dose d’amour
et de désir suspendu à tout –
à tout
ce qui est toi
À la chaleur
et à la froideur
à l’amabilité
et à l’obstination
à ton bon vouloir
et ton mécontentement
à chacun de tes gestes
à tes mauvais gestes
ton inconstance
ta constance
Alors cela
te laisser être toi
n’est
peut-être pas
si difficile
Erich Fried, poèmes extraits du recueil Es ist was es ist, Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1983 ; rééd., 2005. Traduction inédite de Chantal Tanet et Michael Hohmann.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2022
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo

Au feu, à l’étang, le visage couleur de la nuit,
odeur de la journée, le visage d’innocente,
de pourpre fleur, de garçon livide, de porc
blanc, de poisson roi, de sale enfant,
qui criait, au feu, à l’étang, au sumac,
à la saveur des baies et des tiges,
la morte répandue, la robe éparpillée, la salie,
tout au feu, à l’étang, les draps, les nuages autour,
autour de la cheminée, même le héros, le premier parleur
au baiser, le premier loup qui dort, au feu,
à l’étang, au parfum.
Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit,
1980, p. 36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, bufo bufo bufo, énumération | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2022
André Frénaud, Il n'y a pas de paradis

De toi, de moi, d’où sortait la lumière ?
Dans la grande bienveillance de l’âtre profond
où je me flattais de brûler pour me découvrir
comme un rayon de flammes et m’éclairer à ma lumière,
quand celle-ci était l’amour qui sortait de moi
parce qu’il était destiné à qui j’étais voué.
Et je multipliais les feux, j’embrasais l’alentour.
Je croyais en un pouvoir d’aurore perpétuel.
(...)
Nous. Nous étions retrouvés, nous devions nous déprendre.
Et qui affirme se trompe, qui croit en soi se hausse en vain.
L’unité que je poursuivais avec nos cœurs tâtonnants,
si elle anéantit quelquefois nos limites
ce fut malgré toi, malgré moi peut-être.
André Frénaud, Il n’y a pas de paradis, Poésie/Gallimard,
1987, p. 181 et 183.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, il n'y a pas de paradis, la lumière de l'amour | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2022
André Frénaud, Les Rois Mages

Tu es belle
Tu es belle par les relais de la nuit,
tu es belle aux arènes de l’aurore,
tu es toujours dévêtue pour moi,
je veux prendre part à ton visage dans la peine,
je veux nourrir tes yeux par les miens,
je veux garder ma vie entre tes mains.
Répondons aux oiseaux qui sifflent pour nous plaire.
André Frénaud, Les Rois Mages, Poésie Gallimard,
1977, p . 56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, les rois mages, beauté, nudité | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2022
André Frénaud, La Sainte Face

La vie est comme ça
— Ça ne tache pas, c’est du vin rouge.
— Ça vous fera plaisir, c’est du sang.
— Ça ne lui fera pas de mal, ce n’est qu’un enfant.
— Ça ne vous regarde pas, c’est la vérité.
— Ça ne vous touche pas, c’est votre vie.
— Ça ne vous blessera pas, c’est l’amour.
André Frénaud, La Sainte Face, Poésie/Gallimard, 1985, p. 77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la vie est comme ça | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2022
Jacques Roubaud, Autobiographie, chapitre dix
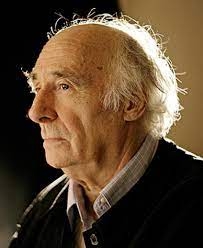
La mémoire
ma mémoire se brouille souvent,
la neige incessante des sensations recouvre de son grand
silence blanc les pistes plus anciennes.
Avec quelle bêche creuserai-je ce manteau pour découvrir
sans les effacer les traces du renard de la jeunesse ?
Alors, je pisse dedans.
Jacques Roubaud, Autobiographie, chapitre dix, Gallimard, 1977,
p. 114.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, autobiographie, chapitre dix, mémoire, neige, renard | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2022
Jacques Roubaud, Octogone
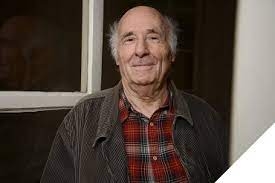
À P. L. pour son 70e anniversaire
« J’ai moins de souvenirs que si j’avais deux ans »
« Ma mémoire n’est plus qu’un souvenir ». Je cite
souvent ces mots. Ce sont deux vers. C’est un peu vite
dire que ce sont vers. Aphorythmr au présent
continuel est leur statut. C’est au hasard
d’une recuisson de langage que la suite
de mallarméennes syllabes reste juste
comptable, tu n’as jamais montré tant d’égards
pour Alexandre que pour Bach (Johann Sebas-
tian). Le second est un décasyllabe ly-
rique, une invention de trouvères. Pali
est le feuillet crayonné d’ans où tu jetas
sa ligne de poids métrique. Sombres paroles.
Ô dure incomplétude des pensives époques.
(var. : ô rude incomplétude des poussives systoles)
Jacques Roubaud, Octogone, Gallimard, 2014, p. 230.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, souvenir, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2022
Jacques Roubaud, Quelque chose noir

Le sens du passé
Le sens du passé naît
d’objets-déjà
Dans tous les moments évidents
je t’ai cherchée
Aussi dans de ténus
interrègnes
Cherchée qui ?
où
es-tu ?
qui ?
qui, n’a plus de nom
ni quoi (sans nom, dans nulle langue)
Je reviendrais de quelques pas en arrière, je serais
dans un espace
différent, en un sens précaire.
Comme si le son traversant l’eau
tombait d’une quarte.
Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacque roubaud, quelque chose noir, disparition, perte | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2022
Les Ruines de Paris

Des fleurs des acacias qui moussent pendent au-dessus du trottoir. Je m’aperçois que trois demoiselles pour vouloir en cueillir des grappes : elles n’y arriveront pas. J’estimerais assez naturel de leur venir en aide, mais qu’en penseraient-elles, et puis moi, dans le vacillement de la courte échelle ? J’attends donc qu’elles aient disparu avant de plonger les bras dans le lait frais bouillonnant de ces géants de la ligne de Ceinture. Les fleurs sentent le grenier à foin un été sous l’averse (je me souviens de l’été de 43), la cigarette Senior Service, le cou de jeune fille, la camomille — bref elles sentent surtout l‘acacia. Si candides, si fragiles, j’en remplis ma sacoche dont le ressort va sauter rue d’Alésia, s’embrouillant dans la chaîne, compliquant prosaïquement le reste de la journée, alors que j’avais prémédité de bouleverser ma vie en offrant ces fleurs — mais je divague, et surtout j’anticipe ; je n’ai même pas encore atteint le coin de la rue de Patay, près du restaurant La Pente Douce ; je ne fais qu’amorcer la descente vers les derniers potagers suspendus de la rue Regnault, et là, dans les lointains brumeux d’une Afrique de rêve, d’horizons en photogravure d’atlas géographique, aberrant mais fatal, sans nom, sans raison, sans emploi, éclôt en fragment absolu le piton du zoo de Vincennes.
Jacques Réda, Les Ruines de Paris, Gallimard, 1972, p. 86-87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, less ruines de paris, acacia, demoiselle, odeur | ![]() Facebook |
Facebook |





