06/10/2022
Jean Gente, Le voleur
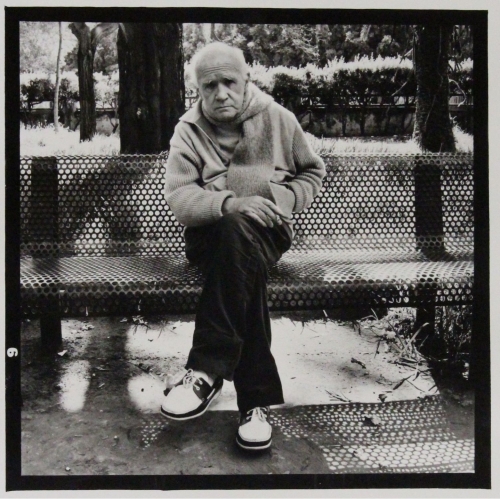
Le voleur
Vous êtes hypocrite immortelle écuyère
En robe d’organdi sur un cheval blond !
En pétales perdus vos beaux doigts s’effeuillèrent
Adieu mon grand jardin par le ciel terrassé !
***
Ainsi je reste seul oublié de lui qui dort dans mes
bras. La mer est calme. Je n’ose bouger. Sa pré-
sence serait plus terrible que son voyage hors
de moi. Peut-être viendrait-il sur ma poitrine.
Et qu’y pourrais-je faire ? Trier ses vomissures ?
Y chercher parmi le vomi, la viande, la bile, ces
violettes et ces roses qu’y délaient et délient
les filets de sang ?
(...)
Jean Genet, Le pêcheur du Suquet, dans Le condamné à mort, L’arbalète, 1958, p. 104-105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, le voleur, amant | ![]() Facebook |
Facebook |
Francis Ponge, La fabrique du pré
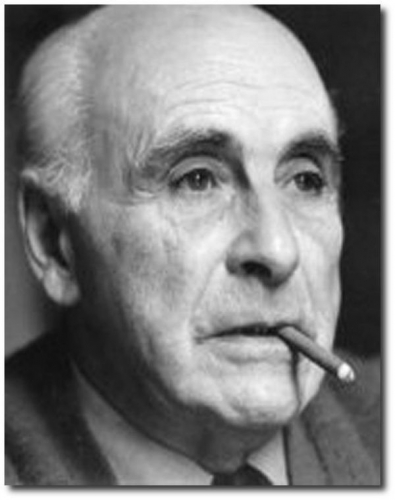
31 mars 1970
I
Il ne fait, pour mon expérience, aucun doute que l’amour des mots (c.a.d la référence (révérencieuse) à une vision traditionnellement humaine et (osons le dire) nationale des choses (il faut expliquer cela) (que l’amour des mots soit cela) soit le chemin à la création (je veux dire, par l’expression sans tricherie d’une sensibilité individuelle, sans seulement la fabrication d’objets de satisfaction, de jouissance pour le goût commun des usagers de la langue, mais l’auto création de l’individu lui-même dans sa ressemblance et sa différence à ceux que l »’on appelle ses semblables.
Francis Ponge, La fabrique du pré, Gallimard, 2021, p. 16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, la fabrique pré, esprit national | ![]() Facebook |
Facebook |
04/10/2022
Pierre Voélin, D'eau et de sang
Ligatures
Toi —tendrement liée — sous le lien de mes bras
ici — sans bruit — sauf les forts battements
du cœur — à ton cou le collier
les perles — les cris
du petit jour `
Tu le sais — ta beauté me déchire
Plus souples les feuillages contre la vitre
le vent amoureux — d’un souffle —
les secoue
Je dirai le nu du désir — avec ou sans honte
tu annonceras — toi — les nuits de perce-neige
Pierre Voélin, D’eau et de sang, dans L’étrangère,
N° 56, 2022, p. 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
29/09/2022
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, onze, douze
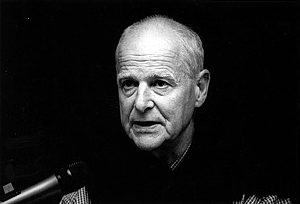
le 18 novembre (2008)
Si, sur une page, je regarde le mot colline, je connais, dans des délais variables, un afflux ou non d’images, d’envies, de mémoire. Une boue de pensée, la soupe des sensations. Il est souvent difficile de les distinguer.
Si, maintenant, je regarde la colline, je connais, dans des délais également variables un afflux ou non d’images, d’envies, de mémoire ; La même soupe, la même boue.
Le corps a vécu deux activités, a accompli deux choses radicalement différentes. Comment les symptômes pourraient-ils être les mêmes ? Ils ne le sont pas. C’est toute la tragédie et toute l’excitation du monde.
Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, onze, douze, Flammarion, 2013, p. 104-105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, onze, douze, colline, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2022
Umberto Saba, Il Canzoniere
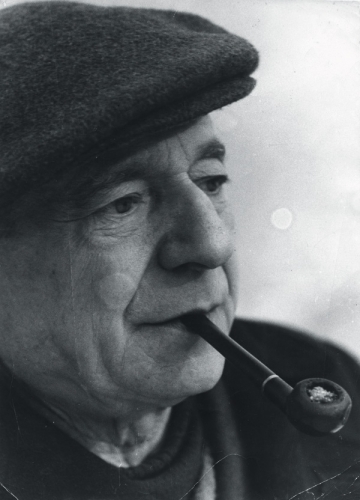
Quand se levait le rideau
Quand se levait le rideau sur le monde
de mon enfance, j’accourus comme
à une fête promise. Une à une
sont tombées les merveilles.
Des espérances conçues, nulle
qui vaille à m’en souvenir, même une larme
et même un seul soupir. Mais il me reste
ton baiser, jeune amie, qu’absences
et respect de nous-mêmes font plus rares.
C’était cela la vie, une gorgée amère.
Umberto Saba, Il Canzoniere, L’âge d’homme, 1988, p. 461.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, il canzoniere, le rideau levé, enfance, merveille | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2022
Umberto Saba, Il Canzoniere
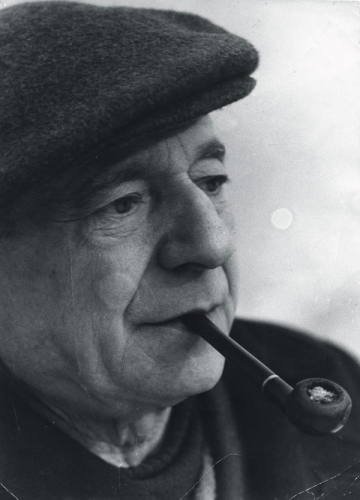
Seul
Je suis seul. Nul n’écoute là
où tout appel aux amis dispersés
est vain.
La haine brille comme un glaçon, et je pense
que je te verrai ce soir, toi que j’aime.
Je pense à tous mes efforts,
tandis que j’allais au hasard
au soleil qui découvre, dans l’ombre qui protège,
pour me dire en paix quelques
mots.
Umberto Saba, Il Canzionere, L’âge d’homme, 1988, p. 460.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2022
Umberto Saba, Il Canzoniere
![]()
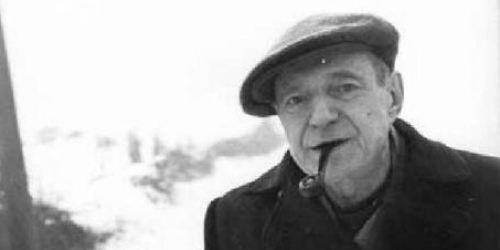
L’adieu
Sans adieu tu m’as laissé et sans pleurs ;
dois-je m’en affliger .
Tu ne pleurais pas parce que tu avais tant,
tant de baisers à me donner.
Certaines ententes amoureuses durent assurément
autant qu’une vie et davantage.
Je connais un amour qui a duré un mois
et qui fut un amour véritable.
Umbero Saba, l Canzoniere, L’âge d’homme, 1988, p. 198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umbertyo saba, il canzoniere, adieu, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2022
Umberto Saba, Il Canzoniere
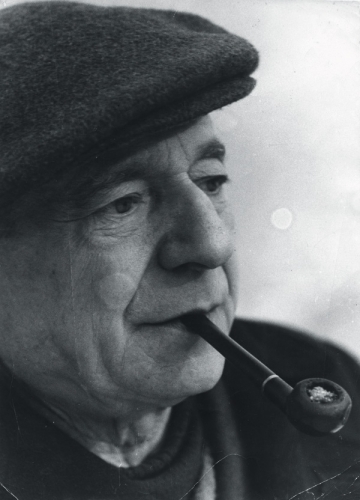
La solitude
Saison changeante, ombre et soleil
font le monde varié, qui dans son aspect riant
nous console, et de ses nuages nous peine.
Et moi, qui à tant de nos apparences et à mes
yeux portait une infinie gratitude
je ne sais aujourd’hui si je dois m’affliger
ou m’en aller joyeux comme quand on sort d’une épreuve :
je suis triste et pourtant la journée est si belle ;
dans mon cœur seulement il fait pluie et soleil.
D’un long hiver je sais faire un printemps ;
quand la route au soleil est une traînée d’or,
le bonsoir, je le dis à moi-même.
J’ai mes brouillards et mes beaux temps en moi tout seul
comme en moi seul est ce parfait amour
pour que l’on souffre tant, moi je ne pleure plus :
en mes yeux en mon cœur je trouve suffisance.
Umberto Saba, Il Canzoniere, L’âge d’homme, 1988, p. 146.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, il canzoniere, solitude, pluie, soleil | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2022
Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent

(...) on a vagabondé dans le lieu, jardin et maison, sans souhaiter rencontrer personne, on a cherché à s’approprier quelque chose que l’on nous a refusé. On a écouté des bribes d’histoires, des fragments sans lien apparent et on n’a pas compris que l’on était ce lien, cette pâte à fixe, ce joint. On est venue à la rencontre d’une enfance meurtrie, on est allée plus loin encore vers l’enfance passée de celles qui n’étaient plus enfants, on se mettait là parce que l’on s’y sentait bien : on était à sa place, retournée à l’autorité de soi-même.
Camille Loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent, dans La revue de belles-lettres, 2022-1, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camillme loivier, les lignes indéfiniment se poursuivent, jardin, lien | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2022
Florence Pazzottu, Le joueur de flûte : recension
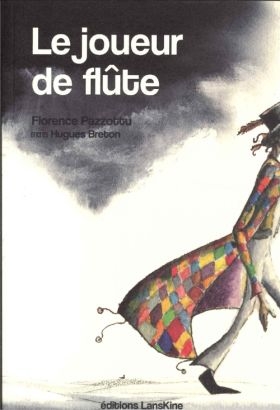
Les contes collectés notamment par Charles Perrault et les frères Grimm ont la plupart du temps été récrits mis au goût du jour pour le public enfantin (souvent très simplifiés, châtrés même) ou avec une visée littéraire et/ou sociale, le texte étant destiné à des adultes. Ainsi Robert Coover est parti de La Belle au Bois-Dormant pour écrire Rose (L’Aubépine) (traduit en 1998) et Christine Angot a proposé sa version de Peau d’Âne où se mêlent autobiographie et imaginaire. Le parti-pris de Florence Pazzottu et de Hugues Breton est différent dans la reprise du conte très connu de Grimm, Le Joueur de flûte de Hamelin : enfants et adultes y trouveront leur compte. L’auteure ne cache pas qu’elle entend déborder la visée convenue du conte en donnant en épigraphe l’intégralité de L’étranger de Baudelaire, qui exalte l’imaginaire, le poème cité extrait d’un livre sur l’exil de l’écrivain iranien, Atiq Rahini.
Rappelons le canevas du conte, que Florence Pazzottu suit scrupuleusement : une ville, au moment des fêtes de Noël, est envahie par des rats et rien n’arrête leur prolifération : rapidement ils dévorent tout. Les autorités tentent sans succès de les éliminer avec des pièges et du poison, ils promettent mille pièces d’or à qui pourra les délivrer du fléau. Un étranger vient et, jouant de la flûte, entraîne les rats hors de la ville. Les habitants se réjouissent mais la récompense est fortement diminuée. L’étranger la refuse et quitte la ville, il y revient quelques semaines plus tard et, jouant à nouveau, entraîne cette fois les enfants qui partent pour toujours. Ce que modifie en profondeur Florence Pazzottu, ce sont des éléments qui, laissant le plan intact, donnent au conte un caractère contemporain.
Il s’agit maintenant d’une « ville sans nom », toutes les villes d’aujourd’hui étant interchangeables avec leurs hautes tours et fermées à qui n’y vit pas. Les habitants ne sont pas divisés en pauvres et riches, vus sous un autre aspect : aucun ne cherche à être autrement que son voisin et chacun « se presse où se pressent les autres ». On apprécie les encres d’Hugues Breton, elles restituent la tristesse des bâtiments et le fait que tous les habitants se ressemblent. C’est après le repas de Noël que les rats envahissent la ville et dévorent en quelques jours toues les réserves. L’homme qui entre dans la ville est étranger par son habit d’Arlequin dont les couleurs connotent la vie et s’opposent à la grisaille des vêtements des citadins ; tous refusent sa différence et se détournent à son approche, sauf les enfants. Il propose aux autorités de les délivrer du « grand mal qui [les] ronge » : ils se moquent et « ricanent » quand, pour agir, il sort une flûte de verre de son sac. C’est la peur et la lassitude qui poussent le dirigeant à promettre une forte somme — un chèque avec beaucoup de zéros — à l’étranger s’il réussit.
Les rats qui accourent aux sons de la flûte sont représentés par Hugues Breton comme une énorme vague, puis comme un nuage noir qui finit par se dissiper. L’étranger revient, et c’est comme s’il n’avait pas existé. La somme promise n’est pas discutée : un enfant en fin de journée vient lui porter le chèque ; la scène se passe aujourd’hui, où tout se consomme et se consume, non à la fin du XIIIe siècle comme dans la légende. L’étranger n’appartient pas à cette société et, avant de partir, dit seulement « C’est donc ainsi ? ». Il s’éloigne de la ville non pour n’avoir pas reçu la somme promise mais parce qu’il attendait des échanges, des paroles, des regards, de ne plus être vu comme un étranger. Il revient un an plus tard et joue à nouveau, cette fois « un chant d’une beauté, d’une force inouïes. Il portait des vies secrètes, singulières, sauvages, inventait des sentiers, ciselait et distinguait recoins et profondeurs. » Le chant porte tout ce qui est contraire à la ville, le vivant, le mystère, l’individuel, l’imaginaire, et seuls les enfants le comprennent, non encore "intégrés" dans la société fermée des adultes qui restent « sourds à l’appel, irrémédiablement ».
Comme dans la tradition, l’étranger entraîne les enfants qui disparaissent à jamais, mais ce n’est pas le vent qui, parfois, porte leur rire : quelques habitants qui, « devenus un peu fous, croient entendre, mêlé au vent » leur « rire insoumis ». Florence Pazzottu conserve les caractéristiques du conte (un héros, une épreuve à surmonter, la résolution des difficultés) en introduisant, sans forcer le ton, des éléments de la vie contemporaine. Ce faisant, elle garde au conte le charme de la lecture en lui ôtant ses aspects surannés et fait passer une critique claire de la société, lisible quel que soit le lecteur.
Florence Pazzottu (texte), Hugues Breton (encres), Le joueur de flûte, éditions Lanskine, 2022, np, 13 €. Cette recension a été publié par Sitaudis le 26 juillet 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence pazzottu, le joueur de flûte : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2022
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette
(Point of view)
Devant la rambarde bleue rouillée de la plage de galets, ils observent les cars de touristes. Un groupe de vieilles dames entre dans un snack éclairé au néon jaune vif. Sur les tables de formica bleu canard sont posés ketchup rouge sang et moutarde kaki. Face aux vagues, cette assemblée argentée boit sagement son thé.
Ils arrivent à deux heures chez leurs amis. La maison est silencieuse. Baby Phoche dort. Ils s’assoient devant le feu de cheminée. La jeune fille saigne du nez plusieurs fois.
Comme la pluie sur l’autoroute ce fluide imprévisible ramène le garçon à son impuissance devant les phénomènes naturels.
Les corons pourpres stagnent dans l’évier.
Elle a taché le sol de la salle de bains.
Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie/Flammarion, 1997, p. 83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, plage, sang | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2022
Sandra Moussempès, Cassandre à bout portant
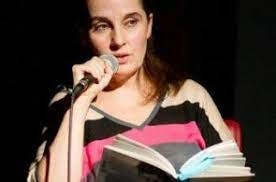
Aujourd’hui je suis contente de moi
Buvant une tasse de thé vert
Lisant des poèmes coréens bien traduits
Contrariée par d’autres choses réduites en cendres
La contrariété fait partie du réel m’avait-on dit
J’ai vu pire que la contrariété
Les os d’un revenant dans un bol de nouilles
Le tr(ou noir qui traîne sur le sol
M’envahit comme une tristesse passagère
La liste des arbres est déjà devenue un défilé de mode
« You are so great ! » au milieu de la forêt la mondanité
prend le pas sur la pulsation
La mariée finale en robe de dentelle
Est une nonne qui entre en scène et cache le trou dans sa traîne
Sandra Moussempès, Cassandre à bout portant, Flamarion/poésie, 2021,
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, cassandrev à bout portant, contrariété | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2022
Cédric Demangeot, Promenade et guerre

d’un retournement du mauvais sort
occidental une peau
de vache écrite
endormie depuis trois millénaires
est aujourd’hui
prise d’un spasme organique qui la
déchire
Cédric Demangeot, Promenade et guerre,
Poésie/Flammarion, 2021, p. 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, promenade et guerre, vache, sort | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2022
Paul Klee, Paroles sans raison : recension
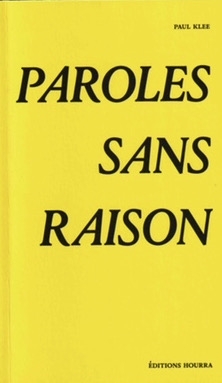
Dans sa jeunesse, Paul Klee (1879-1940) jouait sans cesse Bach au violon et se demandait s’il ne devait pas consacrer sa vie à la musique ; il écrivait aussi des poèmes de contenus variés, dont des quatrains érotiques. On suit dans son Journal* son désir de s’engager dans diverses voies et il s’établissait un programme au printemps 1901 (p. 50) :
au premier chef, l’art de la vie, puis, en tant que profession idéale : l’art poétique et la philosophie ; en tant que profession réaliste : l’art plastique et, à défaut d’une rente : l’art du dessin (illustration).
Comme le rappelle Pierre Alferi, c’est au cours de son voyage en Tunisie (avec August Macke et Louis Moilliet) qu’il a décidé d’être peintre ; il écrivait le 16 avril 1914 après un voyage à Kairouan, « La couleur me possède. (...) Voilà le sens du moment heureux : la couleur et moi sommes un. Je suis peintre. » (p. 282)
C’est avec le regard du peintre qu’il écrit « Voir c’est le savoir », mais la lecture des récits de rêve découvre un Paul Klee proche de Desnos ou de Leiris. Certaines images de son monde onirique, bien éloignées de la vie diurne (un banc de roses, un sorcier), empruntent cependant en partie à la réalité : la fille du sorcier qu’il regarde ferme les rideaux, mais l’observe par une fente ; ces images d’une relation à peine esquissée sont commentées dans la seconde partie du poème par Klee, pour qui on rêve à partir de « ce qui nous a un instant désarmés ». Dans un autre rêve de la même année (1906), s’effectue un mouvement du corps désorganisé vers une origine où se trouverait « Madame l’Archicellule », symbolisant la fertilité ; en même temps, son activité de peintre est évoquée et heureusement reconnue, avec la mention d’une « délégation (...) / pour rendre grâce à son travail ». Rêve encore, cette fois de l’absence de tout espace, de tout corps (« ma nudité volée »), de tout signe qui évoquerait une existence (« effacée, l’épitaphe ») — vision frappante de la disparition, du néant.
La mort, la violence sont présentes autrement, exprimées de manière lapidaire : « Animal humain / heure de sang ». Dans les poèmes retenus apparaît aussi le motif de la claustrophobie, avec l’enfermement dans un lieu clos (« grand danger / pas d’issue ») et, pour en sortir, le plongeon par une fenêtre, mais l’image de la liberté retrouvée (« Libre je vole ») est mise en défaut : la chute sans fin figurée par la répétition : « Mais la pluie fine, / la pluie fine, / la pluie / tombe, / tombe... / tombe... ». Enfermement encore avec le retour de l’enfouissement, lié au monde des morts ou au passage du temps avec l’image classique du « ver qui ronge ». La préoccupation de l’au-delà est aussi mise en scène ironiquement dans une fable où un loup dévore un homme et tire une conclusion de son acte : l’homme peut être le dieu des chiens si le loup peut le manger, et la question demeure, « Où donc est leur [=des hommes] Dieu ? ».
La diversité des poèmes permet de lire d’autres aspects de l’écriture de Paul Klee qu’Alferi rattache notamment à Christian Morgenstern (1871-1914) pour la bouffonnerie, par exemple dans "Parole sans raison" avec des propositions comme « 1. Une bonne pêche est un grand réconfort », « 7. Douze poissons, / douze meurtres ». Ce qui apparaît souvent, ce sont les jeux avec les mots : adjectif qui change de sens selon sa position (« des gens petits / pas de petites gens »), verbe accompagné ou non de la négation : « lui qui sait qu’il ne sait pas / à l’égard de ceux qui ne savent pas / qu’ils ne savent pas / et de ceux qui savent qu’ils savent ». Un poème de quatre courtes strophes est construit avec cinq mots, deux adjectifs de sens opposés, "grand" et "petit", accompagnés de "calme", "forme" et "mobile, mobilité" qui s’achève par le retour du peintre, « calme petite forme s’appelle "peinture" ». Des vers à propos des états de la lune selon le lieu rappellent Max Jacob avec des vers comme : « que le cactus ne la crève pas ! ». Paul Klee avait aussi l’art de la pirouette, un portrait de chat qui saisit ses qualités sensorielles bien différentes des nôtres — « l’oreille cuiller à sons / la patte prête au bond [etc.] » — s’achève par un trait qui le sépare des humains : il « n’a, au fond, rien à faire de nous »
À la suite des poèmes, après une photographie de Paul Klee, sont excellemment reproduits onze tableaux et dessins, tous légendés, le plus ancien de 1915, le plus récent de 1940. Pierre Alferi retrace à grands traits dans sa postface le parcours de Paul Klee, qui continue d’écrire jusqu’à sa mort, en prose et en vers. Traducteur également de John Donne et d’Ezra Pound, il restitue le caractère singulier de l’écriture du peintre ; il propose un choix de traductions en suivant l’ordre chronologique, retenant des textes écrits de 1901 à 1939. L’ensemble des poèmes de Paul Klee est aujourd’hui traduit dans plusieurs langues, pas en français... : espérons que ce premier ensemble de 21 poèmes, publié par les éditions Hourra installées en Corrèze, décidera un autre éditeur d’entreprendre la publication de la totalité.
Paul Klee, Paroles sans raison, Choix, traduction et postface Pierre Alferi, reproduction de onze tableaux, éditions Hourra, 2022, 48 p., 15 €. Cette recension a té publiée par Sitaudis le 22 août 2022.
* Paul Klee, Journal, traduction Pierre Klossowski, Grasset, 1959 ; le Journal est maintenant disponible en poche dans la collection "Les Cahiers rouges" chez le même éditeur.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, paroles sans raison, pierre alferi, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
17/09/2022
Jude Stéfan, Épodes
d c d
comme eut écrit M. Crozatier †
dans son poème 1 2 3 4 5 6
au Refuge 2 rue de la Charité
comme à l’hôpital d’Arthur (la
Conception !)
Ils sont morts à toutes dates
un 14/4/30
le « possesseur du mondez » se tue d’une balle
donc par début de printemps
comme un 14/4/40
naissait l’épouse perdue et comme
par glaciale nuit
le vingt-six janvier dix-huit cent cinquante-cinq
se pendit Gérard
le vingt-sept janvier dix-huit cent trente-sept
dans la neige gisait le duelliste moscovite
mortels mannequins nous sommes moins durables
que Noms et Dates
Jude Stéfan, Épodes, Gallimard, 1999, p. 16.
Stéfan à Cerisy, 2012, photo T. H.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |






