29/11/2015
James Sacré, Dans l'œil de l'oubli, suivi de Rougigogne

J’ai bien conscience souvent que j’écris en mêlant les temps verbaux comme si je voulais mettre ensemble dans un temps présent aussi bien le passé que ce qui ressemble à du futur quand on se prend à rêver, à dire les mots « demain », « plus tard » : le désir d’un présent qui serait aussi bien l’infini que l’éternité dans le plus fugitif arrêt du temps qu’on s’imagine pouvoir vivre. Ce présent, qui ne peut exister pour nous qui n’en finissons pas de vieillir, n’est-il pas la pupille de cet œil de l’oubli dans laquelle je n’ai jamais rien vu pour la bonne raison que n’existant sans doute pas je ne peux que penser ce présent comme une tache aveugle de mon existence, un trou noir dans lequel toute celle-ci s’engouffre lentement jusqu’à la mort.
James Sacré, Dans l’œil de l’oubli suivi de Rougigogne, Obsidiane, 2015, p. 16-17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, dans l’œil de l’oubli, présent, passé, écriture, temps, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
12/07/2015
Claude Chambard, Cet être devant soi
Enfant quand ai-je jamais fait mon ultime pas d’enfant... ma belle écriture pleine & déliée... ma gracieuse silhouette dans le jardin en fleurs... la vraie lumière sur mes joues rondes & roses... quand ai-je cessé de cracher les noyaux de cerise au pied de l’arbre... quand ai-je osé regarder une fille dans les yeux... quand ai-je perdu mes boucles blondes... quand... L’écriture a pris le dessus mais n’a jamais pu remplacer les jouets de l’enfance, le motif dans le tapis scruté pendant des heures, tissé & retissé jusqu’à l’usure du regard. De la neige, du givre, voilà ce qui a tenté de recouvrir l’enfance, en vain, je sais produire un feu interminable & puissant. Dans la grange je me balance sans fin. Le chat se faufile entre la forge & l’établi, m’ignore. J’ai cueilli les petits pois ce matin avec Grandpère, silencieux nous les écossons, dimanche nous les dégusterons avec une viande blanche. C’est là, ce jour-là sans doute, que j’ai compris que pour écrire il fallait soutenir l’autre, le regarder, l’empêcher de tomber. L’autre, cet être devant soi.
Claude Chambard, Cet être devant soi, encres de Anne-Flore Labrunie, Æncrages & C°, 2012, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, cet être deavnt soi, enfance, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2015
James Sacré, Dans l'œil de l'oubli, suivi de Rougigogne

Cahiers guenille
Il y a ces premiers cahiers, quatre ou cinq, que sans doute je détruirai. Parce qu’ils sont la trace d’une sorte de crise informe ; celle d’une affectivité qui sait mal reconnaître ce qu’elle découvre en son corps, qui veut s’en défaire (ou en sublimer le poids) tout en l’affirmant de façon désespérée, plutôt que de l’accepter dans un solide contentement d’être. Celle aussi d’un désir de penser sans s’en donner les moyens de le faire par des lectures autour desquelles il aurait fallu réfléchir, en écrivant vraiment au lieu de jeter sur ces cahiers des cris, des gestes de mots, comme de quelqu’un qui se serait noyé dans son vide incohérent.
Et me voilà parlant de ces cahiers, alors qu’en plus de les détruire je pourrais (je devrais peut-être) n’en rien dire ; si j’en parle maintenant n’est-ce pas que je leur accorde quelque importance persuadé que je suis que c’est là aussi que naît de leur magma brassé et rebrassé de façon répétitive durant quelques années, ce que sera une pratique longtemps continue du poèmes ? Pourtant quand je relis ces cahiers je n’y vois rien qui pourrait expliquer le désir d’écrire. D’ailleurs des poèmes (désespérément mièvres c’est vrai, mais beaucoup plus écrits que les pages de ces cahiers) j’en écrivais depuis bien avant ces années de quasi-ridicule crise d’adolescence.
James Sacré, Dans l’œil de l’oubli, suivi de Rougigogne, Obsidiane, 2015, p. 26.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, dans l'œil de l'oubli, suivi de rougigogne, cahier guenille, écriture, adolescence | ![]() Facebook |
Facebook |
31/05/2015
Henri Thomas, La joie de cette vie
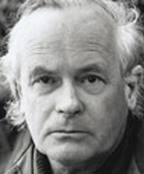
C’est une occupation de voir les nuages courir au vent, se déformer, diminuer, s’élever, s’étaler, disparaître furtivement, changer de lumière et d’ombres. Les nuages ne s’amassent pas dans le ciel à ma demande, mais presque.
Je n’ai pas vécu ce que j’écris maintenant ; je le vis, je le découvre, en l’écrivant — sur le mode de l’écriture, comme on dit en croyant par cette formule expliquer quelque chose.
C’est tellement étrange d’exister autrement qu’une plante ou un caillou, qu’il faudra peut-être s’excuser de mourir. Je suis là à six heures du matin, éveillé depuis quatre, le cœur battant, dans l’attente du jour qui sera sans doute encore obscur. Je n’ai, pour répondre de moi, que mes livres, que j’ai oubliés, après m’y être absorbé, peut-être résorbé. Ils sont pareils en cela aux amours, dont on n’a plus que le titre : un nom, un prénom, une couleur dominante ; le reste a disparu, comme l’herbe des champs, comme les lignes écrites il y a six mois ou dix ans.
Nous vivons sur (si l’on pense à la terre) ou sous (si c’est au ciel) d’anciennes terreurs, et c’est la même terreur. La chose et le mot viennent de terre ?
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 28, 30, 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, nuage, écriture, réalité, vivre, amours passées, terreur | ![]() Facebook |
Facebook |
17/02/2015
Christian Prigent, Entretien sur Arno Schmidt

Arno Schmidt
– À vos yeux, la littérature française offre-t-elle des œuvres qui font au français ce qu'Arno Schmidt fit à l'allemand ?
Ch. P.
— Il me semble que dans la littérature française du siècle dernier, les écrivains qui ont « fait » quelque chose à la langue œuvraient plutôt dans le genre poésie et les « grandes irrégularités de langage » initiées par la « révolution poétique » des années 70 du siècle précédent (Lautréamont, Mallarmé, Rimbaud, Jarry...). Même si, souvent, ce fut pour mettre en cause (voire pour récuser) l’idéologie poétique elle-même (Artaud, Bataille, Ponge, Denis Roche...). Ou pour détourner l’outillage poétique (rythmique, ritournelle, écholalie, polyphonie..) et le faire travailler dans la prose narrative (Beckett, Guyotat) ou le drame (Novarina). Côté roman, au sens à peu près strict du label, je ne vois vraiment rien qui ait eu la rigueur refondatrice qui anime le réalisme analytique de la prose schmidtienne (trouver, comme il le dit lui-même, « une structure de prose plus conforme aux modes de l’expérience humaine », faire de l’écriture un acte de « description et d’éclaircissement du monde par le mot »).
Bien sûr Proust (mais la langue de Proust, en gros, est classique). Bien sûr Céline (mais le « métro émotif » relève d’un lyrisme qui n’a rien à voir avec le raide grincement sablonneux de la prose de Schmidt). Dans les années Schmidt (vers 1952/1960, donc), la prose française moderne, c’est le « nouveau roman ». Rien, à mon sens, qui y soit au niveau de l’exigence méthodique et de l’inventivité stylistique qu’on apprécie chez Arno Schmidt.
X :
– Robbe-Grillet ?
Ch. P.
– Je l'ai à peine lu, et fort tard (trop tard pour que cette lecture ait compté). Autour de moi, dans les années 1970/1980, cette œuvre ne jouait aucun rôle. J'en avais pris connaissance surtout à cause de sa polémique contre Francis Ponge (qui était pour moi un modèle théorique et pratique), dans Pour un nouveau roman. Plus tard (1989), j'ai passé quelques très charmantes heures avec Robbe-Grillet, à Berlin. C'était gai, fort peu « littéraire ». J'aimais sa causticité provocante et sa façon de distiller distraitement des vacheries. Ça ne m'a pas fait aimer beaucoup plus ses livres (surtout ceux qu'il publiait à l'époque).
J'ai davantage lu Claude Simon. Et dit dans Ceux qui merdRent (1993) ce que j'avais à en dire.
X
– Voyez-vous quand même quelques auteurs qu'on pourrait, sans brader l'épithète, qualifier de « schmidtiens » ?
Ch. P.
– Vraiment, je doute que Schmidt ait été beaucoup lu par les écrivains français. Et je ne crois pas qu’il ait eu une influence. Sur les textes de ceux qui écrivent aujourd’hui un peu différemment de ce qu’attend la commande médiatique et marchande, on voit assez bien les marques (souvent délavées) de Beckett et de Duras ; le souvenir aussi de Gertrude Stein, de Thomas Bernhard. Mais Arno Schmidt... Non, vraiment. Peut-être faudrait-il aller voir du côté de ce prosateur extraordinaire qu'est Onuma Nemon (qui a lu Schmidt). Le seul, à ma connaissance, qui serait effectivement « schmidtien » (mais je ne sais pas s'il a lu Arno Schmidt), c’est le très remarquable Hubert Lucot – dont la prose narrative poursuit effectivement un effort semblable d’élucidation de l’expérience (le souvenir) et d’invention de formes (lexicales, syntaxiques, typographiques...) adéquates à cet effort. Mais Lucot est plus... français: plus stylistiquement maniériste, plus psychologique, plus obsédé par le nombril autobiographique, et (aujourd’hui, en tous cas) plus politiquement déclaratif.1Ou: «formes de prose exactement adaptées aux différents mécanismes de la conscience et modes d’expérience » (in Calculs, 1, 1955)
.
X
– Qu'est-ce, selon vous, qu'une influence littéraire, et comment définiriez-vous celle qu'Arno Schmidt a pu exercer sur vous ?
Ch. P.
– Une influence littéraire s’exerce dans le temps de formation d’un mode d’expression propre. Une œuvre propose soudain, de l’expérience (du « réel »), des modes de symbolisation qui viennent, comme dit Rimbaud, « affiner » votre « optique », outiller votre vision et formaliser l’expérience d’une façon qui paraît. Alors on s’applique à comprendre ses procédures, à apprendre ses façons et à user de ses outils. Mais bientôt, voici que ces formes de représentation-là deviennent à leur tour impertinentes, inadéquates – et qu’elles sont perçues comme un nouvel écran entre le monde et vous. Il faut donc leur donner congé, pour traverser autre chose. Ce pourquoi l’amour des Maîtres est toujours un amour ambivalent : il faut tuer les Maîtres, aussi – pour trouver sa voix. J’ai connu cela avec Rimbaud et les poètes surréalistes (dans les années 1960), puis avec Ponge (années 1970), puis avec Denis Roche (idem). Rien ni personne depuis. Arno Schmidt est entré bien trop tard dans ma bibliothèque pour avoir eu sur moi la moindre « influence ». Je ne l’ai lu pour la première fois que vers 1992, alerté par Pascale Casanova, schmidtienne enthousiaste, qui trouvait quelque rapport entre les écrits de Schmidt et ce que je venais de publier côté fiction (Commencement, 1989) et côté théorie (Ceux qui merdRent, 1991). C’était trop tard pour intégrer cette marque nouvelle : les questions qui me travaillaient, les formes dont j’avais besoin pour traiter ces questions, c’était déjà en place. Mais ce que je lisais dans Calculs, par exemple, me semblait effectivement très proche des préoccupations stylistiques qui étaient les miennes dans mes livres de prose.
X
– Quelle est votre pratique de ses textes ? (sauts et gambades ? linéaire ? plusieurs livres simultanés ?)
Ch. P.
– Encore une fois : découverte très tardive, pratique très sporadique, connaissance très lacunaire. J’ai été enthousiasmé par quelques textes, comme le Paysage lacustre avec Pocahontas. Et été, comme j’ai dit, très intéressé par les écrits théoriques (Calculs). Mais je n’ai rien creusé, ni complété (je le regrette bien, croyez-le). Sans doute parce que trop pris, dans les années où cela aurait été utile et possible (entre 1992 et aujourd’hui), par le travail sur mes propres livres, d’une part ; et, d’autre part, par mon attention à ce qui apparaissait d’un peu neuf en France dans le domaine poétique.
13 septembre 2009, inédit (Pour un volume collectif sur l'œuvre d'Arno Schmidt).
Christian Prigent, dans SILO, sur le site des éditions P. O. L
Les œuvres d'Arno Schmidt (1914-1979) ont été traduites en français chez Christian Bourgois et aux éditions Tristram.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ENTRETIENS, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, entretien sur arno schmidt, roman, écriture, influence | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2014
Christian Prigent, La langue et ses monstres : recension

Il est réconfortant de constater que la littérature, la poésie suscitent toujours des études théoriques de la part des poètes (et non des moindres) : Nathalie Quintane (Les années 10, La Fabrique), bientôt, Philippe Beck (Contre un Boileau, un art poétique, Fayard, en janvier 2015)(1), et Christian Prigent ; c'est dire que la nécessité de la théorisation est bien vivante ! La nouvelle édition de La Langue et ses monstres poursuit un travail de lecture et de réflexion ancien ; sorti en 1989, le livre réunissait 11 essais écrits entre 1975 et 1991, 8 s'ajoutent aujourd'hui consacrés à des "monstres" vivants (Éric Clémens, Bernard Noël, Jude Stéfan) ou non (Artaud, Jouve, Pasolini, Ponge, Tarkos). Parallèlement aux livres de poésie et de fiction, Prigent a régulièrement publié des essais sur des poètes (par exemple, Denis Roche, en 1975) et sur des peintres, et l'on peut aussi lire de nombreux textes théoriques, réunis sous le titre silo, sur le site des éditions P.O.L.
La langue et ses monstres, ce sont des travaux pratiques qui prennent pour objet une œuvre, un recueil ou, plus rarement, un poème : points de départ pour analyser comment tel poète travaille la langue — et la singularité de ce travail fait de chacun de ces poètes un "monstre". Le livre s'ouvre sur un avertissement qui donne un mode d'emploi : la lecture à partir de ses « préoccupations d'écrivain » a conduit Prigent à des questions qui s'enchaînent ; la première devrait être au centre de toute lecture, « de quoi parlent ces œuvres qui nous mènent « au bord de limites où toute compréhension se décompose ? » [Bataille] » (9), et il s'agit par le « déchiffrement » de leurs intentions de « mieux évaluer ce dont on parle en fait quand on parle de littérature » (9). Tâche nécessaire, hygiénique.
Le livre s'ouvre avec un essai sur Gertrude Stein au titre provocateur, "Nous ne savons pas lire" ; Stein oblige à abandonner ce à quoi le lecteur a été formé, la lecture qui cherche un/le sens et construit vaille que vaille un récit. Le refus d'exprimer quelque chose selon un ordre, quel qu'il soit, ne permet pas au lecteur d'intégrer dans un cadre familier les « infimes mouvements de syntaxe, sans axe, sans progression linéaire » (19) qui sont un des caractères de l'écriture de Stein — les repères sont mêlés, après une digression le propos principal est oublié, les répétitions abondent, etc. Comme l'écrit Stein, « Ce qui est intéressant, c'est quand il ne se passe rien. » (cité p. 29) La question essentielle de la lecture — de la lisibilité — est à nouveau abordée dans la dernière étude, qui concerne Christophe Tarkos ; lui et d'autres, apparus autour de 1995, « forc[...]ent à réapprendre à lire. » (298) Rien ne semble pourtant gêner la lecture, en déranger les habitudes : une syntaxe simple, un vocabulaire courant. Mais l'évidence des énoncés, sous la forme de descriptions, listes, etc., n'est qu'apparente ; Prigent analyse la manière dont Tarkos « vide la capacité de signifiance des énoncés mobilisés. » (305) ; restent le « mouvement de l'écriture » (302), l'engendrement d'« une matière verbale traitable en tant que telle » (303).
On aurait pu retenir d'autres essais ; ainsi Prigent conclut à propos de Novarina, « La langue qui s'écrit est [...] moins une langue que l'engendrement d'une langue ; c'est une dynamique qui fait sens, non ses produits. » (160-161) C'est toujours la question de la lisibilité de la littérature qui est posée — on ne peut que renvoyer à d'autres réflexions sur ce sujet(2). Mais puisque la lecture, d'une manière ou d'une autre, est freinée, déçue, c'est évidemment la relation de l'écrit aux choses, au réel qui est au centre de ces textes. Lire les "monstres" (et les analyses qui les concernent aident à le faire), c'est comprendre qu'à l'opacité du monde répond une obscurité analogue dans la littérature. Tous les discours qui enveloppent le quotidien de chacun, comme toutes les images qui l'envahissent, construisent une représentation fausse de la réalité. C'est là la grande illusion : la réalité apparaît stable, ordonnée, pleine, faite de blocs signifiants, de lieux communs acceptés quels que soient les sujets abordés. En un mot, lisible.
Cette lisibilité enferme dans des schémas convenus et triomphe, à peu de choses près, dans ce qui est donné dans la société comme littérature — le modèle de la lisibilité étant l'explication de texte à l'école qui réduit la poésie au (néo)lyrisme ou à un formalisme de bon ton (les contraintes oulipiennes). Le refus dans l'écriture de la représentation toujours déjà symbolisée de la vie écarte plus ou moins fortement — voir Rimbaud mythologisé. Que font Stein, Tarkos, Novarina et les autres ? Ils partent du fait que la réalité est un chaos, et qu'il est impossible de restituer, sinon par des effets de réel, quelque chose de l'expérience singulière de la vie ; un livre n'est pas, n'est jamais la vie diverse, bigarrée, plurielle, mélange continu, mouvement incessant : passage.
Rien ne s'écrit qu'on puisse désigner par "poésie", "littérature", qui ne tente pas de mettre à mal l'unicité des représentations dominantes, et pour ce faire il s'agit bien de « trouver une "langue" dans laquelle la tension est le plus méticuleusement possible maintenue entre le désastre du sens et la constitution des représentations sensées. » (267). Cette langue, même maternelle, devient quelque peu étrangère, comme celle de Novarina « au bord de l'idiolecte » (151), de Maïakovski avec sa « violente gutturalisation » (56), d'Artaud avec ses « glossolalies » (198), etc. Pour cela, La Langue et ses monstres est aujourd'hui un de ces livres nécessaires qui analyse clairement en quoi la littérature est toujours politique, c'est-à-dire a à voir avec la vie de la cité.
Christian Prigent, La langue et ses monstres, P. O. L, 2014, 320 p., 21, 90 €.
Recension parue sur Sitaudis le 11 décembre 2014
————————————————
1. Philippe Beck prépare également un autre essai, Qu'est-ce que la poésie ?, à paraître dans la collection Folio de Gallimard.
2. B. Gorrillot, A. Lescart (dir.), L'illisibilité en questions, avec M. Deguy, J-M Gleize, C. Prigent, N. Quintane, Septentrion, 2014.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, la langue et ses monstres, essai, théorie, écriture, réalité, idéologie | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2014
Gertrude Stein, Autobiographie de tout le monde
Gertrude Stein par Picasso, 1906
Mon écriture est aussi limpide que la boue, mais la boue se dépose et les courants d'eau claire filent et disparaissent, peut-être est-ce là la raison mais il n'y a vraiment pas de raison sinon que la terre est ronde et que personne ne connaît les limites de l'univers c'est l'ensemble de ce qui concerne les hommes et les femmes qui est intéressant. Tout le reste c'est la nature humaine et j'ai écrit Alice Toklas dit et elle a toujours raison à tel point que je lui demande souvent si cela ne la fatigue pas que tout compte fait j'ai trop écrit sur ce qu'est la nature humaine.
Donc nous sommes allées à la campagne comme d'habitude avant d'aller en Amérique toutefois nous ne savions pas encore vraiment que nous allions partir en Amérique.
Vous devez continuer à raconter quelque chose bien qu'en ce moment il y ait toujours de moins en moins à dire, c'est-à-dire qu'y a-t-il, la terre est ronde et même les avions sont obligés d'y revenir. Et alors naturellement il y a moins de commencement et de milieu et de fin qu'il y en avait avant et les romans ne sont donc pas très bons à notre époque sauf s'il s'agit de romans policiers où le héros est le mort et de ce fait il ne peut y avoir ni commencement ni milieu ni fin puisqu'il est mort. Ce qui me tracasse dans les romans policiers, c'est qu'ils ne vous disent pas où est passé l'argent. Je suis de plus en plus persuadée que la seule différence entre les hommes et les animaux c'est que les hommes peuvent compter et pas les animaux et s'ils comptent ils comptent surtout de l'argent, et une des choses que j'ai vraiment aimées chez Napoléon c'est son habitude de calculer les dépenses quotidiennes de chacun des personnages des histoires qu'il lisait. Cela m'a toujours considérablement intéressé dans les romans anglais, aujourd'hui eh bien l'argent dans les détails a un peu perdu de sa signification, quoi qu'il en soit vous êtes forcé d'en avoir même si les points de détail sont moins fascinants que jadis dans les vieux romans et c'est vraiment pourquoi les romans ne sont vraiment pas bien écrits aujourd'hui c'est vraiment à cause de cela.
Gertrude Stein, Autobiographie de tout le monde [Everybody's autobiography, 1937], traducteur non indiqué, "Fiction & Cie", Seuil, 1978, p. 123.
z : , série de 4 plaquettes, 9 €
Les revues consacrées à la poésie sont aujourd'hui relativement nombreuses sur la Toile et personne ne s'en plaindra. Leur présence n'a pas, bien heureusement, fait disparaître les revues sur papier, même si beaucoup vivent difficilement, et il faut se réjouir quand un nouveau titre apparaît : le maintien de l'écrit sur un support papier est essentiel pour la transmission de la littérature. Deux ou trois par an, z : propose 4 petites plaquettes insérées dans une enveloppe translucide de petit format (16, 5 x 11, 5), chacune renfermant un poème plus ou moins long ; cette année, au salon de la revue en octobre, z : présentait sa troisième série. La revue a été créée et est animée par trois jeunes poètes, Marie de Quatrebarbes, Maël Guesdon et Stéphane Korvin — ce dernier, également dessinateur, est aussi responsable de la revue aka.
Les titres de la seconde série évoquent des animaux, prétexte dans les quatre textes à des variations sur les mots pour Cécile Mainardi : « je suis la girafe à peine représentée / qui s'encastre le mieux / dans la glace laissée vide par le mot girafe » ("la place de la girafe"), comme pour Martin Richet ("génération de l'animal"), Maël guesdon ("catiches" — Littré : « Trou où se cachent les loutres et les autres amphibies, sur les bords des rivières et des étangs ») et Caroline Sagot-Duvauroux avec un titre programme ("mouches à histoires").
Le lecteur s'apercevra que les animaux ne sont pas absents de la troisième série, liés à la liberté du sauvage (la wilderness de l'anglais) chez Fabienne Raphoz ("mal au dos"), rattachés notamment à l'opéra, au mythe d'Actéon et aux dessins de Magali Lambert pour Arno Bertina ("bigger than life"), provoquant la mise en mouvement d'énumérations pour Anne Kawala ("fly"), suscitant pour Stéphane Bouquet une errance d'une pinède à un parking « où les camping-cars sont en vacances / les enfants jouent entre les voitures [et] les chiens attachés ».
Comme beaucoup de revues, z : n'est pas très visible, trop peu de librairies accueillant les livres de poésie et les revues. On peut commander une ou plusieurs séries directement : zdeuxpoints@gmail.com,ou les acheter dans quelques librairies, à Paris (librairie Texture, librairie Corti) et à Nantes (librairie Vent d'ouest) et, par ailleurs, on se réjouira de consulter le site de la revue : http://zdeuxpoints.tumblr.com/
Note publiée sur Sitaudis le 23 novembre 2014
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gertrude stein, autobiographie de tout le monde, écriture, terre, univers, amérique, roman policier | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2014
Andrea Zanzotto, Idiome, traduction Philippe Di Meo
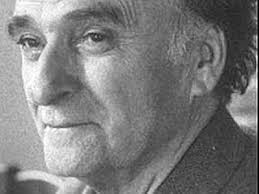
Petits métiers
Comment puis-je oser
vous appeler ici, vous faire signe de la main.
Une main qui n'est plus que son ombre
avare et mesquine
et d'ailleurs une serre, mais tendre comme de la mie de pain.
Et pourtant, quelque chose maintenant la soutient,
e ne sais s'il s'agit d'une crampe ou d'une force ;
pour autant qu'elle vaille elle est toute vôtre,
et vous donnez-lui la force de vous appeler.
Donnez-lui une plume qui ne se torde,
faites que sa pointe ne trébuche sur la feuille.
Il me semble n'avoir rien à écrire
pour commencer ce télex
qui doit tout le néant traverser
(la brûlante difficulté qui brule comme soufre,
qui corrode, étourdit. )
Mais j'essaierai de suivre la trace, au moins, d'un amour —
en dehors, là dans l'obscurit&
profonde des prés du passé.
Ainsi
............................................................
[...]
Mistieròi
Come elo che posse 'ver corajo
de ciomarve qua, de farve segno co la man.
No man che no l'é pi de la só ombria
cagnina e caía.
anzhi 'na sgrifa, ma tèndra 'fa molena.
Epuro ades calcossa la tien sú.
no so se 'n sgranf o se 'na forzha ;
par quel che l'é, la é tuta vostra,
e voi dèghe l'polso par ciamarve.
Dèghe 'na pena che no la sa schinche,
fè che la ponta sul sfój no la se inciónpe.
Me par de no 'ver gnent da méter-dó
par scuminzhiar 'sto telex
che tut al gnent bisogna che 'l traverse
(tut al gran seramént
che 'l brusa come solfer
che l'incaróla e l'intrunis).
Ma proarò la trazha, almanco, de 'n amor —
fora par là inte 'l scur
orbo dei pra del passà.
Cussì
..................................................
[...]
Andrea Zanzotto, Idiome, traduit et présenté par Philippe Di Meo, Corti, 2006, p. 145-147 et 144-146.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idiome, traduit et présenté par philippe di meo, petits métiers, main, écriture, force | ![]() Facebook |
Facebook |
30/09/2014
Édith Azam, Jean-Christophe Bellevaux, Bel échec, images d'Elice Meng
L'écriture à quatre mains est possible sans une grande complicité de la part des auteurs : ils peuvent choisir de suivre une contrainte forte et c'est ce qui a été retenu pour l'écriture des vingt poèmes de Bel échec. L'un propose un texte, l'autre s'y introduit et ajoute des vers ; le premier intervient et transforme, ou non, son texte de départ, et ainsi de suite jusqu'à accord sur l'ensemble. L'attribution à chacun est aisée, l'un a barré ses vers et l'on reconnaîtra, par son usage personnel des deux points, qu'il s'agit d'Édith Azam. Jean-Christophe Bellevaux, de son côté, introduit dans ses vers des allusions diverses, littéraires (« l'éternité retrouvée », « ah que le temps vienne », « mon enfant ma sœur », « Poèmes bleus »), picturales (« l'Origine du monde »), à des chansons (« the show must go », chanson de Queen), etc., et use d'un vocabulaire propre à l'oral (par exemple, « un max », « on est cool »), deux pratiques étrangères, sauf erreur, à Édith Azam.
Les interventions touchent toujours d'abord le début des poèmes, puis n'importe quel endroit ; dans un seul cas, l'ajout d'Édith Azam ouvre un poème (le onzième) et prolonge ainsi le précédent :
Et puis qu'avons-nous fait ?
le vin la fatigue les cigarettes
sont des données objectives
qu'aurions-nous dû mieux faire ?
Le plus souvent, l'insertion dans le poème se fait après les premiers vers, puis dans le corps du poème, un mot ou un fragment étant repris ou glosé ; dans le premier poèmes, « feu » et « as-tu vu s'envoler [...] » entraînent « as-tu vu dans la nuit [...] », puis « brûlait » ; dans le poème 9, le vers « tout va, la pluie, l'absence, tout va bien » est prolongé par :
« tout va bien
tout s'en va
tout est perdu ;
très bien...
mais que l'échec au moins
on le tente au plus juste
oui
que l'échec humain soit :
notre plus bel échec. »
On peut se demander si, dans l'esprit d'Édith Azam, le fait de barrer ses vers n'était pas seulement une façon de les distinguer de ceux de Jean-Christophe Bellevaux, mais aussi une volonté de marquer une distance, un trouble vis-à-vis de son écriture. Ce qui est certain, c'est que le motif de l'échec parcourt l'ensemble du recueil.
Il y a d'abord l'idée d'ignorance des choses, le fait que l'on ne parvient pas à donner un sens à la vie que l'on mène, que la vie n'est que défaite puisque conduisant à la mort sans même qu'on puisse s'arrêter quelques instants et revivre par le souvenir des moments heureux : on perd tout, la mémoire s'enfuit et l'on ne peut qu'à peine revoir des « débris d'enfance / le vieux singe en peluche », toute continuité impossible. Abondent dans le texte les rêves de faire autre chose, d'être un autre, à travers des formulations comme "j'aurais voulu", "j'aimerais", "ce serait si beau", ou dans le vœu rimbaldien du nouveau, en partant « loin », dans un ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de définir, en inventant aussi des langages neufs pour dire les jours autrement. Mais rien ne semble permettre de sortir de l'enlisement qu'est la vie, et quelles que soient les solutions imaginées, les évasions tentées par l'alcool ou le cannabis, s'impose le vide dans une vie jugée « sans importance » — "vide" est un mot récurrent dans Bel échec. Rien ne peut combler le vide, pas même les questions que l'on se pose : elles ne peuvent être que répétées sans trouver de réponse, ainsi « Qui suis-je ? ». La tentation serait d'apprécier « le néant de la béatitude », la « douceur délicieuse du vide », mais comment sortir de ces oxymores ?
La langue n'est pas épargnée qui, elle aussi, « sombre [...] dans le vide », les mots seraient « indigents » et, dans un mouvement de rejet, l'un est prêt à tout abandonner : « foutez-moi le bagage des mots à la mer ». Mais cependant, seules les « singeries » qu'ils représentent donnent le moyen de surmonter la peur de vivre, la peur de la mort, et ce n'est pas un hasard si Jean-Christophe Bellevaux cite dans ses vers, sans guillemets, des fragments de littérature, si parallèlement Édith Azam continue d'écrire « afin de s'écarter / au mieux / de la vie trop étroite ».

On comprend ainsi le sens du titre Bel échec. S'il y a perte, si l'oubli dévore tout, si le quotidien n'est d'abord que heurts et larmes — « c'est gris je dois dire / pas même pastel ou aquarelle / juste gris ça fait pas envie » — il n'empêche qu'il faut toujours rester debout, durer, et se servir pour cela de « la ragouillasse de mots », et écrire puisque « nous ne pouvons pas mieux ».
Édith Azam, Jean-Christophe Bellevaux, Bel échec, images d'Elice Meng, Dernier Télégramme, 2014, 48 p., 10 €.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, jean-christophe bellevaux, bel échec, images d'elice meng, vide, néant, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2014
Matthieu Gosztola, Lettres-Poèmes, correspondance avec Gaudi : recension

On remontera volontiers aux Héroïdes d'Ovide pour débuter la tradition des lettres d'amour adressées à un amant ou une maîtresse fictifs, et l'on sait qu'elles eurent de très nombreuses imitations, notamment à la Renaissance. Les Lettres-Poèmes publiés maintenant auraient été écrits par une jeune femme à Antoni Gaudi, le premier envoi daté du 2 mars 1924, suivi de 17 autres, le dernier du 27 avril 1927, donc après la mort de l'architecte catalan, le 10 juin 1926 à l'âge de 74 ans ; suivent deux fragments d'un journal poème écrit en 2000. Matthieu Gosztola aurait hérité d'un oncle une vieille maison en Espagne et l'un de ses premiers soins aurait été de visiter le grenier : il aurait trouvé, évidemment à l'écart, une malle contenant des lettres et, choisissant ce qui débordait l'intime, les aurait traduites. Traduction est toujours trahison : on reconnaît son écriture dans les poèmes en vers libres d'Antonia Maria Arellano, par ailleurs pianiste. Il n'a pas trouvé trace de cette mystérieuse épistolière qui aurait vécu plus que centenaire : on comprendra que, fictive, elle est prétexte pour son inventeur de reprendre des motifs qui lui sont familiers.
La relation à Gaudi, donc à l'architecture, est donnée d'emblée dans la première lettre : un "on" projette l'utopie de maisons ventres qui ressemblent singulièrement au ventre maternel : elles protègeraient « du danger que / représente / l'imprévisible avec lequel le dehors se confond », et leurs chambres, lieux clos, y seraient avant tout le lieu de l'intime, de l'amant et de l'amante. Affirmation lyrique par le biais d'un indéfini auquel, dès la seconde lettre, se substitue un "je". La fictive Antonia s'enthousiasme pour l'art de Gaudi, à la fois écriture de et dans l'espace, danse des éléments, musique, restitution d'une émotion qui transforme la vision du réel.
Histoire d'une rencontre rêvée entre Antonia et Antoni ? une lettre très courte annonce un rendez-vous, la suivante datée du surlendemain la rappelle, avec l'espoir d'une fusion, évoquée dans une autre lettre, « j'existe avec toi /et seulement / avec toi qui / m'existes / en t'exis- / tant », fusion qui donne lieu à des variations sur les deux prénoms, sur le corps des amants, « non pas mêlés, mais / réunis », et qui inscrit ces « passagers de l'évidence » dans une histoire de l'amour.
Mais la rencontre n'aurait pas eu de lendemain, ce qui n'empêche pas la jeune femme d'écrire : manière de journal au toujours absent, à qui elle s'adresse avec le "vous", puis le "tu". Vient sous sa plume le nom d'Orlando, allusion à l'histoire d'amour de l'Orlando furioso de l'Arioste, nom venu du rêve et lié à l'écriture. Le poème serait assemblage de ce qui est dispersé pour devenir harmonie, « fait de pièces de céramiques cassées, le / poème-trencadis »(1), non pas puzzle à reconstituer mais composition qui demeure toujours inattendue. C'est ce que dit autrement une lettre : dans un groupe qui parle, chaque voix est distincte mais leur ensemble forme « une unité / qui à aucun moment les fait / mourir en tant qu'individualités » ; ou le poème est à l'image de la mer dont on imagine saisir quelque chose en collant un coquillage à l'oreille, et l'on ne fait que saisir ce qui interrompt le silence.
Les premières pages du journal d'Antonia n'abandonnent pas Gaudi, toujours présent, « dans l'ignorance superbe de la mort ». Elle évoque un voyage en Inde, « tourbillon », un autre à Venise, « mirage », qui ne sont rien puisqu'ils ne permettent pas d'« être en lieu, comme l'on dit / être en vie », ce que lui apporte les créations de l'architecte. C'est par le dernier fragment du journal que le lecteur est certain du caractère fictionnel d'Antonia : âgée alors de 103 ans, elle lit Fleischer et reçoit des mails de Jean-Paul Michel, poète auquel la revue NU(e) vient de consacrer un numéro préparé par Gosztola..., et c'est par deux citations, dont l'une étendue de Michel que s'achèvent les lettres poèmes.
À partir du personnage d'Antonia, se mêlent l'hommage à un architecte, des variations sur l'écriture et la musique, une vision du couple — « Nous sommes deux, mais le même élan », écrit-elle à Gaudi —, les motifs du rêve et de l'enfance. Matthieu Gosztola continue aussi son approche singulière de la création, écrivant sa lecture d'une œuvre par la poésie comme il l'a fait dans des entretiens — imaginés — avec Lucian Freud en 2013.
—————————————————————————————
1. trencadis : littéralement "pique-assiette", technique de constitution de mosaïque (inventée par Gaudi) par récupération de morceaux de céramique, utilisée notamment dans le Parc Güell à Barcelone.
Matthieu Gosztola, Lettres-Poèmes, correspondance avec Gaudi, éditions Abordo, 2014, 108 p., 12 €. Recension parue le 16 juin dans la revue numérique Sitaudis.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : matthieu gosztola, lettres-poèmes, correspondance avec gaudi, journal, rêve, enfance, création, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2014
Bernard Noël, "Qu'est-ce qu'écrire", dans La Place de l'autre, Œuvres III

Écrire aujourd'hui
[...]
L'écriture de recherche [....] ne travaille pas à l'écart d'ici et d'aujourd'hui, pas à l'écart de l'état social dans lequel nous vivons. Au lieu de le contester par le témoignage ou la description, elle l'attaque au niveau de la langue. C'est ce qu'il m'importe maintenant d'essayer d'éclairer.
Une collectivité existe en fonction de la relation qui unit ses membres. Cette relation a deux supports : le lieu et la langue. Traditionnellement, cette langue a pour référence l'ordre qui gère la collectivité, c'est-à-dire l'État. De même que l'État met en circulation la monnaie qui règle es échanges, de même il fait circuler un discours qui, si je puis dire, est l'étalon de la communication par le langage. Cela est encore plus vrai dans les sociétés démocratiques et laïques, nées de la révolution. Symboliquement, d'ailleurs, l'Encyclopédie précède la grande Révolution, car elle est le livre qui, en donnant réponse à tout, donne congé à Dieu. Seulement qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui va toujours s'accélérant dans nos sociétés libérales ? C'est que le discours du pouvoir, non seulement est de plus en plus vide, mais par là même vide le discours collectif de son sens. Alors que la censure nous prive de parole, ce phénomène nous prive de sens, et cette nouvelle Sensure équivaut à un très discret et d'autant plus efficace lavage de cerveau.
L'écriture de recherche s'inscrit contre cette dégradation, d'où l'importance dans son travail du mot "langue", d'où la grande place du souci "linguistique". Évidemment un danger formaliste guette ce travail au niveau de la théorisation, mais ce qui le guette surtout, c'est la récupération sous forme de savoir. On peut s'approprier le savoir, on ne peut pas s'approprier le sens, car il nous conduit vers une limité où lui ne s'arrête pas.
Bernard Noël, "Qu'est-ce qu'écrire", dans La Place de l'autre, Œuvres III, P. O. L, 2014, p. 225.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, "qu'est-ce qu'écrire", dans la place de l'autre, écriture, recherche, État, discours, langue, révolution | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2014
Octavio Paz, Arbre au-dedans
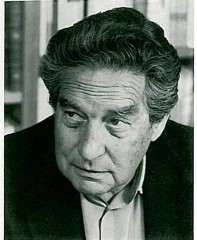
Dix lignes pour Antonio Tàpies
Sur les surfaces urbaines,
les feuilles effeuillées des jours,
sur les murs écorchés, tu traces
des signes charbons, nombres en flammes.
Écriture indélébile de l'incendie,
ses testaments et ses prophéties
désormais devenus splendeurs taciturnes.
Incarnations, désincarnations :
ta peinture est le suaire de Véronique
de ce Christ sans visage qu'est le Temps.
Octavio Paz, Arbre au-dedans, traduction F. Magne
et J-C. Masson, revue par J.-C. Masson, dans
Œuvres, Pléiade, Gallimard, 208, p. 558-559.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, arbre au-dedans, tapies, feuille, mur, signe, écriture, christ, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2014
Jean-Paul Michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012 : recension

Il y a près de quarante ans que le premier livre de poèmes de Jean-Paul Michel a été publié (C'est une grave erreur que d'avoir des ancêtres forbans, 1975). Depuis, une œuvre complexe s'est construite, jalonnée de réflexions à propos de la poésie — pas seulement la sienne —, plus généralement de l'art, et la plus grande partie est réunie dans ce fort volume d'Écrits sur la poésie. Les textes sont d'origine variée : lettres, carnets, "conseils aux jeunes écrivains" (pour suivre une tradition bien établie), entretiens, études, préfaces, mais cette diversité et le passage du temps n'empêchent en rien une quasi permanence de la pensée, aussi bien pour ce que représente la poésie et l'art, la relation au monde que pour la permanence des références et la conduite de l'écriture.
D'entrée de jeu la poésie, l'art sont liés au vécu en ce qu'ils sont saisis comme seuls moyens de vivre « digne » dans le monde, et ce motif de la dignité est repris à différents moments, depuis l'affirmation forte quant au rapport entre poésie et langue (« la poésie est le seul usage digne de la parole », 55 ; souligné par Michel, comme dans les autres citations) jusqu'à, dans les dernières pages, la tâche à nouveau assignée à la poésie « de rendre à chaque chose, à chaque dieu, à chaque homme sa dignité » (283). Dans un hommage à Khaïr-Eddine, Michel définit la grandeur de ce poète par le fait qu'il aurait toujours su « appeler à l'insurrection de la dignité, de la liberté, de la beauté, de l'audace » (230). La dignité — estime, respect de soi-même — est une recherche individuelle, l'activité de création s'éloigne de tout projet de transformation du monde ; peu est dit explicitement à ce sujet, mais sans ambiguïté : il n'est que des « affirmations béates touchant demain » (138), et « la promesse d'une dignité pour tous [...] fut l'abaissement de tous, pas même le salut d'un seul » (137).
Bref, la poésie, l'art doivent « se défendre de la vulgarité du monde »(209), c'est-à-dire échapper au « sérieux du travail et de l'épargne », à tout ce qui rend acceptable l'angoisse de vivre, tout comme ils aident à dépasser les contraintes zoologiques (la faim, la peur, etc.), pour vivre le « sans mesure », le poétique, c'est-à-dire « trahir l'effroi, déployer le cérémonial, entrer dans le sacrifice » (180). On reconnaît là des éléments de la pensée de Bataille, l'un de ceux qui, pour Michel, ont su affronter "l'impossible" et considérer qu'il fallait vivre dans le défi, le dépassement de soi pour, enfin, se « connaître inconnu de soi » (230), pour comprendre que l'on écrit « contre ce que l'on est » (33). Reviennent au fil des réflexions les noms des figures idéales, choisies, de ceux pour qui écrire engageait tout l'être, poètes ou philosophes, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin, Hopkins, Mallarmé, auxquels s'ajoutent dans une liste Héraclite, Socrate, Dante, Shakespeare, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Dostoïevski. C'est la réunion de ceux qui se sont arrachés à la « vie inessentielle » (10), « figures éblouissantes » (94), vrais « saints » (98) dans l'histoire de la pensée.
Le rejet des "valeurs" de la société marchande ou de l'engagement pour des "lendemains qui chantent" n'implique pas le refuge dans une bulle hors de toute atteinte. Les choix peuvent paraître hautains, ils se sont formés par l'expérience des choses et n'excluent évidemment pas une relation sensible au monde, bien au contraire : c'est par le poème, toujours, qu'il est possible de « répondre, par un signe juste, à l'éblouissant éclat de ce qui est » (265). Cette réponse ne peut naître que de la « commotion de l'expérience » (75) : alors est vécu le « feu » — mot récurrent pour exprimer que seule la violence ressentie peut susciter l'écriture. Cet ébranlement aide à prendre conscience de ses manques, de son « insuffisance personnelle » (92), mais aussi à faire face au « grand réel [et à] lui répondre » (149). L'émotion n'est rien si elle n'est pas prise en charge par la langue, pour que soit découverte l'étrangeté de ce qui s'écrit, de nouvelles réécritures ne visant qu'à conserver ce qui « brûle » (221) ; les caractères du premier choc exigent pour être restitués que l'écriture s'apparente à une « bataille » (175), qu'il faut engager son « courage », toutes ses « forces» (id.) pour la mener à bien.
Le poème est juste, la poésie a quelque efficace quand est offert au lecteur avec force, tension, probité, hauteur quelque chose de « l'éclat du scintillant mystère » (163) du monde, quand il perçoit dans les mots « la résistance des choses mêmes » (163). But inatteignable ? sans doute, mais le seul qui vaille qu'on s'y consacre. La réussite serait que les lecteurs, comme celui qui a écrit, se découvrent « à eux-mêmes étrangers » (57) ; c'est dire que pour Michel un livre non seulement doit toucher mais faire mal — un livre publié en 1991 avait pour titre Je lis Hölderlin comme on reçoit des coups —, agir sur le lecteur en l'arrachant au quotidien, déplacer chez lui ce qui était établi : la beauté doit "frapper".
Le pari pour la poésie, l'art, de transformer l'être implique de vivre en « horrible travailleur », selon le mot de Rimbaud, modèle en cela (avec Hölderlin), souvent cité, présent même sur la couverture des Écrits sur la poésie avec un typogramme de Jean Vodaine. Ce travail implique une écriture avec des ciseaux, mieux vaut toujours réduire qu'ajouter, « Écrire, c'est toujours re-lire : corriger, déplacer, espacer, aérer, supprimer, isoler ce qui doit, à la fin, permettre au livre de conserver mieux tel pouvoir propre, tel improbable éclat » (136) ; dans un autre texte, le propos est précisé : « Écrire, c'est relire, corriger, déplacer, interdire, imposer silence, donner forme, jusqu'à ce que le texte tremble de vérité, de passion de la vérité, du désespoir de la vérité » (174).
"Donner forme" : on comprend l'extrême attention portée à la composition et la référence aux collages de Matisse, le rôle donné à la typographie (jeux des polices, de leurs dimensions, opposition du romain et de l'italique, espaces, etc.), éléments qui appartiennent au rythme ; on comprend que Michel soit devenu éditeur pour ne rien laisser de côté dans cette « fête » (57) qu'est pour lui la construction d'un ouvrage : ce n'est qu'à cette condition que le livre peut faire « signe vers un possible "sens"» (157).
Je n'ai fait qu'esquisser ce qui m'a semblé soutenir la réflexion de Michel dans un livre dense, qui — avec bonheur — exige beaucoup du lecteur, traversé d'un bout à l'autre par le désir d'exalter la beauté, ce qui "brûle" : ce qui est. Toujours en se souvenant que la poésie ne vaut qu'à « la condition qu'elle invente sans fin sa forme et sans fin sa fin » (121).
Jean-Paul Michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012, Flammarion, 2013, 320 p. Recension parue dans Europe, avril 2014.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012, art, création, expérience, écriture, feu | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2013
Benoît Casas, L'ordre du jour (recension)

En 2012, Benoît Casas et Luc Bénazet avaient réuni dans Envoi des poèmes échangés par courriel, l'un répondant à l'autre1 ; L'ordre du jour est un livre aussi singulier. Il s'agit d'un journal, tenu scrupuleusement du 1er janvier au 31 décembre, ce qui laisserait le lecteur perplexe (qui a tenu un journal avec cette régularité ?) s'il ne lisait pas la quatrième de couverture : Casas y donne le mode d'emploi : ce journal « imaginaire et synthétique » est construit à partir de fragments tirés de lectures. Recopier une remarque du Journal de Jules Renard du 9 octobre 1893 permet de la réutiliser (en la modifiant un peu) pour la journée du 9 octobre ; la construction littéraire se nourrit également de correspondances variées — les familiers de celle de Flaubert, par exemple, reconnaîtront des passages devenus célèbres (« je dors comme / un caillou / je mange comme / un ogre / et je bois comme / une éponge. ») — de recueils de poèmes ou de réflexions philosophiques, de Michaux ou d'Adorno.
C'est bien toute une bibliothèque qui est traversée dans ce journal écrit en vers libres ; Casas, comme beaucoup de lecteurs, relève ce qui peut susciter sa réflexion, l'inciter à écrire (« lire un paragraphe / de Wittgenstein par jour / pour y méditer et écrire / ou un passage de Benjamin », 241) et ce qui s'accorde avec ses choix. On pourrait, ici et là, repérer une source, parce qu'une formulation éveille un souvenir (Flaubert, ci-dessus), qu'une œuvre citée est un livre de chevet (le Journal de Jules Renard) ou qu'une phrase, par hasard, a été relue récemment (« la poubelle de Babel », dans Rangements de Daniel Oster). Mais c'est là un jeu qui, outre qu'il serait vite décevant, ne conduirait qu'à rassembler une liste de noms, à ajouter à ceux que donne Casas, trace de ses lectures (Marx, Perec, Lorca, Zorn, Proust, Mathiez, Spinoza) et de projets (« démolir / Heidegger »), de ses choix en peinture (Picasso, Fragonard, Goya, Giotto, Rembrandt, Caravage, Bosch) et en musique (Bach, Bartok, Monteverdi, Schumann).
L'essentiel n'est pas dans la reconstruction de listes, ce qui importe est la réflexion que l'on peut engager à propos de ce type de journal, et les notes de Casas à ce sujet sont nombreuses. Il indique la manière dont il a construit le livre : « ce qui me surprend : /que ce que j'ai écrit / soit fait presque entièrement / de citations. de syncopes. / la plus folle mosaïque / qui se puisse imaginer. (p. 248) ». Cette mosaïque met à la fois en évidence la dispersion dans les notations et l'unité d'une vie. Si un ordre du jour est une liste de sujets qui sont classés dans un certain ordre, il est certain que le livre ne remplit pas le programme, sauf si l'on considère que les notations parfois se suivent avec une absence de continuité reflétant ce qui se passe dans la vie ; ainsi : « beau soleil après pluie. / j'aime la blancheur de la lotte. (p. 164) ». On multiplierait les exemples de ces rencontres, mais elles répondent à un souhait de Casas : « cette juxtaposition se voudrait / cubiste mise en forme. (p. 151) » Et il faut alors entendre "ordre du jour" autrement : « passons à l'ordre du jour. / programme d'une vie libre. (p. 12) »
L'unité se construit par la reprise régulière de quelques motifs. Deux sont dominants dans le Journal, bien délimités, « travailler et aimer. (p. 41) ». De là découle toute une série de thèmes qui charpentent L'ordre du jour, accroissant le plaisir à se repérer dans cet « emmêlement [...] de petits riens tressés. (p. 207) ». "Travail" et "travailler" sont deux mots clés ; de quoi s'agit-il ? lire, sans cesse, pour apprendre et se transformer, et de là rejeter tout ce qui néglige la formation de l'esprit ou s'y oppose — on ne s'étonnera pas que soient soulignées « la bêtise la crasse ignorance / des bourgeois. (p. 227) » Écrire aussi, activité qui n'est pas séparée de la lecture, et peut-être L'ordre du jour est-il le livre qui se construit dans la « petite usine d'écriture. (p. 87) », comme certains passages le laissent imaginer : « j'ai l'impression de ne faire qu'accumuler / des notes pour un livre sans savoir /si je trouverai jamais / le courage de l'écrire. (p. 232) » À ce travail sont liées de nombreuses questions relatives à la langue et à la poésie, dont beaucoup sont d'ailleurs au cœur des textes de Casas.
La relation à l'autre dans l'amour est complexe, on s'en doute. Elle apparaît, souvent, seulement sexuelle — « seule compte l'étreinte des corps (p. 40) » — et Casas emprunte à Flaubert l'expression sans détour de la sexualité : « fouteur sentant / le sperme qui monte / et la décharge qui s'apprête. (p. 40) ». Il y a des histoires de séduction, de désir violent et, parallèlement, les bribes d'un récit plutôt romantique où la femme aimée est d'ailleurs liée à ce qui absorbe en partie la vie de l'auteur : « il n'y a que l'amour réciproque. / elle assise sur le lit / lisant un livre.(p. 164) ».
Ni le monde extérieur, le politique mais aussi fleurs et couleurs du ciel, ni les rêves, ni les notations sur l'Italie, de Turin à la Sicile, ne sont absents de ce journal partiellement inventé — mais, note Casas, « quoi que j'écrive / cela raconte mon histoire / sans que je le sache. (p. 229) ».
Benoît Casas, L'ordre du jour, Seuil, 2013.
Cette recension a été publiée en juin sur Sitaudis
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, l'ordre du jour, journal, bibliothèque, citations, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
03/03/2013
Paul Claudel, Positions et propositions

Les mots ont une âme
Les mots ont une âme. Je ne parle pas seulement du mot parlé, avec le timbre que lui imprime la voyelle, et la forme, la vertu, l'impulsion, l'énergie, l'action particulière, que lui confère la consonne. Mais le mot écrit lui-même, j'y trouve autre chose qu'une espèce d'algèbre conventionnelle. Entre le signe graphique et la chose signifiée il y a un rapport. Qu'on m'accuse tant qu'on voudra de fantaisie, mais j'affirme que le mot écrit a une âme, un certain dynamisme inclus qui se traduit sous notre plume en une figure, en un certain tracé expressif. Tout aussi bien que le chinois, l'écriture occidentale a par elle-même un sens. Et sens d'autant mieux que, tandis que le caractère chinois est immobile, notre mot marche.
Ce n'est pas seulement sur le visage de ces affamés que Dante rencontre à je ne sais plus quel étage du Purgatoire que nous avons copié le mot OMO. Partout au fur et à mesure que notre plume va son chemin de gauche à droite sur le papier, l'image, l'idée, le sentiment réverbérés, nous sautent, sous le trait infime, comme on dit, aux yeux. L'évidence est là pour des vocables en français comme œil, oreille, doigt, deux, paon, etc. En anglais les mots pool, moon, constituent de vrais petits paysages. Et quoi de plus hagard que le mot fool ?
Aujourd'hui je voudrais illustrer cette idée par le moyen de cette admirable et mémorable lettre
M m
qui se dresse au milieu de notre alphabet comme un arc de triomphe appuyé sur un triple jambage, à moins que la typographie n'en fasse un échancrement spirituel de l'horizon. Celui du Monde par exemple et pourquoi pas celui de la Mort ? Portique ouvert à toutes sortes de vues et de suggestions.
L'horizon ? Mais quoi plus cérémonial pour le constituer, dans les langues issues de l'Égypte et de la Phénicie, comme dans l'idiome chinois que l'initiale de la Montagne et de la Mer. La montagne immobile aussi bien que la mer qui murmure et qui moutonne. Quand le disque du soleil apparaît au-dessus de l'une et de l'autre, notre lettre monte. Elle plie, elle ondule sous le faix du monstre.
Mais M n'est pas seulement une introduction, une porte aux deux battants divisés par la fissure, nos lèvres quand elles laissent échapper le souffle comme dans muet ou dans murmure (à moins que là toutes ces verticales parallèles ne nous donnent l'impression d'une forêt), elle est à l'intérieur même de notre propre identité. Moi, me voici debout entre mes deux parois comme dans une maison ou dans une armoire. I est un flambeau allumé. O est le miroir qu'est la conscience : à moins que l'on préfère y constater un noyau, ou cette fenêtre ouverte par où se communique la lumière intime. Âme, c'est moi en tant que centre d'aspiration : vers cet o lumineux par exemple qui dans ami suit l'exhalation graphique, tandis que dans aimer elle la précède. Mémoire : je me souviens de moi-même. [...]
Paul Claudel, Positions et propositions, dans Œuvres en prose, Textes établis et annotés par J. Petit et C. Galpérine, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1965, p. 91-93.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, positions et propositions, les mots ont une âme, écriture, moi | ![]() Facebook |
Facebook |







