07/11/2013
Thomas Bernhard, "Retrouvailles", dans Goethe se mheurt [sic]
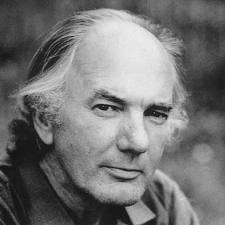
(...) Tant que nous avons vécu chez nos parents, nous étions en réalité enfermés dans deux cachots, et lorsque l'un de nous croyait être enfermé dans le cachot le plus terrible des deux, l'autre avait tôt fait de le détromper en rapportant que le sien était bien plus terrible. Les maisons familiales sont toujours des cachots, rares sont ceux qui parviennent à s'en évader, lui dis-je, la majorité, c'est-à-dire quelque chose comme quatre-vingt-dix-huit pour cent, je pense, reste enfermée à vie dans ce cachot, où elle est minée jusqu'à l'anéantissement, jusqu'à mourir entre ses murs. Mais moi, je me suis évadé, lui dis-je, à l'âge de seize ans je me suis évadé de ce cachot, et depuis je suis en fuite. Ses parents m'avaient toujours prouvé à quel point les parents peuvent être cruels, tandis que, réciproquement, les miens lui avaient toujours prouvé à quel point les parents peuvent être atroces. Lorsque nous nous retrouvions à mi-chemin entre nos maisons parentales, lui dis-je, sur le banc à l'ombre de l'if, je ne sais plus si tu t'en souviens, nous parlions chaque fois de nos cachots familiaux et de l'impossibilité d'y échapper, nous échafaudions des plans, uniquement pour les rejeter aussitôt comme totalement chimériques, sans cesse nous évoquions le renforcement continu du mécanisme répressif de nos parents, contre lequel il n'y avait aucun remède.
[...]
Thomas Bernhard, "Retrouvailles", dans Goethe se meurt, récits, traduit de l'allemand par Daniel Mirsky, Gallimard, p. 11-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, retrouvailles, goethe se mheurt, parent, haine | ![]() Facebook |
Facebook |
18/10/2013
Daniil Harms (1905-1942), Œuvres en prose et en vers

On m'appelle le capucin. Pour ça j'arracherai les oreilles à qui de droit, mais en attendant la gloire de Jean-Jacques Rousseau ne me laisse pas en paix. Pourquoi savait-il tout ? Et comment langer les bébés et comment marier les filles ! Moi aussi j'aimerais comme lui tout savoir. Je sais d'ailleurs déjà tout, mais je ne suis pas sûr de ce que je sais. À propos des enfants je sais pertinemment qu'il ne faut pas les langer, mais les exterminer. Pour ce faire, j'aurais construit en ville une fosse centrale où je les aurais jetés. Et pour que la puanteur de la putréfaction ne monte pas de la fosse, on peut la recouvrir de chaux vive chaque semaine. Dans cette même fosse j'aurais précipité tous les bergers allemands. Maintenant, à propos du mariage des filles. C'est à mon sens encore plus simple. J'aurais préparé une salle commune où, disons, une fois par mois tous les jeunes se seraient réunis. Tous de 17 à 35 ans, doivent se mettre nus et parcourir la salle. Si quelqu'un plaît à quelque autre, le couple se retire dans un coin et s'y examine alors en détail. J'ai oublié de dire que chacun doit porter à son cou une carte avec son nom, son prénom et son adresse. Après, on peut écrire une lettre à la personne qu'on a trouvée à son goût et faire plus ample connaissance. Si un vieux ou une vieille se mêle de ces affaires, je propose de les tuer d'un coup de hache et de les traîner là où l'on traîne les enfants, dans la fosse centrale.
J'écrirais bien encore sur les connaissances que je possède en moi, mais je dois malheureusement aller chercher du gris au bureau de tabac. Quand je sors dans la rue j'emmène toujours avec moi un gros bâton noueux. Je le prends pour en frapper les enfants qui me tombent sous la main. C'est sans doute pour ça qu'on m'a surnommé le capucin. Mais attendez salauds, je vous écorcherai en plus les oreilles !
Daniil Harms, Œuvres en prose et en vers, traduit du russe et annoté par Yvan Mignot, Verdier, 2005, p. 785-786.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniil harms, Œuvres en prose et en vers, enfance, fille à marier | ![]() Facebook |
Facebook |
10/10/2013
Blaise Cendrars, Sous le signe de François Villon

(...) les mauvaises fréquentations que je recherchais ne m'en imposaient pas, et si je m'y complaisais au point de me laisser aller à me tromper sur ma véritable nature, je n'étais dupe ni des gens ni de leur milieu, ni de leur vie car plus on fraye avec ce monde inquiétant qui grouille dans les bas fonds d'une grande ville, plus on s'aperçoit que comme partout ailleurs, chez les bourgeois, chez les ouvriers, chez les paysans, chez les riches et chez les pauvres, les vices, les bobards, les vantardises, les pires excentricités et les insubordinations des révoltés, des anarchistes, des bohèmes, des apaches, des voleurs et des assassins, bref des soi-disant affranchis sont encore mœurs et coutumes de conformistes, c'est-à-dire que tous ces individus déracinés forment une classe, une classe qui a ses traditions et ses privilèges, sa morale, son travail, sa loi et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, tous les préjugés d'honneur et d'argent les plus étroits qui ont également cours forcé dans les autres classes de la société.
En vérité, moi qui voulais être libre (indépendant, je l'étais depuis l'âge de quatorze ans), je ne me sentais, cet hiver-là, nulle part à ma place. C'est pourquoi je revenais toujours à mes livres et passais des nuits à lire.
Blaise Cendrars, Sous le signe de François Villon, dans Œuvres autobiographiques complètes, I, édition publiée sous la direction de Claude Leroy, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2013, p. 84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blaise cendrars, sous le signe de françois villon, classe sociale, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
06/10/2013
Philippe Jaccottet, Taches de soleil ou d'ombre,

1976
À Paris, visite à Francis Ponge. J'arrive rue Lhomond à midi, un peu en avance. On refait la façade ; l'escalier est très délabré. Odette m'ouvre ; elle a les cheveux gris, mais son visage est toujours aussi beau, sa taille aussi fine et droite. Francis sort de sa chambre en maillot de corps ; il me semble un peu plus petit qu'autrefois, un peu plus frêle surtout (il a soixante-dix-sept ans) ; mais le visage peu changé. Il passe ses bretelles et une chemise devant moi, tandis qu'Odette tient absolument à faire son lit contre son gré.
Comme tant d'autres fois, il y a plus de vingt ans, je passe l'après-midi dans le bureau. Après qu'il m'a parlé de ma mère et de la mort de son père, assez vite, tous ses propos vont revenir à lui, en particulier à ses difficultés avec Gallimard. La tête bientôt me fait mal et je ne suis pas sans effort ce long monologue, que conclura la lecture de quelques pages sur le vent, qui ne me convainquent pas complètement. C'est un homme blessé. (Sa riposte aux attaques de ses anciens admirateurs, Pleynet hier, Prigent aujourd'hui, a retrouvé la violence des batailles entre surréalistes.) Il réaffirme son gaullisme, se proclame même plus ultra que Michel Debré. Ce qui se passe dans le monde l'écœure : il m'avoue même qu'il sera heureux de quitter un monde aussi atroce. Quand il évoque de récents rapts d'enfants, je le surprends au bord des larmes.
Il se montre très dur à l'égard de Perse, à peine moins pour Char. Grand éloge, en revanche, de Maldiney (qui, évidemment, ne saurait lui faire de l'ombre).
(11 février)
Philippe Jaccottet, Taches de soleil ou d'ombre, Le Bruit du temps, 2013, p. 110-111.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, taches de soleil ou d'ombre, journal, francis ponge, vieillesse | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2013
Nicole Caligaris, Pierre Le Pillouër, L'expérience D


[...]
Les lèvres fermées, rien n'y tremble, même pas les traits qui les troublent. Et que le type ou, peu importe, cette nature qui tente de se déplacer en pendule, une jambe soudée à l'autre, par bonds, plus lourde qu'aucun marcheur jamais, passant, balancée, sac, les poumons sans ressource et les biceps à bloc, le bassin entre les parallèles inflexibles de deux béquilles, la même, la même, raides comme la justice, ennemies de l'élan à elles deux, sous le regard en coin des gosses du quartier qui se poussent du coude, en soulevant le gémissement réflexe des passants, les bras ouverts, qui déjà regardent par terre, que cette nature ait une idée précise de la défaire, que cette idée se confirme chaque fois qu'elle pose le pied, que le pied lui tremble, et à chaque pas davantage, je veux bien le croire : rien n'égalera la liberté du marcheur, délié de soi, relié au loin, immense au sol quelle que soit sa hauteur, fin d'une finesse de trait, d'une finesse pleine et déliée d'idéogramme, de ligne lancée dans le blanc, muet en aucun point, jamais laissé, à peine posé, relevé de lui-même, léger avec la terre à force de répéter la séparation de ses cuisses, de rappeler pas après pas le triangle dessiné dans le vide par ses guiboles qui ont désarmé la parallèle, qui ont désarmé la raideur pout marcher.
Nicole Caligaris, Pierre Le Pillouër, L'expérience D, L'Arbre à paroles, 2013, p. 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicole caligaris, pierre le pillouër, l'expérience d, marcher, béquilles | ![]() Facebook |
Facebook |
02/10/2013
Jean-Luc Parant, Le fou parle
Arrivé de nulle part, venu d'ailleurs

Quand j'ai commencé à faire des boules et à écrire des textes sur les yeux, je me suis séparé de tout, comme si j'étais arrivé de nulle part et que je venais d'ailleurs. J'ai quitté ma maison, je me suis séparé de mes parents, je me suis éloigné de leur peau, de leur chair et de leur sang. Mes boules et mes textes sur les yeux ont tout recouvert, ils ont recouvert le monde et son histoire. J'ai enterré ma mère et mon père, je me suis retrouvé seul, nu, sans origine, méconnaissable, comme si j'avais alors débarqué sur une terre inconnue où tout restait à découvrir.
Mes boules sont devenues les empreintes de mon corps par où l'on me reconnaît dans l'obscurité, mes textes le regard de mes yeux où l'on me reconnaît dans le jour. Quand je ne suis pas là, mes boules et mes textes sur les yeux me remplacent comme si je vivais en eux. Mes boules sont mon corps, mes textes sur les yeux ma tête.
J'ai fait des boules parce que j'ai fait de la peinture et que je n'arrivais pas à me donner de limites et que, ne sachant pas m'arrêter à la face de la toile devant moi, j'ai commencé à peindre sur les côtés et dans le dos de mes tableaux, je me suis échappé à droite et à gauche, en haut et en bas, loin derrière dans la nuit. Je n'ai plus peint avec mon œil, je n'ai plus regardé la face de mes peintures, j'ai peint avec mes mains, j'ai caressé le dos de mes tableaux, j'ai touché leurs côtés, j'ai tellement mis et remis de couches de peinture que le tableau est devenu un volume, que le tableau a finalement pris la forme d'une boule.
J'ai écrit des textes sur les yeux parce que j'écrivais et que je n'arrivais pas à m'arrêter aux bords de la page et que je continuais à écrire sur la table et que, ne sachant pas m'arrêter, j'ai commencé à écrire dans les marges de mes pages, je me suis échappé à gauche et à droite, en bas et en haut, près devant dans le jour. Je n'ai plus écrit avec ma main, je n'ai plus caressé le dos de mes pages, j'ai écrit avec mes yeux, j'ai regardé la face de mes pages, j'ai vu leurs marges, j'ai tellement mis et remis de couches de mots que le livre est devenu une image que le livre a finalement pris la forme d'yeux intouchables.
Jean-Luc Parant, Le fou parle, d'après un entretien à la clinique de La Borde, préface de Olivier Apprill, éditions Marcel ke Poney, 2008, p. 13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc parant, le fou parle, yeux, boules, nuit, jour, séparation | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2013
Noémie Parant, 45 lettres à D.
14 août 2013
Cher D.,
Noyés donc les jardins et le vide noyés aux bienfaits de l’amour je ne réalise à présent les pages réunies l’issue des lettres approchée pour de vrai, ce qu’il m’est donné d’avoir ni ce qu’il me faut décidément en attendre. Nul de la crête en ce cas, plus que tout ce que j’y perçus limon à la queue de soi rentré là me dédier l’atmosphère et ces nuées, qui culminent pour jamais. Toutes m’échappent aujourd’hui par les chevilles et l’épine du crâne vois-tu n’a plus aucun sentiment que je ne crois ramasser, comme d’émotions à étreindre enfin.
Alors je te parle toujours avant de prendre le bout de ce livre il gagne, de vitesse ces dernières heures reste quelques envois à tenir une quarantaine t’ai-je promis en commençant ainsi, marteler plus résolue l’effet de l’espace sur mes possibles – lui que j’égarai pour du désir et le contrebas, n’ai que faire de ce qu’il peut bien contenir. L’un l’autre m’en moque puisqu’y laissèrent si peu à peine ces gouffres évanouis contre la mémoire et encore, tout juste me revient-il de quoi comprendre quel doux rêve je pus y trouver. Lis cher D. d’amour, combien l’existence est heureuse une fois ravie à la réserve de ce qu’elle voulut confier – échoués de la sorte vallons où périr puis d’ici, voûtes en lieu et place de l’immortel. Mais je saurais inlassablement rapporter et tant de ce qu’elle m’offre à ressentir : le cœur, dis-le toi, le cœur est un prodige désormais ne sert d’ailleurs plus de le formuler sans percevoir sans – que la charge ancienne et le sol que je reçois par la plante et ce jaune là-bas que je n’embrassai, sans qu’ils fondent tous après l’amour.
Ainsi les lignes, elles stopperaient sur ces mots pourtant je l’eus l’envie même si vive de les reconduire une à une – lors qu’elles valent aujourd’hui pour seuls vestiges de l’été finissant. Touche donc là comme il y manque encore quelque chose mon amour, dont je puisse enfin rabattre plus blessante cette ombre jouée autour de la mort. Tu y verras que l’août a coulé entre deux bientôt la gare où ne plus penser aux champs du mourir, que les nouveaux jours s’y apprêtent quoique meurtris à part tes visages, surtout qu’ils me délivrent l’afflux de la vie par ta vie alors j’y faucherai les adieux oui et toi-l’adoré – me suffira de te tenir devant le monde.
Noémie Parant, 45 lettres à D., inédit, à paraître.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noémie parant, 45 lettres à d, livre, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2013
Edoardo Sanguineti, Corollaire — Le noble jeu de l'oye

si tu revis, que corriges-tu ?
eh bien, rien : (je suis débordant de remords torturants,
ô ma femme) : (je suis une épouvantable encyclopédie de conneries [encouillonnées, de semi-criminelles
supergaffes : et elles furent, mes années, un inimitable échantillonnages [d'irrémédiables coquilles existentielles) :
eh bien, je ne retoucherai pas une seule virgule, pas un seul simple [point : (j'aurais trop peur
de l'effet domino) : (tu modifies un geste, un mot ; tu refais, juste comme ça, le [nœud
de ta cravate) : (mais que dis-je ? tu te coupes, d'une narine, un jour, un poil à [peine en trop,
rien d'autre) : (et tu joues un destin — le destin, et tout se tient) : (et puis imagine — [imagine
le cas : tu disparais, alors, de la re-vie que je vivrais, me concédant un bis) :
eh bien :
ce que j'ai eu, je le garde ainsi : (pourvu que je te garde, moi je me garde, [à l'identique)
Edoardo Sangineti, Corollaire, traduction Patrizia Atzei et Benoît Casas, préface de Jacques Roubaud, éditions NOUS, 2013, p. 48.
Le noble jeu de l'oye, LVIII
On prend une jeune fille, n'importe laquelle, là au hasard. On met la jeune fille, là devant nous, nue, assise sur un tabouret de bois, avec la figure toute dans l'ombre, les genoux en pleine lumière, les mains sur les hanches. On coupe les pieds. On jette un reste de temple ionique, là sur la jeune fille, en couleurs, avec trois colonnes et une architrave, avec le ciel bleu et les petits nuages blancs. L'architrave va de travers, en bas de l'épaule gauche, sous le sein droit. Puis elle saute là, à la hauteur du coude, sur le bras droit. Puis on tourne la jeune fille sur le côté, en pied, avec les bras en l'air. On coupe la tête. On coupe les bras, là en haut. On coupe les cuisses. On jette un instrument à vent, là sur la peau de la jeune fille. On jette, par exemple, un cor anglais. La peau de la jeune fille, là de côté, est une clairière dans le bois, avec quelques touffes d'herbe, avec un cor anglais. Puis on fait mieux. On dit à la jeune fille qu'elle doit se tourner toute, elle, là de dos, en pied. On coupe les pieds. On coupe tout ce qu'il y a, des genoux au bas, par derrière. On voit tous les cheveux noirs, ainsi, à la jeune fille. On voit aussi une de ses tresses qui pend, là jusqu'à mi-dos, à elle, précisément. On voit sa main droite qui pointe, là par la gauche, là de dos, de côté, de l'avant-bras gauche. Ses ongles sont laqués en rouge, son annulaire a un anneau, son pouce regarde en haut. On jette une tête de femme qui se penche par un rideau. La femme déplace le rideau avec les mains, s'avance avec la tête, avec les cheveux bouclés, cuivrés. Puis la femme se retire en arrière, la jeune fille se ferme son dos. Puis on dit à la jeune fille qu'elle doit s'asseoir, encore, là de dos, là par terre, avec la tête très penchée en avant. Un se couche sur le sol, alors. Il voit le dos nu, il voit les jambes qui pointent à peine, là sur le côtés, qui s'en vont par là, en perspective. On en jette deux qui regardent le coucher du soleil, un homme et une femme, sur le bord de la mer, tournés par là, vers la mer, avec le vent qui souffle dans les cheveux de la femme. Puis on photographie tout. CAMERA : Pentax H3, with Super-Takumar f/1.8 lens. EXPOSURE :st f/2.8, shutter speed varied. FILM : Kodachrome Type B. LIGHTING : two 3200 K floods bounced.
Edoardo Sanguineti, Le noble jeu de l'oye, "Tel Quel", éditions du Seuil, 1969, p. 82-83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edoardo sanguineti, corollaire, la noble jeu de l'oye, amour, humour | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2013
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves)

Quatre vingt-six
Il se demande souvent si la question du rapport à la sphère n'est pas, de par sa nature même, insoluble. La sphère n'est pas présente en permanence devant ses yeux, cependant, même lorsqu'elle s'éloigne, même lorsqu'elle se retire ou se cache, la sphère agit, et il croit comprendre que si le monde présente cette forme qu'on connaît, c'est précisément parce qu'il doit accueillir la sphère. Parfois, alors qu'il vient de se réveiller, dans la chambre plongée dans une semi-obscurité — le jour a déjà commencé pour tout le monde, et ce n'est pas ce qu'il aime se lever tard, mais en retard — la sphère se tient en équilibre au milieu de la chambre ; il l'examine avec attention car, telle une question, la sphère exige de l'attention. La sphère n'est pas toujours de la même couleur, elle passe par toutes les nuances du gris au noir : parfois, et ce sont les moments les plus intéressants, la sphère bascule, laissant place à une cavité sphérique, à une vide entièrement privé de lumière. Il arrive que la sphère s'absente quelque temps, mais rarement plus d'une dizaine de jours. Elle réapparaît à l'improviste, à n'importe quelle heure, sans raison compréhensible, comme si elle revenait de voyage, comme après une absence légèrement coupable quoique convenue. Il a l'impression que la sphère fait semblant de présenter ses excuses, mais qu'elle est en réalité ironique et, même innocemment, maligne. Il fut un temps où, par la violence, il tenta d'effacer de sa vie cette présence révulsive ; mais la sphère est taciturne, insaisissable, à moins qu'elle ne décide elle-même de frapper ; elle provoque alors dans la partie du corps qu'elle atteint, une douleur opaque, sombre, déchirante. Quoi qu'il en soit, la manifestation typique de l'hostilité de la sphère consiste à s'interposer entre lui et quelque chose qu'il essaie de voir ; dans ce cas, la sphère est susceptible de devenir minuscule, une bille turbulente qui danse et s'esquive devant ses yeux. Il est une fois de plus tenté d'affronter la sphère avec une soudaine brutalité, comme s'il ignorait que, de par sa constitution il est impossible de l'atteindre ; ou bien il envisage de s'enfuir, de recommencer sa vie en un lieu que la sphère ne connaît pas. Mais il ne croit pas que cela soit possible ; il pense qu'il doit convaincre la sphère de ne pas exister, et il sait que pour la conduire à cette progressive séduction du néant, il lui faut emprunter une voie lente, patiente, labyrinthique, et faire preuve d'ingéniosité et de minutie.
Giorgio Manganelli, Centurie (cent petits romans fleuves), prologue de Italo Calvino, traduction Jean-Baptiste Para, éditions W, 1985, p. 183-184.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, centurie (cent petits romans fleuves), jean-baptiste para, fantastique, humour, labyrinthe | ![]() Facebook |
Facebook |
28/07/2013
Jean Tardieu, La première personne du singulier

Les surprises du dimanche
La conversation s'engagea au milieu du jardin. Les interlocuteurs, au prix de douloureuses courbatures, faisaient semblant d'être assis, mais aucun siège ne les portait. Ils formaient un cercle parfait autour d'un petit cheval qui était là Dieu sait pourquoi.
(Un peu plus loin, autour de la pelouse, les chaises et les fauteuils faisaient cercle de leur côté.)
On parla d'abord de la question des ponts, puis de la question des ponts de bois, puis des bois de pins, puis des sapins, puis des lapins, puis de la jungle et des ours.
À ce moment (quand on parle du loup !...) un ours parut sur la route, un accordéon sur le ventre, la cigarette au bec. Il dansait en s'accompagnant.
Les chaises et les fauteuils pris de panique rentrèrent précipitamment à la maison.
Les interlocuteurs lassés d'un long effort s'étendirent sur l'herbe.
La nuit vint. L'ours chantait. J'étais heureux.
Le petit poulain grandit, devint plus haut qu'un chêne — et blanc d'écume comme la mer. C'était Pégase, le cheval de la poésie, celui que nous révérons tous.
Jean Tardieu, La première personne du singulier, Gallimard, 1952, p. 117-118.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, la première personne du singulier, les surprises du dimanche, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
26/07/2013
Jean Tardieu, Une Voix sans personne

Les mots égarés
Je marchais par une nuit sans fin
sur une route où luisaient seules
des lueurs agitées délirantes
comme les feux d'une flotte en perdition.
Sous la tempête mille et mille voix sans corps
souffles semés par des lèvres absentes
plus tenaces qu'une horde de chacals
plus suffocantes qu'une colère de la neige
à mes oreilles chuchotaient chuchotaient.
L'une disait « Comment » l'autre « Ici »
ou « Le train » ou « Je meurs » ou « C'est moi »
et toutes semblaient en désaccord :
une foule déçue ainsi se défait.
Tant de paroles échappées
des ateliers de la douleur
semblaient avoir fui par les songes
des logements du monde entier.
« Je t'avais dit » — « Allons ! » — « Jamais ! »
« Ton père » — « À demain ! » « Non, j'ai tiré ! »
« Elle dort » — « C'est-à-dire » — « Pas encore »
« Ouvre ! » — « Je te hais ! » — « Arrive ! »
Ainsi roulait l'orage des mots pleins d'éclairs
L'énorme dialogue en débris, mais demande et réponse
étaient mêlés dans le profond chaos ;
le vent jetait dans les bras de la plainte la joie,
l'aile blessée des noms perdus frappait les portes au hasard
l'appel atteignait toujours l'autre et toujours le cri égaré
touchait celui qui ne l'attendait pas. Ainsi les vagues,
chacune par la masse hors de soi déportée
loin de son propre désir, et toutes ainsi l'une à l'autre
inconnues mais à se joindre condamnées
dans l'intimité de la mer.
Jean Tardieu, Une Voix sans personne, Gallimard, 1954, p. 21-22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
23/07/2013
Jean Tardieu, On vient chercher Monsieur Jean

Une bouteille à la mer
Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, c'est-à-dire jusqu'à ces moments privilégiés où un enfant commence à prendre conscience de lui-même et de ce qui l'entoure, il me semble avoir toujours entendu une certaine voix qui résonnait en moi, mais à une grande distance, dans l'espace et dans le temps.
Cette voix ne s'exprimait pas en un langage connu. Elle avait le ton de la parole humaine mais ne ressemblait ni à ma propre voix ni à celle des gens qui me connaissent. Elle ne m'était pourtant pas étrangère, car elle semblait avoir une sorte de sollicitude à mon égard, une sollicitude tantôt bienveillante et rassurante, tantôt sévère, grondeuse, pleine de reproches et même de colère.
Les moments où j'entendais cette voix étaient ceux où ma vie paraissait suspendue dans le vide, interrompue, arrêtée, comme une horloge dont on ne voit plus bouger les aiguilles et dont on n'entend plus le battement.
Cette expérience très ancienne, primitive, sauvage, surtout secrète (car je n'en parlais à personne), s'est reproduite souvent au cours de mon existence, mais jamais elle n'a été aussi expressive, aussi intense que pendant mon extrême jeunesse, car rien ne pouvait alors en fausser la signification : elle résonnait dans une étendue absolument vacante, absolument solitaire.
Jean Tardieu, On vient chercher Monsieur Jean, Gallimard, 1990, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, on vient chercher monsieur jean, une bouteille à la mer, souvenir, voix | ![]() Facebook |
Facebook |
13/07/2013
Luc Bénazet et Benoït Casas, Envoi
![11 décembre [préparatifs] poésie & poésie & histoire revues,italie traductions... poésie & duo : je prépare liste et nom,avancer ou reculer avançant. sans reculer au point de ,la lumière [gra,envoi,conversation écrite,lettre,poésie](http://litteraturedepartout.hautetfort.com/media/01/00/958850887.jpg)
Luc Bénazet
11 décembre
[préparatifs]
Poésie &
Poésie & Histoire
revues, Italie
traductions...
Poésie & duo :
je prépare liste et noms
discours-montage
livres-outils
piles des titres
dispositif serré
en vue de
littéral oral
et d'accélération prochaine.
![11 décembre [préparatifs] poésie & poésie & histoire revues,italie traductions... poésie & duo : je prépare liste et nom,avancer ou reculer avançant. sans reculer au point de ,la lumière [gra,envoi,conversation écrite,lettre,poésie](http://litteraturedepartout.hautetfort.com/media/00/01/1009763535.jpg)
Benoît Casas
19/12/10
calendrier. Considérant sa propre vie, avancer ou reculer
avançant. Sans reculer
au point de mire des regards — à l'arête du nez —, la lumière
[grandit ou bien décline
sans arrêt
Luc Bénazet et Benoït Casas, Envoi, Héros-Limite, 2012, p. 44-45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 11 décembre [préparatifs] poésie & poésie & histoire revues, italie traductions... poésie & duo : je prépare liste et nom, avancer ou reculer avançant. sans reculer au point de, la lumière [gra, envoi, conversation écrite, lettre, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
23/06/2013
Jean-Paul Michel, « Quand on vient d'un monde d'Idées, la surprise est énorme »,

« Nos ennemis dessinent notre visage » (1997-1998)
« Nos ennemis dessinent notre visage »
Cette vérité effraie.
Pour survivre nous cachons ce que nous sommes.
Nous masquons des vertus en vices.
Nous montrons des richesses que nous n'avons pas.
Nous inclinons dès l'enfance à l'injure et au mépris.
Adolescents, nous mettons un point d'honneur à blesser le cœur de qui nous aime.
Nous désirons communément le pire malgré les supplications et les larmes.
Nous rugissons comme des tigres sous l'injure.
Nous sommes pour nous-même notre pire ennemi.
Nous nous heurtons à ce qui est.
Nous appelons cela connaître.
Nous allons à nos fins sans savoir avec zèle.
Nous appelons notre folie savoir.
Nous pensons en cela échapper.
Nous éprouvons de la honte de ce qui devrait nous donner de la fierté, de la fierté de ce qui devrait nous donner de la honte.
Nous désirons jusqu'aux plus grandes souffrances.
Nous avons le goût surprenant de nous avilir.
Nous répétons des erreurs anciennes.
Ces inconséquences nous apparaissent.
Nous nous livrons à leur peu de sens.
[...]
Jean-Paul Michel, « Quand on vient d'un monde d'Idées, la surprise est énorme », 'When One comes from a World of Ideas, Vast is the Surprise', Quarante poèmes choisis, traduits et post-présentés par Michael Bishop, VVV / William Blake & Co, 2013, p. 71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2013
Louis Aragon, Le Paysan de Paris

Le passage de l'Opéra
1924
On n'adore plus aujourd'hui les dieux sur les hauteurs. Le temple de Salomon est passé dans les métaphores où il abrite des nids d'hirondelles et de blêmes lézards. L'esprit des cultes en se dispersant dans la poussière a déserté les lieux sacrés. Mais il est d'autres lieux qui fleurissent parmi les hommes, d'autres lieux où les hommes vaquent sans souci à leur vie mystérieuse et qui peu à peu naissent à une religion profonde. La divinité ne les habite pas encore. Elle s'y forme, c'est une divinité nouvelle qui se précipite dans ces modernes Éphèses comme au fond d'un verre, le métal délacé par un acide ; c'est la vie qui fait apparaître ici cette divinité poétique à côté de laquelle mille gens passent sans rien voir, et, qui, tout d'un coup, devient sensible, et terriblement hantante, pour ceux qui l'ont une fois maladroitement perçue. Métaphysique des lieux, c'est vous qui bercez les enfants, c'est vous qui peuplez leurs rêves. Ces plages de l'inconnu et du frisson, toute notre matière mentale les borde. Pas un pas que je fasse vers le passé, que je ne retrouve ce sentiment de l'étrange, qui me prenait, quand j'étais encore l'émerveillement même, dans un décor où pour la première fois me venait la conscience d'une cohérence inexpliquée et de ses prolongements dans mon cœur.
Toute la faune des imaginations, et leur végétation marine, comme par une chevelure d'ombre se perd dans les zones mal éclairées de l'activité humaine. C'est là qu'apparaissent les grands phares spirituels, voisins par la forme de signes moins purs. Laporte du mystère, ne défaillance humaine l'ouvre, et nous voilà dans les royaumes de l'ombre. Un faux pas, une syllabe achoppée révèlent la pensée d'un homme. Il y a dans le trouble des lieux de semblables serrures qui ferment mal sur l'infini. Là où se poursuit l'activité la plus équivoque des vivants l'inanimé prend parfois un reflet de leurs plus secrets mobiles : nos cités sont ainsi peuplées de sphinx méconnus qui n'arrêtent pas le passant rêveur, s'il ne tourne vers eux sa distraction méditative, qui ne lui posent pas de questions mortelles. Mais s'il sait les deviner, ce sage, alors, que lui les interroge, ce sont encore ses propres abîmes que grâce à ces monstres sans figure il va de nouveau sonder. La lumière moderne de l'insolite, voilà désormais ce qui va le retenir.
Louis Aragon, Le Paysan de Paris, Gallimard, 1926, p. 17-18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, le paysan de paris, mystère, quotidien, passage de l'opéra | ![]() Facebook |
Facebook |






