27/08/2011
Jean Ristat, Du coup d'état en littérature...

La littérature n’a cessé de se rêver ; elle secrète son mythe. Elle se remet en question en prétendant se donner des institutions idéales : elle codifie, institue. Aujourd’hui, elle voudrait que les lecteurs disent : la littérature c’est nous. Elle complote de renverser l’auteur qui règne en despote sur son œuvre, bastion réputé imprenable. Il n’est que trop vrai que nous fûmes abusés.
Moi, je dis : le cercle est bouclé mais je passe outre. Puisque tout est fini, achevé, alors je puis écrire. Je ne serai plus dévoré de scrupules. C’est moi qui pose le sens.
Je décide de répéter, ostensiblement, volontairement. J’accepte même de plagier. Ainsi je prends la parole, j’usurpe le sens. J’organise un rapt en plein jour. Je fais la chasse au sens tout en le déclarant mien. Ceci est mon cheval de Troie. Je prends tous les masques ; je n’ai pas d’identité propre. Je me dissimule. Je ne crains pas d’être duplice. Si Dieu il y a, il n’est qu’un travesti. Je ne serai plus révolté, mais pratique. Je ne projetterai pas ma parole en une quelconque prophétie. Ma question est : comment prendre le pouvoir en littérature ? Je dis que les mythologies sont usées. La littérature est à elle-même une mythologie qui entrave son propre fonctionnement. Nous avons perdu le bon usage des mythes.[…]. Falsification du mythe la poésie égare, elle dévie le sens, insensiblement. Ô je le sais, la littérature souffre de n’être plus poésie ; elle a mauvaise conscience. Platon là-dessus a dit juste. Les poètes n’ont pas de place dans la cité. Je comprends : tout coup d’état en littérature opèrera une séparation des pouvoirs. La poésie n’est pas philosophie, pas plus que la philosophie n’est poésie. Voilà la salubrité. Aujourd’hui je ne rêverai plus de la « poésie-connaissance ». Je ne ressusciterai pas le poète, comme guide des peuples en péril. La poésie n’est connaissance de rien. Les poètes, littéralement et dans tous les sens, ne savent pas et n’ont pas à savoir ce qu’ils disent. Mais qu’on y prenne garde ! Je ne dirai pas non plus que le poète est un inspiré. J’irai jusqu’à prétendre que le langage, pour lui, ne fait pas problème. Je préfèrerais dire : la poésie est le langage se faisant problème. Aussi bien le tragique de la poésie n’est pas dans la connaissance. Le poète quand il philosophe est ridicule. Le tragique est de l’ordre du poème en ce qu’il est un langage replié sur lui-même et se suffisant à soi seul. Posé là, comme objet. Le poète est un baroque parce qu’il dit la liberté du désordre. Il nous fait rêver à des lieux débauchés. Et puis laissons là la poésie. Je lui donne son congé. La littérature est mensonge. J’ai horreur de la vérité.
Je ferai comme si. Je considèrerai la littérature comme jeu. Je n’ai pas à distinguer entre ne pas dire ce qui est vrai et dire ce qui est faux, comme ce bon Jean-Jacques. Il n’y a pas de vérité. Les sens d’un discours sont autant de masques. Supposer qu’on puisse les ôter tous n’a pas d’intérêt ; hors le masque il n’y a rien.
Jean Ristat, Du coup d’état en littérature suivi d’exemples tirés de la Bible et des Auteurs anciens, collection Le Chemin, Gallimard, 1970, p. 56-57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, du coup d'état en littérature, poésie. | ![]() Facebook |
Facebook |
24/08/2011
Olivier Rolin, Bric et broc
 Le roman n’arrête, ne décrète rien, ne décide de rien. Il n’est pas normatif. Quel est le ressort, s’il y en a un, du prince Mychkine, le héros de L’Idiot, et que penser de lui ? Est-il un saint ou un faible d’esprit, ou un malade, tout cela à la fois, est-il beau, est-il ridicule ? » De toutes les belles figures de la littérature, écrit Dostoïevski dans une lettre à sa nièce, la plus achevée est Don Quichotte. Mais Don Quichotte est beau parce qu’il est en même temps ridicule. » Phrase qui va au cœur de ce qui fait la force paradoxale du roman : d’être l’art de l’ambiguïté. Emma Bovary est-elle belle ou ridicule ? Les deux évidemment, et belle parce que, aussi, ridicule (d’une tout autre façon, d’ailleurs, on peut en dire autant de Bouvard et Pécuchet). Dans le petit train de Balbec, le Narrateur aperçoit une femme vulgaire qu’il prend pour une tenancière de bordel ; au voyage suivant, le « petit clan » Verdurin lui apprend que c’est la très aristocratique princesse Sherbatoff : Barthes voit dans ce renversement une des lois de La Recherche du temps perdu. Et ce renversement n’est pas la substitution d’une vérité à une apparence, il préside à une permutation infinie : « L’un des termes permutés, ajoute-t-il, n’est pas plus "vrai" que l’autre. […] À la syntaxe classique qui nous dirait que la princesse Sherbatoff n’est qu’une tenancière de maison publique, Proust substitue une syntaxe concomitante : la princesse est aussi une tenancière de bordel. »
Le roman n’arrête, ne décrète rien, ne décide de rien. Il n’est pas normatif. Quel est le ressort, s’il y en a un, du prince Mychkine, le héros de L’Idiot, et que penser de lui ? Est-il un saint ou un faible d’esprit, ou un malade, tout cela à la fois, est-il beau, est-il ridicule ? » De toutes les belles figures de la littérature, écrit Dostoïevski dans une lettre à sa nièce, la plus achevée est Don Quichotte. Mais Don Quichotte est beau parce qu’il est en même temps ridicule. » Phrase qui va au cœur de ce qui fait la force paradoxale du roman : d’être l’art de l’ambiguïté. Emma Bovary est-elle belle ou ridicule ? Les deux évidemment, et belle parce que, aussi, ridicule (d’une tout autre façon, d’ailleurs, on peut en dire autant de Bouvard et Pécuchet). Dans le petit train de Balbec, le Narrateur aperçoit une femme vulgaire qu’il prend pour une tenancière de bordel ; au voyage suivant, le « petit clan » Verdurin lui apprend que c’est la très aristocratique princesse Sherbatoff : Barthes voit dans ce renversement une des lois de La Recherche du temps perdu. Et ce renversement n’est pas la substitution d’une vérité à une apparence, il préside à une permutation infinie : « L’un des termes permutés, ajoute-t-il, n’est pas plus "vrai" que l’autre. […] À la syntaxe classique qui nous dirait que la princesse Sherbatoff n’est qu’une tenancière de maison publique, Proust substitue une syntaxe concomitante : la princesse est aussi une tenancière de bordel. »
Ces figures de l’indécidé qui sont celles de la vie humaine en tant qu’elle n’est pas une simple quantité, une force, un pion dans un jeu ou une stratégie, ce n’est pas un défaut de savoir qui les crée et les fait vaciller, mais au contraire un savoir subtil. L’indécidé qui est celui de l’âme, oserait-on dire d’un vieux mot qui n’implique pas forcément une transcendance. Le savoir que nous transmet le roman, et qu’il est seul à pouvoir nous transmettre — ni l’histoire ni aucune science humaine ne le pourra — c’est celui-ci : nos destinées sont toutes tramées d’équivoque, même les plus apparemment droites se laissent envisager de plusieurs façons, sont susceptibles de plusieurs vérités.
Olivier Rolin, Bric et broc, Verdier, 2011, p. 42-43.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier rolin, bric et broc, roman, ambiguïté | ![]() Facebook |
Facebook |
13/08/2011
Cesare Pavese, Le Métier de vivre
18 octobre [1938]
Décrire la nature en poésie, c’est comme ceux qui décrivent une belle héroïne ou un puissant héros.
10 novembre [1938]
La littérature est une défense contre les offenses de la vie. Elle lui dit : « Tu ne me couillonnes pas ; je sais comment tu te comportes, je te suis et je te prévois, je m’amuse même à te voir faire, et je te vole ton secret en te composant en d’adroites constructions qui arrêtent ton flux. »

16 avril 1940
Il doit être important qu’un jeune homme toujours occupé à étudier, à tourner des pages, à se tirer les yeux, ait fait sa grande poésie sur les moments où il allait sue le balcon, sous le bosquet, sur la colline ou dans un champ tout vert. (Silvia latini, Vie solitaire, Souvenirs) La poésie naît non de l’our life’s work, de la normalité de nos occupations mais des instants où nous levons la tête et où nous découvrons avec stupeur la vie. (La normalité, elle aussi, devient poésie quand elle se fait contemplation, c’est-à-dire quand elle cesse d’être normalité et devient prodige.)
On comprend par là pourquoi l’adolescence est grande matière à poésie. Elle nous apparaît à nous — hommes — comme un instant où nous n’avions pas encore baissé la tête sur nos occupations.
20 février
La poésie est non un sens mais un état, non une compréhension mais un être.
Cesare Pavese, Le Métier de vivre, traduit de l’italien par Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 103, 113, 153, 255.
Publié dans MARGINALIA, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
09/08/2011
Jacques Borel, Journal de la mémoire
 La phrase longue, oui, et le recul, sans cesse, de l’apparition de tel événement ou de tel personnage qui ont pourtant, dès le début, été annoncés. Je sais que c’est pour eux que j’ai pris le départ, à eux que je finirai par en venir, mais leur introduction se trouve infiniment retardée par l’intrusion, à mesure que l’écriture avance de son pas propre et de plus en plus indépendant, de mille thèmes, de mille sensations, de mille associations, de nouveaux jalons spontanément jaillis, dont à la fois elle se nourrit et se compose, et qui l’entraînent. C’est aussi qu’un monde se déroule en nous à chacune des moindres secondes que nous vivons, que tout, pensées, sensations, soudains affleurements de la mémoire, provoqué par le langage et à son tour le provoquant, accourt ensemble, et que, si l’on veut tout capter de cette profusion instantanée, si l’on veut vraiment aller jusqu’au bout, comme j’espère pouvoir le faire un jour, de chacun de ces mouvements, de cet indivisible flux à chaque seconde tout entier présent et à chaque seconde aussi éveillant de nouvelles harmoniques, l’on ne peut, sous peine d’appauvrissement, éviter cette profusion, cette ramification ou cette prolifération de l’écriture, cette multiplication des incidentes, qui sont à l’image même de la vie de la conscience et de ses franges plus obscures.
La phrase longue, oui, et le recul, sans cesse, de l’apparition de tel événement ou de tel personnage qui ont pourtant, dès le début, été annoncés. Je sais que c’est pour eux que j’ai pris le départ, à eux que je finirai par en venir, mais leur introduction se trouve infiniment retardée par l’intrusion, à mesure que l’écriture avance de son pas propre et de plus en plus indépendant, de mille thèmes, de mille sensations, de mille associations, de nouveaux jalons spontanément jaillis, dont à la fois elle se nourrit et se compose, et qui l’entraînent. C’est aussi qu’un monde se déroule en nous à chacune des moindres secondes que nous vivons, que tout, pensées, sensations, soudains affleurements de la mémoire, provoqué par le langage et à son tour le provoquant, accourt ensemble, et que, si l’on veut tout capter de cette profusion instantanée, si l’on veut vraiment aller jusqu’au bout, comme j’espère pouvoir le faire un jour, de chacun de ces mouvements, de cet indivisible flux à chaque seconde tout entier présent et à chaque seconde aussi éveillant de nouvelles harmoniques, l’on ne peut, sous peine d’appauvrissement, éviter cette profusion, cette ramification ou cette prolifération de l’écriture, cette multiplication des incidentes, qui sont à l’image même de la vie de la conscience et de ses franges plus obscures.
Jacques Borel, Journal de la mémoire, éditons Champ Vallon, 1994, p. 54.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
05/08/2011
Jacques Réda, Celle qui vient à pas légers
 Poète, on ne l’est guère que quelques années dans une vie et, durant ces années, quelques mois ou semaines (je dirai volontiers : minutes) ; qui plus est, sans pouvoir sur le retour de ce saisissement qui nous exclut. Car c’est commodité, si nous ramenons la poésie à des noms de poètes qui en sont si peu les auteurs (comme on a toujours dit — j’entends les poètes eux-mêmes, en proie à cette fatalité ; non pas des docteurs qui soudain s’en épatent, et se sentent d’autant plus libres d’en juger qu’elle les épargne). Et, bien sûr, d’un certain point de vue impressionniste ou statistique, il y a autant de poésies que de poètes. Mais comment pourrait-on parler de la poésie en général, si l’inflexion fondamentale, commune aux voix les plus diverses, n’était en fin de compte anonyme ? Cette plénitude intermittente, celui qui la connaît un peu sait bien qu’elle est dépossession. Dépossession heureuse, mais dépossession. De sorte que la poésie a toujours été faite par tous, ou par personne si l’on préfère.
Poète, on ne l’est guère que quelques années dans une vie et, durant ces années, quelques mois ou semaines (je dirai volontiers : minutes) ; qui plus est, sans pouvoir sur le retour de ce saisissement qui nous exclut. Car c’est commodité, si nous ramenons la poésie à des noms de poètes qui en sont si peu les auteurs (comme on a toujours dit — j’entends les poètes eux-mêmes, en proie à cette fatalité ; non pas des docteurs qui soudain s’en épatent, et se sentent d’autant plus libres d’en juger qu’elle les épargne). Et, bien sûr, d’un certain point de vue impressionniste ou statistique, il y a autant de poésies que de poètes. Mais comment pourrait-on parler de la poésie en général, si l’inflexion fondamentale, commune aux voix les plus diverses, n’était en fin de compte anonyme ? Cette plénitude intermittente, celui qui la connaît un peu sait bien qu’elle est dépossession. Dépossession heureuse, mais dépossession. De sorte que la poésie a toujours été faite par tous, ou par personne si l’on préfère.
Jacques Réda, Celle qui vient à pas légers, Fata Morgana, 1985, p. 9-10.
Publié dans MARGINALIA, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, celle qui vien tà pas légers, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
03/08/2011
Jean-Louis Giovannoni, Pas japonais
 On ne peut écrire qu'en perdant
On ne peut écrire qu'en perdant
le corps de ce que l'on nomme.
Tu parles, tu écris pour que les choses
ne coïncident plus avec elles-mêmes.
On n'écrit pas pour donner aux choses une
place, on écrit pour faire de la place ;
pour que l'arbre ne vienne jamais dans son
nom et que la pierre se taise dans ce qui la
désigne.
Écrire, c'est apporter de l'eau à une source
pour qu'elle découvre sa soif.
Écrire, c'est appeler, appeler surtout pour
que rien ne vienne.
Tu parles, tu écris pour ne pas perdre pied,
pour te tenir dans la distance de
toute chose.
Comment continuer à écrire en sachant
qu'aucun mot ne peut contenir le corps
de ce qu'il nomme.
Écrire, c'est chercher sans cesse un point d'appui.
Écrire, pour lire sa voix dans la voix
des autres.
Peut-être que nos mots sont la seule
terre où l'on peut s'établir ?
Écrire, c'est se tenir à côté de ce qui
se tait.
Écrire, c'est maintenir l'appel,
n'être que le lieu de cet appel.
Jean-Louis Giovannoni, Pas japonais, dans Ce lieu que les pierres regardent, suivi de Variations, Pas japonais, L'Invention de l'espace, préface de Gisèle Berkman, éditions Lettres vives, 2009 (Pas japonais avait été publié en 1992, éditions Unes), p. 93, 95, 95, 96, 96, 98, 100, 100, 101, 103, 104, 106.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, pas japonais, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
01/07/2011
André du Bouchet, La lampe dans la lumière aride (2)
 (Poésie : se rappeler la nuit le matin)
(Poésie : se rappeler la nuit le matin)
Deux poètes, deux poésies :
celle qui s’élabore tandis que le héros reste muet, les mots du silence, celle qui emboîte la parole au héros.
Le courage, la volonté d’écrire, n’est autre que de se résigner à se décider à se servir de ces mots défaillants, sans y voir d’avantage ou d’issue immédiate. La mémoire, seule, si faible, dit que ce labeur servira.
les mots défaillants
tous défaillants, tremblants, comme moi,
comme ce bras à nouveau saisi de paralysé
Je me suis assis sur un rocher habituellement écrasé par le jour. Rocher trempé d’aurore. Maculé de ces taches de bleu vif orange qui éclaboussaient l’horizon. Lichen encore visible le jour, comme ces végétations marines, adhérant aux roches qui attendent l’heure de la marée pour s’épanouir. Un champ de nuages collait aux mêmes rochers, de disques noirs et blancs enchevêtrés, durement échoués comme ces tas de nuages pavés, durement tassés, écrasés les uns contre les autres, très bas. Le plafond bas du ciel. L'écorce du ciel qui se fendille. Le rocher brillait extraordinairement. Comme un bloc de ciel. Criblé de lichen orange. Dans le village, au départ. Pierraille.
pan de pierres écroulées. Mur dur sourd aveugle au-dessus du bol de feu, muet, de la grande tasse d’eau de l’aube.
Le soc rougi qui laboure la terre.
Lumière aigre de la première lampe au fond du village
au centre des toits.
La poésie tire son obscurité de cet effort de transvaser les qualités des choses dans le langage — refusant de les évoquer directement — comme si elles pouvaient exister en dehors de celui qui parle.
Écrire
Parler de la terre. Parler aux hommes, parler, autant se parler à soi-même. On ne sort pas de l’homme. Le reste passe. Et pourtant les seuls êtres différents de soi que l’on puisse concevoir, ce sont les hommes.
Poésie : quand la réalité commence à déserter les images qu’elle a charroyées, et qu’elles apparaissent nues et seules.
Les images nues qu’il faut ramener à la réalité,
légèrement différentes de la réalité première.
Les faits de la réalité trouvent, s’ils sont bien observés, de merveilleuses sonorités dans les mots.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 67, 80, 82-83, 91, 93, 96, 99.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, poésie, écrire, la lampe dans la lumière aride | ![]() Facebook |
Facebook |
28/06/2011
Michel Deguy, "Rencontre culturelle de poésie", dans Brevets
« Rencontre culturelle de poésie »
 […]
[…]
Quand on dit « il y a quelque chose que je n’aime pas chez toi », c’est qu’on n’aime plus le tout — et bientôt plus du tout. C’est ce que ne se disent pas les « spécialistes » ramassés en congrès syncrétique, pas même apparentés, donc, à ceux d’une « équipe scientifique » qui doivent comparer et totaliser en quelque façon les protocoles de labo, les hypothèses et travaux… La poésie, je veux dire ce que des contemporains, qui pensent avoir la modernité dans leur dos, dénotent souvent des termes de « production poétique », devenue inégale à sa réflexion, voire méprisante à l’égard de la « philosophie de la poésie », intolérante même à l’idée d’un débat public agitant le « il y a quelque chose que je n’aime pas chez toi », laisse à l’organisation culturelle le soin de rassembler les « poètes » en participants qui boivent à sa santé, on dit « symposium ».
Que si la puissance culturelle invitante est, d’aventure, le Pays-de-Galles ou la Réunion, on y parlera de « la poésie galloise » ou « réunionnaise » — mais pas de la poésie. Défense de la « minorité », examen statistique des publications en gallois ou en réunionnais, revendication des droits à l’expression, etc.
Quant à la revue : une revue de poésie se trouve confirmée par le culturel en sa spécialité : elle est localisée ; son local est celui des petits-médias (heures creuses, radios libres, rubriques « d’information » dans la feuille de chou, etc.) Naguère elle fut grande Revue (Nord-Sud, Commerce, nrf 1930, etc.) ; c’était avant le culturel ; elle évoquait le tout à son voisinage, elle était fragmentairement encyclopédique, arrogante, etc. N’est-ce donc pas ce qu’une revue « malgré tout » doit reconquérir, repoursuivre ? Faire apparaître « le tout », en emblèmes abyssaux, et en articulation problématique avec ses autres, dans la sphère où elle joue son rôle.
Michel Deguy, Brevets, éditions Champ Vallon, 1986, p. 140-141.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, brevets, poésie, le "culturel", les revues | ![]() Facebook |
Facebook |
26/06/2011
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

Rhétorique : dépouillés de la rhétorique, on ne se bat plus que les poings nus. (Ferblanterie des mythologies, armurerie comique et naturelle, etc.) O finissait par ne plus entendre que le choc des armures. Nous sommes aujourd’hui au point si intéressant, si vif, de nous reconstituer une coquille.
André du Bouchet par Giacometti
Dire : pourquoi est-ce que j’écris, ou veux écrire — pas exactement pour le plaisir, ou combler les trous du temps — ou précisément pour cela — l’oisiveté finit par se contre dire et donner un pouce à des forces. Si elle est appuyée par quelques inconvénients solides sur lesquels on peut compter — en dehors : travail, gymnastique, bonté, etc.
Aujourd’hui, comme chaque jour : il faut que la « poésie » devienne plus (autre chose) qu’un constat ou bien se démette. (Moralité, règle de vie, rythme impératif, non-impérieux — mais le mot est détestable.)
Rhétorique. Le « sonnet » devait être une sorte de garde-fou. Écrits par centaines. Des bonheurs relatifs — et de détail — assez pour rendre heureux dans une certaine mesure — mais dans l’ensemble, une fois bouclé le sonnet, rien de bien moderne, ni qui valait qu’on s’y attache ou s’y abîme. Il n’y avait plus qu’à recommencer. Mallarmé essaie d’en faire un absolu, un gouffre. Il s’y abîme. Tout près, justement, de forcer le langage : il n’écrit qu’une poignée de sonnets , au lieu de la multitude que le genre comporte.
De mon côté écrire des poèmes résolument enracinés dans l’effort de l’homme : il sera parfumé des idées du monde ambiant, choyé par le vent. L’eau lui lavera sa sueur. Mais d’abord lui-même —
(Reverdy. C’est ça la réalité telle que je la sens et la respire : mais il faut tout redécouvrir pour soi, comme si vous n’aviez jamais écrit, jamais rien dit. Mais cela je ne l’aurais jamais aussi bien su si je ne vous avais pas lu.)
ART : perpétuel.
Il n’y aura jamais de terme à cette surprise, à cet étonnement sans précédent que nous donnent un poème, une œuvre d’art, pour aussitôt (à condition de nous avoir donné cette surprise, cet étonnement) rentrer dans tout ce qu’il y a de plus familier. L’homme familier (« miracle dont la ponctualité émousse le mystère », Baudelaire) ne cessera jamais de s’émerveiller de lui-même, de se voir reflété dans les yeux de ses semblables.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955,éditon établie et préfacée par Clément Layet, éditions Le Bruit du Temps, 2011, p. 30, 31, 33, 34, 44, 58, 62.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, carnets, notes sur la poésie, poème, œuvre d'art | ![]() Facebook |
Facebook |
22/06/2011
Ivar Ch'Vavar, Travail du poème
Le réel n’est pas ce que je vois, parce que je ne vois pas ce qui est là (pourtant bien là). Je ne vois rien du tout de ce qui est là. — Ce que j’appelle l’effet de réel, c’est quand je vois ce qui est là. Cela m’arrive. — Soit dans la "réalité" (immédiatement), soit dans une œuvre, par exemple en écoutant un morceau de musique, regardant un tableau ou un film, lisant un poème ou une page de roman. — Je n’ai jamais pu admettre qu’une œuvre soit moins "réelle" que la "réalité". On appelle souvent poésie l’œuvre où se produit un effet de réel : qui fait qu’on accède au réel, une sorte d’"illumination" ou je ne sais pas quoi qui fait qu’on voit, et que soi-même on devient réel, on est, on ne souffre plus du "trop peu de réalité", et c’est l’harmonie des Navahos ou la vie unitive des bouddhistes : le réel… On  peut appeler poésie l’acte créateur qui constitue cette œuvre et donne à travers elle accès au réel… Souvent faut-il l’intercession d’un créateur pour voir ce qui est. Les peupliers de Monet sont là et les vieux souliers de Van Gogh, les rochers de Cézanne, on apprend à voir en regardant ces tableaux ; et la musique de Bach, de Nielsen ou de Schnittke, on apprend à entendre la musique du monde. Le monde est là et un talus de Rimbaud est là, un ciel de Pierre Jean Jouve ; et Thomas Hardy ou Bernanos, Dostoïevski nous montrent des hommes et des femmes réels, et quand on lit Soleil hopi de Talayesa il y a des parois rocheuses qui sont là vraiment, présentes verticalement. — L’art n’a pas d’autre message. Ou s’il en a d’autres, ils n’appartiennent pas au même plan (plan du réel), le seul message de l’art, c’est que le réel est là, qu’il faut seulement tomber de le voir, comme qui dirait, et on est dans l’harmonie, ou l’acuité ou l’évidence, je ne sais pas comment vous appelleriez ça.
peut appeler poésie l’acte créateur qui constitue cette œuvre et donne à travers elle accès au réel… Souvent faut-il l’intercession d’un créateur pour voir ce qui est. Les peupliers de Monet sont là et les vieux souliers de Van Gogh, les rochers de Cézanne, on apprend à voir en regardant ces tableaux ; et la musique de Bach, de Nielsen ou de Schnittke, on apprend à entendre la musique du monde. Le monde est là et un talus de Rimbaud est là, un ciel de Pierre Jean Jouve ; et Thomas Hardy ou Bernanos, Dostoïevski nous montrent des hommes et des femmes réels, et quand on lit Soleil hopi de Talayesa il y a des parois rocheuses qui sont là vraiment, présentes verticalement. — L’art n’a pas d’autre message. Ou s’il en a d’autres, ils n’appartiennent pas au même plan (plan du réel), le seul message de l’art, c’est que le réel est là, qu’il faut seulement tomber de le voir, comme qui dirait, et on est dans l’harmonie, ou l’acuité ou l’évidence, je ne sais pas comment vous appelleriez ça.
Ivar Ch’Vavar, Travail du poème, Préface de Laurent Albarracin, édition des Vanneaux, 2011, p. 121.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivar ch'vavar, travail du poème, réel, message de l'art | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2011
Jude Stéfan, Grains & issues
 Et la poésie, elle ? Elle exige une distance dans le langage — on ne poétise pas comme on élabore un roman ou rédige un pamphlet —, elle ne peut répondre à un effort direct, né de la vie même, qui s’inscrirait sitôt en des données verbales propres au scandale ou à la rage de l’être : elle requiert une forme. (À l’opposé de cet artefact D. Collobert a écrit des instants vécus, ponctués de tirets, d’enchaînements de perceptions et sensations unissant vie et écriture, parce qu’elle souffrait cette incapacité d’engagement réel, de témoignage incarné dans le poème, qui l’a menée à son propre renoncement, à ce niveau extrême la littérature étant perçue impossible parce que générale, impersonnelle, négatrice du Soi).
Et la poésie, elle ? Elle exige une distance dans le langage — on ne poétise pas comme on élabore un roman ou rédige un pamphlet —, elle ne peut répondre à un effort direct, né de la vie même, qui s’inscrirait sitôt en des données verbales propres au scandale ou à la rage de l’être : elle requiert une forme. (À l’opposé de cet artefact D. Collobert a écrit des instants vécus, ponctués de tirets, d’enchaînements de perceptions et sensations unissant vie et écriture, parce qu’elle souffrait cette incapacité d’engagement réel, de témoignage incarné dans le poème, qui l’a menée à son propre renoncement, à ce niveau extrême la littérature étant perçue impossible parce que générale, impersonnelle, négatrice du Soi).
Ces questions ne naissent que d’une croyance naïve en un sujet. Quel est le sujet dans le poème ou le texte — le substrat personnel et fictif ? Beaucoup se croient « auteurs », comme on dit dans les manuels, alors que la littérature est une puissance anonyme de langage, ou j’ « engage » ma propre mort originelle, en toute perte. Même pas contemporain de moi-même, selon Mallarmé, ailleurs, quelque part dans l’espace virtuel qu’est l’écriture vaine, un simulacre de vérité.
Jude Stéfan, « De l’engagement (ou la poésie, elle), dans Grains & issues, La ligne d’ombre, 2008, p. 64-65.
© photo Tristan Hordé
envoi
outre les cendres
au soir d’un beau jour
il n’y a plus le sentiment
du temps ou des choses il
n’y a plus que la lettre
phrases et tablettes
brûlées les seules questions
dieu, la mort, le temps, l’amour,
la mer, le trou
où jouir et naître
pourquoi jadis ces sourcils fournis
adieu riantes peintures
Sertorius et Pompée
les mouches d’été
Jude Stéfan, Caprices, Gallimard, 2004, p. 81.
p. de Virgule
j’ai longtemps médité sur ta nudité
le mur était enlacé de lierre le
même qui dévorerait ta rouille
mes mains froides à ton flanc battant
et les rides sur ton visage attendant
puis nous nous crucifiions soudain
en pleurs comme emprisonnés aheurtés à
nos parois de chair, j’ai longtemps cher-
ché ta tombe désertée toutes tes âmes
mortes qui riaient et qui chantaient
dans les dimanches Toi seule m’étrei-
gnais le membre en chemin je mange enco-
re ta lourde langue Olga ma tante ma
Suzeraine
Jude Stéfan, La Muse province (76 proses en poèmes), Gallimard, 2006, p. 15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, grains & issues, la poésie, caprices, la muse province | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2011
Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure

Chanson du dernier enfant juif
Mon père est pendu à l’étoile,
ma mère glisse avec le fleuve,
ma mère luit
mon père est sourd,
dans la nuit qui me renie,
dans le jour qui me détruit.
La pierre est légère.
Le pain ressemble à l’oiseau
et je le regarde voler.
Le sang est sur mes joues.
Mes dents cherchent une bouche moins vide
dans la terre ou dans l’eau,
dans le feu.
Le monde est rouge.
Toutes les grilles sont des lances.
Les cavaliers morts galopent toujours
dans mon sommeil et dans mes yeux.
Sur le corps ravagé du jardin perdu
fleurit une rose, fleurit une main
de rose que je ne serrerai plus.
Les cavaliers de la mort m'emportent.
Je suis né pour les aimer.
Edmond Jabès, Chanson pour le repas de l’ogre, dans Je bâtis ma demeure, Poèmes 1943-1957, Préface de Gabriel Bounoure, postface de Joseph Guglielmi, Gallimard, 1959, p. 69.

Autour d’un mot comme autour d’une lampe. Impuissant à s’en défaire, condamné, insecte, à se laisser brûler. Jamais pour une idée mais pour un mot. L’idée cloue le poème au sol, crucifie le poète par les ailes. Il s’agit, pour vivre, de trouver d’autres sens au mot, de lui en proposer mille, les plus étranges, les plus audacieux, afin qu’éblouis, ses feux cessent d’être mortels. Et ce sont d’incessants envols et de vertigineuses chutes jusqu’à l’épuisement.
Parler de soi, c’est toujours embarrasser la poésie.
Il y a des êtres qui, leur vie durant, sont demeurés la tache d’encre au bout d’une phrase inachevée.
Un jour, la poésie donnera aux hommes son visage.
Le lecteur seul est réel.
La poésie est fille de la nuit. NOIRE. Pour la voir il faut ou braquer sur elle une lampe de poche — c’est pourquoi, figée dans sa surprise, elle apparaît à nombre de po ètes comme une statue — ou bien, fermer les yeux pour épouser la nuit. Invisible, puisque noire dans le noir, pour se manifester à vous, la poésie fera usage alors, de sa voix. Le poète se laissera fléchir par elle. Il ne s’étonnera plus lorsque, confiante, cette voix, pour lui, prendra la forme d’une main : il lui tendra les siennes.
Lorsque les hommes seront d’accord sur le sens de chaque mot, la poésie n’aura plus de raison d’être.
À l’approche du poème, aurore et crépuscule redeviennent la nuit, le commencement et le bout de la nuit. Le poète y jette alors son filet, comme le pêcheur à la mer, afin de saisir tout ce qui évolue dans l’invisible, ces myriades d’êtres incolores, sans souffle et sans poids, qui peuplent le silence. Il s’emparera, par surprise, d’un monde défendu dont il ignore les limites e tla puissance et surtout l’ empêchera, une fois pris de périr ; les êtres qui le composent, comme les poissons, préférant la mort à la perte de leur royaume.
Hanté par chaque ombre perpétuée indéfiniment, il déchire un rideau de velours, paupière du secret.
La poésie n’a qu’un amour : La poésie.
Edmond Jabès, Les mots tracent, dans Je bâtis ma demeure, Poèmes 1943-1957, Préface de Gabriel Bounoure, postface de Joseph Guglielmi, Gallimard, 1959, p. 156, 157, 158, 158, 159, 163, 164, 165, 165.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, je bâtis ma demeure, chanson du dernier enfant juif, art poétique | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2011
Jean Tardieu, Da capo, Margeries
La voix
 Il me semble avoir, toute ma vie, entendu une certaine voix, étrangère à moi-même et pourtant très intime, qui me parle par intermittence et ne peut pas ou ne sait pas, ou ne veut pas me dire tout ce qu’elle sait. Un guide quelquefois, parfois aussi un abîme, un conseil dangereux, mais toujours une vérité revenue de très loin, exigeante et irréfutable, une sorte de démon de la conscience, de la connaissance (ou plutôt de l’inconnaissance), m’imposant le devoir absolu de transcrire avec soin, ses injonctions, ses plaintes et même ses menaces.
Il me semble avoir, toute ma vie, entendu une certaine voix, étrangère à moi-même et pourtant très intime, qui me parle par intermittence et ne peut pas ou ne sait pas, ou ne veut pas me dire tout ce qu’elle sait. Un guide quelquefois, parfois aussi un abîme, un conseil dangereux, mais toujours une vérité revenue de très loin, exigeante et irréfutable, une sorte de démon de la conscience, de la connaissance (ou plutôt de l’inconnaissance), m’imposant le devoir absolu de transcrire avec soin, ses injonctions, ses plaintes et même ses menaces.
Lorsque à mon tour, c’est moi qui interroge et qui demande : « Pour qui ? Pour quoi ? Dans quel but ? », cette voix ne répond pas, mais elle a du moins le pouvoir de me communiquer une certitude obscure : c’est que (peut-être dans ce monde, peut-être hors de ce monde), il existe une région sereine et innocente où tout est su, compris et consommé d’avance. Où la rencontre d’un seul avec tous est non seulement possible mais attendue depuis toujours. Au-delà de toute vie et de tout déclin, de toute présence et de toute absence, de toute joie, de toute douleur, au-delà même de toute parole, une « réconciliation » avec ce qui nous dépasse et nous dévore. La fusion et le retour des êtres séparés qui se retrouvent dans l’unité, dans l’absence originelle.
Jean Tardieu, Da capo, Gallimard, 1995, p. 35.
La tête vide
Dans les chemins creux et perdus
je suis homme parmi les hommes
Point d’ombre plus haute que moi
point d’écho plus long que la voix
j’ai l’épaisseur de la surface
Plus léger que feuille d’automne
sous le murmure de l’oubli
qui passe à travers les mains vides
habillé de soleil
et d’incompréhensible
silence dans les branches.
(1944)
Jean Tardieu, Margeries, Gallimard, 1986, p. 228.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, da capo, margeries, la voix | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2011
Guillevic, Art poétique, Terraqué
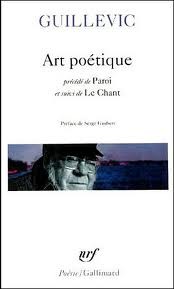
Qu’est-ce qu’il t’arrive ?
Il t’arrive des mots
Des lambeaux de phrase.
Laisse-toi causer. Écoute-toi
Et fouille, va plus profond.
Regarde au verso des mots
Démêle cet écheveau.
Rêve à travers toi,
À travers tes années
Vécues et à vivre.
Ce que je crois savoir,
Ce que je n’ai pas en mémoire,
C’est le plus souvent,
Ce que j’écris dans mes poèmes.
Comme certaines musiques
Le poème fait chanter le silence,
Amène jusqu’à toucher
Un autre silence,
Encore plus silence.
Dans le poème
On peut lire
Le monde comme il apparaît
Au premier regard.
Mais le poème
Est un miroir
Qui offre d’entrer
Dans le reflet
Pour le travailler,
Le modifier.
— Alors le reflet modifié
Réagit sur l’objet
Qui s’est laissé refléter.
Chaque poème
A sa dose d’ombre,
De refus.
Pourtant, le poème
Est tourné vers l’ouvert
Et sous l’ombre qu’il occupe
Un soleil perce et rayonne,
Un soleil qui règne.
Mon poème n’est pas
Chose qui s’envole
Et fend l’air,
Il ne revient pas de la nue.
C’est tout juste si parfois
Il plane un court moment
Avant d’aller rejoindre
La profondeur terrestre.
Guillevic, Art poétique, dans Art poétique, précédé de Paroi et suivi de Le Chant, préface de Serge Gaubert, Poésie / Gallimard, 2001, p. 166, 172, 177, 178,180 et 184.
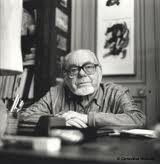
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, art poétique, terraqué, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2011
Hilde Domin, A quoi bon la poésie aujourd'hui
À quoi bon la poésie aujourd’hui
 À quoi bon la poésie aujourd’hui ? Pourquoi lire de la poésie, pourquoi écrire des poèmes ? Poser cette question, c’est presque sous-entendre : aujourd’hui encore — comme si hier, ce pourquoi nous avons à nous excuser aujourd’hui avait eu, peut-être, un sens.
À quoi bon la poésie aujourd’hui ? Pourquoi lire de la poésie, pourquoi écrire des poèmes ? Poser cette question, c’est presque sous-entendre : aujourd’hui encore — comme si hier, ce pourquoi nous avons à nous excuser aujourd’hui avait eu, peut-être, un sens.
Deux réponses extrêmes sautent à l’esprit, négatives toutes les deux. La première récuse la question : il n’y a pas d’ « à quoi bon » qui fasse, la poésie, comme toute forme d’art, est à elle-même son propre but. Aujourd’hui et toujours. Or c’est bien là l’enjeu : tout ce qui importe vraiment est à soi-même sa propre fin, donc à la fois inutile et essentiel. Et peut-être même plus essentiel aujourd’hui que jamais. La poésie aussi. Il s’agira bien d’avancer ici la preuve de cette nécessité, d’explorer ce qu’elle peut signifier.
La seconde réponse récuse l’objet : à l’époque où nous vivons, il convient de s’occuper de choses plus utiles, il convient de « changer le monde ». Or, dit-on, l’art ne change pas le monde. On ferait bien de se plonger dans les pages politiques des journaux au lieu de lire ou d’écrire des poèmes. Proposition qui non seulement ne représente pas une véritable alternative, mais au fond, se borne à reprendre le postulat d’Adorno, répété à satiété et démenti depuis longtemps, selon lequel la poésie aurait été rendue impossible par Auschwitz. Autrement dit, la poésie ne saurait être à la hauteur de la réalité particulière de notre temps.
Je répète ma question tout en la précisant : la poésie a-t-elle encore une fonction dans la réalité de notre vie moderne ? Et si oui, laquelle ?
Formulé de la sorte, notre sujet sera : poésie et réalité. Ou encore : poésie et liberté.
Car pour peu que l’on envisage la poésie comme un exercice de liberté, on rejoint déjà l’autre question, celle de la transformation de la réalité. Au contraire de l’art, en effet, la transformation de la réalité n’est pas une fin en soi, mais elle est au service de la liberté potentielle de l’homme, au service de son humanité. Sinon, elle est sans intérêt. Dans ce sens, les deux questions tournent autour du même axe.
En tout cas, c’est la réalité qui est en cause (1). Je citerai Joyce, qui annonçait sa décision de se vouer à l’écriture dans les termes suivants : « I go to encounter for the millionth time the reality of experience [Je vais affronter pour la millionième fois la réalité de l’expérience] ».
Jamais encore, semble-t-il, la réalité n’a été aussi perfide que celle qui nous entoure aujourd’hui. Elle menace de détruire la réciprocité entre elle et nous, elle menace, d’une manière ou d’une autre, de nous anéantir. C’est le danger le plus subtil qui semble presque le plus inquiétant : il existe sans exister. Tout le monde en parle. Personne ne le rapporte à soi. Ce danger s’appelle la « chosification », c’est notre métamorphose en une chose, en un objet manipulable : la perte de nous-mêmes.
La poésie peut-elle encore nous aider à affronter une telle réalité ?
[…]

Hilde Domin (1909-2006)
Le poète nous offre une pause pendant laquelle le temps s’arrête. C’est-à-dire que tous les arts offrent cette pause. Sans cette « minute pour l’imprévu », selon la formule de Brecht, sans ce suspens pour un « agir » d’une autre sorte, sans la pause pendant laquelle le temps s’arrête, l’art ne peut être ni accueilli, ni compris, ni reçu. Sur ce point, l’art s’apparente à l’amour : l’un et l’autre bouleversent notre sentiment du temps.
C’est à partager une expérience non pas identique mais similaire, que les différents arts nous invitent sur l’île de leur temporalité spécifique — cette île dont on parle régulièrement et qui existe déjà chez Mallarmé et Hofmannsthal, l’île qui surgit au milieu du tourbillon de la vie active pour n’exister que quelques instants, le temps de reprendre haleine. Qu’offre donc la poésie, sur le sol précaire qui affleure ici : ce singulier mariage de rationalité et d’excitation, cet art de la parole et du non-dit ?
La poésie nous invite à la rencontre la plus simple et la plus difficile qui soit : la rencontre avec nous-mêmes. […] La poésie ne donne que l’essence de ce qui arrive aux hommes. Elle nous relie à la part de notre être qui n’est pas touchée par les compromis, à notre enfance, à la fraîcheur de nos réactions. Je dis « de nos réactions » pour ne pas dire de notre émotion, bien que je rejoigne ici un poète aussi froid et cérébral que, par exemple, Jorge Guillén. « Tu niñez / Ya fábula de fuentes » — « ton enfance / déjà légende de sources ». Et du fait que la poésie nous relie à nous-mêmes, à notre propre moi, elle nous relie aussi aux autres, elle nous restitue notre aptitude à communiques. C’est cela, à mon avis, que la poésie peut nous offrir — à une degré plus haut que tout autre art, et que tout autre occupation de l’esprit.
Hilde Domin, "À quoi bon la poésie aujourd’hui", traduit de l’allemand par Marion Graf, dans La Revue de belles-lettres, éditons Médecine et Hygiène, Chêne-Bourg (Suisse), 2010, I-2, p. 233-234, 235 et 236.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hilde domin, poésie et réalité, poésie et expérience | ![]() Facebook |
Facebook |





