05/12/2011
Roger Giroux, L'arbre le temps

Que bâtirais-je avec ma langue ?
Quel palais fou de désespoir ?
Hanté d'absence immobiles ?
Quelle ville, vouée, dès jadis
Aux purs silences de l'oubli ?
Arbre, amour, solitude, poussière...
Et c'est comme si je n'existais pas
Dans cette immensité qui me sépare de moi-même
Dans l'intouchable de ce lieu
Frémissant, monstrueux...
NEUTRE : être nu.
Parole neutre, parole nue, parole non à dire, parole non dite. Et disant cette parole non dite, l'œil s'ouvre dans la vision non plus œil dit, vision dite, mais œil et vision confondus dans le non dit. (Et la parole non-dite doit être, et DONC est dite, sinon elle ne serait pas « non-dite »). Parole incorrigible, et qui ne revient pas deux fois sur ses traces, parole écrite sur une surface toujours blanche, combustible. (Parole qui brûle tout sur son passage, et soi-même ; qui se détruit en se proférant ; qui n'existe que pour n'être pas. Cette parole : un feu qui se dévore, et ne laisse dans la bouche qu'un goût de cendre ; qui ne laisse de la bouche que cendre).
Roger Giroux, L'arbre le temps, suivi de Lieu-je et de Lettre,
Mercure de France, 1979, p. 41 et 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger giroux, l'arbre le temps, neutre | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2011
René Char, Fenêtres dormantes sur le toit

Le poème sur son revers, femme en besogne à qui les menus objets domestiques sont indispensables. La richesse et la parcimonie.
Avant de se pulvériser, toute chose se prépare et rencontre nos sens. Ce temps de préparatifs est notre chance sans rivale.
Il en faut un, il en faut deux, il en faut... Nul ne possède assez d'ubiquité pour être son contemporain souverain.
Peindre l'intimité par le défaut du fumeux intérieur. Nos yeux filtrants s'y essaient.
La poésie ose dire dans la modestie ce qu'aucune autre voix n'ose confier au sanguinaire Temps. Elle porte aussi secours à l'instinct en perdition. Dans ce mouvement, il advient qu'un mot évidé se retourne dans le vent de la parole.
La grâce d'aller chaque fois plus avant, plus nu en nommant le même objet de demi-jour qui amplement nous figure, c'est à la lettre reprendre vie.
René Char, Fenêtres dormantes et portes sur le toit, Gallimard, 1979, p. 12, 13, 16, 17, 18-19, 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené car, fenêtres dormantes sur le toit, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2011
Michel Leiris, Le Ruban au cou d'Olympia

À main droite
ma manie de manipuler,
démantibuler,
désaxer et malaxer les mots,
pour moi mamelles immémoriales,
que je tète en ahanant.
Murmure barbare, en ma Babel,
tu me tiens saoul sous ta tutelle
et, bavard balourd, je balbutie.
À main gauche, mes machins,
mes zinzins,
mes zizanies,
les soucis (chichis et chinoiseries) qui me cherchent noise,
mes singeries, momeries et moraleries.
Ô gagâchis qu'agacé j'ai sagacement jaugé et tout de go gommé,
jugeant superfétatoirement enquiquinant son chuchotis ?
Au milieu
le mal mou qui me moud,
me mord,
me lime, m'annule,
m'humilie
et que, miel amer, je mettrais méli-mélo à mille lieues mijoter,
mariner,
macérer.
N'a-t-il dit que ce monde dément demande un démenti,
le démon qui m'enmantèle, m'enmêle et me démantèle.
Qu'est-ce que, pratiquement, je poursuis ?
— La combinaison de mots, phrases, séquences, etc., que je suis seul à pouvoir bricoler et qui — dans ma vie pareille, comme toute autre, à une île où les conditions d'existence ne cessent d'empirer — serait mon vade-mecum de naufragé, me tenant lieu de tout ce qui permet à Robinson de subsister : caisse d'outils, Bible, voire Vendredi (si je dois finir dans une solitude à laquelle je n'aurai pas le cœur d'apporter le catégorique remède).
... Ou plutôt ce qui me fascine, c'est moins le résultat, et le secours qu'en principe j'en attends, que ce bricolage même dont le but affiché n'est tout compte fait qu'un prétexte. Au point exact où les choses en sont au-dedans comme au dehors de moi, quoi d'autre que ce hobby pourrait m'empêcher de devenir un Robinson qui, travaux nourriciers expédiés, ne ferait plus que se glisser vers le sommeil, sans même regarder la mer ?
Michel Leiris, Le Ruban au cou d'Olympia, Gallimard, 1981, p. 176-177 et 195.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, le ruban au cou d'olympia, jeu de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
25/11/2011
Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue
 Qu'un mot puisse être perdu, cela veut dire : la langue n'est pas nous-mêmes. Que la langue en nous est acquise, cela veut dire : nous pouvons connaître son abandon. Que nous puissions être sujets à son abandon, cela veut dire que le tout du langage peut refluer sur le bout de la langue. Cela veut dire que nous pouvons rejoindre l'étable ou la jungle ou l'avant-enfance ou la mort.
Qu'un mot puisse être perdu, cela veut dire : la langue n'est pas nous-mêmes. Que la langue en nous est acquise, cela veut dire : nous pouvons connaître son abandon. Que nous puissions être sujets à son abandon, cela veut dire que le tout du langage peut refluer sur le bout de la langue. Cela veut dire que nous pouvons rejoindre l'étable ou la jungle ou l'avant-enfance ou la mort.
En jouant sur le mot qui se tient sur le bout de la langue, je ne joue pas sur les mots. Je ne tire pas par les cheveux de cette femme la tête érigée en l'air, étendant le bras dans un suspens comparable aux gestes des patriciennes effrayées devant le phallus voilé de la Villa des Mystères. La non-domination du souvenir d'un nom néanmoins connu ou d'une idée qu'on ressent en l'absence de ses signes — qu'on ne ressent pas vraiment mais qui brûle : «Je brûle ! Je brûle ! » — est la non-domination de soi et est l'ombre portée de la mort pour peu qu'on ne remette pas la main sur le mot qui fuit. C'est cette main dans le silence. C'est cette prédation silencieuse. Écrire, trouver le mot, c'est éjaculer soudain. Ce sont cette rétention, cette contention, cette arrivée soudaine.
C'est approcher non par le feu — « Je brûle ! » — mais le foyer central où le feu prend sa flamme.
Le poème est ce jouir. Le poème est le nom trouvé. Le faire-corps avec la langue est le poème. Pour procurer une définition précise du poème, il faut peut-être convenir de dire simplement : le poème est l'exact opposé du nom sur le bout de la langue.
Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue, P. O. L, 1993, p. 60, 76-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, le nom sur le bout de la langue | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2011
James Sacré, Un paradis de poussière (note de lecture)
James Sacré voyage en s'installant dans une région : il la parcourt sans hâte, observe les paysages, les manières de vivre de se déplacer et d'habiter les lieux, le travail des hommes, et il se nourrit avec les uns et les autres. Ce n'est pas dire qu'Un Paradis de poussières serait un ouvrage d'ethnologue..., c'est bien un livre de poète, construit avec une alternance d'ensembles consacrés au voyage et aux rencontres (18), et des parties lyriques (14) titrées chaque fois "Geste parlé", qui sont des adresses amoureuses à l'Autre.
Il n'est pas nécessaire de connaître l'œuvre de James Sacré pour accueillir cette nouvelle plongée dans le Maroc de Sidi Slimane. On en sort pour des moments à Larache pour la tombe de Jean Genet, un voyage jusqu'à Sakiet Sidi Youssef en Tunisie pour se recueillir en pensant au bombardement de l'armée française le 8 février 1958 ; on revient en France à l'Institut du Monde Arabe ou, à Toulouse, pour un hommage au grand écrivain Edmond Amran El Maleh. Le lecteur des précédents livres ne se retrouvera pas dans du "déjà lu", mais reconnaîtra des motifs propres à ce qui, au fil du temps, est devenu une œuvre : le discours amoureux, la tendresse pour les animaux et les hommes, le questionnement sur la mémoire et sur l'écriture1, les tentatives de nouer les noms de couleur comme sur une toile — ce qui se résout provisoirement par une rencontre avec le peintre Khalil El Ghrib2 —, et sans doute le plus apparent ; le plaisir d'écrire une certaine manière de renaître lors de chacun des séjours au Maroc.
On entre d'emblée dans le livre comme s'il s'agissait d'une relation de voyage. On débute par des notations sur «l'activité marchande» avec «toutes sortes de petites silhouettes», «des camions pleins de couleurs». C'est le jeu des couleurs de ces camions qui arrête le regard, la juxtaposition et l'entrelacement du rouge, du vert, de l'orange, du blanc, du jaune..., « ça fait / Beaucoup de couleurs, et des formes, qui échappent aux mots ». Ce sont les mouvements des uns et des autres, petits marchands d'eau, de figues de barbarie, de beignets, d'escargots, vendeurs de menthe, enfants, chalands oisifs qui sont croqués, et « À vrai dire on pourrait écrire sans fin ». La description ne peut qu'être indécise, toujours à reprendre, à rectifier pour tenter de restituer quelque chose du vivant : une couleur, une forme, un mouvement, des bruits de la rue. Dans chaque "geste parlé", c'est encore la difficulté de parler à l'autre (et de l'entendre vraiment) qui apparaît : « On finit par s'inventer des formules qui ont l'air de dire / Mais on ne sait pas ce qu'elles disent ».
Les deux temps du livre, le récit et le geste parlé, pourraient être perçus comme nettement séparés si l'on se tenait aux titres ; on passe par exemple de "Un soir on a sorti deux chaises devant la porte" à "Ce qu'on mêle en échangeant des mots", ou de "Les gens sont là, pas loin" à "Le mot rien dans le mots vivant". Cependant, dans chaque temps on retrouve une tension analogue : il y a d'une part le désir de "donner à voir", d'autre part celui d'exprimer simplement la complexité d'une relation amoureuse, et le doute de parvenir à noter quelque chose de la réalité telle qu'elle est ou telle qu'elle a été vécue. Dans cette interrogation sur la portée du regard attentif ou amoureux, le lecteur est même introduit dans un poème : « C'est trop descriptif ton poème que tu diras, / Ces vagues mots sur la misère de l'endroit » ; réponse est faite à ce lecteur pour qu'il lise autrement et attache moins d'importance au récit qu'à l'émotion qui en est à la source :
Le poème n'est-il que des mots ? Pour les disposer ainsi, selon un rythme et des arrangements divers,
N'a-t-il pas fallu quelque transport de cœur, fût-ce
Dans le plus grammatical déguisement des phrases ?
Écrire
C'est toujours plus qu'écrire.
Ce qui ne peut venir dans le poème, c'est l'homogène, l'unité de sens. Peut-être l'écrit aide-t-il à ce que le lecteur « s'imagine un peu » ce qui a été vu, mais il ne peut ignorer que le "monde", le rapport à l'Autre n'entrent pas dans les mots. James Sacré ne parvient pas plus à saisir avec la photographie ce qu'il sait devoir toujours lui échapper, il regrette d'ailleurs que ses photographies soient « le plus souvent mal prises ». Ce qui reste, c'est toujours « De la poussière de mots, un poème », la « poussière du poème ». La réalité s'enfuit, même quand est noté ce qui est regardé, et bien plus fragiles encore sont les images du passé : autre poussière, « Poussière du temps, tamis / De la mémoire ». Des moments de la campagne marocaine, des gestes du travail, une couleur de la terre dérangent la durée vécue et rapportent à un temps aboli :
On comprend mieux tout d'un coup que la campagne est pas loin,
Pas si loin non plus (qu'est-ce qui s'en va ?)
Celle que labourait mon père
Avec la même sorte de petit tracteur [...]
C'est aussi le souvenir du village natal en Vendée, le jardin près de la maison, la sieste de la mère qui resurgissent, et les bruits entendus dans la vilel marocaine lui semblent « comme un prolongement des jours de foire aux bestiaux à Coulonges-sur-l'Autize » — « la drôle de charpie que c'est le temps », mais seul 'écrit permet d'évoquer ce « paradis dans la bouche » qu'est le couscous partagé dans un village. Les mots sont « une couture au temps » ; ce sont les mots de l'enfance, régionaux ou appartenant à des techniques anciennes qui viennent à propos des choses du Maroc : "ranche", "cenelle" ou "dorne" : « [...] comme si la terre / Ouvrait sa dorne [= son giron] remplie d'une histoire [...] ».
Sans doute le livre est toujours à faire puisque le poème est là pour « remettre de l'ordre dans le monde »...
James Sacré, Un paradis de poussière, Marseille, André Dimanche, 2007.
Publié dans MARGINALIA, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, un paradis de poussière | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2011
Henri Lefebvre, Les Unités perdues
 [...] Perdu l'atelier de Guy Levis Mano, 6 rue Huyghens à Paris · Cervantès disait de lui-même qu'il fallait aussi l'admirer pour ce qu'il n'a pas écrit · On ne sait où, ni comment, Baruch de Spinoza apprit à polir les verres optiques ; à la fin de sa vie, le philosophe écrit un Traité de l'iris qu'il jette ensuite au feu, sans doute pour un problème de censure · En 1889, Fernand Drujon publie Essai bibliographique sur la destruction volontaire des livres ou Bibliolytie · Il n'existe aucun ouvrage en français sur l'insurrection ouvrière de l'été 1951 à Berlin Est · Les dix-huit derniers mois de sa vie, le peintre suisse Andréas Walser les dépense à Paris, peignant près de deux cents tableaux ; il meurt en 1930 à vingt-deux ans, les deux tiers de son œuvre ont disparu. · Les manuscrits déchirés par W. B. Yeats pour obtenir les versions «heureuses» de Deirdre et de On Baile's Strand · Out in the World, roman inachevé et non publié de Jane Bowles · Chinese Series, film inachevé de Stan Brakhage · La plupart des œuvres de jeunesse de Nicolas de Staël ont été détruites · Les réponses écrites de Gisèle Prassinos aux lettres de son éditeur Henri Parisot ont été perdues · La Société des Auteurs de Grande-Bretagne publie une enquête menée auprès de neuf cent cinquante-quatre écrivains sur les relations entretenues avec leurs éditeurs ; au premier rang des plaintes : la perte ou le vol des manuscrits · «Est-il mort le secret perdu dans Atlantis ? », question sans réponse posée par les poètes du Grand Jeu · [...]
[...] Perdu l'atelier de Guy Levis Mano, 6 rue Huyghens à Paris · Cervantès disait de lui-même qu'il fallait aussi l'admirer pour ce qu'il n'a pas écrit · On ne sait où, ni comment, Baruch de Spinoza apprit à polir les verres optiques ; à la fin de sa vie, le philosophe écrit un Traité de l'iris qu'il jette ensuite au feu, sans doute pour un problème de censure · En 1889, Fernand Drujon publie Essai bibliographique sur la destruction volontaire des livres ou Bibliolytie · Il n'existe aucun ouvrage en français sur l'insurrection ouvrière de l'été 1951 à Berlin Est · Les dix-huit derniers mois de sa vie, le peintre suisse Andréas Walser les dépense à Paris, peignant près de deux cents tableaux ; il meurt en 1930 à vingt-deux ans, les deux tiers de son œuvre ont disparu. · Les manuscrits déchirés par W. B. Yeats pour obtenir les versions «heureuses» de Deirdre et de On Baile's Strand · Out in the World, roman inachevé et non publié de Jane Bowles · Chinese Series, film inachevé de Stan Brakhage · La plupart des œuvres de jeunesse de Nicolas de Staël ont été détruites · Les réponses écrites de Gisèle Prassinos aux lettres de son éditeur Henri Parisot ont été perdues · La Société des Auteurs de Grande-Bretagne publie une enquête menée auprès de neuf cent cinquante-quatre écrivains sur les relations entretenues avec leurs éditeurs ; au premier rang des plaintes : la perte ou le vol des manuscrits · «Est-il mort le secret perdu dans Atlantis ? », question sans réponse posée par les poètes du Grand Jeu · [...]
Henri Lefebvre, Les Unités perdues, Manuella éditions, 2011, p. 82-84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
31/10/2011
Michel Leiris, Journal, 1922-1989
 Contre la tendance (ou mieux : les prétentions) totalitaire du surréalisme : l'artiste n'a pas à se mêler à tout prix de tous les problèmes du jour (qu'il envisage fatalement sous un angle esthétique, mettant de l'art partout, infestant toutes choses, — alors qu'à l'origine il se proposait de nier l'art en abattant ses barrières (ce faisant, il n'a réussi qu'à libérer, rendre plus pernicieux le fauve)) ; il ne doit pas non plus viser à l'art pur, s'enfermer dans sa tour d'ivoire, se mettre en cage ; simplement, qu'il se pose tous les problèmes du jour, mais qu'il les résolve à sa manière, selon ses moyens propres. Échec pratique de Dada qui, supprimant ces barrières, n'a amené que la pire confusion, le mélange de l'esthétisme à tout.
Contre la tendance (ou mieux : les prétentions) totalitaire du surréalisme : l'artiste n'a pas à se mêler à tout prix de tous les problèmes du jour (qu'il envisage fatalement sous un angle esthétique, mettant de l'art partout, infestant toutes choses, — alors qu'à l'origine il se proposait de nier l'art en abattant ses barrières (ce faisant, il n'a réussi qu'à libérer, rendre plus pernicieux le fauve)) ; il ne doit pas non plus viser à l'art pur, s'enfermer dans sa tour d'ivoire, se mettre en cage ; simplement, qu'il se pose tous les problèmes du jour, mais qu'il les résolve à sa manière, selon ses moyens propres. Échec pratique de Dada qui, supprimant ces barrières, n'a amené que la pire confusion, le mélange de l'esthétisme à tout.
Qu'il y ait pour l'individu une mort sans au-delà, et pour le monde une fin par retour à l'équilibre, enlève aux choses tout « sérieux ». Et c'est pourquoi l'on ne peut parler que de « jeu ».
Que tout soit jeu, cela veut dire que tout est théâtre, simulation, illusion, etc., et qu'en somme « tout n'est que vanité ». Sûr de cela comme je le suis, je pourrais être un pataphysicien conséquent, qui tiendrait pour allant de soi que toutes les solutions sont imaginaires, donc égales entre elles et finalement égales à zéro (car une solution, pour être quelques chose, doit être la solution juste, à l'exclusion des autres). Ainsi, l'idée que je ne fais que jouer mon propre jeu — solution imaginaire entre autres solutions imaginaires — selon mon propre système de valeurs ou choix originel ne me gênerait nullement. Mais le fait est — et là est ma contradiction — que j'éprouve un désir impérieux de justifier objectivement ce système subjectif, de lui trouver des fondements qui dépassent ma propre personne et soient pour mes actions des sortes de lettres de créance, ce qui revient à transformer le jeu en quelque chose de sérieux, de non gratuit, et donc à récuser le côté « bon plaisir » sans lequel il n'est pas de jeu.
Question : une œuvre d'art peut-elle (à elle seule) donner la joie quasi-extatique que donne parfois un spectacle naturel ?
— Il semblerait que non. Mais le spectacle naturel donnerait-il cette joie s'il ne renvoyait à des œuvres qu'on a vues ou à des lectures qu'on a faites ?
Vœu : rester capable de « faire l'art »quand on n'est plus en âge de faire l'amour.
Michel Leiris, Journal, 1922-1989, édition établie, présentée et annotée par Jean Jamin, Gallimard, 1992, 26 décembre 1935, p. 294, 22-24 août 1969, p. 639, 17 août 1977, p. 683.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, jean jamin journal, art et engagement | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2011
Ezra Pound, ABC de la lecture, traduit par Denis Roche
Ezra Pound a précisé que son A B C de la lecture « ne s’adresse pas à ceux qui sont déjà arrivés à une pleine connaissance du sujet sans en connaître les données ».

QUAND ON SE MET À ÉCRIRE on imite toujours quelque chose qu’on a entendu ou lu.
La majorité des écrivains ne dépasse jamais ce stade.
La véritable éducation ne devrait être confiée qu’aux hommes qui INSISTENT sur le savoir, le reste est affaire de gardiens de moutons.[…] Il faut beaucoup d’expérience pour qu’un homme soit capable de définir une chose dans son propre genre, c’est-à-dire définir la peinture comme peinture, l’écriture comme écriture. On identifie tout de suite le mauvais critique à ce qu’il commence par discuter du poète et non du poème.
Le mauvais poète fait de la mauvaise poésie parce qu’il ne perçoit pas les relations de temps. Il est incapable d’en jouer de manière intéressante, par le moyen des brèves et des longues, des syllabes dures ou molles et des diverses qualités du son qui sont inséparables des mots de son discours.
On ne peut tout mettre en quarante-cinq pages. Mais même si j’avais eu Quatre cent cinquante pages à ma disposition, je n’aurais certes pas écrit un traité convaincant sur l’art du roman. Je n’ai pas écrit de bon roman. Je n’ai pas écrit de roman. Je n’ai pas l’intention d’écrire de romans et je ne dirai à personne comment s’y prendre tant que je n’en aurai pas écrit un moi-même.
Ezra Pound, ABC de la lecture, traduit de l’anglais par Denis Roche, Gallimard, 1967, p. 66, 75, 80 et 179.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, abc de la lecture, denis roche | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2011
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts
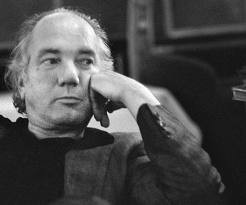 Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
De toute ma vie je ne me suis jamais libéré par l’écriture. Si tel avait été le cas, il ne resterait rien. Et que ferais-je de la liberté que j’aurais obtenue ? Je ne suis pas du tout partisan de la délivrance. Du cimetière peut-être. Mais non, je ne crois pas à cela non plus, parce qu’alors il n’y aurait rien.
Je n’ai pas besoin d’inventer quoi que ce soit. La réalité est bien pire. Par le biais de mes relations avec les gens de ce village, je sais ce qu’ils endurent, je sais à quelle heure ils dorment, ce qu’ils mangent, et quand leur cancer se déclare. Il y a beaucoup de fabriques de papier dans ce secteur, et un bon nombre d’estropiés auxquels les machines ont coupé les doigts, les bras ou un bout d’oreille. Peu à peu les machines leur coupent tout. Ou bien vous roulez à motocyclette sur les rails. Et vous y laissez une jambe. C’est ce qui est arrivé à l’ancien propriétaire de cette ferme. C’était un travailleur posté. J’ai chauffé la maison avec des jambes de bois. Lui en avait fait une grande consommation.
L’être humain refuse d’admettre que la nature est plus grandiose qu’un battement de cœur. Une prairie en fleurs est une chose si prodigieusement fondamentale que la gorge se serre rien qu’à y penser. Mais tout sera perdu, hormis pour quelques créatures un peu demeurées. Peut-être verra-t-on naître alors quelque chose de véritablement nouveau.
Pour que ça vienne avec fraîcheur, j’alterne toujours : après la prose, une pièce de théâtre. Le principal attrait du théâtre, ce sont les gens avec lesquels vous travaillez. Lorsque vous écrivez de la prose, vous êtes seul. Vous envoyez le manuscrit à l’éditeur, vous recevez bientôt de sa part une lettre stupide, puis vous n’avez plus aucune nouvelle, jusqu’à ce que vous parvienne un livre imprimé à la va-comme-je-te-pousse, truffé de ces fautes que vous vous étiez escrimé à corriger, ensuite, après un long silence, les critiques entrent en scène, le cauchemar, et en plus vous ne gagnez presque rien. En revanche, travailler pour le théâtre, c’est du stress. Au bout de quelques semaines, ça me tape sur les nerfs, tous ces acteurs effroyables. Je suis alors content quand une nouvelle prose démarre pendant ce temps-là. Et je supporte de traverser des mois en solitaire.
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts, traduit de l’allemand par Jean-Baptiste Para, dans Europe, n° 959, mars 2009, p. 19, 19, 19-20, 21, 21-22.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, prose et théâtre, écrire, jean-baptiste para | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2011
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

Encore une fois les hibous
J’allais à travers temps évoquant l’avenir
Que j’avais vu la veille au sein de quelque rêve
Et le long de l’espace au rebours de l’agir
Je laissais s’écouler glauque et vive la sève
De grands arbres plantés à l’instar du menhir
Pour marquer du soleil la fugitive trêve
Et qu’à leurs pieds géants les ans viennent gésir
En attendant le jour où l’homme se relève
Ni debout ni couchés des êtres à genous
Plantaient leur front plaintif dans une terre aride
La bouche dilatée arrachant des caillous
Mais je ne voudrais pas d’un destin aussi dous
Souligner la tendance assurément putride
C’est lorsque la nuit vient que volent les hibous
Qui cause ? Qui dose ? Qui ose ?
Si j’osais je dirais ce que je n’ose dire
Mais non je n’ose pas je ne suis pas osé
Dire n’est pas mon fort et fors que de le dire
Je cacherai toujours ce que je n’oserai
Oser ce n’est pas rien ce n’est pas peu de dire
Mais rien ce n’est pas peu et peu se réduirait
À ce rien si osé que je n’ose produire
Et que ne cacherait un qui le produirait
Mais ce n’est pas tout ça Au boulot si je l’ose
Mais comment oserai-je une si courte pause
Séparant le tercet d’avecque le quatrain
D’ailleurs je dois l’avouer je ne sais pas qui cause
Je ne sais pas qui parle et je ne sais qui ose
À l’infini poème apporter une fin
*
Acriborde acromate et marneuse la vague
au bois des écumés brouillés de mille cleurs
pulsereuse choisit un destin coquillage
sur le sable où les nrous nretiennent les nracleus
Si des monstres errants emportés par l’orague
crentaient avec leurs crons les crepâs des sancleurs
alors tant et si bien mult et moult c’est une ague
qui pendrait sa trapouille au cou de l’étrancleur
Où va la miraison qui flottait en bombaste
où va la mifolie aux creux des cruses d’asthe
où vont tous les ocieux sur le chemins des mers
on ne sait ce qui court en poignant sur la piste
on ne sait ce qui crie en poussant le tempiste
dans le ciel où l’apur cherche un bénith amer
on ne sait pas
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, Le Point du jour,
Gallimard, p. 197-198, 141-142, 139-140.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, jeu de langage | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2011
Paul Valéry, Littérature (Œuvres II)
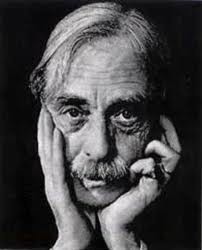
Les livres ont les mêmes ennemis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu.
Dans le poète :
L’oreille parle,
La bouche écoute ;
C’est l’intelligence, l’éveil, qui enfante et rêve ;
C’est le sommeil qui voit clair ;
C’est l’image et le phantasme qui regardent,
C’est le manque et la lacune qui créent.
La poésie n’est que la littérature réduite à l’essentiel de son principe actif. On l’a purgée des idoles de toute espèce et des illusions réalistes ; de l’équivoque possible entre le langage de la « vérité » et le langage de la « création », etc.
Et ce rôle quasi créateur, fictif du langage — (lui, d’origine pratique et véridique) est rendu le plus évident possible par la fragilité ou par l’arbitraire du sujet.
L’idée d’Inspiration contient celle-ci : Ce qui ne coûte rien est ce qui a le plus de valeur.
Ce qui a le plus de valeur ne doit rien coûter.
Et celle-ci : Se glorifier le plus de ce dont on est le moins responsable.
Quelle honte d’écrire, sans savoir ce que sont langage, verbe, métaphores, changements d’idées, de ton ; ni concevoir la structure de la durée de l’ouvrage, ni les conditions de sa fin ; à peine le pourquoi, et pas du tout le comment ! Rougir d’être la Pythie…
Paul Valéry, Littérature, dans Œuvres II, édition établie et annotée par Jean Hytier, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, p. 546, 547, 548 et 550.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, littérature, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2011
Jean Paulhan, À demain la poésie
Ce qu'en dit le premier venu
 Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du onde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.
Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du onde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.
Ensuite vient le poème, laissons cela. Et quand il est passé ? Non, tu n'as pas appris grand-chose. Que le temps passe vite. Si l'on veut. (Pourtant il est toujours là.) Qu'il faut profiter de la vie pendant que tu la tiens. Bien sûr. Peut-être que tes cheveux ressemblent à des feuilles, et tes dents à des rochers. (D'ailleurs, pas tant que ça.) Tu t'en doutais. Cependant, tu te sens vaguement changé, il t'est resté quelque trace de l'évènement : c'est comme s'il était soudain devenu bizarre que les cheveux ressemblent plus ou moins à des feuilles, et que ta vie soit courte. Dans quelle stupeur es-tu plongé, où le plus banal te paraît singulier, et le singulier banal ? Or il arrive que l'état se prolonge et t'étrange quelques moments. (Comme si le mystère de la poésie, c'était de rendre mystérieux tout ce qui n'est pas elle.) Il dépasse de ta manche un fil qui t'agace parce que tu le vois trembloter sur le papier de ton livre. Tu le brûles à la base, du bout de ta cigarette. Alors tu le vois soudain qui se tord en grelottant, puis se penche et s'abat comme un arbre coupé à la hache, tu crois l'entendre gémir. Tu demeures consterné. Un peu plus tard, tout rentre dans l'ordre. Mais entre l'attente et la retombée, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est proprement là le mystère. Et si l'on accorde qu'il est précisément mystérieux que reste-t-il à en dire ? Rien.
Jean Paulhan, À demain, la poésie, Introduction à une anthologie [1947], dans Œuvres complètes, tome II, Le Cercle du Livre précieux, 1966, p. 312.
Publié dans MARGINALIA, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2011
Jacques Réda, L'Herbe des talus

Tombeau de mon livre
Livre après livre on a refermé le même tombeau.
Chaque œuvre a l’air ainsi d’une plus ou moins longue allée
Où la dalle discrète alterne avec le mausolée.
Et l’on dit, c’était moi, peut-être, ou bien : ce fut mon beau
Double infidèle et désormais absorbé dans le site,
Afin que de nouveau j’avance et, comme on ressuscite —
Lazare mal défait des bandelettes et dont l’œil
Encore épouvanté d’ombre cligne sous le soleil —
Je tâtonne parmi l’espace vrai vers la future
Ardeur d’être, pour me donner une autre sépulture.
Jusqu’à ce qu’enfin, mon dernier fantôme enseveli
Sous sa dernière page à la fois navrante et superbe,
Il ne reste rien dans l’allée où j’ai passé que l’herbe
Et sa phrase ininterrompue au vent qui la relit.
Jacques Réda, L'herbe des talus, Gallimard, 1984, p. 208.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'herbe des talus, tombeau | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2011
Walter Benjamin, Images de pensée
Je déballe ma bibliothèque
Un discours sur l’activité de collectionneur
 Je déballe ma bibliothèque. Oui. Elle n’est pas encore sur les rayons, l’ennui discret de l’ordre ne s’est pas encore répandu sur elle. Je ne peux pas non plus marcher le long des rayonnages pour les passer en revue devant un auditoire bienveillant. Vous n’avez rien à craindre de tout cela. Je vous prie de vous transporter avec moi dans le désordre des caisses défoncées, dans l’air rempli de poussière de bois, sur le sol recouvert de papiers déchirés, parmi les piles de volumes tout juste ramenés à la lumière du jour après deux ans d’obscurité, pour partager un peu l’état d’esprit, pas du tout élégiaque mais plutôt impatient, qu’ils éveillent chez un authentique collectionneur. Car c’est quelqu’un de cette sorte qui vous parle et ne parle en somme que de lui. Ne serait-il pas présomptueux, ici, en se réclamant d’une apparente objectivité, d’énumérer les pièces maîtresses ou les principales sections d’une bibliothèque, ou vous exposer l’histoire de sa constitution, voire de vous expliquer son utilité pour l’écrivain ? Avec les mots qui suivent, en tout cas, j’ai en vue quelque chose de plus manifeste, de plus tangible ; il me tient à cœur de vous faire entrevoir le rapport d’un collectionneur avec ses possessions, de vous faire entrevoir plutôt l’activité du collectionneur que la collection. Il est tout à fait arbitraire que je procède en m’aidant d’une réflexion sur les diverses façons d’acquérir des livres. Une telle décision est, comme tout autre, une digue contre le raz-de-marée de souvenirs qui déferle sur tout collectionneur qui se penche sur ce qu’il possède. Toute passion confine au chaos mais celle du collectionneur confine à celui des souvenirs : le hasard, le destin qui colore à mes yeux le passé sont également perceptible dans le fouillis familier de ces livres. Car cette possession, qu’est-elle d’autre sinon un désordre où l’habitude a pris ses aises au point de prendre l’apparence de l’ordre ? Vous avez déjà entendu parler de gens dont la perte de leurs livres fait tomber malades, d’autres qui sont devenus criminels pour en acquérir. Dans ce domaine l’ordre n’est jamais que flottement au-dessus de l’abîme. « Le seul savoir exact qu’il y ait, a dit Anatole France, est le savoir sur l’année de parution et le format des livres. » En effet, s’il y a une contrepartie au dérèglement de la bibliothèque, c’est la rigueur de son catalogue.
Je déballe ma bibliothèque. Oui. Elle n’est pas encore sur les rayons, l’ennui discret de l’ordre ne s’est pas encore répandu sur elle. Je ne peux pas non plus marcher le long des rayonnages pour les passer en revue devant un auditoire bienveillant. Vous n’avez rien à craindre de tout cela. Je vous prie de vous transporter avec moi dans le désordre des caisses défoncées, dans l’air rempli de poussière de bois, sur le sol recouvert de papiers déchirés, parmi les piles de volumes tout juste ramenés à la lumière du jour après deux ans d’obscurité, pour partager un peu l’état d’esprit, pas du tout élégiaque mais plutôt impatient, qu’ils éveillent chez un authentique collectionneur. Car c’est quelqu’un de cette sorte qui vous parle et ne parle en somme que de lui. Ne serait-il pas présomptueux, ici, en se réclamant d’une apparente objectivité, d’énumérer les pièces maîtresses ou les principales sections d’une bibliothèque, ou vous exposer l’histoire de sa constitution, voire de vous expliquer son utilité pour l’écrivain ? Avec les mots qui suivent, en tout cas, j’ai en vue quelque chose de plus manifeste, de plus tangible ; il me tient à cœur de vous faire entrevoir le rapport d’un collectionneur avec ses possessions, de vous faire entrevoir plutôt l’activité du collectionneur que la collection. Il est tout à fait arbitraire que je procède en m’aidant d’une réflexion sur les diverses façons d’acquérir des livres. Une telle décision est, comme tout autre, une digue contre le raz-de-marée de souvenirs qui déferle sur tout collectionneur qui se penche sur ce qu’il possède. Toute passion confine au chaos mais celle du collectionneur confine à celui des souvenirs : le hasard, le destin qui colore à mes yeux le passé sont également perceptible dans le fouillis familier de ces livres. Car cette possession, qu’est-elle d’autre sinon un désordre où l’habitude a pris ses aises au point de prendre l’apparence de l’ordre ? Vous avez déjà entendu parler de gens dont la perte de leurs livres fait tomber malades, d’autres qui sont devenus criminels pour en acquérir. Dans ce domaine l’ordre n’est jamais que flottement au-dessus de l’abîme. « Le seul savoir exact qu’il y ait, a dit Anatole France, est le savoir sur l’année de parution et le format des livres. » En effet, s’il y a une contrepartie au dérèglement de la bibliothèque, c’est la rigueur de son catalogue.
Aussi l’existence du collectionneur est-elle dialectiquement tendue entre les pôles du désordre et de l’ordre.
Walter Benjamin, Images de pensée, traduit de l’allemand par Jean-François Poirier et Jean Lacoste, collection Titres n° 138, Christian Bourgois éditeur, 2011 [1998], p. 159-161.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, images de pensée, bibliothèque, collectionneur | ![]() Facebook |
Facebook |
29/08/2011
André Frénaud, Hæres

La double origine du langage
à Alain Lévêque
Le perdu inoubliable, inconnu,
le sein où j’avais part, originel,
j’essaie avec ma langue,
et cette rumeur dans l’oreille qu’elle fomente
et qu’il me semble reconnaître,
de recouvrer — oh ! je tâtonnerai — une parole
où être aspiré, respirer,
où me dissiper dans la mer.
… Ou si le discours qui s’acharne,
qui s’arrache de ma bouche,
venait d’un élan sans cesse intimidé,
— et qui se hérisse d’autant plus, qui raffine,
que je n’y arrive pas ! —
pour mimer
la syllabe initiatrice,
dominatrice,
lorsque le père émit
l’univers en mouvement,
où je figure au rôle, ces jours-ci,
d’où je parle.
André frénaud, Hæres 1964-1974, Gallimard, 1982, p. 202.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, origine du langage | ![]() Facebook |
Facebook |






