20/01/2013
Pierre Bergounioux, Lettre de réclamation à la régie du temps

C'est pour dériver avec nous, changer et s'altérer comme nous faisons, que le monde nous semble identique. L'universelle métamorphose confère une apparence permanente à nos existences. Mais qu'une chose demeure inchangée, à l'écart, resurgisse, et la perte consubstantielle à l'épreuve du temps nous transperce et nous fait chanceler. Pareille expérience est de tous les âges. on s'étonne, dès l'enfance, de n'être plus le même, ni plus rien, lorsqu'une idée, un objet importants, à quelques mois de là, ont pâli. Qu'étions-nous donc, qu'ils aient pu nous tenir sous leur charme, régenter nos actes et nos pensées ? Mais la portée de l'affaire, alors, est limitée par l'exigence, encore, de nos embrassements, l'absence de recul, notre peu de durée. Le délai requis, pour qu'elle devienne opératoire, dangereuse, est celui d'une vie, quand, des trois générations qui sont l'éternité ici-bas, selon un mot de Keynes, la nôtre, seule, demeure et s'apprête au départ. Elle a eu son jour. L'espace qui s'ouvrait, devant elle, elle l'a traversé. Le futur a migré dans le passé. On est devenu tout ce qu'on pouvait. Ce qu'il était permis d'escompter, on l'a obtenu, ou non. L'heure est venue de renoncer, d'un coup — ce sont les disparitions brutales qui éclaircissent nos rangs — ou morceau par morceau, quand le corps multiplie les signes d'usure et de délabrement, que les tâches auxquelles on se sentait voué, perdent leur nécessité sentie, l'âpre intérêt qu'on y trouvait.
Pierre Bergounioux, Lettre de réclamation à la régie du temps, lavis de Jean-Baptiste Sécheret, Circa 24, 2012, np.
© Photo Chantal Tanet.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, lettre de réclamation à la régie du temps, métamorphose | ![]() Facebook |
Facebook |
18/01/2013
Dominique Buisset, Quadratures

On ne sort pas vivant de l'à présent
Il n'a d'autre issue qu'en lui-même sans
Après sans rien nulle postérité
Sans aucun pas de côté apaisant
Pour aller souffler hors de l'incessant
On reste cloué au poste hérité
De qui on ne sait trop si même sang
Au chaudron fait même boudin cuisant
Mais régime riche ou sage eau riz thé
On rejoint toujours la majorité
*
J'ai aimé : trop long errata...
qu'aurais-je bien de plus à dire ?
On ne revient plus sur ses pas.
Pas aimé. Je n'ai pas plus à dire :
Que n'ai-je trié mes émois ?
J'ai mordu à bien trop d'appas,
et, bientôt, sur elles et moi,
un édredon de terre en tas...
Dominique Buisset, Quadratures, postface de
Jacques Roubaud, éditions NOUS, 2010, p. 69 et 42.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique buisset, quadratures, rime, jeu de mots, homophonie | ![]() Facebook |
Facebook |
16/01/2013
Georges Perec, Un homme qui dort

Tu es seul, et parce que tu es seul, il faut que tu ne regardes jamais l'heure, il faut que tu ne comptes jamais les minutes. Tu ne dois plus ouvrir ton courrier avec fébrilité, tu ne dois plus être déçu si tu n'y trouves qu'un prospectus t'invitant à acquérir pour la modique somme de soixante-sept francs un service à gâteaux gravé à ton chiffre ou les trésors de l'art occidental.
Tu dois oublier d'espérer, d'entreprendre, de réussir, de persévérer.
Tu te laisses aller, et cela t'est presque facile. Tu évites les chemins que tu as trop longtemps empruntés. Tu laisses le temps qui passe effacer la mémoire des visages, des numéros de téléphone, des adresses, des sourires, des voix.
Tu oublies que tu as appris à oublier, que tu t'es, un jour, forcé à l'oubli. Tu traînes sur le boulevard Saint-Michel sans plus rien reconnaître, ignorant des vitrines, ignoré du flot montant et descendant des étudiants. Tu n'entres plus dans les cafés, tu n'en fais plus le tour d'un air soucieux, allant jusque dans les arrière salles à la recherche de tu ne sais plus qui. Tu ne cherches plus personne dans les queues qui se forment toutes les deux heures devant les sept cinémas de la rue Champollion. Tu n'erres plus comme une âme en peine dans la grande cour de la Sorbonne, tu n'arpentes plus les longs couloirs pour atteindre la sortie des salles, tu ne vas plus quêter des saluts, des sourires, des signes de reconnaissance dans la bibliothèque.
Tu es seul. Tu apprends à marcher comme un homme seul, à flâner, à traîner, à voir sans regarder, à regarder sans voir. Tu apprends la transparence, l'immobilité, l'inexistence. Tu apprends à être une ombre et à regarder les hommes comme s'ils étaient des pierres. Tu apprends à rester assis, à rester couché, à rester debout. Tu apprends à mastiquer chaque bouchée, à trouver le même goût atone à chaque parcelle de nourriture que tu portes à ta bouche. Tu apprends à regarder les tableaux exposés dans les galeries de peinture comme s'ils étaient des bouts de murs, de plafonds, et les murs, les plafonds, comme s'ils étaient des toiles dont tu suis sans fatigue les les dizaines, les milliers de chemins toujours recommencés, labyrinthes inexorables, texte que nul ne saurait déchiffrer, visages en décomposition.
Georges Perec, Un homme qui dort, 10/18, 1976 [Denoël, 1967], p. 68-71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, un homme qui dort, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
08/01/2013
Philippe Beck, Poésies didactiques
Et la prose

Prose :
de la masse absorbante
supposant trop les nerfs
fragiles de l’enfantine poésie ?
De la poésie enfantine d’aujourd’hui ?
Véhicule insouciant
véhiculé.
Ce qui est serré
et qu’aère la poésie,
ou la trame sérieuse
de la vie dont les mailles
sont assouplies ou bien relâchées
par de la poésie oxygénée ?
La vertu est prose,
et l’innocence est poésie ?
Hum.
Le monde des corps est prosaïque
et l’espace est poème du commencement,
puis, quand formé, p. de la fin ?
Donc, la santé vraie est prose ?
Et la poésie médicament ?
Mais la santé absolue
est absolument prosaïque,
et il n’y a plus la poésie
si tout est santé
paradisiaque (hypothèse d’alcool),
car les divertissements règnent
là-bas, sans délai.
Là-bas = absolu pays des jouets.
Des poupées.
Le Non
au pur devoir de diversion
est un problème musical.
De la médecine musique.
Philippe Beck, Poésies didactiques,
Théâtre typographique, 2001, p. 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, poésies didactiques, la poésie, musique | ![]() Facebook |
Facebook |
31/12/2012
Claude Dourguin, Les nuits vagabondes
Je ne sais quel incident, retard pris dans le dédale des déviations, de routes secondaires non signalisées, nous fit arriver aux abords d'une petite cité maritime bien après le coucher du soleil. Heure, lassitude, il n'était pas question de poursuivre. Un toit ? Il n'y pensait pas. L'air, très doux, balançait les étoiles pâles au ciel, dans la perspective d'une avenue vaguement industrielle des bâtiments cubistes découpaient l'ombre, côté terre de grands pylônes inscrivaient pour les visiteurs d'autres planètes leurs chiffres cabalistiques. Pour une fois, ils semblaient porteurs d'une beauté — futuriste et, si l'on songeait à l'énergie mystérieuse dont ils supportaient les fils — vaguement mystique. Une petite route transversale prise au hasard permit de s'éloigner un peu, découverte en bout de champ voué à la culture maraîchère une banquette d'herbe, nous nous installâmes ente deux couvertures. Sur l'Ouest, une grande lune rousse s'était levée, hésitante derrière un voile de nuages blancs d'une extrême finesse. Pleine, elle se tenait proche, d'une taille, semblait-il excessive, grand œil distrait ouvert sur la scène. Au ciel gris bleu sans profondeur, éteint par d'imperceptibles nuées en bandes longues, errantes, on ne distinguait plus que quelques étoiles, discrètes. La nuit se tenait coite dans l'air humide et tiède, nul indice ne permettait de se situer, campagne indéterminée, incertaine peut-être même, ville campagne pour Alphonse Allais ? L'étrangeté venait de cette indéfinition tranquille, de ce suspens sous l'œil chassieux de la lune et de l'absence sans traces de ce pourquoi nous nous étions mis en route.
Un sommeil bref fut le lot de ce que j'éprouvai comme une traversée les yeux bandés. Vers cinq heures, un gigantesque bruit de ferraille à quoi se superposa puis se mêla, chaos tonitruant, celui de moteurs — automobiles, camions, dont on entendait passer les vitesses, accélérations, l'une derrière l'autre, moulinettes aiguës, ou, courtes saccades de gros transporteurs ; décélérations brèves, diminuendo, il devait y avoir un feu rouge proche —, ce vacarme secoua l'aube, très vite s'intensifia puis finit, à la manière d'un gaz, par occuper la totalité de l'espace.
Claude Dourguin, Les nuits vagabondes, éditions Isolato, 2008, p. 27-29.
© Photo Claude Dourguin.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, les nuits vagabondes, voyage, sommeil, bruit | ![]() Facebook |
Facebook |
30/12/2012
Pierre Michon, Les Onze

Je vous prie, Monsieur, d'arrêter votre attention sur ceci : que savoir le latin quand on est Monseigneur le Dauphin de la Maison de France et le fils de Corentin la Marche, ne sont pas une seule et même chose ; ce sont même deux choses diamétralement opposées : car quand l'un, le dauphin, lit à chaque page, à chaque désinence, à chaque hémistiche, une glorieuse ratification de ce qui est et doit être, dont il fait lui-même partie, et que levant les yeux par ailleurs entre deux hémistiches, il voit par la fenêtre des Tuileries le grand jet d'eau du grand bassin et derrière le grand bassin sur les chevaux de Marly la Renommée avec sa trompette, l'autre, François Corentin, qui relève la tête vers des futailles et de la terre de cave gorgée de vin, l'autre voit dans ces mêmes désinences, ces mêmes phrases qui coulent toutes seules et trompettent, à la fois le triomphe magistral de ce qui est, et la négation de lui-même, qui n'est pas : il y voit que ce qui est, même et surtout si ce qui est paraît beau, l'écrase comme du talon on écrase une taupe.
De cela , Monsieur — et surtout de ce que Corentin le père bien sûr ne savait pas lire, mais encore à peine parler, et seulement patois, excellait seulement dans le savant mélange de vins violets et d'alcools blancs ; de ce que sa présence, sa vie, était à elle seule pour qui lit Virgile, une honte inexpiable (ce qui bien sûr quand on lit Virgile, quand vraiment on le lit avec le cœur, et non pas à la façon déboussolée d'un écolier limousin, est un solécisme inexpiable, mais ceci est une autre affaire) ; de ce que, privé de langage, le père l'était aussi de ce qu'on appelle l'esprit ; que d'ailleurs s'il s'était avisé d'avoir de l'esprit et de jurer lui aussi que Dieu est un chien cela aurait donné quelque chose d'informe qu'on peut transcrire à peu près par Diàu ei ùn tchi, une sorte d'éternuement — de cela tout découle, tout ce qui nous intéresse : la curiosité intellectuelle, la volonté, l'âpreté littéraire, et pour finir l'impeccable réversion de l'injure patoise en petits sonnets anacréontiques ; le grand couteau limousin tout à fait dissimulé dans des bouquets de fleurs versifiables [...]
Pierre Michon, Les Onze, Verdier, 2009, p. 39-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, les onze, le latin, virgile, dividion sociale | ![]() Facebook |
Facebook |
20/12/2012
François Bon, Sortie d'usine

[...]
Bruits désordonnés, des sons extorqués par le viol de l'usage, les choses disséquées par la distension extrême en elles des résonances. Comme règle : faire du bruit sans règle, et la dissonance même n'aurait pu advenir deux fois consécutives, qu'on savait toujours briser en lui extorquant plus encore de dissonnement. Quant à la destruction de la chose si l'on n'en tirait pas l'apothéose dans la douleur sursaturée qui excluait par sa surdité sifflante le bruit même, le lendemain on réparerait.
Tout : l'outil, l'acier, le cri, moteurs, air comprimé, tout ce qui ici était susceptible de manifestation bruyante, dans cette seule condition de libérer une sonorité qui ne soit pas en deçà du bruit général mais atteigne l'intenable où cela commence vraiment à faire mal. Non pas un instrument de plus dans le tohu-bohu général, mais un bris du son même dont la règle n'était que de l'en faire jaillir à l'excès dans la provocation sans limite des choses.
Les choses : tout, ici où se mettaient en œuvre des puissances amplifiant la main de l'homme, faisait au choc réponse sonore, puissances qu'il suffisait d'exciter pour que la réponse outrepasse les possibilités auditives de l'homme qui en était pourtant l'origine et la cause, en fasse le catalyseur seulement de ce qui lui était devenu à lui-même insoutenable. Il n'y avait qu'à. Et frotter, forcer, battre, racler. On tapait et cognait, cela sifflait et craquait. Une barre de fer, un marteau, contre l'établi, le bâti de machine, le poteau de charpente, et quelque force encore humaine qui les jetât contre dans la luminosité violente du choc elles demeuraient, les choses, par-delà les résonances, identiques à elles-mêmes, bosselées peut-être, éraillées, tordues, mais intactes dans leur fonctionnalité, et provocantes dans leur puissance figée à plus bruit, pire encore.
François Bon, Sortie d'usine, éditions de Minuit, "mdouble", 2011 [1982], p. 80-81.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois bon, sortie d'usine, bruit, dissonance | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2012
Jean de la Croix, Cantique spirituel, traduction de Jacques Ancet

Chansons entre l'âme et l'époux
Épouse
[1]
Mais où t'es-tu caché
me laissant gémissante mon ami ?
Après m'avoir blessée
tel le cerf tu as fui
sortant j'ai crié, tu étais parti.
[2]
Pâtres qui monterez
là-haut sur les collines aux bergeries,
si par chance voyez
qui j'aime dites-lui
que je languis, je souffre et meurs pour lui.
[3]
Mes amours poursuivrai,
j'irai par les montagnes et les rivières,
les fleurs ne cueillerai,
ne craindrai lions, panthères
et passerai les forts et les frontières.
[4]
Demande aux créatures
Ô forêts et taillis
que mon ami a de sa main plantés,
verdoyantes prairies
de fleurs tout émaillées,
dites si parmi vous il est passé.
[5]
Réponse des créatures
Mille grâces versant,
en hâte par ces bois il est passé
et en les regardant
son visage a jeté
sur eux le vêtement de la beauté.
*
Canciones entre el alma y el esposo
[1]
Esposa
Adónde te escondiste
amado y me dejaste con gemido ?
Como el ciervo huiste
habiéndome herido
sali tras ti clamando, y eras ido
[2]
Pastores los que fuerdes
allá por las majadas al otero
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero
decidle que adolezeo, peno u muero.
[3]
Buscandos mi amores
iré por esos montes y reberas
ni cogeré las flores
ni temeré les fieras
y pasaré los fuertes y fronteras.
[4]
Pregunta a las criaturas
O bosques y espesuras
plantadas por la mano del amado
O prado de venduras
de flores esmaltado
decid si por vosotros ha pasado
[5]
Respuesta de las criaturas
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura
e yéndolos mirando
con sola su figura
vestido los dejó de hermosura.
Jean de la Croix, Cantique spirituel, traduction de Jacques Ancet dans Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Œuvres, édition publiée sous la direction de Jean Canavaggio, Bibliothèque de la Pléiade, 2012, p. 696-699.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de la croix, cantique spirituel, jacques ancet, épouse, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
29/10/2012
François Lallier, Les archétypes

Sources de la Seine
I
Les pièces sur le bitume réparé des routes
Souvent il me semble qu'elles me retiennent,
Comme des trous à la surface du temps,
Et je vois des visages, sur le chemin d'une fête.
Ce sont les visages épurés des vivants, sortis de terre,
Ayant perdu toute croyance dans la mort
Parce que baignés par l'eau invisible
Ils ne regardent que l'ici qui les entoure, où la nuit à venir
Dans le midi encore respire un vent d'étoiles.
Procession pourtant presque immobile, ils parlent,
Souriant sans raison.
Le tournant là-bas se tient dans sa courbe, et il attend
De les accueillir là où change le paysage
Sous une voûte transparente impossédable.
Leur pain a le parfum de l'inutile absinthe,
leur eau la douceur d'ombre et de cristal
Du sang dans les veines —
Comme a le rosier près de la fenêtre,
Un inexplicable cri de joie.
Et j'avance avec eux.
L'infirme trajectoire qui m'emporte
Laisse fuir l'une après l'autre mes ombres,
À chaque tour de roue j'abandonne un regard qui me ressemble
Et va demeurer là, dans un lieu devenu ma mémoire,
Et qui en vérité m'appelle.
Qu'est-ce qui relie ces lieux et ces êtres, je ne sais,
Et pas plus ce qui me relie à eux,
Je ne peux que transposer ce dévoilement et cette mémoire,
Dans les mots à la fois contingents et nécessaires.
Mon seul guide : que l'écorce du sens se recompose
Sous le rythme qui la brise, écoulement, vibration, couleur,
Luttant contre l'oubli.
François Lallier, Les archétypes, Le temps qu'il fait, 2012, p. 35-36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois lallier, les archétypes, sources de la seine, l'oubli | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2012
Francis Ponge, Dans l'atelier du « Nouveau Recueil »,

Souvenirs d'Avignon
Notre île cahote comme une marmite ;
Vagues et rochers font autour des bouillons gris.
La pluie. D'accord nous sommes à terre.
Éclair. L'Oiseau passe près du phare.
Nos vaisseaux brûlent.
*
À cloche-tinte la souris boit
La rampe de bois n'est pas sûre
Un ongle y racle de la cire
Deux chaussures ne sont pas loin
Toute la province d'ailleurs se révolte
Dans toutes les charrettes sur les chemins
Se tiennent de futurs guillotinés en chemise
Les bras croisés derrière le dos
À demain. À demain sonnent les cloches
Grand Branle-bas. Je n'y serai plus
Je serai au contraire très loin
Toutes vos voitures de foin déchargées
Vieux réseau, tu passes à niveau sur les routes
Raison de plus pour l'hirondelle
Qu'on me verse le café chez le garde-barrière
Si j'y passe c'est perpendiculairement
*
[...]
Francis Ponge, Dans l'atelier du « Nouveau Recueil », dans
Œuvres complètes, II, édition publiée sous la direction de Bernard Beugnot, Bibliothèque de la Pléiade, 2002, p. 349-350.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, dans l'atelier du « nouveau recueil », souvenirs d'avignon | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2012
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

De l'information nulle à une certaine espèce de poésie
C'est bien vrai qu'il faut dire il neige quand il neige
c'est comme ça que l'on se fait comprendre
c'est en disant qu'il neige quand il neige que
c'est agréable de faire la conversation avec des gens qui disent que
c'est le temps qui veut ça qu'il neige quand il neige
c'est comme ça qu'on vit en société sans difficultés aucune et
c'est comme ça qu'on se fait des amis et
c'est si facile de dire qu'il neige quand il neige
plutôt que de dire il pleut
en effet
c'est prétentieux de dire qu'il pleut s'il neige
mais où la poésie va-t-elle se nicher dans tout ça ?
dans un flocon
dans un flocon de neige
arrosé de marsala
un jour d'été sur la grève
d'une plage au Sahara
où si l'on dit : « tiens... mais il neige...»
c'est un peu au hasard...
comme ça...
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, "Le Point du jour",
Gallimard, 1965, p. 108-109.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
07/10/2012
Colette, La Paix chez les bêtes

Les couleuvres
Ce sont deux pauvres sauvageonnes, arrachées, il y a quelques jours, à leur rive d'étang, à leurs joncs frais, au tertre chaud, craquelé sous le soleil, dont elles imitent les couleurs fauves et grises. Elles ont fait un voyage maudit, avec deux cents de leurs pareilles, étouffées dans une caisse, bruissantes, et le marchand qui me choisit celles-ci brassait ce vivant écheveau, ces cordages vernissés, démêlait d'un doigt actif les lacets minces, les fouets robustes, les ventres clairs et les dos jaspés.
« Ça, c'est un mâle... Et ça c'est une grosse femelle... Elles s'ennuieront moins, si vous les prenez toutes les deux...»
Je ne saurais dire si c'est d'ennui qu'elles s'étirent, contre les vitres de leur cage. Les premières heures, je faillis les lâcher dans le jardin, tant elles battaient de peur les parois de leur prison. L'une frappait sans relâche, de son dur petit nez, le même joint de vitres ; l'autre s'élevait d'un jet jusqu'au toit grillagé, retombait molle comme une verge d'étain entrain de fondre, et recommençait... Leur offrir, à toutes deux, la liberté, la jardin, le gazon, les trous du mur... Mais les chattes veillaient, gaies et féroces, prêtes à griffer les écailles vulnérables, à crever les vifs yeux d'or.
J'ai gardé les couleuvres et je plains en elles, encore une fois, la sagesse misérable des bêtes sauvages, qui se résignent à la captivité, mais sans jamais perdre l'espoir de redevenir libres. La secrète horreur, l'horreur occidentale du reptile ressuscite en moi, si je me penche longtemps sur elles, et je sais que le spectacle de leur danse, le mot sans fin qu'elles écrivent contre la vitre, le mouvement mystérieux d'un corps qui progresse sans membres, qui se résorbe, se projette hors de soi, ce spectacle dispense la stupeur.
[...]
Colette, La Paix chez les bêtes, dans Œuvres, II, texte établi, présenté et annoté par Michel Mercier, Bibliothèque de la Pléiade, édition publiée sous la direction de Claude Pichois, Gallimard, 1986, p. 127-128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : colette, la paix chez les bêtes, les couleuvres, bêtes sauvages | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2012
Luc Bénazet et Benoît Casas, Envoi

— J'ai une proposition à te faire.
— Dis !
— Dire ? Non. Précisément.
Mais voici ce que je peux t'écrire :
je ne sais pas exactement
Quelle est cette proposition ;
Il s'agit grosso modo de ceci
(que je nomme mais qui reste à inventer)
une conversation écrite
*

9 octobre
[raisin]
poème de saison
où la lumière s'éteint.
marqueurs :
lampes jaunes
dehors plomb
cendre pluie
refuge : érémitisme laborieux.
Livres, livres, écran, souris.
Livres. Noms.
construction lente.
Vers du jour.
14/10/10
quatre. Condensation lente, transformation du métal, lignes et [points épars —
la veine rouge est de type nuage
coulures. à flanc, une cabane. L'été est prochain
la direction dans l'espace est homonyme à la saison
18 octobre
dans le métro
sur le journal
puis sur écran
saisi par la photographie
de ce sol rouge
de cette bosse toxique
savoir du désastre :
brûlures, irritation ophtalmiques
résidus corrosifs, bauxite
L'œil reste captif
de l'impact
de ce miroir rouge
de cette force plate
de cette étendue
feu liquide.
Luc Bénazet et Benoît Casas, Envoi, Héros-Limite,
2012, p. 5 et 35-36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc bénazet et benoît casas, envoi, conversation écrite | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2012
Henri Thomas, La joie de cette vie
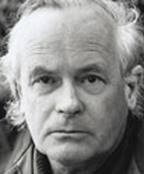
J'écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages, comme Paulhan, où l'on disparaît quand la machine se modifie pour votre mort.
Je quitte tout, presque tout, pour la route des mots.
Si la mort est la solution forcée du problème appelé la vie, nous ne comprenons pas plus le problème que la solution, et si nous pouvons constater cela, c'est grâce au langage, que nous ne comprenons pas davantage.
Je n'ai pas vécu ce que j'écris maintenant ; je le vis, je le découvre, en l'écrivant — sur le mode de l'écriture, comme on dit en croyant par cette formule expliquer quelque chose.
Je n'ai, pour répondre de moi, que mes livres, que j'ai oubliés, après m'y être absorbé, peut-être résorbé. Ils sont pareils en cela aux amours, dont on n'a plus guère que le titre : un nom, un prénom, une couleur dominante ; le reste a disparu comme l'herbe des champs, comme les lignes écrites il ya six mois ou dix ans.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 21, 28, 29, 30, 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, écrire, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2012
Jean-Loup Trassard, Inventaire des outils..., Traquet motteux....

Des fermes
Depuis une ferme dont le nom était Les Champs blancs, à cause des parcelles de sarrazin fleuri qui tournaient autour, mon arrière-grand-mère allait au village à cheval. La cause profonde d'une passion pour les fermes s'enracine-t-elle dans ce bocage normand ? Ou bien mon goût serait-il né d'une réjouissance enfantine à deviner que la ferme est ce qui reste, en France, le plus proche de la maison primitive, celle qui eut charpente en os de baleine, puis des parois de branches tressées, puis des complications, recoins et dépendances, creusées dans la terre, consolidées de pierres ?
Car la ferme, ramifiée en cellier, grange, resserre, grenier, hangars, berderie ou étable, est une maison qui enrichit sans fin la plaisir d'habiter. Il y a l'abri et l'espace, les bêtes, le nécessaire pour vivre et travailler. Surtout il y a un puits (quelquefois dans les murs comme celui d'un château fort pour résister aux sièges). Surtout il y a un feu. C'est une réserve d'outils, de nourriture, de chaleur. Les volailles ne s'en écartent guère, le bétail s'empresse d'y revenir quand la barrière du pré s'entrouve. Aux heures de distribution du grain, du lait ou du fourrage, les dindes, les cochons, les chèvres y appellent ensemble.
Jean-Loup Trassard, Traquet moteux ou L'agronome sifflotant, Le temps qu'il fait, 1994, p. 17.
*
C'est plutôt à la remise que s'expose la panoplie des instruments à main : appuyés, suspendus, piqués dans une poutre. Bien que parfois ils ne coupent plus ou perdent leur manche, toutes fonctions mêlées, ils sont toujours disponibles pour qui veut prononcer, même intérieurement, leur nom et s'en saisir.
Parmi eux, venues de l'aube où d'autres les avaient courbées pour nous, ces lames de métal dont nous ne cherchions pas l'origine en les posant sur notre bras, pour la protection d'autrui leur tranchant leur tranchant tourné vers notre propre corps.
L'un des bruits qui rythmait le temps lourd des premières après-midi orageuses était alors celui du marteau martelant la faux sur l'enclumette plantée dans une souche. Laquelle servait de siège pour cet ouvrage.
[...] Tête d'acier légèrement arquée dont un bord est coupant et l'autre formé par une nervure qui donne la rigidité. Le tranchant et le dos se joignent en pointe aiguë tandis que la base, large, porte une queue qui permet, avec anneau et coin, la fixation sur un manche de bois. La longueur de ce manche, muni d'une poignée transversale, sert un peu de balancier. Mais ne partez pas sans réglage ! La faux qui n'en a pas l'air est un instrument très complexe... Suivant le type de lame, la nature des tiges à couper, la taille du faucheur, sa force, son habileté, sera déplacée la poignée réglable le long du manche, seront à modifier l'angle que fait la lame avec le manche ou l'angle que fait le plan de cette lame avec le sol qu'elle rase. Et ces nuances subtiles entrent en combinaison. L'on tenait compte encore de la verse éventuelle du foin ou de la pente du terrain.
Alors le faucheur; s'étant assuré du sol, le pied droit en avant, prenait son élan de gauche à droite, engageait la pointe dans l'herbe, lançait l'oscillation. Il suivait sans cesse la faux des yeux pour veiller à ne pas émousser sa faux tout en coupant le plus bas possible. Le bruit de l'herbe tranchée déjà le renseignait sur le rythme à garder et sur le rapport du fil avec la résistance végétale.
Jean-Loup Trassard, Inventaire des outils à main dans une ferme, photographies de l'auteur, Le temps qu'il fait, 1981, p. 11-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, inventaire des outils à main, traquet motteux, la ferme, la faux | ![]() Facebook |
Facebook |






