23/09/2012
Hervé Guibert, Des Aveugles

Ils étaient parés de robes incolores, de calottes de diable à cornes molles, de masques sans relief et sans trait, de capes informes qui n'étaient que le crissement virevoltant de leurs plis, de loups non échancrés, de diadèmes de lave et de collerettes de glace, d'inutiles azurs brodés, de pyjamas de soie rouge trompette et bleu violon, d'autres de bleus mous et de verts irritants, de bruns indistincts, de brassards et de couronnes de grelots, ils ne représentaient pas des hommes mais des rayons de lune, des rivières, des arbres de foudre, des éruptions, des ténèbres phosphorescentes les encerclaient en crépitant de doigt en doigt comme des feux magiques, sans danger pour se tourner la tête ils se rincèrent les yeux à l'alcool pur, ils se mirent des valses, is burent du feu dans des œillères, ils échangèrent chaussures contre tricornes, ils ajoutèrent des cascades de rubans sur leurs perruques, leurs mains étaient gantées de feuilles et leurs mollets de feux gainés, ils coururent d'un bout à l'autre des couloirs et sautèrent les obstacles, ils s'étaient déguisés en colonnes et en traîneaux, en Niagaras et en Monts-Blancs, ils dévorèrent des pièces montées et en croquèrent mariés et communiants, tout ruisselants d'odeurs qui n'étaient pas les leurs — hommes contre femmes, animaux contre cadavres — ils se poursuivirent dans les jardins, ils se lancèrent dans les pattes des rats mécaniques, les incendiaires luttèrent avec les prestidigitateurs, ils chutèrent délicieusement.
Hervé Guibert, Des Aveugles, Folio / Gallimard, 1985 [1983], p. 11-12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé guibert, des aveugles, fantaisie | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2012
Danielle Collobert, Cahiers 1956-1978

Le calme revient par moments — le silence — et aussi conscience de tout ce qui n'est pas entièrement présent — longtemps pour apprivoiser les mots — départ — décision de partir — décollement de l'instant — et du lieu — pas d'éloignement immédiat —
perception égale — plane —
les mots — beaucoup de mots — sans raison apparente_
des mots dissemblables — de gens — de consonances — très éloignés entre eux — produisent sur moi le même effet ou plutôt la même gêne ou malaise — des mots prononcés par certaines personnes détruisent en moi ce que je croyais très solide — ça m'effraie — j'arrive difficilement à dépasser le moment de cette gêne qui dure parfois des jours entiers — sans que d'autres impressions viennent s'y substituer — je dors sans que la sensation disparaisse au réveil — ça s'étend à des domaines inhabituels — par exemple l'autre jour ce désir énorme de manger jusqu'à la sensation de lourdeur — de boire jusqu'à l'inconscience — être un organe géant — monstrueux — engloutir ce mot-là — la sensation de ce mot —
Danielle Collobert, Cahiers 1956-1978, Change, Sefhers/Laffont, 1983, p. 26.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, cahiers 1956-1978, le silence, les mots | ![]() Facebook |
Facebook |
17/09/2012
Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses

Lacunes
Fascinant, le rêve l'est par ses lacunes bien plus que par son contenu souvent, examiné a posteriori, d'une consternante banalité.
Illusoire ?
La mémoire (n'est-elle fonction que de lanterne sourde ?), le paysage (la réalité faussement dite extérieure), les mots (leur charge affective en jeu) : autant, je le voudrais, de vases communicants, gages d'intimité.
Désarroi de la lecture
Lire : triturer, malaxer, tordre et détordre au plus près d'une vérité qui échappe.
Des notes de lecture éparses sur la table, réduites au strict minimum, parfois plus développées, des phrases ou bribes de phrases recopiées, des réflexions adjacentes, d'inattendus croisements de chemins, une errance sans but, inquiète et captivante : le livre lu et relu se défait, soumis à une véritable mise en pièces — en vue de quelque remise en état pour l'instant douteuse, quelle reconstitution toujours à remettre en cause ?
Cependant — n'est-ce pas là l'essentiel ? — il ne cesse de former un tout, de se régénérer ou métamorphoser en nous dans les moments de répit où notre volonté n'agit plus sur lui de même que, dans le reste de l'existence, chahutés par les émotions, la fatigue, la bousculade de nos journées, nous avons besoin, pour nous retrouver, d'un sommeil réparateur.
Savoir, quand un livre nous tient à cœur, si ce n'est pas plutôt lui qui poursuit en nous son exploration et, tirant à lui une part de nous-même, restaure ainsi son unité en même temps que la nôtre.
Sans ce travail sous-jacent, tout effort demeurant vain et désordonné, notre désir de comprendre, d'entrer en sympathie ne pourrait sans doute que se briser ; telle une vague venue se jeter contre des rochers, nous-même, provisoirement, nous ne serions qu'éclaboussures.
Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses, "en lisant en écrivant", José Corti, 2007, p. 74, 83, 84-85.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la rumeur de toutes choses, rêve, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2012
Edmond Jabès, Aely

Le livre
L'ombre a, pour passé, la lumière et la clarté, l'ombre.
Quel que soit le chemin que nous empruntions, le passé brasille au loin, tel d'une bougie, le dernier bout libre de la mèche.
Nous retrouvons la chandelle quittée, le temps d'une lecture.
Le livre est le lieu de ces allers et retours ampliatifs.
... de la nuit à la nuit, c'est-à-dire de l'en deçà à l'au-delà du passé.
Je fais une œuvre qui, instantanément, se refait dans le livre.
Cette répétabilité est celle de sa propre respiration, comme elle est celle de la reduplication de chacun de ses signes.
Si inspirer consiste à remplir d'oxygène ses poumons, expirer serait donc les vider de vie, glisser dans le vide.
Ainsi, nous ne nous maintenons au monde que parce que nous consentons d'avance à mourir.
Edmond Jabès, Aely, Gallimard, 1972, p. 157-158.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, aely, l'ombre, la lumière, le livre | ![]() Facebook |
Facebook |
12/08/2012
Sylvia Plath, Arbres d’hiver, précédé de La Traversée

Mort-nés
Ces poèmes ne vivent pas : c’est un triste diagnostic.
Ils ont pourtant bien poussé leurs doigts et leurs orteils,
Leur petit front bombé par la concentration.
S’il ne leur a pas été donné d’aller et venir comme des humains
Ce ne fut pas du tout faute d’amour maternel.
Ô je ne peux comprendre ce qui leur est arrivé !
Rien ne leur manque, ils sont correctement constitués.
Ils se tiennent si sagement dans le liquide formique !
Ils sourient, sourient, sourient, sourient de moi.
Et pourtant les poumons ne veulent pas se remplir ni le cœur s’animer.
Ils ne sont pas des porcs, ils ne sont pas même des poissons,
Bien qu’ils aient un air de porc et de poisson —
Ce serait mieux s’ils étaient vivants, et ils l’étaient.
Mais ils sont morts, et leur mère presque morte d’affolement,
Et ils écarquillent bêtement les yeux , et ne parlent pas d’elle.
Stillborn
These poems do not live : it’s a sad diagnosis.
They grew their toes and fingers well enough,
Their little foreheads bulged with cincentration.
If they missed out on walking about like people
It wasn’t for any lack of mother-love.
O I cannot understand what happened to them !
They are proper in shape and number and every part.
They sit so nicely in the pickling fluid !
They smile and smile and smile and smile at me.
And still the lungs won’t fill and the heat won’t start.
They are not pigs, they are not even fish,
Though they have a piggy and a fishy air —
It would be better if they were alive, and that’s what they were.
But they are dead, and their mother near dead with distraction.
And their stupidly stare, and do not speak of her.
Sylvia Plath, Arbres d’hiver, précédé de La Traversée, édition
bilingue, présentation de Sylvie Doizelet, Traductions de
Françoise Morvan et Valérie Rouzeau, Poésie/Gallimard,
1999, p. 88 ( texte anglais)-89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, arbres d’hiver, précédé de la traversée, valérie rouzeau, françoise morvan | ![]() Facebook |
Facebook |
09/08/2012
Jean-Pascal Dubost, et leçons et coutures

Clément Marot Faire des poèmes de tête de mule et de lard et de bique et de pioche et de bois donc mauvaise et à claquer et soupe au lait, puisant dans l'enfance son lot de paroles cassantes qui turlupinent la teste de belins devenue qui, de riens, fait tout un Graal de soi, et résiste à l'émasculation mentale maternelle et politique et puticitaire en digressanr carrément comme un cochon même les vendredis pour faire chier les curés de l'âme et se faire, en solitaire, plaisir, et à la moindre occasion, car à chaque fois sa marotte (la vie n'est tolérable qu'avec), et poète se faire, sans en faire tout un poème, mais en faire tout un plat [le Graal], pour accumuler joyeusement ses défauts, et voilà, j'ai fait partout—
Jean-Pascal Dubost, et leçons et coutures, éditions Isabelle Sauvage, 2012, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pascal dubost, et leçons et coutures, clément marot | ![]() Facebook |
Facebook |
31/07/2012
Jean-Claude Mattrat, La chose le chaos
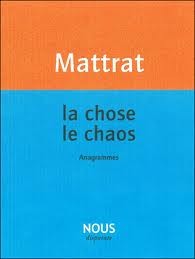
anagrammes :
artiste confirmé artifice monstre
artiste émergeant stratagème entier
l'édulcoré fait l'élu décoratif
l'acte de chair délit à cacher
tu bricoles l'obscurité
en vérité on a lu une révélation
l'identité française cadre et infantilise
l'égalité agit-elle ?
l'alternative être vaillant
pétition géante attention piège
le crétin est le centriste
Jean-Claude Mattrat, La chose le chaos, anagrammes, éditions NOUS, 2012, p. 58-59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude mattrat, la chose le chaos, anagramme | ![]() Facebook |
Facebook |
23/07/2012
Ossip Mandelstam, Lettres

Ma Nadinka ! Je suis complètement perdu. C'est très dur pour moi. Nadik, je devrais toujours être avec toi. Tu es ma courageuse, ma pauvrette, mon oisillon. J'embrasse ton joli front, ma petite vieille, ma jeunette, ma merveille. Tu travailles, tu fais quelque chose, tu es prodigieuse. Petit Nadik ! Je veux aller à Kiev, vers toi. Je ne me pardonne pas de t'avoir laissée seule en février. Je ne t'ai pas rattrapée, je n'ai pas accouru dès que j'ai entendu ta voix au téléphone, et je n'ai pas écrit, je n'ai rien écrit presque tout ce temps. Comme tu arpentes notre chambre, mon ami ! Tout ce qui, pour moi, est cher et éternel se trouve avec toi. Tenir, tenir jusqu'à notre dernier souffle, pour cette chose chère, pour cette chose immortelle. Ne la sacrifier à personne et pour rien au monde. Ma toute mienne, c'est dur, c'est toujours dur, et maintenant je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Ils(1) m'ont embrouillé, me tiennent comme en prison, il n'y a pas de lumière. Je veux sans cesse chasser le mensonge et je ne peux pas, je veux sans cesse laver la boue et je n'y arrive pas.
À quoi bon te dire combien tout, absolument tout est délire, rêve inhumain et blafard ?
Ils m'on torturé avec cette affaire, cinq fois ils m'ont convoqué. Trois enquêteurs différents. Longuement : trois-quatre heures. Je ne les crois pas, bien qu'ils soient aimables.
(13 mars 1930, à Nadejda Mandelstam)
(1) Mandelstam est interrogé par le Guépéou, police politique.
Ossip Mandelstam, Lettres, traduit du russe par Ghislaine Capogna-Bardet, préface d'Annie Epelboin, Solin / Actes Sud, 2000, p. 243.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, lettres, nadejda, police politique soviétique | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2012
Les techniciens du sacré, anthologie Jérôme Rothenberg

Le dieu Dumuzi
Chant de la vulve d'Inana
je suis femme moi
qui dans cette maison
de lapis sacré
portant
dans mon sanctuaire dis ma
prière sacrée
moi qui suis femme moi
qui suis reine des cieux
que l'officiant
le psalmodie
que le chanteur le chante
& que mon nouvel époux
mon Dumuzi mon
taureau furieux me comble
que les mots tombent
de leurs bouches
ô chanteurs chantant
pour leur jeunesse
leur chanson qui s'élève
à Nippour offrande à faire
au fils de dieu
moi qui suis femme chante pour
le louer
l'officiant le psalmodie
moi qui suis Inana
lui donne le chant de ma vulve
ô étoile ma vulve de la Grande Ourse
vulve barque lancée des cieux
nouvelle lune beauté croissante vulve
désert mon labour vulve
chant des oies sauvages en jachère
où ma motte attend
d'être inondée par lui
colline ma
vulve béante
& la fille demande :
qui va la labourer ?
Vulve mouillée inondée
la mienne moi la reine
menant jusqu'ici ce bœuf
« femme il labourera pour toi
notre roi Dumuzi labourera pour toi
ô laboure ma vulve ô mon cœur
mes cuisses sacrées en sont
trempée ô mère sacrée »
[Sumer]
Les techniciens du sacré, anthologie de Jérôme Rothenberg, version française établie par Yves di Manno, José Corti, 2007, p. 354-355.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les techniciens dy sacré, jérôme rothenberg, yves di manno, sumer | ![]() Facebook |
Facebook |
28/05/2012
P. N. A. Handschin, Abrégé de l'histoire de ma vie

Encore une fois, je suis reparti sur les routes en solitaire, craintif et timide, j' avais peu — pour ne pas dire pas — d'amis adolescent, j'ai découvert la musique avec Léo Stinato, les Choux Facis et Bob Dylan m'a mis le pied à l'étrier en me donnant l'occasion de chanter (La Carmagnole, a cappella) sur scène (au Concertgebouw d'Amsterdam soudainement déserté) mes débuts ont été assez difficiles — pour ne pas dire désastreux — c'est certain, nos vies sont faites de tout un réseau de voies mêlées et inextricables, parmi lesquelles un instinct fragile nous guide, équilibre toujours précaire entre la raison et le cœur léger (mais n'exagérons pas), j'ai quitté le lycée (au lycée j'étais tellement peu sociable que j'avais l'air presque dément) et ai commencé à faire des petits boulots pas forcément très catholiques, mes parents (catholiques intégristes (et antisémites opiniâtres et racistes déclarés et homophobes incurables) oui) m'ont causé plus de mal somme toute que ne l'aurait fait un ennemi féroce, et acharné, et sont allés je ne mens pas jusqu'à me faire interner en hôpital psychiatrique (HDL, hospitalisation à la demande d'un tiers) où ils m'ont laissé pourrir le terme n'est pas trop fort plus d'un an (un an avec des "collègues" braqueurs de bureaux de tabac, détraqués sexuels, atrophiés du cerveau, camés, SDE, schizophrènes, obèses boulimiques, suicidés ratés... un an trois cent soixante-cinq jours multiplié par vingt et un cachets par jour — sept mille six cent soixante cinq cachets j'étais devenu un zombie, on devait se lever à sept heures tapantes du matin pour ne RIEN faire de la journée, et quand on avait été "sage" on était autorisé à la rigueur à mettre ses propres habits (si en état) sinon c'était le port du pyjama bleu turquoise (avec fermeture à glissière dans le dos, inaccessible au patient) de l'établissement. Exceptionnellement on pouvait sortir dans la cour, qu'il me faudrait plus justement nomme courette — espèce de fonds de puits pathétique, sans écho —, avec son minuscule carré de mauvaise herbe dure et maigre enceint de murailles noirâtres assez hautes hérissées de tessons et de pointes sournoises et de fil de fer barbelé, pour horizon ce déplorable séjour qui m'a brisé (l'orgueil et la volonté), m'a enfoncé (dans l'ombre épaisse et la brume), m'a anéanti.
Anéanti par le décès accidentel (sur l'autoroute A13 à Épône dans les Yvelines) de ma compagne Évelyne, j'ai erré sans but çà et là entre la France et la Belgique jusqu'en juin avant de m'installer de nouveau au rez-de-chaussée d'un hôtel sordide de Bellevue), borgne et louche, à Paris, j'ai travaillé dans une conserverie de poisson (Baltika Importation Exportation, rue Frédéric-Schneider dans le XVIIIe), puis dans une blanchisserie un moment j'ai même été incarcéré — pour fraude à la carte bleue et trafic de faux champagne rosé (mille cent une bouteilles) et d'amphétamines — à la prison de la Santé et l'humeur déjà bien chancelante de ma mère se sont détériorées sévèrement tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de fiche en l'air de gâcher ma jeunesse et peut-être ma vie, je l'ai passée à me défendre péniblement de l'envie dévorante et maligne d'y mettre fin octobre, j'ai trouvé un emploi [...]
P. N. A. Handschin, Abrégé de l'histoire de ma vie, Argol, 2011, p. 66-69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : p.n.a. handschin, histoire de ma vie, autobiographie et fiction | ![]() Facebook |
Facebook |
25/05/2012
Federigo Tozzi, Les Bêtes (traduction Philippe Di Meo)

Je reviens dans les grandes prairies, que j'aimais avant même de lire Pétrarque, pour voir les fleurs que j'aurais offertes, il y a bien des années, à une jeune fille que j'imaginais comme je la vois maintenant dessinée dans certain livre. Elle devait être surtout gentille et sentimentale ; et elle devait m'aimer toujours autant, même si je l'avais épousée Et, parfois, relisant nos lettres, nous aurions soupiré à l'unisson.
Mais cette année aussi, il y a des fleurs et peut-être même davantage, car le temps a été moins sec ; et alors, l'envie me prend de courir vers l'horizon pour voir si je parviens à étreindre cette femme qui me semble plus vivante que parle passé.
Mais il y a seulement une hirondelle qui trisse.
*
J'ai toujours eu peu de temps pour aimer quelqu'un
Cet été était si chaud que dans le ciel lui-même, il n'y avait pas de place pour lui. On eût dit que le soleil se levait toujours plus grand, et il était impossible d'imaginer le moment où il se coucherait.
Haies empoussiérées, cyprès sur le point de sécher, semble-t-il, arbres morts, sorghos et maïs devenus blancs, réseaux d'araignées si brillants qu'ils semblaient faits d'un métal qui couperait les mains, portes crevassées, tonneaux défoncés, la terre si dure que plus personne ne la travaillait, les lits des torrents sans libellules et à l'herbe fanée, saules qui ne poussaient plus, mûriers à feuilles minuscules, socs luisants, pierres qui échaudaient, nuages rouges comme des flammes, étoiles filantes !
Sur le nœud d'un olivier chante une cigale : je l'aperçois. Je m'approche, sur la pointe des pieds, en équilibre d'une motte de terre à l'autre. Je l'attrape. Je lui arrache la tête.
Federigo Tozzi, Les Bêtes, traduction de Philippe Di Meo, collection Biophilia, José Corti, 2012, p. 34-35, 48.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : federigo tozzi, les bêtes, philippe di meoété | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2012
Marcel Jouhandeau, Correspondance avec Jean Paulhan

Depuis trois mois, une chatte mendiante se terrait à notre porte du côté du jardin du matin au soir. Sans doute, une abandonnée. Après les repas, ma mère lui apportait nos restes, mais je sentais que pour la pauvre bête, c'était moins de nos restes qu'elle avait faim que de notre intimité. Chaque fois qu'on entrouvrait la porte en effet, elle regardait l'avenue de cette cuisine où il devait y avoir du feu et une bonne odeur avec un geste si naïf et si éloquent d'envie et d'impatience, mais ma mère ne sachant pas d'où la bête venait, ne voulait pas la laisser pénétrer chez elle. Hier, j'ai obtenu qu'on l'adoptât et elle s'est précipitée à l'intérieur de son rêve comme d'un Paradis et elle s'y pavane maintenant, ivre de bonheur. Sans bassesse, elle est en admiration devant toute chose et ne cesse de nous remercier en se serrant tour à tour contre les jambes de ma mère et contre les miennes. Je la prends sur mes genoux, quand elle n'ose même pas monter sur une chaise. Son humilité et sa discrétion me ravissent. Je me plais à la combler et je ne saurais dire ce que cette présence du « bonheur » me fait du bien. C'est une chatte de l'espèce la plus commune, mais distinguée, à la robe blanche et manteau de deuil ; son petit museau plus blanc que le reste, sous deux bandeaux noirs très réguliers où s'enchâssent les yeux verts. J'aime surtout quand à demi assise elle vire sur elle-même comme aidée par une aile invisible sur deux pattes de devant longtemps levées, telles deux menottes, sans qu'elle paraisse avoir besoin de les reposer sur le plancher pour garder l'équilibre, avec des grâces de kangourou. On dirait qu'elle sait beaucoup plus qu'une autre, qu'elle sait beaucoup mieux le prix de la moindre joie. La misère et la souffrance lui ont donné une âme et cette science.
Marcel Jouhandeau, dans Marcel Jouhandeau, Jean Paulhan, Correspondance, 1921-1968, édition établie, annotée et préfacée par Jacques Roussillat, Gallimard, 2012, 11 février 1931, p. 114-115.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel jouhandeau, jean paulhan, correspondance, chat | ![]() Facebook |
Facebook |
03/05/2012
Georges Perros, Papiers collés

Demander le sens d'un vers, c'est vouloir en savoir plus long que le poète lui-même. Le sens d'un vers, c'est et ce ne peut être que le vers lui-même. Le poète s'embarrasse, manque « d'esprit » si jamais il croit pouvoir signifier autrement que par la poésie. Et donne des regrets.
Ce qu'il y a de brutal et d'exemplaire chez Rimbaud, c'est qu'il rend la vie inutile. Inutilisable. Toute lecture, toute ambition intellectuelle, hors de question. Puisqu'un Rimbaud est possible, tout est vain. Il arrive et il parle. Et sa parole est un chant. Et ce chant implique tous les chants possibles. Et les annule. L'expérience, la durée, l'homme sont ici mis en déroute. Il renverse toutes les lois, en imposant la loi qui est et reste le haut fait d'être ce que l'on est. Il ne vit que par raccroc, il respire parce qu'il faut
bien. Et peu importe alors ce qu'il va faire de cette vie dérisoire. Sa poche d'ignorance, d'inspiration est préservée. Il rend à ce qu'on nomme la vie le suprême hommage, qui consiste à opérer comme si l'on n'avait que faire de ce qu'elle laisse espérer. Héritier milliardaire qui vivrait comme si ce trésor ne lui était de rien. Superbe mépris. Il rendra la cassette pleine, sans même s'être soucié d'en vérifier les richesses. Antiphilosophique extrême qui respecte aussi peu la mort que la vie. Il avance oreilles bouchées, lèvres closes, muet jusqu'au rire ; oui proprement angélique. Brûlant toutes ses cartes sans calcul, sans préméditation, sans plaisir. Il est ce qu'il est et fait ce qu'il fait. Le secret de Rimbaud, c'est l'évidence. Un rien de présence déplacée et c'en était fait. Il réussissait ou il échouait. Alors que son destin n'est pas qualifiable. Est le présent même.
Georges Perros, Papiers collés, Gallimard, 1960, p. 33, 78-79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, papiers collés, rimbaud, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
15/04/2012
Colette, "Mœurs de la glycine", Pour un herbier

Mœurs de la glycine
J'espère bien qu'elle est encore vivante, qu'elle le sera longtemps, cette despote au moins deux fois centenaire, florissante, incoercible, la glycine qui hors de mon jardin natal s'épanche au-dessus de la rue des Vignes. La preuve de sa vitalité me fut apportée l'an dernier, par une alerte et charmante pillarde aux cheveux blancs... Une robe noire, une blanche chevelure, une agilité de sexagénaire : tout cela avait sauté, dans la rue des Vignes déserte comme autrefois, jusqu'à atteindre et dérober un long lien terminal de glycine, qui acheva de fleurir à Paris, sur le lit-divan où me tient l'arthrite. La fleur en forme de papillon détenait, outre le parfum, un petit hyménoptère, une chenille arpenteuse, une coccinelle heptapunctata, le tout en provenance directe, inespérée, de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Pour dire le vrai, cette glycine, à qui je trouvais, sur ma table-banquette, une fragrance, une couleur bleu mauve, une attitude quasi reconnaissables, je me souviens qu'elle fut de mauvais renom, tout le long de l'étroit empire borné par un mur, défendu par une grille. Elle date de très loin, d'avant le premier mariage de Sido ma mère. Sa folle floraison de mai, sa résurgence maigre d'août septembre embaument les souvenirs de ma petite enfance. Elle se chargeait d'abeilles autant que de fleurs, et murmurait comme une cymbale dont le son se propage sans s'éteindre, plus belle chaque année, jusqu'à l'époque où Sido, penchée curieusement sur le fardeau de fleurs, fit entendre le petit « Ah ! Ah ! » des grandes découvertes attendues : la glycine commençait à attacher la grille.
Comme il ne pouvait pas être question, dans l'empire de Sido, de tuer une glycine, celle-ci exerça, exerce encore sa force réfléchie. Je l'ai vue, soulever, brandir en l'air, hors des moellons et du mortier, un imposant métrage de grille, tordre les barreaux à l'imitation de ses propres flexions végétales, et marquer une préférence pour l'enlacement ophidien d'un tronc et d'un barreau, qu'elle finit par incruster l'un à l'autre. Il lui arriva de rencontrer le chèvrefeuille voisin, le charmant chèvrefeuille mielleux à fleurs rouges. Elle eut l'air d'abord de ne pas le remarquer, puis le suffoqua lentement comme un serpent étouffe un oiseau.
J'appris, à la voir faire, ce qu'est sa puissance meurtrière, qui sert une convaincante beauté. J'appris comment elle couvre, étrangle, pare, ruine, étaye. L'ampélopsis est un petit garçon, comparé aux spires, ligneuses dès leur premier âge, de la glycine.
[...]
Colette, Pour un herbier [1948], dans Œuvres, IV, édition publiée sous la direction de Claude Pichon et Alain Brunet, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2001, p. 892-893.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : colette, pour un herbier, mœurs de la glycine | ![]() Facebook |
Facebook |
09/04/2012
Julien Gracq, La Forme d'une ville

La forme d'une ville change plus vite, on le sait, que le cœur d'un mortel. Mais, avant de le laisser derrière elle en proie à ses souvenirs — saisie qu'elle est, comme le sont toutes les villes, par le vertige de métamorphose qui est la marque de la seconde moitié de notre siècle —, il arrive ainsi, il arrive plus d'une fois que, ce cœur, elle l'ait changé à sa manière, rien qu'en le soumettant tout neuf encore à son climat et à son paysage, en imposant à ses perspectives intimes comme à ses songeries le canevas de ses rues, de ses boulevards et de ses parcs. Il n'est pas nécessaire, il est sans doute même de médiocre conséquence qu'on l'ait souvent habitée. Plus fortement, plus durablement peut-être, agira-t-elle sur nous si elle s'est gardée en partie secrète, si on a vécu avec elle, par quelque singularité de condition, sans accès vrai à son intimité familière, sans que notre déambulation au long de ses rues ait jamais participé de la liberté, de la souple aisance de la flânerie. Pour s'être prêtée sans commodité, pour ne s'être jamais tout à fait donnée, peut-être a-t-elle enroulé plus serré autour d'elle, comme ue femme, le fil de notre rêverie, mieux jalonné à ses couleurs les cheminements du désir.
Julien Gracq, La Forme d'une ville [José Corti, 1985], dans Œuvres complètes, II, édition établie par Bernhild Boie, avec la collaboration de Claude Dourguin, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1995, p. 773.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, la forme d'une ville | ![]() Facebook |
Facebook |





