30/09/2012
Emily Dickinson, Poèmes, traduits par Claire Malroux

La « Nature » est ce que nous voyons —
La Colline — l'Après-Midi —
L'Écureuil — l'Éclipse — Un beau Bourdon —
Mieux — la Nature est Paradis —
La Nature est ce que nous entendons —
Le Loriot — la Mer —
Le Tonnerre — un Grillon —
Mieux — la Nature est Harmonie —
La Nature est ce que nous connaissons —
Mais sans avoir l'air de le dire —
Si débile est notre Sagesse
Face à sa Simplicité
"Nature" is what we see —
The Hill — the Afternoon —
Squirrel — Eclipse — the Bumble bee —
Nay — Nature is Heaven —
Nature is what we hear
The Bobolink the Sea —
Thunder — the Cricket —
Nay — Nature is Harmony —
Nature is what we know —
Yet have no art to say —
So impotent Our Wisdom is
To her Simplicity
Emily Dickinson, Poèmes, traduit et préfacé par
Claire Malroux, Belin, 1989, p. 193 et 192.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, poèmes, claire malroux, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
29/09/2012
Jacques Dupin, L'embrasure

Ce qu'une autre m'écrivait
comme avec une herbe longue et suppliciante
toi, toute, en mon absence, là,
dans le pur égarement d'un geste
hostile au gerbier du sang,
tu t'en délivres
tel un amour qui vire sur son ancre, chargé
de l'ombre nécessaire,
ici, mais plus bas, et criant
d'allégresse comme au premier jour
et toute la douleur de la terre
se contracte et se voûte
et surgit en une chaîne imprévisible
crêtée de foudre
et ruisselante de vigueur
*
Malgré l'étoile fraîchement meurtrie
qui bifurque
— c'est sa seule cruauté le battement
de ma phrase qui s'obscurcit
et se dénoue —,
il est encore capable, lui, de soutenir
la proximité du murmure
Jacques Dupin, L'embrasure, Gallimard, 1969,
p. 32 et 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, l'embrasure, amour, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2012
Henri Thomas, La joie de cette vie
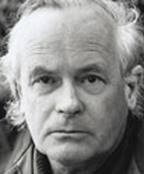
J'écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages, comme Paulhan, où l'on disparaît quand la machine se modifie pour votre mort.
Je quitte tout, presque tout, pour la route des mots.
Si la mort est la solution forcée du problème appelé la vie, nous ne comprenons pas plus le problème que la solution, et si nous pouvons constater cela, c'est grâce au langage, que nous ne comprenons pas davantage.
Je n'ai pas vécu ce que j'écris maintenant ; je le vis, je le découvre, en l'écrivant — sur le mode de l'écriture, comme on dit en croyant par cette formule expliquer quelque chose.
Je n'ai, pour répondre de moi, que mes livres, que j'ai oubliés, après m'y être absorbé, peut-être résorbé. Ils sont pareils en cela aux amours, dont on n'a plus guère que le titre : un nom, un prénom, une couleur dominante ; le reste a disparu comme l'herbe des champs, comme les lignes écrites il ya six mois ou dix ans.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 21, 28, 29, 30, 33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, écrire, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2012
Paul Claudel, Cinq grande odes

La Muse qui est la grâce
Encore ! encore la mer qui revient me chercher comme une barque,
La mer encore qui retourne vers moi à la marée de syzygie et qui me lève et remue de mon ber comme une galère allégée,
Comme une barque qui ne tient plus qu'à sa corde, et qui danse furieusement, et qui tape, et qui saque, et qui fonce, et qui encense, et qui culbute, le nez à son piquet,
Comme le grand pur sang que l'on tient aux naseaux et qui tangue sous le poids de l'amazone qui bondit sur lui de côté et qui saisit brutalement les rênes avec un rire éclatant !
Encore la nuit qui revient me rechercher,
Comme la mer qui atteint sa plénitude en silence à cette heure qui joint l'Océan les ports humains pleins de navires attendants et qui décolle la porte et le batardeau !
Encore le départ, encore la communication établie, encore la porte qui s'ouvre !
Ah ! je suis las de ce personnage que je fais entre les hommes ! Voici la nuit ! Encore la fenêtre qui s'ouvre !
Et je suis comme la jeune fille à la fenêtre du beau château blanc, dans le clair de lune,
Qui entend, le cœur bondissant, ce bienheureux sifflement sous les arbres et le bruit de deux chevaux qui s'agitent,
Et elle ne regrette point la maison, mais elle est comme un petit tigre qui se ramasse, et tout son cœur est soulevé par l'amour de la vie et par la grande force cosmique !
[...]
Paul Claudel, "Quatrième ode", dans Cinq grandes odes, préface de Jean Grosjean, Poésie / Gallimard, 1966 [1913], p. 73-74.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, cinq grandes odes, la muse, la mer, la nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2012
Jean Frémon, Rue du Regard

Paysage / Figure
La très étroite bande verticale de paysage qui se découpe entre le mur et le volet à demi fermé de la fenêtre qui éclaire la chambre nuptiale où les époux Arnolfini se tiennent , debout, par la main, est très irréelle. Très imaginaire.
Par une effet de métonymie, on a coutume d'appeler Figure un tableau plus haut que large, parce qu'il est plutôt approprié au portrait, buste, mi-corps ou en pied, et Paysage un tableau plus large que haut. (Par la vertu d'une seule ligne horizontale, un sol et un ciel sont là, c'est un paysage, le reste est facultatif. Il serait amusant de chercher les exceptions — Corot, il peint les arbres comme des figures, Constable aussi.)
Verticale, la bande de paysage des Arnolfini est plus une figure qu'un paysage, c'est l'intrusion, à dose infinitésimale, comme par une meurtrière, du mythe du paradis perdu dans le rite matrimonial. Adam et Éve, chassés par Mantegna, ont retrouvé un bercail. Il est cossu, il est même sacré, on est près de se déchausser !
Sur l'appui de la fenêtre, comme oubliée là par mégarde, une pomme, en pleine lumière, avec sa petite ombre portée, vient opportunément rappeler l'innocence d'avant la chute.
Jan Van Eyck était là.
Jean Frémon, Rue du Regard, P. O. L, 2012, p. 199-200.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean frémon, rue du regard, paysage, figure, van eyck | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2012
Jean-Loup Trassard, Inventaire des outils..., Traquet motteux....

Des fermes
Depuis une ferme dont le nom était Les Champs blancs, à cause des parcelles de sarrazin fleuri qui tournaient autour, mon arrière-grand-mère allait au village à cheval. La cause profonde d'une passion pour les fermes s'enracine-t-elle dans ce bocage normand ? Ou bien mon goût serait-il né d'une réjouissance enfantine à deviner que la ferme est ce qui reste, en France, le plus proche de la maison primitive, celle qui eut charpente en os de baleine, puis des parois de branches tressées, puis des complications, recoins et dépendances, creusées dans la terre, consolidées de pierres ?
Car la ferme, ramifiée en cellier, grange, resserre, grenier, hangars, berderie ou étable, est une maison qui enrichit sans fin la plaisir d'habiter. Il y a l'abri et l'espace, les bêtes, le nécessaire pour vivre et travailler. Surtout il y a un puits (quelquefois dans les murs comme celui d'un château fort pour résister aux sièges). Surtout il y a un feu. C'est une réserve d'outils, de nourriture, de chaleur. Les volailles ne s'en écartent guère, le bétail s'empresse d'y revenir quand la barrière du pré s'entrouve. Aux heures de distribution du grain, du lait ou du fourrage, les dindes, les cochons, les chèvres y appellent ensemble.
Jean-Loup Trassard, Traquet moteux ou L'agronome sifflotant, Le temps qu'il fait, 1994, p. 17.
*
C'est plutôt à la remise que s'expose la panoplie des instruments à main : appuyés, suspendus, piqués dans une poutre. Bien que parfois ils ne coupent plus ou perdent leur manche, toutes fonctions mêlées, ils sont toujours disponibles pour qui veut prononcer, même intérieurement, leur nom et s'en saisir.
Parmi eux, venues de l'aube où d'autres les avaient courbées pour nous, ces lames de métal dont nous ne cherchions pas l'origine en les posant sur notre bras, pour la protection d'autrui leur tranchant leur tranchant tourné vers notre propre corps.
L'un des bruits qui rythmait le temps lourd des premières après-midi orageuses était alors celui du marteau martelant la faux sur l'enclumette plantée dans une souche. Laquelle servait de siège pour cet ouvrage.
[...] Tête d'acier légèrement arquée dont un bord est coupant et l'autre formé par une nervure qui donne la rigidité. Le tranchant et le dos se joignent en pointe aiguë tandis que la base, large, porte une queue qui permet, avec anneau et coin, la fixation sur un manche de bois. La longueur de ce manche, muni d'une poignée transversale, sert un peu de balancier. Mais ne partez pas sans réglage ! La faux qui n'en a pas l'air est un instrument très complexe... Suivant le type de lame, la nature des tiges à couper, la taille du faucheur, sa force, son habileté, sera déplacée la poignée réglable le long du manche, seront à modifier l'angle que fait la lame avec le manche ou l'angle que fait le plan de cette lame avec le sol qu'elle rase. Et ces nuances subtiles entrent en combinaison. L'on tenait compte encore de la verse éventuelle du foin ou de la pente du terrain.
Alors le faucheur; s'étant assuré du sol, le pied droit en avant, prenait son élan de gauche à droite, engageait la pointe dans l'herbe, lançait l'oscillation. Il suivait sans cesse la faux des yeux pour veiller à ne pas émousser sa faux tout en coupant le plus bas possible. Le bruit de l'herbe tranchée déjà le renseignait sur le rythme à garder et sur le rapport du fil avec la résistance végétale.
Jean-Loup Trassard, Inventaire des outils à main dans une ferme, photographies de l'auteur, Le temps qu'il fait, 1981, p. 11-13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, inventaire des outils à main, traquet motteux, la ferme, la faux | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2012
Édith Azam, qui journal fait voyage

le jour du chien qui me mordra
Dans le jardin d'en face
un chien hurle à la mort :
il attend le printemps.
Près de la niche
os en plastique
plastique bouffé
par les fourmis.
Lui le chien
le très vieux chien
il est aveugle
ses yeux de cire sont gris pâle
ses yeux de cire ne voient pas
les fourmis rouges bouffer l'os
les fourmis rouges qui approchent
le chien de cire hurle à la mort
le très vieux chien
le trop vieux chien
Pendant ce temps le printemps passe
le printemps passe
le printemps passe
le printemps passe...
Le jour du jour bouffe ton tapis
Cette fois le walkman à fond
me fais la cinquième
de Beethov'
Je cours trois cents kilomètres heure
je dépasse mon corps
arrache les cheminées chimiques
désosse les lignes de chemin de fer
et me fais moi :
tout dérailler
Dehors ?
Dehors tout va très vite
le point de fuite
est souterrain
l'autre côté de moi
ne laisse pas de temps
Édith Azam, qui journal fait voyage, Atelier de
l'agneau, 2012, p. 34, 42. www.at-agneau.fr
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, qui journal fait voyage, le chien, le temps | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2012
Hervé Guibert, Des Aveugles

Ils étaient parés de robes incolores, de calottes de diable à cornes molles, de masques sans relief et sans trait, de capes informes qui n'étaient que le crissement virevoltant de leurs plis, de loups non échancrés, de diadèmes de lave et de collerettes de glace, d'inutiles azurs brodés, de pyjamas de soie rouge trompette et bleu violon, d'autres de bleus mous et de verts irritants, de bruns indistincts, de brassards et de couronnes de grelots, ils ne représentaient pas des hommes mais des rayons de lune, des rivières, des arbres de foudre, des éruptions, des ténèbres phosphorescentes les encerclaient en crépitant de doigt en doigt comme des feux magiques, sans danger pour se tourner la tête ils se rincèrent les yeux à l'alcool pur, ils se mirent des valses, is burent du feu dans des œillères, ils échangèrent chaussures contre tricornes, ils ajoutèrent des cascades de rubans sur leurs perruques, leurs mains étaient gantées de feuilles et leurs mollets de feux gainés, ils coururent d'un bout à l'autre des couloirs et sautèrent les obstacles, ils s'étaient déguisés en colonnes et en traîneaux, en Niagaras et en Monts-Blancs, ils dévorèrent des pièces montées et en croquèrent mariés et communiants, tout ruisselants d'odeurs qui n'étaient pas les leurs — hommes contre femmes, animaux contre cadavres — ils se poursuivirent dans les jardins, ils se lancèrent dans les pattes des rats mécaniques, les incendiaires luttèrent avec les prestidigitateurs, ils chutèrent délicieusement.
Hervé Guibert, Des Aveugles, Folio / Gallimard, 1985 [1983], p. 11-12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé guibert, des aveugles, fantaisie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2012
Pascal Quignard, Abîmes, Dernier Royaume III

Amaritudo
Dans la volupté se perd le désir d'être heureux. Plus on s'abandonne tout entier au désir, plus le bonheur est presque là. On le guette et toute l'erreur consiste dans ce point. On s'attend à sa rencontre. On le pressent. On le voit soudain ; on l'attend encore plus ; il s'approche ; il arrive. En arrivant il se détruit.
Cet argument permet de comprendre les décisions de la chasteté.
Le désir est lié au perdu sans limites.
De deux façons. 1. Le désir est plus proche du perdu que la joie génitale, plus récente, qui croit mettre la main dessus. 2. On perd le désir en jouissant. Cette perte très désagréable dans ses conséquences est même la définition de la volupté.
Pascal Quignard, Abîmes, Dernier Royaume III, Folio -Gallimard, 2004 [2002], p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, abîmes, dernier royaume iii, la perte, le désir | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2012
Danielle Collobert, Cahiers 1956-1978

Le calme revient par moments — le silence — et aussi conscience de tout ce qui n'est pas entièrement présent — longtemps pour apprivoiser les mots — départ — décision de partir — décollement de l'instant — et du lieu — pas d'éloignement immédiat —
perception égale — plane —
les mots — beaucoup de mots — sans raison apparente_
des mots dissemblables — de gens — de consonances — très éloignés entre eux — produisent sur moi le même effet ou plutôt la même gêne ou malaise — des mots prononcés par certaines personnes détruisent en moi ce que je croyais très solide — ça m'effraie — j'arrive difficilement à dépasser le moment de cette gêne qui dure parfois des jours entiers — sans que d'autres impressions viennent s'y substituer — je dors sans que la sensation disparaisse au réveil — ça s'étend à des domaines inhabituels — par exemple l'autre jour ce désir énorme de manger jusqu'à la sensation de lourdeur — de boire jusqu'à l'inconscience — être un organe géant — monstrueux — engloutir ce mot-là — la sensation de ce mot —
Danielle Collobert, Cahiers 1956-1978, Change, Sefhers/Laffont, 1983, p. 26.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, cahiers 1956-1978, le silence, les mots | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2012
Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur : recension

On oublie que la large diffusion du livre est récente au regard de l’histoire de l’écrit. Un grand succès de libraire au milieu du XVIIIe siècle était vendu à 1500 exemplaires et l’immense majorité de la population n’y avait pas accès. La lecture n’avait pas les mêmes formes qu’aujourd’hui ; peu savaient lire et seule la pratique de la lecture à voix haute permettait une large diffusion de certains textes, ceux surtout de la Bibliothèque bleue, ainsi nommés parce que les livrets, brochés, portaient une couverture bleue1. Il s’agissait de petits recueils, méprisés alors des élites, qui abordaient les thèmes les plus divers : miracles, prophéties, recettes de cuisine, économie domestique, histoire sainte, etc. ; ils proposaient aussi des choix de contes et des romans de chevalerie abrégés. C’est cette dernière catégorie de titres que transporte dans sa boîte, de villages en hameaux, le jeune Julien Letrouvé.
Le récit de Pierre Silvain rappelle dans une belle fiction cette histoire de la lecture. Julien Letrouvé, abandonné à sa naissance comme son patronyme l’indique, devenu très jeune gardien d’un troupeau de cochons, a passé la petite enfance au milieu de fileuses qui travaillaient dans une écreigne – une habitation souterraine. L’une des femmes, qui avait failli devenir religieuse, lit pour ses compagnes : « tous écoutaient la liseuse tenant son petit livre à la lueur d’un falot posé sur une hotte renversée, les esprits vagabondaient vers des horizons toujours bleus, des lointains tout de douceur et de promesses ». Le jeune Julien, après la puberté, quitte ce refuge et devient colporteur, mais il laisse la mercerie à ses confrères et se voue à la seule diffusion du livre. Le lecteur le suit quand il quitte le libraire chez qui il remplit sa boîte avec L’Histoire de Fortunatus, Mélusine, La Complainte du Juif errant, Till l’espiègle et des fabliaux.
Le récit se déroule pendant une période bien troublée, à la veille de la bataille de Valmy en septembre 1792, et c’est dans la direction du champ de bataille que se dirige Julien sans le savoir. Il avance sous la pluie et dans le vent, et au cours de sa marche apparaissent des personnages contemporains — l’astronome Laplace arrête son cocher qui monte le colporteur à ses côtés, la lourde voiture du roi en fuite le dépasse. S’ajoutent, comme dans un livre, la confusion des temps, et surgissent dans le récit Fabrice del Dongo à Waterloo et Chateaubriand enrôlé dans l’armée des Princes, mais aussi les jours de la Terreur de 1793 et l’image de poupées, qui sont d’ailleurs mis en scène dans un autre livre de Pierre Silvain2 … Julien marche et, presque un siècle plus tard, « eût pu croiser un autre marcheur » dans cette région, Rimbaud. Gœthe est également convoqué, racontant la bataille de Valmy et, dans l’histoire de Julien, au début de la retraite, un soldat prussien, Voss, déserte. Après une longue errance, il se lie avec l’adolescent. Ce soldat à la vie romanesque parle et lit le français. Julien lui ouvre vite la boîte aux merveilles, celle des livres, et Voss s’enfuit dans la lecture – au point que Julien craint de ne pas le retrouver : « J’ai eu peur, tu étais parti si loin dans les mots, mais tu es revenu ». Le soldat lit ensuite, cette fois à voix haute, et Julien, qui suit les mots lus, « retrouvait le besoin inapaisable de comprendre ce que lui refusait son ignorance ». L’histoire qu’il écoute, c’est la dernière qu’il a entendue dans l’écreigne.
Il s’agit bien d’un récit d’initiation, de formation, et tout apprentissage est difficile. La soldatesque abattra le déserteur et brûlera les livres, ces livres au milieu desquels Julien vivait « caché, protégé » : « Le Paradis perdu, l’Âne d’or, Les Voyages de Gulliver, Une vie et Salammbô, Du Côté de chez Swann , Là-bas, Le Bruit et la fureur, L’Odyssée. » Construction onirique ? Oui, comme la fin du parcours de Julien. Lui, l’enfant venu de nulle part (sans père ni mère), reprend sa route vers nulle part. Il marche tout un hiver, dans la neige et le gel, s’arrête au printemps dans une ferme et, quand il assure qu’il va continuer sa route vers « là-bas », la femme qui l’a accueilli : « Il n’y a pas de là-bas, ici on est au bout du monde […] Et qui pourrait vous attendre, là où vous allez, plus loin que le bout du monde ?». Alors ? Réponse bouleversante : « Celle qui lit les livres ». C’est la fin du parcours, et cette femme qui, comme lui, ne sait pas lire peut se substituer à la liseuse de l’écreigne qui déchiffrait le mystère des mots, devenir la lectrice du monde.
Je n’ai retenu que des bribes, rapporté sommairement une intrigue sans assez dire la force des évocations qui font croire aux temps mêlés, à la fusion d’une certaine réalité avec l’univers des livres, sans dire aussi le charme d’une langue déliée, précise, maîtrisée, inspirée : impossible de ne pas lire d’une traite ce bref "roman", superbe manière d’honorer la lecture, le livre.
Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur, Verdier, 2007, 11 €.
©Photo Tristan Hordé
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, julien letrouvé colporteur, livre, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2012
Emily Jane Brontë, Poèmes, "L'amour et l'amitié"

L'amour et l'amitié
L'amour à la sauvage églantine est pareil
Et l'amitié pareille au houx.
Si le houx reste obscur quand fleurit l'églantine,
Lequel fleurit plus constamment ?
La sauvage églantine est suave au printemps ;
L'été, ses fleurs embaument l'air.
Attendez toutefois que revienne l'hiver,
Qui dira l'églantine belle ?
Dédaigne l'églantine et sa vaine couronne,
Fais du houx luisant ta parure
Afin, lorsque décembre aura flétri ton front
Qu'il y respecte sa verdure.
[automne 1839]
Love and friendship
Love is like the wild rose-briar,
Friendship like the holy-tree —
The holy is dark when the rose-briar blooms
But which bloom most constantly ?
The wild rose-briar is sweet in spring,
Its summer blossoms scents the air ;
Yet wait till winter comes again
And who will call the briar fair ?
Then scorn the silly rose-briar now
And deck thee with the holly's sheen,
That when December blights thy brow
He will may leave thy garland green.
[Autumn, 1839]
Emily Jane Brontë, Poèmes, traduction de Pierre Leyris, édition
bilingue, Poésie / Gallimard, 1983 [1963], p. 89 et 88.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily jane brontë, poèmes, "l'amour et l'amitié" | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2012
Charles Baudelaire, Fusées

L'enthousiasme qui s'applique à autre chose que les abstractions est un signe de faiblesse et de maladie.
La vie n'a qu'un charme vrai ; c'est le charme du Jeu Mais s'il nous est indifférent de gagner ou de perdre ?
De la langue et de l'écriture prises comme opérations magiques, sorcellerie évocatoire.
Dans certains états de l'âme presque surnaturels, la profondeur de la vie se révèle tout entière dans le spectacle, si ordinaire qu'il soit, qu'on a sous les yeux. Il en devient le symbole.
Il y a dans l'acte de l'amour une grande ressemblance avec la torture ou avec une opération chirurgicale.
Si un poète demandait à l'État le droit d'avoir quelques bourgeois dans son écurie, on serait fort étonné, tandis que si un bourgeois demandait du poète rôti, on le trouverait tout naturel.
Ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire.
À chaque minute nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps. Et il n'y a que deux moyens pour échapper à ce cauchemar : la plaisir et le travail. Le plaisir nous use. Le travail nous fortifie. Choisissons.
Plus nous nous servons d'un de ces moyens, plus l'autre inspire de répugnance.
Charles Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, texte établi et annoté par Y.-G. Le Dantec, édition révisée par Claude Pichois, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1968, p. 1251, 1252, 1256, 1257, 1257, 1257, 1259, 1266.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles baudelaire, fusées, le temps, l'amour, la vie | ![]() Facebook |
Facebook |
17/09/2012
Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses

Lacunes
Fascinant, le rêve l'est par ses lacunes bien plus que par son contenu souvent, examiné a posteriori, d'une consternante banalité.
Illusoire ?
La mémoire (n'est-elle fonction que de lanterne sourde ?), le paysage (la réalité faussement dite extérieure), les mots (leur charge affective en jeu) : autant, je le voudrais, de vases communicants, gages d'intimité.
Désarroi de la lecture
Lire : triturer, malaxer, tordre et détordre au plus près d'une vérité qui échappe.
Des notes de lecture éparses sur la table, réduites au strict minimum, parfois plus développées, des phrases ou bribes de phrases recopiées, des réflexions adjacentes, d'inattendus croisements de chemins, une errance sans but, inquiète et captivante : le livre lu et relu se défait, soumis à une véritable mise en pièces — en vue de quelque remise en état pour l'instant douteuse, quelle reconstitution toujours à remettre en cause ?
Cependant — n'est-ce pas là l'essentiel ? — il ne cesse de former un tout, de se régénérer ou métamorphoser en nous dans les moments de répit où notre volonté n'agit plus sur lui de même que, dans le reste de l'existence, chahutés par les émotions, la fatigue, la bousculade de nos journées, nous avons besoin, pour nous retrouver, d'un sommeil réparateur.
Savoir, quand un livre nous tient à cœur, si ce n'est pas plutôt lui qui poursuit en nous son exploration et, tirant à lui une part de nous-même, restaure ainsi son unité en même temps que la nôtre.
Sans ce travail sous-jacent, tout effort demeurant vain et désordonné, notre désir de comprendre, d'entrer en sympathie ne pourrait sans doute que se briser ; telle une vague venue se jeter contre des rochers, nous-même, provisoirement, nous ne serions qu'éclaboussures.
Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses, "en lisant en écrivant", José Corti, 2007, p. 74, 83, 84-85.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la rumeur de toutes choses, rêve, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2012
Edmond Jabès, Aely

Le livre
L'ombre a, pour passé, la lumière et la clarté, l'ombre.
Quel que soit le chemin que nous empruntions, le passé brasille au loin, tel d'une bougie, le dernier bout libre de la mèche.
Nous retrouvons la chandelle quittée, le temps d'une lecture.
Le livre est le lieu de ces allers et retours ampliatifs.
... de la nuit à la nuit, c'est-à-dire de l'en deçà à l'au-delà du passé.
Je fais une œuvre qui, instantanément, se refait dans le livre.
Cette répétabilité est celle de sa propre respiration, comme elle est celle de la reduplication de chacun de ses signes.
Si inspirer consiste à remplir d'oxygène ses poumons, expirer serait donc les vider de vie, glisser dans le vide.
Ainsi, nous ne nous maintenons au monde que parce que nous consentons d'avance à mourir.
Edmond Jabès, Aely, Gallimard, 1972, p. 157-158.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, aely, l'ombre, la lumière, le livre | ![]() Facebook |
Facebook |





