31/08/2012
Giorgio Caproni, Le Mur de la terre, traduit de l’italien par Philippe Di Meo
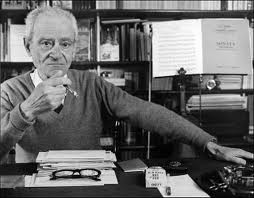
Et seul
lorsque je serai si seul
que je n’aurai plus même
pour compagnie moi-même,
je prendrai alors moi aussi ma
décision.
Un jour à l’aube,
je décrocherai la lanterne
du mur, et dirai adieu
au vide.
Pas à pas,
descendrai dans le ravin.
Mais alors aussi, ma
pierre abandonnée,
au nom de quoi, et où
trouverai-je un sens (que, semble-t-il,
d’autres n’ont pas trouvé) ?
E solo
quando sarò così solo
da non aver più nemmeno
me stesso per compagnia,
allora prenderò anch’io la mia
decisione.
Staccherò
dal muro la lanterna
un’alba, e dirò addio
al vuoto.
A passo a passo
scenderò nel vallone.
Ma anche allora, in nome
di che, e dove
troverò un senso (che altri,
pare, non han trovato),
lasciato questo mio sasso.
Giorgio Caproni, Le Mur de la terre, traduit de l’italien
par Philippe Di Meo, Atelier La Feugraie, 2002, p. 130-131.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio caproni, le mur de la terre, traduit de l’italien par philippe di meo | ![]() Facebook |
Facebook |
30/08/2012
Renée Vivien, La Vénus des aveugles, dans Poésies complètes

Chanson pour mon ombre
Droite et longue comme un cyprès,
Mon ombre suit, à pas de louve,
Mes pas que l’aube désapprouve.
Mon ombre marche à pas de louve,
Droite et longue comme un cyprès,
Elle me suit, comme un reproche,
Dans la lumière du matin.
Je vois en elle mon destin
Qui se resserre et se rapproche.
À travers champs, par les matins,
Mon ombre me suit comme un reproche.
Mon ombre suit, comme un remords,
La trace de mes pas sur l’herbe
Lorsque je vais, portant ma gerbe,
Vers l’allée où gîtent les morts.
Mon ombre suit mes pas sur l’herbe
Implacable comme un remords.
Renée Vivien, La Vénus des aveugles, dans Poésies complètes,
Librairie Alphonse Lemerre, 1944, p. 204-205.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : renée vivien, la vénus des aveugles, dans poésies complètes | ![]() Facebook |
Facebook |
29/08/2012
Serge Essénine, La Confession d'un voyou, dans Quatre poètes russes

La confession d’un voyou
Ce n’est pas tout un chacun qui peut chanter
Ce n’est pas à tout homme qu’est donné d’être pomme
Tombant aux pieds d’autrui.
Ci-après la toute ultime confession,
Confession dont un voyou vous fait profession.
C’est exprès que je circule, non peigné,
Ma tête comme une lampe à pétrole sur mes épaules.
Dans les ténèbres il me plaît d’illuminer
L’automne sans feuillage de vos âmes.
C’est un plaisir pour moi quand les pierres de l’insulte
Vers moi volent, grêlons d’un orage pétant.
Je me contente alors de serrer plus fortement
De mes mains la vessie oscillante de mes cheveux,
C’est alors qu’il fait si bon se souvenir
D’un étang couvert d’herbes et du rauque son de l’aulne
Et d’un père, d’une mère à moi qui vivent quelque part,
Qui se fichent pas mal de tous mes poèmes,
Qui m’aiment comme un champ, comme de la chair,
Comme la fluette pluie printanière qui mollit le sol vert.
Ils viendraient avec leurs fourches vous égorger
Pour chaque injure de vous contre moi lancée.
Pauvres, pauvres paysans !
Sans doute vous êtes devenus pas jolis
Et toujours vous craignez Dieu et les poitrines des marécages.
Oh ! si seulement
Vous pouviez comprendre qu’en Russie votre enfant
Est le meilleur poète.
Craignant pour sa vie, n’aviez-vous pas du givre au cœur
Lorsqu’il trempait ses pieds nus dans les flaques d’automne ?
Il se promène en haut de forme aujourd’hui
Et en souliers vernis.
[...]
Serge Essénine, dans Quatre poètes russes, V. Maïakovsky, B. Pasternak, A. Blok, S. Essénine, texte russe présenté et traduit par Armand Robin, éditions du Seuil, 1949, p. 59-61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge essénine, la confession d'un voyou, armand robin | ![]() Facebook |
Facebook |
28/08/2012
Liliane Giraudon, Divagation des chiens

« À force. À force de rêver d’un autre lecteur, j’en suis arrivée à imaginer une sorte de "manœuvre" pour échapper au rang des poètes qui d’ailleurs n’ont jamais voulu de moi. "Enfantillages", mais c’est vrai. La seule appartenance mythique et impersonnelle que je désirais, c’était celle-là. Je mesure mieux maintenant ces larmes versées à la lecture d’une lettre de Hölderlin où il déclarait simplement "les hommes ont-ils donc réellement honte de moi ?" Parlait-il de lui ou de l’ensemble de ce qu’il avait déjà écrit ? Je sais bien. Il ne faut pas mélanger. Son corps, soi-même, l’écriture (Ah ! l’horrible imbécillité de ceux qui bavent "moderne", estampillent la moindre affichette, la plus petite liste artistique. Comme si le poème avait à s’ordonner à l'art ou à une quelconque idée neuve du beau. Comme si écrire était un jeu. Du savoir-faire avec en prime quoi ? Quel risque ?) Il m’a fallu du temps pour comprendre. Agencer formellement sur du rien à dire, ce néant d’après dans le vacarme d’un monde plus sanglant et stupide que celui des siècles précédents, non. Ce que je voulais, c’était tout simplement la fatalité comme ajustement. Non pas "ma vie sans moi", mais le poème sans moi. J’ai manqué de forces. Je ne pouvais vivre cette évidence. Alors il y eut les exercices spirituels pour ne plus écrire. J’ai cru que j’allais devenir folle.Depuis, sur les bords de l’étang où je fais de longues marches jusqu’à la tombée du jour, j’ai ramassé un chien. Il ne me quitte plus. Nous mangeons strictement la même chose : viande crue.
Je ne bois plus que de l’eau. Je suis devenue chaste. Mes cheveux ont blanchi mais ils sont toujours aussi longs. Ne m’envoie plus rien. C’est vraiment inutile. Je ne veux plus lire. Ni rien savoir. Je t’en prie, n’insiste plus pour les traductions d’Émilie Dickinson. Je les ai toutes détruites cet hiver. Dans le petit poêle. Tu as raison. J’ai trahi, mais "fidèlement". Ce retournement connu de nous seules ne pouvait être que catégorique.
Hölderlin, Celan ou Pessoa deviendront des otages. C’est le Retour. Saison très noire pour ceux qui poursuivent. Ici les premières violettes apparaissent. Il suffit d’écarter doucement les herbes. Chasser de son cœur la mortelle impatience. Commencer vraiment la véritable attente. Celle concernant ceux qui enfin n’attendent plus rien... »
Liliane Giraudon, Divagation des chiens, P.O.L., 1988, p. 14-15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liliane giraudon, divagation des chiens, écrire la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
27/08/2012
Jacques Réda, Démêlés, poèmes 2003-2007

Je crois comprendre que, voici plusieurs millions d'années,
Soit bien avant que la nôtre apparût,
Beaucoup d'espèces aujourd'hui toujours déterminées
Proliféraient, et qui n'ont pas décru.
Des moustiques et des fourmis restés confits dans l'ambre
En sont la preuve. Et leur race, dit-on,
Va durer quand, de nos efforts, ne resteront que cendre,
Énigmes de granit ou de béton,
Carcasses de métal, monceaux de papier, de plastique
Sur la planète où le Vieil Océan
Malade bercera de son roulis automatique
L'épave de quelque dernier géant
Navire insubmersible avec passagers, équipage,
Os grelottants, tout avenir vomi.
De notre épisode, le vent aura tourné la page
Et soufflera sans troubler la fourmi.
Douces mains, chers beaux yeux, sourires, soupirs d'aise,
Amours aux irréfutables instants,
N'avez-vous donc été que mirages, hypothèse
Dans le chaos du possible et du temps ?
Alors tourbillonnez, remous ; valsez, ondes houleuses ;
Trous noirs, gobez ; carbonisez, quasars ;
Amas, croulez ; prélassez-vous un instant nébuleuses,
Et puis oubliez-nous, dieux des hasards.
Jacques Réda, Démêlés, poèmes 2003-2007, Gallimard, 2008, p. 17-18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, démêlés, poèmes 2003-2007 | ![]() Facebook |
Facebook |
26/08/2012
Andrea Zanzotto, Idiome, traduction par Philippe Di Meo

Écoutant depuis le pré
Sur la touche, le doigt anéanti insiste
sur une note toujours ratée
et pourtant inhumainement juste
au-delà de tout exemple réussie
Une note, jusqu’à ce que sang soit le doigt,
puis, il s’estropie, en un mouvement
de trille raté
au-delà de tout exemple
néanmoins reréussi
Rayonnant depuis toute chose, une offre infinie
parvient sur cette note, sur ce doigt
énervé, et d’ailleurs depuis longtemps anéanti,
qui veut la prendre en charge, donner crédit
à une partition universelle possible,
déverser d’une bande enregistrée
dans une autre
non moins mythique instrument
Une adresse ou une déclaration d'expéditeur
insistante comme bec de pic-vert,
c’est sur ce doigt que tape l’offre,
sienne-unique, de rien-du-tout, qui n’allèche rien,
et, toujours creusant sur cette touche,
et toujours la ratant, dans la déserte
réalité, qui par ailleurs s’affine comme matin,
son obstination contre tout pourquoi,
son inépuisable ni existible pour qui, pour quoi,
ajuste, devine
Ascoltando dal prato
Insiste il dito annichilito sul tasto
in una nota sempre sbagliata
eppure disumanamente giusta
al di là di ogni esempio azzeccata
Una nota fino a che sangue è il dito
e poi si azzoppa in uno sbagliato
movimento di trillo
al di là di ogni esempio
tuttavia riazzeccato
Un’infinita, irraggiante da tutto, offerta
arriva su quella nota, su quel dito
innervosito, anzi da tempo annichilito,
che vuol farsene carico, dar credito
a un possibile universale spartito
riversare da un nastro registrato
a un altro
non meno mitico instrumento
Un indirizzo o un’una dichiarazione di mittente
come becco di popicchio insistito
è in quel dito cha batte l’offerta
sua-unica, da-nulla, che nulla alletta
e che scavando per sempre in quel tasto
e sbagliandolo sempre, nella deserta
realtà che per altro come mattina s’affina,
la sua ostinazione contro ogni perché,
il suo per chi per che non mai esauribile
né esistibile assesta, indovina
Andrea Zanzotto, Idiome, traduction de l’italien, du dialecte haut-trévisan (Vénétie) et préface par Philippe Di Meo, José Corti, 2006, p. 36 et 37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idiome, traduction philippe di meo | ![]() Facebook |
Facebook |
25/08/2012
Fleur Adcock, dans Anthologie bilingue de la poésie anglaise

Poème qui se termine par une mort
Ils laveront sur toi tous mes baisers, effaceront mes marques
et mes pleurs – je pleurais plus facilement
lors de cette folle vie toute pimentée – et les taches plus heureuses,
fines écailles de papier de soie... Il est merdique ce début
de pacotille, et faux en plus – toutes les traces de ce genre
tu les as toi-même poncées, il y a des années de cela
quand tu m’as renvoyé mes lettres, la semaine où j’ai épousé
ce singe anecdotique. Donc je recommence. Donc :
Ils ôteront les tubes, les goutte-à-goutte, les pansements
que je censure dans mes rêves. Ils ne manqueront pas ; c’est vrai,
de te laver ; et ils te déposeront dans une boîte.
Après quoi tout ce qu’ils pourront faire d’autre
n’aura pas d’importance. C’est ça, mon style laconique.
Tu le louais, tout comme je louais la complexité
de tes broderies perlées ; ces liens nous entrelaçaient,
mailles endroit, mailles envers tissées sur la charpente de l’univers...
Poem ended by a death
They will wash all my kisses and fingerprints off you
and my tearstains – I was more inclined to weep
in those wild-garlicky days – and our happier stains,
thin scales of papery silk... Fuck that for a cheap
opener, and false too – any such traces
you pumiced away yourself, those years ago
when you sent my letters back, in the week i married
that anecdotal ape. So start again. So :
They will remove the tubes and drips and dressings
which I censor from my dreams. They will, it is true,
wash you ; and they will put you in a box.
After which whatever else they may do
won’t matter. This is my laconic style.
You praised it, as I praised your intricate pearled
embroideries ; these links laced us together,
plain and purl acros the ribs of the world...
Fleur Adcok, traduction de Bernard Brugière, dans Anthologie bilingue de la poésie anglaise, Pléiade/Gallimard, 2001, p. 1496-1497.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fleur adcock, poème qui se termine par une mort | ![]() Facebook |
Facebook |
24/08/2012
Jean-Paul de Dadelsen, Bach en automne, IV, dans Jonas

Bach en automne
IV
Le ciel au soir est vert. À la lisière du bois les chevreuils
Viennent humer au loin les villages roux de feuilles et de fumées.
Bientôt, quand la nuit tombera le vent de Pologne,
La brume montera des prés.
Le regard du faon découvre trois lieues de plaine sans refuges.
Autour du sommeil des hameaux les barrières vermoulues n’arrêtent
Ni les reîtres ni la peste.
Le monde dans l’espace et la durée étale sa placidité.
J’ai lu longtemps dans ce livre perpétuel. Autrefois j’ai décrit
Les gambades au mois de mai du jeune agneau,
Le vol instable des émouchets.
Je ne décrirai plus. Tout est nombre. L’arbre,
Rivière de feuilles ou noir de gel, entre la terre et le ciel instaure
Une figure permanente.
Le monde est en repos, dit-on ; les princes sont en paix, peut-être.
Entre la nue basse et l’horizon convexe s’éloigne une gloire exténuée
De lumière inaccessible. Le monde à travers fastes et largesses demeure
Établi dans l’exil.
Il faut rentrer. L’haleine de la nuit descend sur nos visages aveugles.
L’âme écoute approcher tes pas ; entre chez nous, Seigneur ;
Il se fait tard.
Jean-Paul de Dadelsen, Bach en automne, IV, dans Jonas, préface d’Henri Thomas, Poésie/Gallimard, 1986, p. 28-29.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul de dadelsen, bach en automne, iv, dans jonas | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2012
Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes

Et tu as traversé la mort
comme en la neige l’oiseau
toujours noir scellant l’issue…
Le temps a dégluti
les adieux que tu lui offris
jusqu’à l’extrême abandon
au bout de tes doigts
Nuit d’yeux
S’immatérialiser
Ellipse, l’air a baigné
la rue des douleurs…
Und du gingst über den Tod
wie der Vogel im Schnee
immer schwarz siegelnd das Ende –
Die Zeit schluckte
was du ihr gabst an Abschied
bis auf das äusserste Verlassen
die Fingerspitzen entlang
Augennacht
Körperlos werden
Die Luft umspülte – eine Ellipse –
die Strasse der Schmerzen –
Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes, traduit de l’allemand
par Lionel Richard, Denoël, 1967, p. 258-259.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelly sachs, brasier d’énigmes et autres poèmes, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
22/08/2012
Antoine Emaz, Plaie, encres de Djamel Meskache : recension

Avant la table des matières qui reproduit l'incipit des 28 séquences du livre, deux dates indiquent la durée de la rédaction, 2. 09. 07 - 23. 11 07. L'ensemble a été écrit dans un laps de temps assez bref, comme d'une seule coulée, ce qui assure une homogénéité forte autour du seul motif, une rupture. On n'en lira pas le récit ; Plaie ne reconstitue rien de l'événement lui-même, attaché seulement au parcours qui le suit : comment vivre l'après ?
La rupture défait complètement la personne, et comment le dire sinon par l'analogie avec une atteinte au corps ? Il n'y a pas ici de division entre l'"esprit" et le corps, c'est ce qui constitue le sujet qui est en cause, et ce sont les termes évoquant la béance, le choc, qui peuvent rendre compte de la violence vécue : plaie plusieurs fois, lèvres [de la plaie], blessure, brûlure sans fin. Cette plaie évolue, elle suppure, en sort du pus, il faut en couturer les bords, la guérir, elle devient boursouflée ; il restera une balafre, une ride — cependant, la plaie fermée, la faille demeure, la rupture est cause d'un « trou d'être ». Et ce qui s'est passé « dedans » a modifié la relation à l'extérieur, au « dehors ».
Le bouleversement du moi entraîne de profonds changements dans la perception du monde. Il y a d'abord le sentiment vif de ne plus appartenir à une communauté : l'extérieur est ressenti seulement comme lieu du bruit, donc de l'indifférenciation, quand le silence occupe toute la place en soi. Les choses perdent leurs couleurs, semblent comme de la « cendre », la distinction entre le beau et le laid est abolie ; tout apparaît « sale » (le mot revient plusieurs fois), comme touché par ce qui a atteint le moi, et c'est cette transformation négative qu'il faut dépasser. Dans les moments les plus forts de cette solitude non voulue, toute appréhension du dehors disparaît : « muet / aveugle // monde vide », il est alors impossible d'échanger des mots avec autrui.
Ce n'est pas qu'autrui soit absent : la "plaie" est devinée et le risque est d'attirer la compassion, la pitié, ce qui accroît la difficulté à recouvrer un équilibre, à « s'en sortir sans sortir » comme l'écrivait Ghérasim Luca repris par Antoine Emaz. Raidissement ? Plutôt position éthique souvent affirmée dans l'œuvre et redite ici : « on est encore debout », « digne / c'est debout » qui éloigne le déversement lyrique auquel on s'attend avec ce genre de situation. Il s'agit donc d'aller seul « au bout de la nuit » et pour ce faire dissimuler, faire aux yeux d'autrui comme si rien n'était arrivé, mais la feinte pour le dehors laisse intacte la douleur du dedans : les pensées qui ramènent à l'innommable — la rupture — sont là, obsédantes, dans la tête, la "cage", la "cave", les "quatre murs", et sur elles se greffent de très anciennes peurs, venues de l'enfance, celle du chien qui agresse, incontrôlable, impossible à dominer comme est impossible à comprendre la rupture ; elle n'était « ni évitable ni inévitable » :
pour la énième fois
on repasse la séquence
pour voir l'erreur
la cause
ça a
eu lieu
parce que
parce que
parce que
rien
on ne voit pas
Il n'y a pas d'explication et la difficulté consiste à intégrer le fait dans la série des événements vécus, à le chosifier, tout en sachant que l'oubli est impossible, que rangé dans la mémoire la "chose" sera toujours là, qu'on ne peut la recouvrir de « sable vase lie ». Comment sortir du labyrinthe ? La fuite, c'est le sommeil, c'est-à-dire l'absence à soi, pour ne pas vivre le vide des jours ; le recours, c'est poursuivre vaille que vaille les gestes de la vie quotidienne, les gestes mille fois répétés (« faire la vaisselle »), ces tâches « sans passé / sans futur », et plus encore la vue du jardin qui redonne l'idée du temps qui passe. Ce n'est que ce mouvement du sujet dans le temps qui conduit progressivement à la "guérison", et si à un moment de la reconstruction on lit « poser que c'est / ne repose pas », à son terme le constat est accepté : « [...] rien à juger / pas de morale / c'est ». Mais l'engagement nécessaire dans le "dehors" n'est efficace que soutenu par le travail d'écriture.
Les mots, les mots éloignent la douleur, comblent le vide — parce qu'il y a bien le vide si fortement dit par Lamartine : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » ; ici :
poésie usée à cœur
juste dire
seul
pour n'être pas tout à fait seul
« les mots comme pierre de poucet » donnent le moyen d'un va-et-vient entre le passé qu'il faut, de toute manière, intégrer dans la mémoire, et le futur, ne serait-ce que parce qu'ils permettent de penser le temps, d'anticiper : « on sera fera dira ». Les mots ne peuvent pas combler ce « creux noir » de l'absence, mais suivre leur chemin « tordu tortueux tors » conduit à abandonner le masque, le fard, le mensonge avec les autres, à n'avoir plus à écrire « on ne sait plus qui on est / peut-être on » ;
au moins les mots sont au travail
on les entend s'affairer
recoudre la nuit
faire leur besogne de nains
dans la tête
Longue besogne, non pour retrouver la vie comme "avant", mais pour vivre à nouveau le temps, ce que disent les derniers vers :
l'eau du temps maintenant
non plus boue
ou pus
Il y a bien dans Plaie une situation lyrique ("l'absence de l'aimée") mille fois mise en mots, ce qui n'a pas d'importance : les motifs ne sont guère nombreux et seule compte la manière de dire. On apprécie l'étendue du poème, les reprises d'une séquence à l'autre de quelques points (le repli, la feinte, le dedans/le dehors, l'écriture), leur entrelacement et un approfondissement qui renouvelle l'approche d'un thème commun. On retrouve le vers bref d'Antoine Emaz, la respiration posée avec les silences (les "blancs" de la page) dans la diction, le goût pour un vocabulaire réduit jusqu'à la sécheresse, la distance forte aussi vis-à-vis de l'épanchement — position éthique — jusqu'à faire du thème de la rupture une épure à laquelle font subtilement écho les encres de Djamel Meskache.
Antoine Emaz, Plaie, avec des encres de Djamel Meskache, éditions Tarabuste, 2009, 12 €.
Publié dans Emaz Antoine, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plaie, avec des encres de djamel meskache, éditions tarabuste | ![]() Facebook |
Facebook |
21/08/2012
Florence Pazzottu, L’Inadéquat (la langue crée le dé)

à ma mère
alors poème
– enfant en moi de sept mois n’était pas un
non-parlant mais ce
tout-oreille
qu’effondra en lui-même
aussi bien commença
l’extrême silence d’une
(bien que revenue) disparue-mère
l’indispensable qui (don de langue)
fait sol
et
sens – a
lors poème
(persiste
ce mouvement tiers cette absence
– réel l’impossible retour n’efface
pas le manque fracturant et fondant
aujourd’hui)
ce tout multiple – poème – possiblement
disjoncte
Florence Pazzottu, L’Inadéquat (la langue crée le dé), Flammarion, 2005, p. 87.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence pazzottu, l’inadéquat (la langue crée le dé), poème | ![]() Facebook |
Facebook |
20/08/2012
Philippe Beck et Xavier Person, Redonnons sa place à la poésie
Je reprends ci-dessous le texte paru dans la page « Rebonds » de Libération du 17 août 2012. À diffuser !
À l’heure où certains imaginent fondre la poésie dans un vaste ensemble réunissant le roman et le théâtre (1), il est peut-être bon de rappeler la place que peut occuper la poésie au sein de la littérature. Et ce dont, pour nous, «poésie» est le mot.
En ces temps de crise inédite, alors que les désastres ne sont plus seulement derrière nous ou à côté de nous, mais bien devant nous, est-il encore temps de s’arrêter au vieux mot «poésie» ? Les modernités littéraires successives ont, chacune à leur manière, déclaré la caducité de ce terme, son invalidité, en même temps qu’elles en refondaient les puissances. La mort répétée de la poésie, l’adieu qu’elle ne cesse de se faire à elle-même, inscrivent sa dynamique dans une interrogation et une incertitude qui, paradoxalement, lui redonnent légitimité aujourd’hui.
D’autres l’ont dit avant nous, dans la saturation des discours et des mots usés qui opacifient le réel de leurs fausses évidences, l’écriture poétique ouvre parfois une brèche. Par une sorte d’arrêt dans le flux continu de la prose du monde, elle peut faire disjonction. «Autres directions» est le panneau qu’elle invite à suivre au sortir du chemin à sens unique que semble indiquer le langage usuel.
Une politique de la poésie est peut-être à imaginer sous le rapport de son «idiorythmie», par quoi elle oppose à la normalisation des manières d’être et de penser un hiatus inacceptable. Cependant, il ne s’agit pas d’idolâtrer nos singularités, mais bien plutôt, affrontant la faillite de nos certitudes et de nos représentations, de nous engager dans ce que nous ignorons de nous-mêmes et du monde.
Entendons-nous bien : nous ne voulons pas opposer la poésie au roman, à tout le reste, ni l’enfermer dans quelque cercle des poètes en voie de disparition, mais bien plutôt interroger la littérature à partir de cette «littérature de la littérature», en quoi consiste le poème, cet «effort au style», «taux de densité cruelle», qui de la poésie fait une expérience à l’extrême pointe du langage et de la pensée. En cet échec possible du langage et de la pensée, en cet espoir aussi bien.
La poésie est le plus souvent une tentative de construction, même précaire, de formes incertaines. Elle peut prendre le risque d’autres agencements dans la langue, d’autres configurations de pensée, d’émotions. Qu’elle soit du côté du chant ou du côté de la «littéralité de la littérature», selon Derrida, elle ose quelque chose et, pour cela, doit avoir du courage : «Le courage, le cœur, le courage de se rendre, au travers du refoulement, à ce qui se passe ici dans la langue et par la langue, aux mots, aux noms, aux verbes et finalement à l’élément de la lettre […].»
Il s’agit pour nous de prendre ce qui a nom «poésie» assez au sérieux pour y chercher - pourquoi pas ? - d’autres manières de vivre et de penser. Construire une cabane à l’instant du désastre ? Non. En ces temps inconnus où nous entrons, pouvons-nous continuer de toujours écrire et lire ce que nous connaissons déjà, toujours la même histoire ?
Prétention excessive ? C’est juste l’attention à un mot que nous proposons, loin des infantilisations bienveillantes mais néfastes auxquelles la réduisent trop souvent des actions de «promotion». Le courage dont nous parlons n’appelle nulle condescendance. De sorte qu’au-delà de l’estompement d’un mot du fronton du Centre national du livre (CNL), c’est le sens même de l’action culturelle dans le champ de la «littérature de recherche» qu’on pourrait aujourd’hui interroger.
Des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, des journalistes, des critiques et des lecteurs de tous âges, des écrivains et des artistes, de multiples acteurs de la vie littéraire continuent de prêter attention aux écritures poétiques. Que le Centre national du livre fasse place dans sa réforme à ce qui les anime est la moindre des choses.
Notre souhait est que les Assises du livre et de l’écrit, dont la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, vient de confirmer la mise en œuvre, prennent en compte les résonances du mot «poésie» et, par lui, ce qui fait notre dignité d’êtres de langage, à travers les saisons.
Cette concertation donne espoir aux écrivains, qui se sont mobilisés pour dénoncer la manière dont le processus était imposé et les risques qu’il faisait courir au champ poétique. Qu’il ait pu être question d’estomper le mot «poésie» pour, aux dires de l’actuel président du CNL, obéir aux préconisations de la Cour des comptes, n’est pas insignifiant.
(1) Prévue dans le projet de réforme du Centre national du livre (CNL) datant du 12 mars, la suppression de la commission Poésie du CNL a été suspendue en juillet par la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, qui doit lancer prochainement une concertation sur le sujet.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck et xavier person, redonnons sa place à la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
19/08/2012
Samuel Beckett, Poèmes suivi de mirlitonnades

Elles viennent
autres et pareilles
avec chacun c’est autre et c’est pareil
avec chacune l’absence d’amour est autre
avec chacune l’absence d’amour est pareille
*
La mouche
entre la scène et moi
la vitre
vide sauf elle
ventre à terre
sanglée dans ses boyaux noirs
antennes affolées ailes liées
pattes crochues bouche suçant à vide
sabrant l’azur s’écrasant contre l’invisible
sous mon pouce impuissant elle fait chavirer
la mer et le ciel serein
*
musique de l’indifférence
cœur temps air feu sable
du silence éboulement d’amours
couvre leurs voix et que
je ne m’entende plus
me taire
Dieppe
encore le dernier reflux
le galet mort
le demi-tour puis les pas
vers les vieilles lumières
[Ces poèmes, ont d’abord été publiés en français dans Les Temps modernes, n° 14, novembre 1946, respectivement p. 288, 290, 290 et 291 (ce dernier sans titre)].
*
que ferais-je sans ce monde sans visage sans questions
où être ne dure qu’un instant où chaque instant
verse dans le vide dans l’oubli d’avoir été
sans cette onde où à la fin
corps et ombre ensemble s’engloutissent
que ferais-je sans ce silence gouffre des murmures
haletant furieux vers le secours vers l’amour
sans ce ciel qui s’élève
sur la poussière de ses lests
que ferais-je je ferais comme hier comme aujourd’hui
regardant par mon hublot si je ne suis pas seul
à errer et à virer loin de toute vie
dans un espace pantin
sans voix parmi les voix
enfermées avec moi
Samuel Beckett, Poèmes suivi de mirlitonnades, éditions de
Minuit, 1978, p. 7, 11,12, 15, 23.
[L’ensemble des poèmes a été traduit de l’anglais par l’auteur.]
À propos de Beckett :
Maurice Blanchot, Où maintenant ? qui maintenant ?, dans Le Livre à venir, Gallimard, 1959.
Ludovic Janvier, Pour Samuel Beckett, éditions de Minuit.
Ludovic Janvier, Samuel Beckett par lui-même, Seuil, 1969.
Cahiers de l’Herne : Samuel Beckett, 1976.
Revue d’esthétique : Samuel Beckett, Privat, 1986.
Charles Juliet, Rencontres avec Samuel Beckett, Fata Morgana, 1986.
Critique : Samuel Beckett, septembre 1990.
Deirdre Bair, Sameul Beckett [biographie], traduction de l’anglais par Léo Dilé, Fayard, 1990.
André Bernold, L’amitié de Beckett, Hermann, 1992.
Pascale Casanova, Beckett l’abstracteur, Seuil, 1997.
John Knowlson, Samuel Beckett [biographie], traduction de l’anglais par Oristelle Bonis, Solin/Actes Sud, 1999.
Anne Atik, Comment c’était [souvenirs], L’Olivier, 2003.
Nathalie Léger, Les vies silencieuses de Samuel Beckett, Allia, 2006.
Collectif, Objet Beckett, Centre Pompidou [catalogue d'exposition], 2007.
Un site (en anglais) : http://beckett.english.ucsb.edu
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, poèmes suivi de mirlitonnades | ![]() Facebook |
Facebook |
18/08/2012
John Ashbery, Poèmes français, dans Fragment

Simples, les arbres posés sur le paysage
Comme des gerbes de foin qu’on aurait laissé traîner là.
Le crottin des chevaux disparus, les pierres qui l’imitent,
Tout nous parle des cieux, qui ont créé cette scène
Par leur seule position.
Or en s’associant trop strictement aux trajets des choses
On perd cette sublime espérance faite de la lumière qui asperge les arbres.
Car chaque progrès est négation, de mouvement et surtout de nombre.
Ce nombre ayant perdu sa finesse indescriptible
Tout doit être perçu comme quantités infinies de choses.
Tout est paysage : perspective de rochers
Battues par d’innombrables vagues ;
Champs de blé à ne plus pouvoir en compter ; forêts
Aux sentiers perdus ; tours de pierre
Et enfin et surtout les grands centres urbains, avec
Leurs buildings et leurs populations, au centre desquels
Nous vivons notre vie, faite d’une grande quantité d’instants isolés
Pour être perdue au sein d’une multitude de choses.
John Ashbery, Poèmes français, dans Fragment, traduit de l’américain par Michel Aucouturier, Seuil, 1975, p. 18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ashbery, poèmes français, fragment, paysage | ![]() Facebook |
Facebook |
17/08/2012
Jean-Jacques Viton, comme ça

ce qui est troublant dans l’orage
ce sont ses poses avant reprises
éclairs grêle vents crépitements
un tournoiement de signes embrouillés
sur un lointain de paysages convulsifs
dans la crème acide des foules
peut-on dans cet état excentrique se rappeler
les trois derniers mots que l’on a prononcés
trouver précisément en quelle saison on est
le jour de la semaine ... et sa date
quel département quelle province
et puisqu'on y est quel pays
pour réussir à se dénouer de l’orage
répéter quelques mots sans rapport
polyphonie rebours géométrie aztèque
ils trouveront des récepteurs secrets
s’infiltreront comme des filets d’irrigation
dans la peau du paisible
Jean-Jacques Viton, comme ça, P. O. L., 2003, p. 48.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-jacques viton, comme ça, orage, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |





